ISSN 1977-0936
Journal officiel
de l'Union européenne
C 346
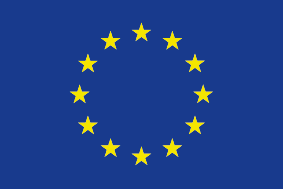
Édition de langue française
Communications et informations
59e année
21 septembre 2016
|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346 |
|
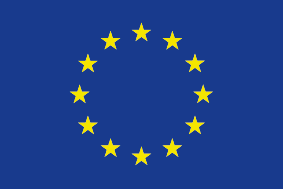
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
59e année |
|
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
|
||
|
|
|
|
I Résolutions, recommandations et avis |
|
|
|
RÉSOLUTIONS |
|
|
|
Parlement européen |
|
|
|
Mardi 28 avril 2015 |
|
|
2016/C 346/01 |
||
|
2016/C 346/02 |
||
|
2016/C 346/03 |
||
|
|
Mercredi 29 avril 2015 |
|
|
2016/C 346/04 |
||
|
2016/C 346/05 |
||
|
2016/C 346/06 |
||
|
2016/C 346/07 |
||
|
|
Jeudi 30 avril 2015 |
|
|
2016/C 346/08 |
||
|
2016/C 346/09 |
||
|
2016/C 346/10 |
||
|
2016/C 346/11 |
||
|
2016/C 346/12 |
||
|
2016/C 346/13 |
||
|
2016/C 346/14 |
||
|
2016/C 346/15 |
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la situation au Nigeria (2015/2520(RSP)) |
|
|
2016/C 346/16 |
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur le cas de Nadia Savtchenko (2015/2663(RSP)) |
|
|
2016/C 346/17 |
||
|
2016/C 346/18 |
|
|
II Communications |
|
|
|
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE |
|
|
|
Parlement européen |
|
|
|
Mardi 28 avril 2015 |
|
|
2016/C 346/19 |
|
|
III Actes préparatoires |
|
|
|
PARLEMENT EUROPÉEN |
|
|
|
Mardi 28 avril 2015 |
|
|
2016/C 346/20 |
||
|
2016/C 346/21 |
||
|
2016/C 346/22 |
||
|
2016/C 346/23 |
||
|
2016/C 346/24 |
||
|
2016/C 346/25 |
||
|
2016/C 346/26 |
||
|
2016/C 346/27 |
||
|
2016/C 346/28 |
||
|
2016/C 346/29 |
||
|
|
Mercredi 29 avril 2015 |
|
|
2016/C 346/30 |
||
|
2016/C 346/31 |
||
|
2016/C 346/32 |
||
|
2016/C 346/33 |
||
|
2016/C 346/34 |
||
|
2016/C 346/35 |
||
|
2016/C 346/36 |
||
|
2016/C 346/37 |
||
|
2016/C 346/38 |
||
|
2016/C 346/39 |
||
|
2016/C 346/40 |
||
|
|
Jeudi 30 avril 2015 |
|
|
2016/C 346/41 |
|
Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements du Parlement: Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. |
|
FR |
|
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2015-2016
Séances du 27 au 30 avril 2015
Le procès-verbal de cette session a été publié dans le JO C 206 du 9.6.2016.
Les textes adoptés du 29 avril 2015 concernant les décharges relatives à l'exercice 2013 ont été publiés dans le JO L 255 du 30.9.2015 .
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Mardi 28 avril 2015
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/2 |
P8_TA(2015)0107
Mise en œuvre du processus de Bologne
Résolution du Parlement européen du 28 avril 2015 sur le suivi de la mise en œuvre du processus de Bologne (2015/2039(INI))
(2016/C 346/01)
Le Parlement européen,
|
— |
vu l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), |
|
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme, et en particulier son article 26, |
|
— |
vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier son article 14, |
|
— |
vu la déclaration conjointe de la Sorbonne, signée le 25 mai 1998, à Paris, par les quatre ministres chargés de l'enseignement supérieur pour la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, sur l'harmonisation et l'architecture du système européen d'enseignement supérieur (déclaration de la Sorbonne) (1), |
|
— |
vu la déclaration conjointe signée à Bologne, le 19 juin 1999, par les ministres de l'éducation de 29 pays européens (déclaration de Bologne) (2), |
|
— |
vu le communiqué publié par la conférence des ministres européens chargés de l'enseignement supérieur, qui s'est tenue les 28 et 29 avril 2009 à Louvain et à Louvain-la-Neuve (3), |
|
— |
vu la déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010, adoptée par les ministres de l'éducation de 47 pays, qui a officiellement instauré l'espace européen de l'enseignement supérieur (4), |
|
— |
vu le communiqué publié par la conférence ministérielle et le troisième forum politique de Bologne, qui se sont tenus à Bucarest les 26 et 27 avril 2012 (5), |
|
— |
vu la stratégie de mobilité pour l'espace européen de l'enseignement supérieur à l'horizon 2020, adoptée par la conférence ministérielle de l'espace européen de l'enseignement supérieur qui s'est tenue à Bucarest, les 26 et 27 avril 2012 (6), |
|
— |
vu la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI») (7), |
|
— |
vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (8), |
|
— |
vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la poursuite de la coopération européenne visant la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (9), |
|
— |
vu la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie (10), |
|
— |
vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation («Éducation et formation 2020») (11), |
|
— |
vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 26 novembre 2009 sur le renforcement du rôle de l'éducation en vue d'assurer le bon fonctionnement du triangle de la connaissance (12), |
|
— |
vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur (13), |
|
— |
vu la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire (14), |
|
— |
vu la recommandation du Conseil du 28 juin 2011 intitulée «Jeunesse en mouvement — Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d'éducation et de formation» (15), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 10 mai 2006 intitulée «Faire réussir le projet de modernisation pour les universités: formation, recherche et innovation» (COM(2006)0208), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Soutenir la croissance et les emplois — un projet pour la modernisation des systèmes d'enseignement supérieur en Europe» (COM(2011)0567), |
|
— |
vu le rapport intitulé «L'enseignement supérieur en Europe 2009: les avancées du processus de Bologne» (Eurydice, Commission européenne, 2009) (16), |
|
— |
vu le rapport intitulé «Focus sur l'enseignement supérieur en Europe 2010: l'impact du processus de Bologne» (Eurydice, Commission européenne, 2010) (17), |
|
— |
vu le rapport intitulé «L'espace européen de l’enseignement supérieur en 2012: rapport sur la mise en œuvre du processus de Bologne» (Eurydice, Commission européenne, 2012) (18), |
|
— |
vu l'enquête Eurobaromètre 2007 sur la réforme de l'enseignement supérieur, réalisée auprès de professionnels de l'enseignement (19), |
|
— |
vu l'enquête Eurobaromètre 2009 sur la réforme de l'enseignement supérieur, réalisée auprès d'étudiants (20), |
|
— |
vu la publication d'Eurostat du 16 avril 2009 intitulée «The Bologna Process in Higher Education in Europe — Key indicators on the social dimension and mobility» (Le processus de Bologne dans l'enseignement supérieur en Europe: indicateurs clés en matière de dimension sociale et de mobilité) (21), |
|
— |
vu le rapport final de la Conférence internationale sur le financement de l'enseignement supérieur qui s'est tenue à Erevan, en Arménie, les 8 et 9 septembre 2011 (22), |
|
— |
vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur le processus de Bologne et la mobilité des étudiants (23), |
|
— |
vu sa résolution du 20 mai 2010 sur le dialogue université-entreprise: un nouveau partenariat pour la modernisation des universités en Europe (24), |
|
— |
vu sa résolution du 13 mars 2012 sur la contribution des institutions européennes à la consolidation et aux avancées du processus de Bologne (25), |
|
— |
vu le Fonds européen pour les investissements stratégiques (26), |
|
— |
vu l'article 52 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0121/2015), |
|
A. |
considérant que l'importance du processus de Bologne dans la conjoncture économique actuelle devrait résider dans la poursuite de l'objectif du développement du niveau de connaissance et d'innovation le plus élevé possible pour les citoyens par un large accès à l'éducation et à la mise à jour permanente des connaissances, principe qui devrait trouver sa place dans la révision de la stratégie «Europe 2020» et dans la mise en œuvre du plan d'investissement pour l'Europe de M. Juncker; |
|
B. |
considérant que les analyses montrent que près d'un tiers des employeurs de l'Union éprouvent des difficultés à trouver des salariés dotés de qualifications adéquates; qu'eu égard à l'objectif de réduction de l'inadéquation des qualifications au sein de l'Union (décalage entre les compétences professionnelles d'un individu et les exigences du marché du travail), la réforme de Bologne ne s'est pas avérée très efficace à ce jour; que l'inadéquation des qualifications est devenue pour l'Europe un enjeu majeur qui concerne l'ensemble de la société, depuis la productivité et le rendement des entreprises jusqu'au bien-être actuel et à venir des jeunes; |
|
C. |
considérant que la résorption du chômage des jeunes n'a pas beaucoup progressé depuis le début de la crise en 2008; que fin 2014, l'Union comptait environ 5 millions de jeunes chômeurs âgés de moins de 25 ans; |
|
D. |
considérant que, comme l'a dit un philosophe, «les universités devraient être guidées par la quête de la vérité et de la beauté», en plus de leur devoir de préparation des nouveaux professionnels, scientifiques, ingénieurs, professeurs, médecins, responsables politiques et citoyens; |
|
E. |
considérant qu'il est important de considérer les universités comme les véritables acteurs principaux du processus de Bologne, au-delà du rôle de soutien en matière de coordination, de réglementation et de ressources des institutions régionales et nationales; |
|
F. |
considérant que, dans le cadre de cette initiative intergouvernementale, menée en coopération avec les milieux universitaires, des efforts ont été déployés pour apporter une solution européenne commune à de graves problèmes qui se posent dans de nombreux pays, mais que ces efforts se sont révélés insuffisants; |
|
G. |
considérant que le véritable objectif du processus de Bologne est de soutenir la mobilité et l'internationalisation ainsi que de rendre compatibles et comparables entre elles les normes et la qualité des divers systèmes d'enseignement supérieur, dans le respect de l'autonomie des universités, et de contribuer ainsi à la création d'un espace européen véritablement démocratique capable d'offrir les mêmes chances à tous les citoyens; |
|
H. |
considérant qu'une évaluation des progrès accomplis au cours des quinze dernières années s'impose et que cette évaluation devrait refléter tant la réussite incontestée du projet en termes de coopération interrégionale que les problèmes qui subsistent ainsi que les degrés variables de réalisation des objectifs; |
|
I. |
considérant que le processus de Bologne, bien qu'ayant orienté et encouragé des réformes de l'enseignement dans la plupart des pays, peut, du fait d'une piètre communication et d'un manque de compréhension de sa véritable portée par les acteurs concernés, être perçu par ces derniers comme une charge administrative dans certains pays; |
|
J. |
considérant qu'il importe de reconnaître la nature paneuropéenne du processus de Bologne, ainsi que de saluer la participation active de tous ses acteurs, y compris les étudiants, les enseignants, les chercheurs et le personnel non enseignant; |
|
K. |
considérant qu'il est indispensable, en particulier en ces temps de crise économique, que l'éducation, la formation, la formation professionnelle, la connaissance et la recherche continuent de bénéficier d'un soutien financier, qui devrait, en outre, aller croissant; |
|
L. |
considérant, dans ce contexte en constante évolution, qu'il est nécessaire de réaffirmer l'engagement politique sous-tendant le processus de Bologne et la participation des institutions européennes, des gouvernements nationaux et de toutes les autres parties prenantes dans la réalisation du processus; |
Rôle du processus de Bologne
|
1. |
relève que l'éducation et la recherche sont l'un des principaux piliers de toute société qui cherche à promouvoir le développement des compétences, la croissance et la création d'emplois; souligne qu'il est capital, pour qui souhaite s'attaquer aux fléaux de la misère, des inégalités sociales et du chômage, en particulier le chômage des jeunes, tout en promouvant l'inclusion sociale, d'investir davantage dans l'éducation; |
|
2. |
relève que le processus de Bologne pourrait aider à remédier à l'inadéquation des qualifications au sein de l'Union, s'il permettait aux étudiants d'acquérir et de développer les compétences requises par le marché du travail, et qu'il pourrait ainsi atteindre l'objectif important qu'est l'amélioration de l'employabilité des diplômés; |
|
3. |
a conscience du rôle que joue le processus de Bologne dans la création d'une Europe de la connaissance; insiste sur le fait que la diffusion des connaissances, l'enseignement et la recherche constituent des éléments essentiels de la stratégie «Europe 2020» et contribuent à favoriser la citoyenneté européenne; souligne toutefois qu'il est nécessaire de consulter le milieu de l'enseignement supérieur (professeurs, étudiants et personnel non enseignant) afin de mieux comprendre l'opposition rencontrée par les réformes liées au processus de Bologne, et souligne également la nécessité de garantir un enseignement public gratuit, accessible à tous et répondant aux besoins de la société; |
|
4. |
relève que les réformes de Bologne ont donné lieu à la mise en place d'un espace européen de l'enseignement supérieur et qu'elles ont rendu possibles d'importantes avancées, au cours des quinze dernières années, en matière de comparabilité des structures d'enseignement, d'amélioration de la mobilité, de mise en place de systèmes de garantie de la qualité et de reconnaissance des diplômes, de renforcement de la qualité des systèmes éducatifs et de l'attractivité de l'enseignement supérieur en Europe; |
|
5. |
constate qu'il reste encore beaucoup à faire dans le cadre du processus de Bologne concernant l'ajustement des systèmes éducatifs aux besoins du marché du travail et l'amélioration globale, en Europe, de l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur, de la compétitivité dudit enseignement et de son attractivité; relève que les établissements européens d'enseignement supérieur devraient être en mesure de réagir rapidement aux évolutions économiques, culturelles, scientifiques et technologiques de la société moderne afin d'exploiter pleinement leur potentiel pour encourager la croissance, l'employabilité et la cohésion sociale; |
|
6. |
prend acte des objectifs fixés pour les années à venir ainsi que des priorités nationales en matière de mesures à prendre avant la fin de l'année 2015, définis par la conférence ministérielle de l'espace européen de l'enseignement supérieur qui s'est tenue à Bucarest en 2012, ainsi que des recommandations de ladite conférence relatives à la stratégie en matière de mobilité pour l'espace européen de l'enseignement supérieur à l'horizon 2020, tout en recommandant la création de nouveaux observatoires, de nouveaux rapprochements des différentes communautés universitaires et de nouveaux systèmes d'intégration des membres de ces communautés universitaires dans la réforme de Bologne; |
Enjeux et priorités
|
7. |
invite les pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur à mettre en application les réformes, définies d'un commun accord, dont le but est d'accélérer la réalisation des objectifs du processus de Bologne et de renforcer la crédibilité de l'espace européen de l'enseignement supérieur; encourage à prêter assistance aux pays qui rencontrent des difficultés à mettre en œuvre ces réformes; se dit favorable, à cet égard, à la création de partenariats élargis entre les pays, les régions et les parties prenantes; |
|
8. |
demande aux États membres de renforcer et de moderniser davantage leurs systèmes d'évaluation des établissements d'enseignement supérieur, selon les modèles des systèmes d'enseignement avancés au niveau international, sanctionnant l'excellence, avec pour critères le développement du savoir, de la recherche et de la science; |
|
9. |
insiste sur le fait qu'il est important de préserver la diversité de l'enseignement, en particulier la diversité des langues; prie instamment les États membres d'accroître le nombre de bourses étudiantes et de garantir un accès facile à ces bourses; |
|
10. |
fait observer la nécessité de consacrer davantage d'efforts au développement de l'espace européen de l'enseignement supérieur, et de s'appuyer pour cela sur les progrès effectués en vue de la réalisation des objectifs de cet espace ainsi que sur la coordination avec l'espace européen de l'éducation et de la formation, l'espace européen de l'éducation et de la formation tout au long de la vie et l'espace européen de la recherche; |
|
11. |
invite toutes les parties prenantes concernées par l'application du processus de Bologne à renforcer la garantie de la qualité afin de parvenir à un espace européen de l'enseignement supérieur à même de renforcer son attractivité en tant que référence internationale d'excellence académique; |
|
12. |
invite les États membres, les pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur ainsi que l'Union dans son ensemble, à promouvoir la compréhension, par le public, du processus de Bologne de manière à lui susciter des appuis, y compris en agissant au plus près du citoyen pour encourager une participation plus efficace et plus dynamique à la réalisation des objectifs du processus; |
|
13. |
fait observer que la Commission, en tant que membre du processus de Bologne, joue un rôle important dans le développement de l'espace européen de l'enseignement supérieur, et lui demande de remplir plus avant son rôle en redonnant un nouveau souffle au processus et en consacrant davantage d'efforts encore à la réalisation des objectifs fixés; |
|
14. |
souligne la nécessité d'inclure la qualité de l'enseignement et de la recherche dans le secteur tertiaire parmi les objectifs visés; estime que le renforcement de l'employabilité des diplômés, qui constitue également un objectif de la stratégie «Europe 2020», ferait un bon indicateur de réalisation de ces objectifs; |
|
15. |
invite au dialogue entre les gouvernements, les établissements d'enseignement supérieur et les instituts de recherche pour qu'ils puissent mieux cibler, optimiser et rendre plus efficace l'utilisation donnée aux fonds disponibles et élaborer de nouveaux modèles variés de financement en complément du financement public; souligne également l'importance du programme «Horizon 2020» pour encourager des projets collaboratifs de recherche entre les établissements européens d'enseignement supérieur et s'inquiète des tentatives répétées de réduction de son financement alors que d'autres domaines du budget ne sont pas remis en question; |
|
16. |
invite les gouvernements à améliorer l'efficacité du financement public en faveur de l'enseignement et à respecter l'objectif principal de l'Union consistant à investir 3 % du PIB européen dans la recherche et le développement à l'horizon 2020; souligne qu'un financement ambitieux en faveur de l'enseignement et de la recherche est nécessaire, car ce sont là des instruments clés pour garantir l'accès à un enseignement de qualité pour tous, ainsi que pour lutter contre la crise économique et le chômage; |
|
17. |
insiste sur les sources de financement possibles pour l'enseignement supérieur, l'enseignement et la formation professionnels offertes par le Fonds européen pour les investissements stratégiques; se dit très préoccupé par les réductions de financement prévues pour le programme «Horizon 2020» dans les domaines de la recherche et de l'éducation en faveur du Fonds européen pour les investissements stratégiques; |
|
18. |
met en garde contre le fait que toute réduction touchant le programme «Horizon 2020» nuirait sans aucun doute à la mise en œuvre complète du processus de Bologne, et exhorte par conséquent la Commission à revenir sur cette décision; |
|
19. |
encourage les démarches fondées sur la participation de l'ensemble du milieu universitaire et des partenaires sociaux, que les initiatives partent de la base et soient reprises par le sommet ou l'inverse; invite les ministres de l'espace européen de l'enseignement supérieur à coopérer et à s'engager politiquement en vue de la mise en œuvre d'une stratégie commune qui permette de mener à bien les réformes de Bologne; |
|
20. |
invite à étoffer davantage les programmes d'étude en les dotant d'objectifs clairement définis, afin que les diplômés en sortent munis des connaissances et du panier de compétences (tant générales que professionnelles) nécessaires non seulement pour se préparer aux exigences du marché du travail et renforcer leur capacité à étudier et à se former tout au long de la vie, mais également plus fondamentalement pour favoriser l'intégration des citoyens; soutient la pleine mise en œuvre du cadre européen des certifications professionnelles; |
|
21. |
insiste sur le rôle joué par les disciplines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques et sur leur importance pour la société, l'économie et l'employabilité des diplômés; |
|
22. |
appelle de ses vœux la mise en application adéquate, au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur, du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) et de l'instrument de supplément au diplôme, deux outils clés qui permettent d'exprimer le travail exigé des étudiants lors d'une formation et les compétences que ces étudiants y auront apprises, le tout dans le but de faciliter la mobilité et d'aider les étudiants à présenter de manière structurée leurs résultats universitaires et extrascolaires; |
|
23. |
insiste sur l'importance de garantir une reconnaissance et une compatibilité mutuelles des titres universitaires pour renforcer le système de garantie de la qualité au niveau européen et dans tous les pays membres de l'espace européen de l'enseignement supérieur, conformément à la version révisée des normes et lignes directrices européennes en matière de garantie de la qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur; invite tous les pays membres de l'espace européen de l'enseignement supérieur et leurs agences respectives chargées de la garantie de la qualité à rejoindre les réseaux européens de garantie de la qualité (ENQA et EQAR); |
|
24. |
encourage les partenaires du processus de Bologne, et en particulier la Commission européenne, à mesurer régulièrement l'inadéquation des compétences et des qualifications au moment de l'entrée des diplômés dans le monde du travail; |
|
25. |
souligne l'importance de l'objectif de la stratégie «Europe 2020» visant à porter à 40 % la proportion de la population de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur et acquis les compétences et les qualifications adéquates pour trouver un emploi épanouissant; |
|
26. |
insiste sur l'utilité des cadres de certification, garants d'une transparence accrue, et invite les pays du processus de Bologne à poursuivre leurs efforts visant à rendre leurs cadres de certification nationaux compatibles avec ceux de l'espace européen de l'enseignement supérieur et avec les cadres européens; |
|
27. |
souligne que les cadres nationaux des certifications dans de nombreux États membres doivent encore être adaptés au cadre européen des certifications ainsi qu'aux normes et lignes directrices européennes en matière de garantie de la qualité; relève que de nombreux cadres nationaux des certifications ne sont toujours pas inscrits dans le registre européen des agences de garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur (EQAR); |
|
28. |
relève que la mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs et du personnel non enseignant constitue l'une des principales priorités du processus de Bologne; appelle les États membres à multiplier les possibilités de mobilité et à en améliorer la qualité, et souligne la nécessité de renforcer la mise en application de la stratégie de mobilité pour l'espace européen de l'enseignement supérieur à l'horizon 2020 ainsi que la nécessité d'atteindre l'objectif quantitatif de 20 % de mobilité étudiante à l'horizon 2020; souligne, à cet égard, le rôle crucial que jouent les programmes «Erasmus+» et «Horizon 2020», ainsi que l'importance d'une mise en œuvre et d'une promotion efficaces et harmonieuses de ces programmes; insiste sur le fait que les bourses d'études se rapportant à Erasmus+ devraient être exonérées de taxes et de cotisations sociales; |
|
29. |
appelle de ses vœux l'inclusion progressive de la mobilité des étudiants dans les programmes universitaires officiels; |
|
30. |
souligne qu'il est nécessaire que les étudiants et les enseignants de l'enseignement supérieur artistique et musical soient correctement représentés dans les programmes de mobilité de l'Union; |
|
31. |
invite la Commission et les États membres à évaluer, dans le cadre des critères de classement des universités et des établissements de formation supérieure, le niveau de partenariat et de mobilité européenne et internationale qu'ils défendent; |
|
32. |
prend acte du rôle central joué par les établissements d'enseignement supérieur dans la promotion de la mobilité et dans la production de diplômés et de chercheurs possédant des connaissances et des compétences qui leur permettent de réussir grâce à leur employabilité dans l'économie mondiale; |
|
33. |
invite les États membres, l'Union et l'espace européen de l'enseignement supérieur à renforcer la mobilité en favorisant l'apprentissage des langues, en levant les obstacles administratifs, en mettant au point un mécanisme de soutien financier adéquat et en garantissant la transférabilité des bourses et des crédits; constate que la mobilité est toujours moins accessible aux étudiants issus de milieux moins favorisés; |
|
34. |
met l'accent, en ce qui concerne la création et la mise en œuvre des programmes, sur l'évolution du paradigme éducatif vers une démarche qui replace l'étudiant au centre de l'apprentissage et mette en valeur le développement personnel des étudiants; souligne l'importance de la participation des étudiants à la gouvernance de l'enseignement supérieur; |
|
35. |
souligne que les programmes d'étude devraient s'articuler autour des exigences à long terme du marché; insiste également sur le fait que l'employabilité implique que les étudiants maîtrisent un large éventail de compétences, qui les prépareront au marché du travail et leur permettront d'apprendre tout au long de leur vie; encourage, à cet égard, la tenue d'un dialogue actif et le recours à la coopération nationale et transfrontalière, en matière de programmes et de stages, entre les universités et les entreprises, susceptible de contribuer à lutter contre la crise économique, à stimuler la croissance économique et à participer à la création d'une société fondée sur la connaissance, offrant ainsi des perspectives plus larges pour la société; encourage les établissements d'enseignement supérieur à s'ouvrir aux études transdisciplinaires, à la création d'instituts de recherche universitaires et à la collaboration avec divers partenaires; |
|
36. |
souligne la nécessité d'élargir l'offre de formation en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie ainsi qu'en matière de formes d'éducation complémentaires, telles que l'éducation non formelle et informelle, qui sont essentielles pour le développement des compétences non techniques; |
|
37. |
demande que soient consentis des efforts pour consolider le lien entre enseignement supérieur, recherche et innovation, y compris par la promotion d'un enseignement fondé sur la recherche, et souligne le rôle du programme «Horizon 2020» en tant que mécanisme de financement clé susceptible de redonner un élan à la recherche; appelle de ses vœux une meilleure synchronisation des mesures prises en soutien au processus de Bologne, telles que les programmes «Horizon 2020» et «Erasmus+»; |
|
38. |
invite à créer des parcours d'apprentissage plus adaptables, qui comprennent des programmes menant à un double diplôme et des études interdisciplinaires et soutiennent l'innovation, la créativité, l'enseignement et la formation professionnels et l'entrepreneuriat dans l'enseignement supérieur, et invite également à explorer tout le potentiel des nouvelles technologies, de la numérisation et des TIC afin d'enrichir l'enseignement et l'apprentissage, de développer davantage un large éventail de compétences et d'élaborer de nouveaux modèles d'apprentissage, d'enseignement et d'évaluation; |
|
39. |
demande aux établissements d'enseignement supérieur, aux administrations publiques, aux partenaires sociaux et aux entreprises de poursuivre le dialogue pour faciliter et améliorer l'employabilité des étudiants; souligne, à cet égard, la nécessité de recentrer le débat sur le potentiel inexploité de l'enseignement supérieur pour stimuler la croissance et l'emploi; demande aux pays membres de l'espace européen de l'enseignement supérieur et aux établissements d'enseignement supérieur d'améliorer leur coopération afin de garantir la qualité des stages et des formations d'apprenti et de renforcer la mobilité dans ce domaine; insiste sur le fait que les parties prenantes devraient mieux coopérer afin de relever le niveau initial des qualifications, renouveler la main-d'œuvre qualifiée et améliorer l'offre, l'accessibilité et la qualité de l'orientation professionnelle; estime en outre qu'il conviendrait d'encourager davantage les stages en entreprise intégrés dans les programmes d'étude; |
|
40. |
souligne qu'il est nécessaire de permettre l'accès des réfugiés reconnus à toutes les institutions de l'espace européen de l'enseignement supérieur afin de leur permettre de se construire une existence autonome grâce à l'éducation; souligne en outre que les titres de séjour pour les diplômés à la recherche d'une activité professionnelle qualifiée devraient être libéralisés davantage; insiste sur le fait que davantage d'efforts devraient être consentis dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des réfugiés reconnus, compte tenu notamment de la mobilité de ces étudiants; |
|
41. |
souligne que les États membres, ainsi que tous les établissements d'enseignement supérieur membres de l'espace européen de l'enseignement supérieur, ont la responsabilité de fournir un enseignement de qualité à même de relever les défis sociaux et économiques, et met l'accent sur le fait qu'ils doivent collaborer de manière étroite afin d'atteindre les objectifs définis dans le cadre du processus de Bologne; |
|
42. |
relève que seuls quelques États membres ont mis au point une stratégie complète visant à inclure les étudiants issus de milieux socioéconomiques défavorisés dans l'enseignement supérieur et tenté de résoudre ainsi le problème du filtre social; |
|
43. |
appelle de ses vœux une participation accrue des professeurs de l'enseignement secondaire dans le processus de Bologne en matière de promotion de la qualité dans la formation des professeurs et la mobilité professionnelle, de manière à répondre aux nouvelles exigences en matière d'enseignement et de formation d'une société fondée sur la connaissance et contribuer à améliorer les performances des étudiants; |
|
44. |
insiste sur le rôle de l'éducation, sa qualité et sa mission dans la formation des générations à venir, sur sa contribution à la cohésion sociale et économique plus large ainsi qu'à la création d'emplois, à une plus grande compétitivité et au potentiel de croissance; à cet égard, appelle de ses vœux une meilleure reconnaissance du corps enseignant; |
|
45. |
invite à consentir des efforts sur le plan économique et social en vue d'améliorer l'inclusion sociale en fournissant à tous un accès équitable et ouvert à une éducation de qualité, en rendant plus aisés la reconnaissance des qualifications professionnelles, des périodes d'étude à l'étranger et des connaissances précédemment acquises, ainsi que les programmes de compétences non techniques et l'apprentissage formel et informel, et en fournissant, grâce à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, un enseignement pertinent à une population estudiantine diversifiée; |
|
46. |
souligne la dimension sociale du processus de Bologne; invite à prendre des mesures destinées à améliorer la participation des groupes sous-représentés ou défavorisés, en s'appuyant par exemple, entre autres, sur les programmes internationaux de mobilité; |
|
47. |
insiste sur le rôle de la mobilité au sein du secteur de l'éducation dans l'apprentissage interculturel et sur le fait que le processus de Bologne devrait prendre des mesures actives pour favoriser les connaissances interculturelles et le respect mutuel parmi les étudiants; |
|
48. |
estime nécessaire l'élaboration d'une stratégie plus poussée en matière de dimension de l'espace européen de l'enseignement supérieur, grâce à une coopération avec d'autres régions du monde, afin de rendre l'espace européen de l'enseignement supérieur plus compétitif et plus attractif dans un contexte mondialisé, d'améliorer la diffusion d'informations sur l'espace européen de l'enseignement supérieur, de renforcer la coopération fondée sur le partenariat, d'intensifier le dialogue politique et de poursuivre la reconnaissance des qualifications; |
|
49. |
souligne la nécessite de renforcer la collecte de données parmi les pays de l'espace européen de l'enseignement supérieur, afin de mieux cerner et relever les défis posés par le processus de Bologne; |
|
50. |
souligne l'importance que revêt la prochaine conférence ministérielle de l'espace européen de l'enseignement supérieur, qui se tiendra à Erevan en mai 2015, en ce qui concerne l'évaluation, objective et critique, tant des progrès accomplis vers la réalisation des priorités définies pour la période 2012-2015 que des retards en la matière, le but étant de stimuler et de renforcer davantage, avec l'appui total de l'Union européenne, l'espace européen de l'enseignement supérieur; |
o
o o
|
51. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf
(2) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf
(3) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf
(4) http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf
(5) http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf
(6) http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf
(7) JO L 354 du 28.12.2013, p. 132.
(8) JO L 289 du 3.11.2005, p. 23.
(9) JO L 64 du 4.3.2006, p. 60.
(10) JO C 111 du 6.5.2008, p. 1.
(11) JO C 119 du 28.5.2009, p. 2.
(12) JO C 302 du 12.12.2009, p. 3.
(13) JO C 135 du 26.5.2010, p. 12.
(14) JO C 191 du 1.7.2011, p. 1.
(15) JO C 199 du 7.7.2011, p. 1.
(16) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf
(17) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf
(18) http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138FR.pdf
(19) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
(20) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf
(21) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0
(22) http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253
(23) JO C 8 E du 14.1.2010, p. 18.
(24) JO C 161 E du 31.5.2011, p. 95.
(25) JO C 251 E du 31.8.2013, p. 24.
(26) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 (COM(2015)0010).
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/10 |
P8_TA(2015)0108
Le cinéma européen à l'ère numérique
Résolution du Parlement européen du 28 avril 2015 sur le cinéma européen à l'ère numérique (2014/2148(INI))
(2016/C 346/02)
Le Parlement européen,
|
— |
vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) le 20 octobre 2005, |
|
— |
vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1), |
|
— |
vu la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (2), |
|
— |
vu le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (3), |
|
— |
vu les conclusions du Conseil du 25 novembre 2014 sur la politique audiovisuelle européenne à l'ère numérique (4), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe» (COM(2010)0245), |
|
— |
vu le premier rapport de la Commission du 4 mai 2012 relatif à l'application de la directive 2010/13/UE (directive «Services de médias audiovisuels»), Services de médias audiovisuels et dispositifs connectés: perspectives passées et futures (COM(2012)0203), |
|
— |
vu le premier rapport de la Commission du 24 septembre 2012 relatif à l'application des articles 13, 16 et 17 de la directive 2010/13/UE au cours de la période 2009-2010 — Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels linéaires et à la demande dans l'UE (COM(2012)0522), |
|
— |
vu le troisième rapport de la Commission du 7 décembre 2012 intitulé «On the challenges for European film heritage from the analogue and the digital era» (SWD(2012)0431), relatif à la mise en œuvre de la recommandation 2005/865/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes, |
|
— |
vu la communication de la Commission du 18 décembre 2012 sur le contenu dans le marché unique numérique (COM(2012)0789), |
|
— |
vu le Livre vert de la Commission «Se préparer à un monde audiovisuel totalement convergent: croissance, création et valeurs» du 24 avril 2013 (COM(2013)0231), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 15 novembre 2013 sur les aides d'État en faveur des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles (5), |
|
— |
vu la communication de la Commission du 15 mai 2014 intitulée «Le cinéma européen à l'ère numérique — Associer la diversité culturelle et la compétitivité» (COM(2014)0272), |
|
— |
vu l'avis du Comité des régions du 4 décembre 2014 sur «Le cinéma européen à l'ère numérique», |
|
— |
vu sa résolution du 16 novembre 2011 sur le cinéma européen à l'ère numérique (6), |
|
— |
vu sa résolution du 11 septembre 2012 sur la distribution en ligne d'œuvres audiovisuelles dans l'Union européenne (7), |
|
— |
vu sa résolution du 22 mai 2013 sur l'application de la directive «Services de médias audiovisuels» (8), |
|
— |
vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la préparation à un monde audiovisuel totalement convergent (9), |
|
— |
vu l'article 52 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0123/2015), |
|
A. |
considérant que les films sont des biens qui sont à la fois culturels et économiques et contribuent dans une large mesure à l'économie européenne sur le plan de la croissance et de l'emploi, tout en contribuant à façonner les identités européennes en reflétant la diversité culturelle et linguistique, en promouvant les cultures européennes au-delà des frontières, en facilitant les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre citoyens, ainsi qu'en participant à la formation et au développement d'un esprit critique; |
|
B. |
considérant que le potentiel des secteurs culturels et créatifs en Europe, et en particulier de l'industrie cinématographique européenne, reste partiellement inexploité en ce qui concerne la promotion de la diversité et du patrimoine culturels européens et la création de croissance et d'emplois durables qui, à leur tour, peuvent bénéficier à d'autres secteurs de l'économie, offrant ainsi à l'Europe un avantage compétitif au niveau mondial; |
|
C. |
considérant que l'industrie cinématographique européenne est l'une des plus prolifiques du monde (1 500 films sortis en 2014), mais se caractérise par une structure hétérogène tant en termes de financement que de type de production; |
|
D. |
considérant que les films européens se distinguent par leur qualité, leur originalité et leur diversité, mais qu'ils pâtissent d'une promotion et d'une distribution limitées dans l'Union, ce dont témoignent les taux d'audience relativement faibles mesurés face à une concurrence internationale féroce ainsi qu'aux difficultés rencontrées sur le plan de la distribution tant à l'intérieur de l'Europe qu'en dehors; |
|
E. |
considérant que la circulation des films européens non nationaux dans les États membres reste limitée en dépit des nombreux films produits chaque année, tandis que les productions non européennes sont largement diffusées dans l'Union; |
|
F. |
considérant que la diversité des films européens reflétant la richesse et la force de la diversité culturelle et linguistique de l'Europe se traduit par une fragmentation naturelle du marché cinématographique européen; |
|
G. |
considérant que la promotion d'une production cinématographique de qualité est particulièrement importante pour les plus petits États membres de l'Union dont la langue compte un faible nombre de locuteurs; |
|
H. |
considérant que le sous-programme MEDIA du programme Europe créative offre de nouvelles sources de financement et possibilités en matière de distribution et de diffusion de films européens non nationaux, d'élargissement du public et de soutien à l'éducation aux médias; |
|
I. |
considérant que l'un des principaux objectifs du marché unique numérique devrait consister à instaurer la confiance dans l'internet et à améliorer l'accès au contenu audiovisuel légal, contribuant ainsi à l'investissement dans le cinéma européen; |
|
J. |
considérant que la projection cinématographique, en tant que première fenêtre d'exploitation, continue de générer une part importante des recettes cinématographiques et est par conséquent vitale pour le financement de la production et de la distribution de films européens, en plus de jouer un rôle déterminant dans le succès rencontré par les films concernés dans les fenêtres de mise à disposition ultérieures; |
|
K. |
considérant toutefois qu'un nombre croissant de films européens disposant d'un budget de production et de promotion modeste bénéficieraient de stratégies de sortie plus souples et d'une mise à disposition plus rapide dans le cadre des services de vidéo à la demande; |
|
L. |
considérant qu'une meilleure organisation des fenêtres d'exploitation maximiserait le public potentiel tout en réduisant l'attractivité de la consommation non autorisée de films; |
|
M. |
considérant que l'article 13, paragraphe 1, de la directive «Services de médias audiovisuels» oblige les États membres à s'assurer que les fournisseurs de services à la demande promeuvent la production d'œuvres européennes; considérant que cette disposition a été mise en œuvre de diverses manières, avec des niveaux d'exigences juridiques différents, ce qui a amené les fournisseurs à s'établir dans les États membres appliquant les niveaux d'exigences les plus faibles; |
|
N. |
considérant que la plupart des fonds publics alloués à l'industrie cinématographique européenne, par des sources tant nationales qu'européennes, sont utilisés pour la production de films; |
|
O. |
considérant que l'article 14 du règlement (UE) no 1295/2013 établissant le programme «Europe créative» prévoit que la Commission mette en place un «mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs» dans le but de faciliter l'accès au financement pour les PME œuvrant dans les secteurs culturels et créatifs et d'améliorer la capacité des intermédiaires financiers participants à mieux évaluer les risques associés aux projets pour lesquels les PME sollicitent des prêts et des financements; |
|
P. |
considérant que, dans son troisième rapport du 7 décembre 2012 intitulé «On the challenges for European film heritage from the analogue and the digital era», la Commission a mis en évidence que 1,5 % seulement du patrimoine cinématographique européen a été numérisé; considérant que ce pourcentage est resté inchangé depuis lors, malgré les risques soulignés de longue date de voir disparaître définitivement un pan important de ce patrimoine et de ne pouvoir le transmettre aux générations futures, en citant à titre d'exemple le cas des films muets, dont seuls 10 % ont été conservés; |
|
Q. |
considérant que la numérisation et la convergence des médias créent de nouvelles possibilités de distribution et de promotion des films européens au-delà des frontières, en plus de renforcer la capacité d'innovation et la flexibilité, tout en modifiant de manière significative le comportement et les attentes des spectateurs; |
|
R. |
considérant qu'il est essentiel de garantir le financement de la numérisation, de la conservation et de l'accessibilité en ligne du patrimoine cinématographique et du matériel connexe, ainsi que de fixer des normes européennes relatives à la conservation des films numériques; |
|
S. |
considérant que l'éducation aux médias, et en particulier l'éducation cinématographique, peut permettre aux citoyens de développer un esprit et une vision critiques et stimuler leur propre créativité et capacité d'expression; |
|
T. |
considérant que les droits d'auteur à l'ère numérique doivent continuer à stimuler les investissements dans la production et la création de films et garantir une rémunération appropriée aux titulaires des droits, tout en encourageant le développement de nouveaux services et l'accès transfrontalier pour les citoyens et en permettant aux secteurs culturels et créatifs de continuer de contribuer à la croissance et à la création d'emplois; |
|
U. |
considérant qu'il importe de garantir l'efficacité de la mise en œuvre de la directive 2012/28/UE sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines et de donner au public un accès aux films correspondant à la définition des œuvres orphelines; |
Promotion, distribution transfrontalière et accessibilité
|
1. |
encourage l'industrie cinématographique européenne à poursuivre le développement de services novateurs ainsi que de nouveaux modèles commerciaux et canaux de distribution de façon à améliorer la disponibilité transfrontalière des films européens dans l'Union et, au-delà, à permettre aux spectateurs de l'Union d'avoir accès à un éventail toujours plus large de films sur un nombre croissant de plateformes; suggère, à cet égard, que l'industrie cinématographique européenne prenne exemple sur les bonnes pratiques commerciales en vigueur en dehors de l'Union; |
|
2. |
reconnaît les effets de l'utilisation non autorisée d'œuvres créatives sur le cycle de création et les droits des créateurs; insiste sur la nécessité d'améliorer l'offre légale de qualité et de sensibiliser la jeune génération; |
|
3. |
suggère d'explorer plus avant le développement de la portabilité transfrontalière des services audiovisuels, compte tenu de la croissance rapide de la vidéo à la demande et des transactions en ligne dans l'Union, dans la mesure où cela permettrait aux spectateurs de visionner des films où qu'ils soient; |
|
4. |
souligne l'importance d'une commercialisation ciblée au sein de l'Union qui prenne en considération les spécificités culturelles des publics européens de façon à garantir une promotion plus efficace des films européens; |
|
5. |
demande instamment, à cet effet, d'accroître la disponibilité des films en version sous-titrée afin de favoriser la circulation transfrontalière des films européens, de sensibiliser davantage les spectateurs à la diversité culturelle et linguistique de l'Europe et d'améliorer la compréhension mutuelle; |
|
6. |
relève, en particulier, le rôle joué par le sous-programme MEDIA sur le plan du soutien au sous-titrage et au doublage pour améliorer la disponibilité des films européens notamment en version originale sous-titrée, ce qui facilite leur diffusion et améliore la connaissance et la compréhension des cultures et langues européennes; |
|
7. |
souligne l'importance de l'action préparatoire récemment adoptée concernant l'«externalisation ouverte du sous-titrage pour favoriser la circulation des œuvres européennes» et des travaux à accomplir par la Commission pour mettre en œuvre cette action; |
|
8. |
soutient par ailleurs des initiatives telles que le projet pilote de la Commission intitulé «Promouvoir l'intégration européenne à travers la culture», qui vise à accroître la disponibilité de films européens sous-titrés, en proposant de nouvelles versions sous-titrées pour une sélection de programmes télévisés dans l'ensemble de l'Europe; |
|
9. |
réaffirme l'importance fondamentale d'améliorer l'accessibilité des films pour les personnes handicapées, notamment au moyen de l'audiodescription et du sous-titrage; |
|
10. |
souligne le rôle significatif joué par les chaînes de télévision européennes privées et publiques dans la production de films, pour la télévision mais aussi pour le cinéma dans le cadre de coproductions, et souligne leur rôle vital pour de nombreuses sociétés de production cinématographique dans l'Union européenne, surtout celles de petite et moyenne taille; |
|
11. |
rappelle le rôle du prix LUX du Parlement européen, dont la reconnaissance a augmenté au fil des ans, dans la promotion des films européens, grâce à la possibilité qu'il offre de sous-titrer le film lauréat dans les 24 langues officielles de l'Union, améliorant ainsi la visibilité, la connaissance et la disponibilité des films européens; invite les parlements nationaux à promouvoir davantage le prix LUX dans les États membres en coopération avec les bureaux d'information du Parlement européen; |
|
12. |
estime qu'il est nécessaire d'encourager et de soutenir les coproductions européennes et que l'augmentation de ce type de productions pourrait se traduire par une distribution à plus grande échelle des films européens en Europe; |
|
13. |
souligne par ailleurs le succès grandissant des séries télévisées européennes de grande qualité et l'importance stratégique de continuer à encourager leur production, leur distribution et leur promotion sur les marchés européens et mondiaux; |
|
14. |
invite les États membres à soutenir et à promouvoir les manifestations spéciales, telles que les festivals de cinéma et les cinémas itinérants, pour encourager et soutenir la distribution et la diffusion des films européens sur leur territoire; |
|
15. |
suggère de renforcer les mesures déjà existantes en vue d'une meilleure optimisation du prix des places de cinéma, du développement d'offres promotionnelles innovantes ainsi que de la conception d'abonnements qui contribueraient à l'attractivité des salles de cinémas et ouvriraient leur accès à tous; |
Élargissement du public
|
16. |
encourage les distributeurs et les exploitants de salles de cinéma à améliorer la visibilité et la disponibilité de films européens non nationaux afin de toucher un public plus large; |
|
17. |
reconnaît que les cinémas restent les principaux lieux de présentation et de promotion des films et constituent également des lieux qui présentent une dimension sociale importante, des lieux de rencontre et d'échange de points de vue pour le public; souligne que la disparition des petits cinémas indépendants, en particulier dans les petites villes et les régions moins développées, limite l'accès aux ressources, au patrimoine et au dialogue culturels européens; invite dans ce cadre la Commission et les États membres à aider à l'équipement de tous les écrans en technologies audiovisuelles numériques afin d'empêcher la disparition de ces cinémas; |
|
18. |
souligne l'importance d'assurer la promotion des films dès le début de la production pour en améliorer la diffusion et garantir une meilleure information des publics potentiels en Europe; |
|
19. |
souligne l'importance du sous-programme MEDIA concernant l'expérimentation d'approches innovantes d'élargissement du public, en particulier par le soutien de festivals, d'initiatives d'éducation au cinéma et d'actions d'élargissement du public; |
Conditions équitables
|
20. |
rappelle que l'article 13, paragraphe 1, de la directive «Services de médias audiovisuels» oblige les États membres à veiller à ce que les fournisseurs de services à la demande promeuvent des œuvres européennes; souligne que cette disposition a été mise en œuvre de manière inégale, avec différents niveaux d'exigences juridiques, ce qui pourrait inciter certains fournisseurs à s'installer dans des États membres ayant défini les niveaux d'exigences les plus bas; |
|
21. |
est d'avis qu'il convient d'impliquer financièrement dans la création d'œuvres cinématographiques européennes, même de manière indirecte, l'ensemble des acteurs qui tirent un profit de leur offre directe, de leur commercialisation ou de leur distribution, y compris au moyen d'un référencement ou d'une mise à disposition dans le cadre de services de vidéo à la demande; demande à la Commission de tenir compte de cette approche y compris dans le cadre de l'examen des systèmes de financement du cinéma des États membres sur le plan de la concurrence; |
|
22. |
invite la Commission à tenir compte des éléments ci-dessus dans sa proposition de révision du cadre juridique actuel de façon à garantir une situation équitable sur le marché audiovisuel européen créant des conditions équitables et égales pour l'ensemble des fournisseurs; |
|
23. |
invite les plateformes de VOD et de SVOD à rendre publiques les données sur la consommation de chaque film de leur catalogue, en vue d'une évaluation correcte de leur importance; |
Financement
|
24. |
estime qu'afin d'améliorer la diffusion des films européens sur les marchés européens et internationaux, il est nécessaire de mieux équilibrer les fonds publics destinés à la production et à la distribution et d'accroître le soutien au développement, à la promotion et à la distribution au niveau mondial; |
|
25. |
estime qu'il est indispensable d'augmenter le financement en termes réels des activités de distribution, de promotion et de commercialisation des œuvres cinématographiques, sans pour autant réduire celui des activités de production; |
|
26. |
invite notamment les États membres à augmenter le financement public pour soutenir dès les premiers stades la distribution et la promotion des films nationaux à l'étranger, ainsi que des films européens non nationaux; |
|
27. |
engage les États membres à adopter des mesures d'incitation visant à faciliter la production, la distribution, la mise à disposition et l'attractivité des films européens; est d'avis que l'application des mêmes taux de TVA réduits aux œuvres culturelles audiovisuelles vendues en ligne ou autrement stimule la croissance de nouveaux services et de nouvelles plateformes; |
|
28. |
souligne le rôle que doit jouer le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs du programme Europe créative en vue de faciliter l'accès des PME œuvrant dans les secteurs culturels et créatifs à un financement et d'encourager les intermédiaires financiers à investir davantage, de façon à augmenter les possibilités de financement de l'industrie cinématographique; |
|
29. |
suggère d'évaluer l'efficacité et l'efficience des systèmes européens et nationaux de financement du cinéma, en portant une attention particulière à la qualité et à la portée des œuvres soutenues, ainsi que la disponibilité et l'efficacité des instruments de financement en ce qui concerne la commercialisation et l'élargissement du public; demande à la Commission de communiquer aux États membres des exemples des bonnes pratiques recensées dans le cadre de cet examen; |
|
30. |
rappelle que la production et la coproduction de films requièrent un investissement financier considérable et que le cadre juridique actuel n'empêche pas l'octroi de licences multiterritoriales; souligne par conséquent que la pluralité des systèmes de production et de distribution devrait être maintenue pour encourager les investissements dans les films européens, afin de répondre aux exigences d'un marché européen d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que de préserver et de promouvoir la diversité culturelle; |
|
31. |
souligne que les films européens sont soutenus par un grand nombre de fonds publics européens, nationaux et régionaux, dont il convient d'encourager une utilisation plus complémentaire afin d'accroître leur efficacité; |
Forum du film européen
|
32. |
salue l'initiative de la Commission de créer un «forum du film européen» afin de faciliter l'instauration d'un dialogue structuré avec tous les acteurs du secteur de l'audiovisuel autour des problèmes que rencontre actuellement ce secteur à l'ère numérique, ce dans le but d'améliorer la coopération, le rassemblement des informations et l'échange des bonnes pratiques; |
|
33. |
demande à cet égard la participation et la coopération à grande échelle de toutes les institutions concernées, en particulier le Parlement européen; |
Éducation aux médias
|
34. |
invite les États membres à redoubler d'efforts pour renforcer la place de l'éducation aux médias et, en particulier, de l'éducation cinématographique dans le programme scolaire et dans les établissements d'éducation culturelle, ainsi qu'à mettre en place des initiatives au niveau national, régional ou local couvrant tous les niveaux de l'éducation et de la formation formelles, informelles et non formelles; |
|
35. |
est conscient du rôle particulier joué par les cinémas comme lieu d'apprentissage intergénérationnel des domaines cinématographiques et médiatiques, et salue les mesures ciblées qui soutiennent cette fonction des cinémas; |
|
36. |
attire l'attention sur la promotion des films pédagogiques à destination des jeunes et se dit favorable aux concours qui les encouragent à créer leurs propres œuvres audiovisuelles; souligne également les possibilités qu'offre le sous-programme MEDIA sur le plan du soutien des projets d'éducation cinématographique; |
Innovation
|
37. |
soutient les pratiques et les projets innovants tels que l'action préparatoire de la Commission sur la circulation des films européens à l'ère numérique, qui vise à expérimenter un modèle de sortie des films plus flexible dans les médias dans plusieurs États membres, et se félicite de l'intégration de cette action dans le programme «Europe créative»; |
|
38. |
estime qu'en rendant les fenêtres d'exploitation plus flexibles, ces initiatives pourraient bénéficier à certains types de films européens au niveau de la visibilité, de l'audience, des recettes et des économies de coûts, et encourage la Commission et les États membres à les étudier de plus près; |
Numérisation et archivage
|
39. |
invite les États membres à veiller à la numérisation des œuvres cinématographiques et à instaurer des mécanismes de dépôt obligatoire pour les formats numériques ou à adapter à ceux-ci les mécanismes existants en demandant, pour les films numériques, le dépôt d'un master numérique respectant les normes internationales; |
|
40. |
souligne l'importance des archives audiovisuelles, en particulier celles des institutions chargées du patrimoine cinématographique et des diffuseurs du service public, et demande instamment aux États membres de garantir un niveau de financement et des systèmes d'octroi des droits adéquats pour faciliter l'accomplissement de leur mission d'intérêt général, dont la conservation et la numérisation du patrimoine cinématographique ainsi que son accessibilité au public; |
|
41. |
souligne le rôle important de la bibliothèque numérique européenne Europeana en tant que bibliothèque numérique pour le patrimoine audiovisuel européen (cinématographique et télévisé); |
o
o o
|
42. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres. |
(1) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(2) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 221.
(4) JO C 433 du 3.12.2014, p. 2.
(5) JO C 332 du 15.11.2013, p. 1.
(6) JO C 153 E du 31.5.2013, p. 102.
(7) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 64.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0215.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0232.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/17 |
P8_TA(2015)0109
Nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts
Résolution du Parlement européen du 28 avril 2015 sur une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier (2014/2223(INI))
(2016/C 346/03)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier» (COM(2013)0659), |
|
— |
vu les documents de travail des services de la Commission SWD(2013)0342 et SWD(2013)0343 accompagnant cette communication, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil «Agriculture et pêche» du 19 mai 2014 sur la nouvelle stratégie forestière de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité des régions du 30 janvier 2014 intitulé «Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier», |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2014 sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une nouvelle stratégie de l'UE pour les forêts et le secteur forestier», |
|
— |
vu sa résolution du 16 février 2006 sur la mise en œuvre d'une stratégie forestière pour l'Union européenne (1), |
|
— |
vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète», |
|
— |
vu la stratégie «Europe 2020», notamment les initiatives «Une Union pour l'innovation» et «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources», |
|
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de l'UE relative à l'adaptation au changement climatique» (COM(2013)0216), |
|
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel — stratégie de l'UE à l'horizon 2020» (COM(2011)0244), |
|
— |
vu l'article 52 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-0126/2015), |
|
A. |
considérant que l'Union européenne ne dispose d'aucune compétence pour l'élaboration d'une politique forestière commune, mais que certaines politiques de l'Union peuvent avoir des conséquences sur les politiques forestières nationales, et que ce sont les États membres qui décident des approches politiques en lien avec la sylviculture et les forêts; |
|
B. |
considérant que, sans préjudice de la compétence évidente des États membres, il est potentiellement intéressant que le secteur forestier soit mieux et plus activement coordonné et que le positionnement de cet important secteur économique et pourvoyeur d'emplois au niveau européen, notamment dans les zones rurales, soit meilleur, tout en protégeant les écosystèmes et en offrant des avantages écologiques pour tous; |
|
C. |
considérant que le bois est une ressource renouvelable souvent sous-exploitée en Europe et que l'utilisation intelligente et durable de cette matière première, entre autres via le développement et l'échange des savoir-faire, doit être assurée; |
|
D. |
considérant que les forêts sont des sources uniques de flore, de faune et de champignons; |
|
E. |
considérant que la taille et les caractéristiques des forêts sont extrêmement variables, le territoire de certains États membres étant recouvert de forêts pour plus de moitié; que des forêts gérées de manière durable sont d'une importance capitale pour la valeur ajoutée locale, régionale, européenne et internationale, puisqu'elles garantissent des emplois dans les zones rurales et contribuent à une société fondée sur la bioéconomie, ce qui est bénéfique pour la santé humaine, en particulier dans les régions structurellement désavantagées, et qu'elles contribuent en parallèle grandement à la protection de l'environnement et du climat, ainsi qu'à la biodiversité; |
|
F. |
considérant que la biomasse forestière constitue une source très importante d'énergie renouvelable; que les forêts européennes absorbent et stockent actuellement environ 10 % des émissions de carbone de l'Union et apportent ainsi une contribution importante aux efforts d'atténuation du changement climatique; |
|
G. |
considérant qu'en raison de l'urbanisation de notre société, les citoyens de l'Union sont moins en contact avec les forêts et ont une faible connaissance de la sylviculture et de ses retombées sur la prospérité, les emplois, le climat, l'environnement, la santé humaine et l'ensemble de la chaîne de valeur, ainsi que du lien avec les écosystèmes au sens large; |
|
H. |
considérant qu'un nombre croissant de politiques de l'Union accentuent les pressions sur les forêts; que ces pressions doivent faire l'objet d'un équilibrage prudent et que la demande portant sur de nouveaux usages du bois aux fins de la bioéconomie et de la bioénergie doit s'accompagner d'une utilisation efficace des ressources, du recours à de nouvelles technologies et du respect des limites d'un approvisionnement durable; |
|
I. |
considérant que la sylviculture européenne est marquée par la gestion durable et la planification à long terme et que le principe de durabilité devrait être encore renforcé à tous les niveaux, de l'échelon local à l'échelon mondial, afin de créer des emplois, de préserver la biodiversité, d'atténuer les changements climatiques et de lutter contre la désertification; |
|
J. |
considérant qu'il est essentiel de souligner le rôle économique, social et environnemental des forêts, y compris dans le contexte de la protection et de la promotion du patrimoine culturel et naturel ainsi que de la promotion de l'(éco)tourisme durable; |
|
K. |
considérant qu'en raison de l'augmentation de la population mondiale, il existe une demande croissante en énergie et que les forêts devraient, par conséquent, jouer un rôle plus important dans le futur bouquet énergétique de l'Union; |
Remarques générales — rôle des forêts, de la sylviculture et du secteur forestier pour l'économie et la société
|
1. |
salue la communication de la Commission sur une nouvelle stratégie forestière de l'UE et les documents de travail qui l'accompagnent et souligne qu'une stratégie forestière de l'Union doit mettre l'accent sur la gestion durable des forêts et sur leur rôle multifonctionnel d'un point de vue économique, social et environnemental et doit garantir une meilleure coordination et communication des politiques de l'Union directement ou indirectement liées à la sylviculture; souligne dans ce contexte que les initiatives politiques européennes de plus en plus nombreuses dans des domaines comme la politique économique et en matière d'emploi, la politique énergétique, environnementale et climatique, requièrent une plus grande contribution du secteur de la sylviculture; |
|
2. |
souligne la nécessité de déterminer la valeur des services écosystémiques forestiers de manière plus systématique et de la prendre en considération dans le processus décisionnel des secteurs public et privé; |
|
3. |
observe que seules des forêts de montagne saines et stables peuvent assurer pleinement leurs fonctions de protection pour l'homme et la nature en empêchant les avalanches et les coulées de boue et en jouant leur rôle de défense naturelle contre les inondations; souligne que des échanges transfrontaliers s'imposent tout particulièrement dans ce contexte; |
|
4. |
souligne à cet égard qu'il convient de s'opposer à toute tentative de rattachement de la sylviculture à la compétence de l'Union européenne et qu'il convient de respecter le caractère local et régional du secteur et la compétence de droit des États membres dans ce domaine, tout en recherchant la cohérence entre les compétences respectives de l'Union européenne et des États membres; |
|
5. |
souligne que les forêts de l'Union sont marquées par une grande diversité, et notamment de grandes différences en matière de propriété des forêts, de leur taille, de leur nature et des problèmes rencontrés; |
|
6. |
souligne que la stratégie de l'Union pour les forêts doit tenir compte du fait que les forêts couvrent plus de la moitié du territoire de certains États membres, que les forêts gérées de manière durable présentent une importance considérable en créant de la valeur aux niveaux local et régional et en garantissant les emplois dans les régions rurales, tout en apportant une contribution vitale à l'environnement; |
|
7. |
souligne à cet égard l'importance particulière des forêts mixtes stables présentant des essences indigènes adaptées à leur milieu, et le rôle essentiel que ces forêts jouent dans les écosystèmes ainsi que leur contribution à la biodiversité; |
|
8. |
invite les États membres à soutenir les propriétaires de forêts dans leurs efforts pour préserver et créer des forêts mixtes indigènes locales; |
|
9. |
juge décevant le fait que les conditions de travail des travailleurs forestiers ne soient pas prises comme point de référence dans la stratégie proposée et invite la Commission à tenir compte des exigences d'une organisation du travail intelligente, de normes technologiques élevées et d'emplois de qualité; |
|
10. |
relève que le secteur forestier emploie actuellement plus de 3 millions de citoyens européens, et souligne que sa compétitivité à long terme ne sera assurée que grâce à une main-d'œuvre qualifiée; |
|
11. |
estime que la stratégie de l'Union pour les forêts devrait fixer les conditions permettant à l'Union de disposer des moyens de formation pertinents et d'une main-d'œuvre qui soit pleinement consciente des défis et des menaces auxquels le secteur forestier est actuellement confronté, mais également des règles de sécurité inhérentes à la gestion forestière; |
|
12. |
souligne la nécessité d'une stratégie commune complète et globale, et se félicite de la reconnaissance du rôle et des avantages économiques, environnementaux et sociaux des forêts et du secteur forestier dans l'Union européenne; |
|
13. |
est convaincu que cette reconnaissance constitue une base solide pour soutenir le secteur forestier de l'Union, entre autres en ce qui concerne la prévention et la gestion des catastrophes forestières, l'amélioration de l'utilisation efficace des ressources, l'accroissement de la compétitivité, la relance de l'emploi, le renforcement des industries forestières et la préservation des fonctions écologiques; |
|
14. |
souligne le rôle important joué par la bioéconomie pour la réalisation des nouvelles priorités de croissance, d'emploi et d'investissement de la Commission; |
|
15. |
reconnaît que l'Union doit contribuer à soutenir les politiques nationales afin de parvenir à une gestion active multifonctionnelle et durable des forêts, notamment la gestion de divers types de forêts, et de renforcer la coopération afin de faire face aux défis transfrontaliers comme les feux de forêts, le changement climatique et les catastrophes naturelles, ou les espèces étrangères invasives; |
|
16. |
estime que la stratégie doit prendre davantage en considération le problème des maladies des arbres qui, par exemple dans le cas du dépérissement du chêne, font des ravages dans les plantations de chênes-lièges au Portugal, en France et en Espagne, en touchant notamment les zones de protection spéciales et les réserves de la biosphère; |
|
17. |
souligne que la croissance prévue de la demande en bois représente à la fois une chance et un défi pour les forêts et pour tous les secteurs forestiers, compte tenu en particulier du fait que les sécheresses, les incendies, les tempêtes et les ravageurs forestiers devraient, selon les prévisions, endommager les forêts plus fréquemment et plus gravement à la suite du changement climatique; rappelle, dans ce contexte, la nécessité de protéger les forêts contre ces menaces croissantes et de concilier leurs fonctions de production et de protection; |
|
18. |
se félicite des actions visant à augmenter la couverture forestière, en particulier avec des espèces indigènes, dans les zones ne convenant pas à la production alimentaire et notamment à proximité immédiate des zones urbaines afin de limiter les effets néfastes de la chaleur, de réduire la pollution et de renforcer les liens entre la population et les forêts; |
|
19. |
soutient pleinement les efforts déployés par la Commission pour promouvoir durablement une prospérité fondée sur le secteur forestier ainsi que l'emploi dans ce domaine en Europe; |
|
20. |
souligne le rôle important de la production et de l'utilisation durables de bois et d'autres matériaux forestiers tels que le liège et d'autres produits dérivés du bois y compris les fibres textiles pour le développement de modèles économiques durables et la création d'emplois verts; |
|
21. |
appelle la Commission à analyser les difficultés d'approvisionnement de l'aval de la filière, liées à l'augmentation de la demande dans les pays tiers en particulier en bois ronds, et à soutenir ce secteur; |
|
22. |
invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures d'incitation, afin d'encourager le groupe toujours plus nombreux des femmes propriétaires de forêts à obtenir des conseils et un soutien spécifiques pour leur permettre d'exploiter leurs forêts de façon active et durable; |
|
23. |
souligne qu'environ 60 % des forêts de l'Union sont privées, pour environ 16 millions de propriétaires de forêts privées, et souligne dans ce contexte l'importance de la propriété et des droits de propriété et soutient toutes les mesures qui permettent aux groupes d'intérêts de participer au dialogue sur le renforcement et la mise en œuvre d'une gestion forestière durable et d'améliorer l'échange d'informations; |
|
24. |
relève que les propriétaires de forêts sont des acteurs clés dans les zones rurales et salue dans ce contexte la reconnaissance de la sylviculture et de l'agroforesterie dans le programme «développement rural» dans le cadre de la PAC 2014-2020; |
|
25. |
estime que la mise en œuvre de la stratégie de l'Union pour les forêts serait plus efficace si elle bénéficiait d'une coordination adéquate avec les financements de l'Union disponibles, y compris ceux du Feader; |
|
26. |
souligne la possibilité pour les États membres et les régions d'utiliser le financement disponible au titre de leurs programmes respectifs de développement rural, de soutenir la gestion forestière durable et de stimuler l'agroforesterie, de fournir des biens environnementaux publics comme la production d'oxygène, la réduction du niveau de CO2 et la protection des cultures contre les effets du changement climatique, ainsi que la stimulation des économies locales et la création d'emplois «verts»; |
|
27. |
reconnaît la nécessité d'améliorer le transport et la logistique pour la gestion forestière et l'extraction du bois; invite par conséquent les États membres à mettre en place des systèmes de logistique et d'exploitation forestière durables ayant un effet négatif réduit sur le climat, à travers notamment l'utilisation de camions et de navires alimentés par des biocarburants durables et un recours accru au transport ferroviaire; encourage l'utilisation des fonds structurels de l'Union et des programmes pour le développement rural à ces fins; |
|
28. |
reconnaît le rôle des forêts dans la société en lien avec la santé physique et mentale des citoyens et le fait que les biens publics procurés par les forêts représentent une forte valeur environnementale et récréative et contribuent à la qualité de vie, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en oxygène, le piégeage du carbone, la filtration de l'air, le stockage et la filtration de l'eau, la maîtrise de l'érosion et la protection contre les avalanches, et qu'ils offrent un site d'activités de loisirs extérieurs; |
|
29. |
encourage les connexions en transports publics entre les zones urbaines et les forêts afin de faciliter l'accès aux forêts et aux zones forestières; |
|
30. |
souligne l'importance d'autres activités liées aux forêts, comme la récolte de produits forestiers non ligneux tels que les champignons ou les fruits rouges, ainsi que le pacage et l'apiculture; |
|
31. |
invite la Commission à promouvoir les activités économiques qui peuvent constituer une source d'approvisionnement en matières premières pour les industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire et une solution alternative de lutte contre le chômage et le dépeuplement dans les zones rurales, et à promouvoir en outre les produits de ces activités puisqu'ils sont bénéfiques pour la santé humaine; |
Efficacité dans l'utilisation des ressources — le bois, matière première durable (gestion forestière durable)
|
32. |
souligne que tant l'utilisation du bois et des autres produits ligneux récoltés en tant que matières premières renouvelables et respectueuses du climat que la gestion forestière durable jouent un rôle important pour les objectifs sociaux de l'Union européenne, comme la transition énergétique, l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci, et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 ainsi que des objectifs en matière de biodiversité; relève qu'une absence totale de gestion active des forêts irait à l'encontre desdits objectifs; |
|
33. |
souligne que les forêts gérées ont une capacité d'absorption du CO2 plus élevée que celles qui ne sont pas gérées, et souligne l'importance de la gestion durable des forêts pour optimiser le potentiel de piégeage du carbone des forêts de l'Union; |
|
34. |
estime que les forêts ne doivent pas être uniquement considérées comme des puits de carbone; |
|
35. |
souligne qu'il y a lieu de veiller à ce que les ressources forestières et les matériaux sylvicoles soient utilisés et réutilisés efficacement, comme moyen de réduire le déficit de la balance commerciale de l'Union, d'améliorer l'autosuffisance de celle-ci dans le domaine du bois et la compétitivité de son secteur forestier, de contribuer au recul de la gestion forestière non durable, de préserver l'environnement et de réduire la déforestation dans les pays tiers; |
|
36. |
soutient pleinement une utilisation efficace des ressources en bois en tant que matière première renouvelable et polyvalente dont la disponibilité est limitée et s'oppose à une priorité juridiquement contraignante dans l'utilisation du bois, ceci restreignant d'une part le marché de l'énergie et la mise au point de nouveaux usages innovants de la biomasse, et étant d'autre part irréalisable dans de nombreuses zones rurales et reculées, ne serait-ce que pour des raisons d'infrastructures; |
|
37. |
est favorable à une approche ouverte axée sur le marché et à la liberté de tous les acteurs du marché en accordant la priorité au bois d'origine locale afin de réduire autant que possible l'empreinte carbone du transport maritime et de stimuler une production locale durable; |
|
38. |
estime impératif, compte tenu du fait qu'une partie des ressources en biomasse parmi les plus importantes de l'Union se trouvent dans ses régions les moins densément peuplées et les plus périphériques, que la stratégie tienne pleinement compte également des spécificités de ces régions; |
|
39. |
reconnaît la valeur du bois pour la production d'énergie en vue de lutter contre la pauvreté énergétique, de contribuer aux objectifs en matière d'énergies renouvelables du cadre en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et d'ouvrir de nouvelles perspectives commerciales; |
|
40. |
considère que la nouvelle stratégie forestière devrait permettre une plus forte coopération sur la question de la structuration de la filière bois et du regroupement des acteurs en vue d'assurer une meilleure utilisation de la ressource forestière; |
|
41. |
estime qu'une gestion forestière durable doit reposer sur des principes et des outils généralement reconnus et acceptés, tels que des critères et des indicateurs relatifs à la gestion forestière durable, visant toujours la totalité du secteur, indépendamment de l'usage final du bois; |
|
42. |
soutient le projet de la Commission d'élaborer, avec les États membres et les parties prenantes, un ensemble ambitieux, objectif et démontrable de critères et d'indicateurs relatifs à la gestion durable des forêts, en soulignant que ces critères devraient s'accorder avec les exigences définies dans le cadre de Forest Europe (conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe) (2), qui constituent une base paneuropéenne pour l'élaboration harmonisée de rapports sur la gestion forestière durable et la base des certifications de durabilité, en tenant compte de la diversité des types de forêts européennes; |
|
43. |
reconnaît que la demande croissante de matériaux forestiers découlant principalement du développement des énergies renouvelables provenant de la biomasse rend nécessaire l'adoption de mesures supplémentaires pour accroître la disponibilité du bois en garantissant une exploitation durable des forêts; |
|
44. |
souligne dans ce contexte que les négociations dans le cadre de Forest Europe en faveur d'une «convention européenne des forêts» (3) en tant que cadre contraignant pour une gestion forestière durable et un meilleur équilibre des intérêts en matière de politique forestière sont déjà bien avancées, et demande aux États membres et à la Commission de déployer tous les efforts nécessaires pour reprendre lesdites négociations et les faire aboutir à la conclusion d'un accord; |
|
45. |
estime que les plans de gestion forestière ou instruments équivalents peuvent constituer des instruments stratégiques importants pour l'application de mesures concrètes au niveau des entreprises pour la planification à long terme et la mise en œuvre d'une gestion forestière durable dans les forêts européennes; souligne toutefois que la mise en place des mesures concrètes des plans de gestion forestière au niveau de la propriété des forêts reste soumise aux réglementations nationales; |
|
46. |
invite les États membres, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, à contrôler et à promouvoir la mise en œuvre des plans de gestion forestière, sans créer de charge bureaucratique inutile; |
|
47. |
se félicite de la séparation claire entre les plans de gestion forestière et les plans de gestion dans le cadre de Natura 2000; |
|
48. |
souligne que les plans de gestion forestière ne représentent une condition pour recevoir des fonds de l'Union au titre du développement rural que pour les bénéficiaires dont l'exploitation excède une certaine taille et que les forêts n'atteignant pas ce seuil en sont exemptées; observe par ailleurs que des instruments équivalents peuvent également être adoptés; |
|
49. |
invite dès lors les États membres à exploiter pleinement cette flexibilité dans la mise en œuvre de la législation, en particulier au bénéfice des petits opérateurs; |
|
50. |
invite la Commission et les États membres à mettre en place des incitations et à soutenir de nouveaux modèles économiques, comme des groupements de production, afin d'encourager les petits propriétaires forestiers à gérer leurs parcelles activement et durablement; |
|
51. |
souligne qu'il est essentiel, pour une mise en œuvre adéquate de la stratégie, de disposer d'un plan d'action spécifique à long terme qui mette l'accent sur l'importance de la mobilisation et de l'utilisation durable du bois issu des forêts, pour créer de la valeur ajoutée et des emplois, tout en prévoyant des moyens pour renforcer les exploitations forestières privées et soutenir les structures organisées de propriétaires forestiers; |
|
52. |
souligne le fait qu'une gestion efficace des ressources devrait comprendre des programmes de soutien au boisement des surfaces impropres à l'agriculture, ainsi qu'à la création de rideaux forestiers; |
Recherche et développement — formation et formation continue
|
53. |
estime qu'il convient d'accorder la priorité à l'application pratique de la recherche, étant donné que l'ensemble du secteur peut bénéficier de nouvelles idées et que l'industrie forestière dispose d'un potentiel important en termes de croissance; considère également que de nouveaux investissements dans l'innovation au sein de ce secteur peuvent créer de nouvelles niches de production et des processus industriels plus efficaces garantissant une utilisation plus intelligente des ressources disponibles et sont susceptibles de réduire les incidences négatives sur les ressources forestières; |
|
54. |
invite la Commission à évaluer, sous l'angle des priorités de la sylviculture et du travail du bois, les programmes européens pour la recherche et le développement (Horizon 2020) et le programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) et à développer, le cas échéant, de nouveaux instruments pour le secteur forestier et à promouvoir la recherche ciblée portant sur des solutions rentables en matière de nouveaux produits du bois innovants pour soutenir le développement d'une bioéconomie durable du bois; |
|
55. |
se félicite des avantages que présente l'échange entre les États membres des bonnes pratiques et des connaissances existantes dans le domaine forestier, et invite les États membres et la Commission à promouvoir les échanges entre les secteurs industriel, scientifique et productif; |
|
56. |
souligne l'importance de soutenir les programmes-cadres de l'Union pour la recherche, le développement et l'innovation pour assurer une croissance intelligente et durable, développer de nouveaux produits à plus haute valeur ajoutée et des technologies plus propres, et atteindre un niveau technologique élevé, en particulier en ce qui concerne les biocarburants raffinés et la construction de bâtiments industriels en bois, mais aussi les secteurs automobile et textile; |
|
57. |
rappelle que, selon la Commission, la bioéconomie représentait en 2009 un marché estimé à plus de 2 000 milliards d'euros, générateur de 20 millions d'emplois et représentant 9 % de l'emploi total au sein de l'Union; |
|
58. |
fait observer que chaque euro investi dans la recherche et l'innovation en bioéconomie au titre du programme Horizon 2020 générera une valeur ajoutée de quelque 10 euros; souligne que les forêts jouent actuellement un rôle crucial dans la bioéconomie et qu'il en sera de même à l'avenir; |
|
59. |
considère que la substitution des matériaux dérivés du pétrole ou à forte intensité thermique par le bois et les produits forestiers récoltés devrait être encouragée, dans le prolongement des progrès obtenus par la recherche et la technologie, et que ceci peut contribuer de manière positive à l'atténuation du changement climatique ainsi qu'à la création d'emplois; |
|
60. |
souligne la nécessité de mener une évaluation des coûts de tous les actes législatifs de l'Union concernant les chaînes de valeur des entreprises forestières, en vue de réduire toute la bureaucratie lourde et inutile, de créer un cadre favorable à l'amélioration, de manière durable, de la compétitivité à long terme du secteur et d'appuyer le principe selon lequel les propositions législatives portant sur le secteur sylvicole et les chaînes de valeur des entreprises forestières doivent être évaluées en profondeur à l'aide d'une analyse d'impact; |
|
61. |
estime que le développement de la base de connaissances en matière de forêts pour la recherche revêt une importance capitale et qu'il est indispensable de disposer d'informations fiables pour la mise en œuvre de la stratégie forestière; |
|
62. |
relève que des informations et des moyens de contrôle sont disponibles grâce au programme Copernicus et à d'autres initiatives spatiales européennes, et recommande une utilisation accrue de ces ressources et outils; |
|
63. |
souligne que les inventaires nationaux des forêts constituent un outil de suivi complet de l'état des forêts et tiennent compte de considérations régionales tout en répondant aux demande de diminution de la bureaucratie et des coûts; |
|
64. |
salue les efforts déployés par la Commission pour mettre en place un système d'information européen sur les forêts, basé sur des données nationales, et des initiatives permettant d'améliorer la comparabilité des données disponibles, et souhaite à ce titre renforcer l'analyse des données relatives à l'économie et l'emploi dans la sylviculture et la filière bois; |
|
65. |
recommande en particulier la mise à disposition de davantage d'ensembles de données à long terme pour contribuer à comprendre les tendances en matière de sylviculture et l'adaptation de ce secteur au changement climatique; |
|
66. |
est d'avis qu'une main-d'œuvre qualifiée et bien formée est essentielle à la mise en œuvre satisfaisante d'une gestion forestière durable et invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures et, le cas échéant, à utiliser les instruments européens disponibles, comme le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et les programmes européens de formation (ET2020), pour favoriser le renouvellement des générations et répondre au manque de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine forestier; |
|
67. |
appelle la Commission à soutenir la réalisation de campagnes d'information sur le secteur forestier et des campagnes de sensibilisation aux possibilités que celui-ci présente et à son attractivité pour les jeunes, pour lutter contre le chômage et le dépeuplement; |
|
68. |
estime en outre que les programmes de formation et de formation continue, en particulier ceux destinés aux jeunes entrepreneurs et sylviculteurs, ainsi qu'aux travailleurs en poste dans le secteur de la construction pour les sensibiliser aux possibilités ouvertes par l'utilisation du bois, devraient être développés afin que le transfert de connaissances dans le domaine de la gestion forestière durable et des industries en aval reste assuré; |
|
69. |
reconnaît qu'une gestion durable tout au long du cycle de vie des produits forestiers peut apporter une précieuse contribution à la réalisation des objectifs d'une économie verte, en particulier les objectifs liés aux politiques d'atténuation du changement climatique et à l'utilisation rationnelle des ressources; |
|
70. |
estime que les États membres devraient promouvoir l'utilisation de produits forestiers dans le secteur de la construction, notamment par leur utilisation dans la construction de maisons plus abordables à partir de matières premières issues de sources durables; |
|
71. |
souligne l'importance des utilisations à haute valeur ajoutée traditionnelles qui possèdent encore un potentiel de croissance énorme, telles que l'utilisation du bois dans la construction et l'emballage; |
|
72. |
observe que les avancées technologiques actuelles permettent la construction de complexes de logements à forte capacité et constitués principalement de bois, limitant ainsi de manière significative les émissions de CO2 dans le secteur de la construction; |
|
73. |
souligne que les normes relatives à l'utilisation du bois dans la construction varient suivant les États membres; demande, par conséquent, un engagement en faveur de l'adoption de règles de l'Union pour promouvoir la diffusion des constructions en bois; |
|
74. |
invite les États membres à mettre au point des initiatives pour soutenir les transferts de connaissances et de technologies et exploiter pleinement les programmes existants de l'Union en appui à la recherche et à l'innovation dans le secteur forestier et sylvicole; |
|
75. |
observe l'existence de lacunes significatives dans la recherche scientifique et technologique liée à l'adaptation de la sylviculture au changement climatique, notamment pour ce qui est de l'incidence croissante des parasites et des maladies qui mettent sérieusement en péril les forêts et les secteurs forestiers en Europe; |
|
76. |
encourage les États membres et la Commission à agir afin de sensibiliser au rôle économique, environnemental et social des forêts et de la sylviculture européennes et à l'importance d'une bioéconomie durable fondée sur les forêts et du bois comme l'une des matières premières renouvelables essentielles de l'Union; |
|
77. |
estime qu'il est important d'encourager les travaux de recherche scientifique orientés vers une utilisation rationnelle de la biomasse et vers un développement des cultures énergétiques à croissance rapide, et de créer un modèle économique incitant à utiliser les déchets de biomasse; |
Défis mondiaux — protection de l'environnement et changement climatique
|
78. |
souligne que la gestion forestière durable a une incidence positive sur la biodiversité et l'atténuation des conséquences du changement climatique et peut réduire les risques d'incendies de forêts, d'infestations de parasites et de maladies; |
|
79. |
souligne que l'Union a convenu qu'à l'horizon 2020, la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, notamment la pollinisation, devaient être enrayées, les écosystèmes et leurs services devaient être maintenus et au moins 15 % des écosystèmes dégradés devraient être rétablis; ajoute que l'Union a également convenu que la gestion des forêts devait être durable, que les forêts, leur biodiversité et les services qu'elles fournissent devaient être préservés et, dans la mesure du possible, renforcés, et que la résilience des forêts face au changement climatique, aux incendies, aux tempêtes, aux ravageurs et aux maladies devait être améliorée; souligne, en outre, qu'il est nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie renouvelée de l'Union en faveur des forêts, qui permette de couvrir les multiples demandes en direction des forêts et les différents avantages qu'elles procurent, et qui contribue à une approche plus stratégique de la protection et de la valorisation des forêts, y compris via la gestion forestière durable (4); |
|
80. |
souligne que d'autres thématiques devraient être approfondies, en particulier le problème de la surpopulation des herbivores, la santé des forêts et la facilitation de la production durable de bois, les ressources génétiques forestières (RGF), les mesures pour prévenir et combattre les feux de forêts et l'érosion des sols, et la reconstitution de la couverture végétale; |
|
81. |
reconnaît que la sylviculture à courte rotation pourrait fournir une biomasse forestière durable, tout en assurant l'entretien nécessaire du territoire, réduisant en cela les risques d'érosion des sols et de glissement de terrain sur les terres en jachère ou abandonnées; |
|
82. |
appelle la Commission et les États membres à prendre des mesures spécifiques en faveur de la réalisation de l'objectif 5 d'Aichi, suivant lequel le rythme d'appauvrissement de tous les habitats naturels, y compris les forêts, devrait être réduit au moins de moitié d'ici à 2020 et, si possible, ramené à près de zéro, et la dégradation et la fragmentation des habitats devraient être sensiblement réduites; |
|
83. |
exhorte les États membres à concevoir leurs politiques forestières de manière à tenir pleinement compte de l'importance des forêts pour la protection de la biodiversité, la prévention de l'érosion des sols, pour garantir la séquestration du carbone et la purification de l'air et maintenir le cycle hydrique; |
|
84. |
souligne que la bioéconomie en tant qu'élément central d'une croissance intelligente et verte en Europe est nécessaire pour la réalisation des objectifs des initiatives phares «Une Union de l'innovation» et «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et que le bois en tant que matière première peut jouer un rôle de premier plan pour tendre vers cette bioéconomie; |
|
85. |
souligne la nécessité de clarifier de toute urgence les incidences sur le plan de l'effet de serre des différentes applications énergétiques de la biomasse forestière et d'en recenser les plus avantageuses du point de vue des effets d'atténuation obtenus dans des délais stratégiques pertinents; |
|
86. |
considère qu'il est important de promouvoir l'application du concept de bioéconomie tout en respectant les limites de durabilité de la fourniture de matières premières afin de favoriser la viabilité des chaînes forestières du point de vue économique à travers l'innovation et les transferts de technologies; |
|
87. |
demande de soutenir davantage des produits forestiers diversifiés, en veillant à ce que les différentes demandes en produits forestiers soient équilibrées et évaluées à l'aune du potentiel de fourniture durable et des autres fonctions et services écosystémiques assurés par les forêts; |
|
88. |
se déclare vivement préoccupé par le rythme de la déforestation mondiale — souvent illégale –, en particulier dans les pays en développement; |
|
89. |
soutient les mécanismes qui favorisent le développement mondial de la sylviculture dans le sens d'une utilisation plus durable, et renvoie pour cela tout particulièrement au règlement de l'Union européenne sur le bois (5), qui vise à lutter contre l'exploitation illégale et contre la mise sur le marché de bois illégal provenant d'importations des pays tiers, ainsi qu'au régime d'autorisation relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (FLEGT) (6) et aux accords volontaires de partenariat associés; |
|
90. |
invite la Commission à publier la révision attendue de longue date du fonctionnement et de l'efficacité du règlement de l'Union sur le bois, et souligne qu'un nouveau règlement devrait être proportionné et envisager des moyens de réduire les coûts superflus et les exigences d'établissement de rapports pour les propriétaires de zones boisées et les sylviculteurs européens sans compromettre l'objectif du règlement; |
|
91. |
est d'avis, compte tenu des défis posés par le réchauffement mondial et le changement climatique, que la bonne santé, la diversité biologique et la solidité des écosystèmes et des populations d'espèces sont nécessaires à leur résilience; |
|
92. |
souligne l'importance des sites Natura 2000, sur lesquels des produits et services de grande qualité environnementale et culturelle peuvent être produits grâce à leurs ressources naturelles extraordinaires; |
|
93. |
souligne l'importance d'écosystèmes forestiers sains offrant un habitat pour la faune et la flore, mais souligne que des actes législatifs louables comme la directive Habitats de l'Union européenne affectent les décisions de gestion des terres et doivent être mis en œuvre de manière proportionnée; |
|
94. |
reconnaît le rôle joué par les forêts dans le développement de secteurs connexes et insiste, en ce sens, sur l'importance d'apporter un soutien aux cultivateurs d'arbres mellifères, de façon à aider également le processus de pollinisation; |
|
95. |
estime que certaines problématiques concernent l'industrie forestière à l'échelle mondiale, en particulier l'abattage illégal, et appelle donc la Commission à renforcer le soutien au secteur forestier dans les instances internationales associées; |
|
96. |
observe que la demande de biomasse, et en particulier du bois, est en pleine croissance, et salue dès lors les efforts déployés par la Commission et les États membres en vue de soutenir les pays en développement dans les mesures qu'ils prennent afin d'améliorer leur réglementation et leurs politiques forestières, en particulier dans le cadre de REDD+ (7) (réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts); |
|
97. |
invite la Commission à mettre au point un plan d'action sur la déforestation et la dégradation des forêts afin de répondre aux objectifs fixés dans sa communication sur la déforestation, comme le demande le septième programme d'action pour l'environnement; considère qu'il est important de veiller non seulement à la préservation et à la gestion des forêts existantes mais aussi au reboisement des zones qui ont été déboisées; |
|
98. |
considère également important qu'il soit fait une mention particulière de la nécessité de procéder au reboisement intensif des zones touchées par des incendies de forêt à répétition; |
Mise en œuvre — rapports
|
99. |
rappelle que la mise en œuvre de la politique forestière de l'Union européenne devrait durer plusieurs années et être coordonnée, qu'il convient de tenir compte de l'avis du Parlement et que la stratégie doit être mise en œuvre de manière efficace, cohérente et peu bureaucratique; |
|
100. |
déplore que le processus de mise en œuvre ait partiellement commencé avant que le Parlement n'ait adopté sa position, et considère que cette méthode n'est pas conforme à l'objectif d'une amélioration de la coordination des politiques forestières tel qu'établi par la Commission dans sa stratégie; |
|
101. |
estime que la nouvelle stratégie doit établir des liens entre les stratégies et plans de financement de l'Union européenne et des États membres et renforcer la cohérence au niveau de la planification, du financement et de la mise en œuvre des activités transsectorielles; |
|
102. |
demande une mise en œuvre inclusive, bien structurée et équilibrée de la stratégie; |
|
103. |
estime dès lors que le mandat du comité permanent forestier devrait être renforcé et que celui-ci devrait être doté de davantage de ressources afin que la Commission puisse pleinement s'appuyer sur l'expertise provenant des États membres lors de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie forestière de l'Union au niveau européen; appelle la Commission à consulter suffisamment tôt le comité permanent forestier préalablement à toute initiative ou projet de texte ayant un impact sur la gestion des forêts et la filière bois; |
|
104. |
met l'accent sur le rôle important du groupe de dialogue civil sur la sylviculture et le liège et d'autres parties prenantes concernées et appelle à leur participation adéquate à la mise en œuvre de la stratégie; |
|
105. |
estime que le caractère transversal des problématiques forestières implique de la part des différents services de la Commission une coopération interne pour l'examen de toute mesure susceptible d'avoir une incidence sur les spécificités de la gestion forestière durable et des industries associées; invite donc la DG Environnement, la DG Action pour le climat, la DG Agriculture, la DG Énergie et la DG Recherche et Innovation ainsi que les autres DG concernées à travailler en concertation et de manière stratégique à assurer la mise en œuvre efficace de la stratégie par le biais d'une coordination et d'une communication renforcées; |
|
106. |
estime qu'eu égard à la fixation de priorités en matière de croissance, d'emploi et d'investissement par la Commission, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la nouvelle stratégie forestière de l'Union, il convient de classer comme prioritaires la promotion de la compétitivité et de la durabilité du secteur forestier, le soutien aux zones rurales et urbaines, le développement de la base de connaissances, la protection des forêts et la préservation de leurs écosystèmes, l'amélioration de la coordination et de la communication ainsi que l'accroissement de l'utilisation durable du bois et des produits forestiers non ligneux; |
|
107. |
invite la Commission à compléter la stratégie par un plan d'action solide contenant des mesures spécifiques et à rendre compte au Parlement chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures concrètes de la stratégie; |
|
108. |
appelle à la convocation d'une commission élargie AGRI-ENVI-ITRE pour permettre une discussion équilibrée sur la progression de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie forestière de l'Union; |
o
o o
|
109. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 413.
(2) Forest Europe, conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, commission de négociation interétatique pour la conclusion d'un accord juridiquement contraignant sur les forêts en Europe: http://www.foresteurope.org/
(3) Voir: http://www.forestnegotiations.org/
(4) Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «'Bien vivre, dans les limites de notre planète»'.
(5) Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
(6) Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (FLEGT = application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux).
(7) Programme pour la réduction des émissions résultant du déboisement et de la dégradation des forêts: http://unfccc.int/methods/redd/items/7377.php
Mercredi 29 avril 2015
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/27 |
P8_TA(2015)0173
Parquet européen
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534 — 2013/0255(APP))
(2016/C 346/04)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (COM(2013)0534), |
|
— |
vu sa résolution du 12 mars 2014 sur la proposition de règlement du Conseil portant création du Parquet européen (1), |
|
— |
vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (COM(2012)0363), |
|
— |
vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à entreprendre (2), |
|
— |
vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) (COM(2013)0535), |
|
— |
vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 2, 6 et 7 du traité sur l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
|
— |
vu la résolution du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, |
|
— |
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 86, 218, 263, 265, 267, 268 et 340, |
|
— |
vu l'article 99, paragraphe 3, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport intérimaire de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des affaires juridiques (A8-0055/2015), |
|
A. |
considérant que les données collectées et analysées par la Commission ont conduit à l'identification de cas de fraude présumée portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union représentent un montant annuel de près de 500 millions d'euros, bien qu'il existe de bonnes raisons de croire qu'environ 3 milliards d'euros pourraient être menacés par la fraude chaque année; |
|
B. |
considérant que le taux de mise en examen est faible — environ 31 % au cours des huit années de la période 2006-2013 — par rapport au nombre de recommandations judiciaires adressées aux États membres par l'OLAF; considérant que l'un des objectifs du Parquet européen est de combler cet écart; |
|
C. |
considérant que certains États membres peuvent se montrer moins actifs dans le domaine de la détection et de la répression des fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ce qui lèse les intérêts des contribuables de tous les États membres qui participent au budget de l'Union; |
|
D. |
considérant que dans sa résolution du 12 mars 2014, le Parlement a demandé au Conseil de l'associer étroitement à ses travaux législatifs à travers un échange continu d'informations et une consultation de tous les instants; |
|
E. |
considérant que les différences qui peuvent exister entre les compétences judiciaires, les traditions juridiques et les systèmes répressifs et judiciaires dans les États membres ne devraient pas entraver ni compromettre la lutte contre la fraude et la criminalité portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union; |
|
F. |
considérant que le terrorisme est également financé par la criminalité organisée, puisque les groupes criminels collectent des fonds en usant de la fraude; |
|
G. |
considérant que l'article 86 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne permet d'étendre les attributions du Parquet européen à la criminalité grave ayant une dimension transfrontière; considérant que cette possibilité peut être prise en compte par le Conseil une fois le Parquet européen établi et opérationnel; |
|
1. |
réaffirme être tout à fait résolu à réaliser les priorités nécessaires à l'établissement du Parquet européen, ainsi qu'à fixer les principes et les conditions qui détermineront son approbation; |
|
2. |
confirme la teneur de son précédent rapport intérimaire, adopté dans sa résolution du 12 mars 2014, et entend le compléter et le mettre à jour à la lumière des dernières évolutions dans le débat au sein du Conseil; |
|
3. |
demande au Conseil d'assurer la transparence et la légitimité démocratique en tenant le Parlement pleinement informé et en le consultant régulièrement; exhorte le Conseil à tenir dûment compte de ses avis, en tant que préalable à son consentement à l'adoption du règlement relatif au Parquet européen; |
|
4. |
rappelle que le Parquet européen devrait avoir pour mission de combattre les infractions liées aux fraudes portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union; rappelle à cet égard que les infractions pénales concernées doivent être définies dans la proposition de directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (dite «directive PIF»); appelle le Conseil, tout en reconnaissant les progrès réalisés par les colégislateurs dans les négociations relatives à l'adoption de la directive PIF, à redoubler d'efforts pour trouver un accord sur cette directive en tant que condition préalable à la création du Parquet européen; |
|
5. |
considère qu'il y a lieu d'appliquer une approche innovante pour mener des enquêtes et engager des poursuites relatives à des infractions commises contre les intérêts financiers de l'Union, ainsi que pour traduire en justice les auteurs de ces infractions, ce afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude, d'accroître le taux de recouvrement et de renforcer la confiance des contribuables dans les institutions de l'Union; |
|
6. |
considère qu'il est essentiel de veiller à l'établissement d'un Parquet européen unique, fort et indépendant qui soit en mesure de rechercher, de poursuivre et de renvoyer en jugement les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, et estime que toute option plus faible serait aux dépens du budget de l'Union; |
Un Parquet européen indépendant
|
7. |
souligne que la structure du Parquet européen devrait être totalement indépendante des gouvernements nationaux et des institutions européennes et protégée de toute influence ou pression politiques; invite donc à faire preuve d'ouverture, d'objectivité et de transparence dans les procédures de sélection et de nomination du procureur général européen, de ses adjoints, des procureurs européens et des procureurs européens délégués; est d'avis que, pour prévenir tout conflit d'intérêts, le poste de procureur européen doit être un poste à temps plein; |
|
8. |
souligne qu'il importe que le Parlement soit associé aux procédures de nomination des procureurs européens et suggère l'organisation d'un concours général ouvert aux candidats ayant l'intégrité, les qualifications, l'expérience et les compétences requises; est d'avis que les procureurs européens pourraient être nommés par le Conseil et le Parlement d'un commun accord sur la base d'une présélection établie par la Commission européenne, à la suite d'une évaluation par un groupe d'experts indépendant composé de juges, de procureurs et de juristes dont les compétences sont reconnues; le procureur général européen, devrait être nommé conformément à la même procédure à l'issue d'une audition par le Parlement; |
|
9. |
estime que les membres du collège doivent être destitués à la suite d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, sur demande du Conseil, de la Commission, du Parlement et/ou du procureur général européen; |
|
10. |
souligne que les États membres doivent associer les instances judiciaires autonomes nationales aux procédures de nomination des procureurs européens délégués conformément à la législation et aux pratiques nationales; |
|
11. |
se félicite de la disposition figurant dans le texte du Conseil relative à l'établissement d'un rapport annuel à l'attention des institutions de l'Union en vue d'assurer une évaluation continue des activités menées par ce nouvel organe; invite le Conseil à veiller à ce que le rapport annuel contienne, entre autres, des informations sur la volonté des autorités nationales de coopérer avec le Parquet européen; |
Une répartition claire des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales
|
12. |
considère que les règles régissant la répartition des compétences entre le Parquet européen et les autorités nationales devraient être clairement définies afin d'éviter toute incertitude ou tout risque d'interprétation erronée dans la phase opérationnelle; estime que le Parquet européen devrait être compétent pour ouvrir des enquêtes et engager des poursuites contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union conformément à la directive relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal; le Parquet européen devrait décider s'il est compétent en premier lieu et avant que les autorités nationales n'ouvrent une enquête propre afin d'éviter les enquêtes parallèles, qui nuisent à l'efficacité; |
|
13. |
affirme que les autorités nationales menant des enquêtes sur des infractions susceptibles de relever de la compétence du Parquet européen devraient être tenues d'informer ce dernier à propos de ces enquêtes; réaffirme que le Parquet européen devrait avoir le droit de reprendre ces enquêtes lorsqu'il le juge approprié, afin d'assurer son indépendance et son efficacité; |
|
14. |
ajoute que les compétences du Parquet européen devraient s'étendre aux infractions autres que celles portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, uniquement si toutes les conditions suivantes sont remplies:
estime en outre qu'en cas de désaccord entre le Parquet européen et les autorités répressives nationales à propos de l'exercice des compétences, il devrait revenir au Parquet européen de décider, au niveau central, qui mènera les enquêtes et engagera les poursuites; estime par ailleurs que la détermination de compétence en vertu de ces critères devra toujours pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel; |
Une structure rationnelle pour une gestion efficace des affaires
|
15. |
déplore que les États membres examinent la possibilité d'une structure collégiale, au lieu de la structure hiérarchique initialement proposée par la Commission; considère, à cet égard, que la décision d'engager des poursuites, le choix de la juridiction compétente, la décision de réattribuer une affaire ou de la classer sans suite et la décision relative à une transaction devraient être prises au niveau central par les chambres; |
|
16. |
souligne que les chambres devraient jouer un rôle de premier plan dans le cadre des enquêtes et des poursuites, et ne devraient pas limiter leurs activités aux simples fonctions de coordination, mais plutôt superviser les travaux des procureurs européens délégués sur le terrain; |
|
17. |
est préoccupé par le lien automatique qui est établi entre tout procureur européen du Bureau central et les recours introduits dans son État membre, puisqu'une telle situation pourrait entraîner des défaillances manifestes en termes d'indépendance des procureurs et de répartition équitable des affaires; |
|
18. |
demande, dès lors, de veiller à une organisation rationnelle du volume de travail du Parquet au niveau central; observe à cet égard que le système d'attribution des affaires entre les chambres devrait être soumis à des critères prédéterminés et objectifs; suggère également d'envisager, à un stade ultérieur, une spécialisation des chambres; |
|
19. |
est convaincu que le niveau indispensable de connaissance, d'expérience et d'expertise des systèmes judiciaires nationaux sera également garanti par le personnel du Bureau central du Parquet européen; |
Mesures d'enquête et admissibilité des preuves
|
20. |
invite le législateur à veiller à l'harmonisation des procédures devant être engagées par le Parquet européen en vue d'obtenir l'autorisation de mettre en œuvre des mesures d'enquête dans les affaires transfrontalières, dans le respect de la législation de l'État membre où la mesure en question est exécutée; rappelle que les colégislateurs ont défini les critères sur la base desquels les États membres sont autorisés à demander des mesures d'enquête en vertu du principe de reconnaissance mutuelle prévu dans la directive 2014/41/UE concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale; considère que les mêmes critères devraient s'appliquer en ce qui concerne les mesures d'enquête à autoriser par le Parquet européen, notamment en ce qui concerne les motifs de refus; |
|
21. |
prie le Conseil de veiller à l'admissibilité des preuves recueillies par le Parquet européen, dans le respect intégral de la législation européenne et nationale pertinente, sur tout le territoire de l'Union, puisqu'il s'agit d'une condition indispensable pour garantir l'efficacité des poursuites, conformément à l'article 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention européenne des droits de l'homme; |
|
22. |
confirme la nécessité pour le Parquet européen de chercher tous les éléments de preuve pertinents, aussi bien à charge qu'à décharge; affirme en outre qu'il convient d'accorder aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre d'une enquête menée par le Parquet européen certains droits en matière de preuves, et notamment:
|
|
23. |
estime, compte tenu des multiples juridictions possibles dans le cadre des infractions ayant une dimension transfrontalière relevant de la compétence du Parquet européen, qu'il est essentiel de veiller à ce que les procureurs européens, les procureurs européens délégués et les autorités nationales chargées des poursuites respectent pleinement le principe ne bis in idem en ce qui concerne les poursuites liées à des infractions relevant de la compétence du Parquet européen; |
Accès au contrôle juridictionnel
|
24. |
affirme que le droit à un contrôle juridictionnel devrait être garanti à tout moment au regard des activités du Parquet européen et reconnaît en outre qu'il importe que ce dernier puisse mener ses activités de manière efficace; estime donc que toute décision prise par le Parquet européen doit être susceptible de contrôle juridictionnel devant la juridiction compétente; estime que les décisions prises par les chambres, telles que le choix de la juridiction compétente pour les poursuites, le classement sans suite d'une affaire ou sa réattribution, ou une transaction devraient pouvoir faire l'objet d'un contrôle juridictionnel devant les juridictions de l'Union; |
|
25. |
considère qu'aux fins du contrôle juridictionnel de toutes les mesures procédurales qu'il adopte dans le cadre de ses fonctions de poursuites, le Parquet européen devrait être considéré comme une autorité nationale devant les juridictions compétentes des États membres; |
Protection juridictionnelle cohérente des suspects et des personnes poursuivies
|
26. |
rappelle que le nouveau Parquet devrait mener ses activités dans le plein respect des droits des suspects et des personnes poursuivies tels que consacrés à l'article 6 du traité UE, à l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et dans les mesures législatives déjà adoptées au niveau de l'Union concernant les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales et la protection des données personnelles; |
|
27. |
affirme que la future directive relative à l'aide juridique devrait s'appliquer de la même manière à l'ensemble des suspects et des personnes poursuivies visés par une enquête ou poursuivis par le Parquet européen; appelle les États membres, en l'absence de directive européenne, à garantir un accès effectif à l'aide juridique conformément aux droits nationaux applicables; |
|
28. |
souligne que tous les suspects et toutes les personnes poursuivies visés par une enquête ou poursuivis par le Parquet européen ont le droit à la protection de leurs données personnelles; ajoute à cet égard que le traitement des données à caractère personnel réalisé par le Parquet européen est soumis au règlement (CE) no 45/2001; souligne que les dispositions particulières relatives à la protection des données contenues dans le règlement du Conseil portant création du Parquet européen devraient seulement compléter et préciser le règlement (CE) no 45/2001 et uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire; |
|
29. |
réaffirme sa ferme volonté de créer le Parquet européen et de réformer Eurojust, comme le prévoit la Commission européenne dans ses deux propositions; invite la Commission à revoir ses estimations de l'impact budgétaire de la structure collégiale; demande une clarification des relations entre Eurojust, le Parquet européen et l'OLAF afin de différencier leurs rôles respectifs dans la protection des intérêts financiers de l'Union; appelle le Conseil et la Commission à étudier la possibilité d'une approche davantage intégrée de ces agences afin de renforcer encore l'efficacité des enquêtes; |
o
o o
|
30. |
exhorte le Conseil à respecter ces recommandations et souligne que les conditions susmentionnées sont essentielles pour que le Parlement donne son accord au projet de règlement du Conseil; |
|
31. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0234.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/32 |
P8_TA(2015)0174
Stratégie en matière d'alcool
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la stratégie en matière d'alcool (2015/2543(RSP))
(2016/C 346/05)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la question à la Commission sur la stratégie en matière d'alcool (O-000008/2015 — B8-0108/2015), |
|
— |
vu le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement du troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (1), |
|
— |
vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la réduction des inégalités de santé dans l'Union européenne (2), |
|
— |
vu l'article 168 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que l'Union complète uniquement l'action menée par les États membres sur les questions de santé publique, |
|
— |
vu le rapport annuel 2011 de la plateforme d'action européenne sur l'alimentation, l'activité physique et la santé, |
|
— |
vu sa résolution du 5 septembre 2007 sur une stratégie de l'Union européenne pour aider les États membres à réduire les dommages liés à l'alcool (3), |
|
— |
vu les conclusions de la réunion des 1er et 2 décembre 2011 du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» intitulées «Remédier aux disparités en matière de santé au sein de l'UE au moyen d'une action concertée visant à promouvoir des modes de vie sains», |
|
— |
vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement, |
|
A. |
considérant que l'abus d'alcool est la deuxième cause de maladie liée au mode de vie dans certains États membres et que l'alcoolisme est un facteur de risque dans plus de 60 maladies chroniques, notamment les maladies alcooliques du foie, la pancréatite chronique alcoolique et presque toutes les autres maladies digestives, le cancer, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les troubles causés par l'alcoolisation fœtale et les troubles neuropsychiatriques tels que la dépendance à l'alcool; |
|
B. |
considérant que les autorités compétentes des États membres sont les mieux préparées à élaborer des politiques taillées sur mesure afin de prévenir l'abus d'alcool; |
|
C. |
considérant qu'il existe une relation de causalité entre l'abus d'alcool et toute une série de troubles mentaux et comportementaux, d'autres maladies non transmissibles ainsi que les traumatismes; |
|
D. |
considérant que les coûts sociaux directs et indirects imputables à l'abus d'alcool ont été estimés à 155,8 milliards d'euros en Europe pour 2010, dont la part la plus importante (82,9 milliards d'euros) ne concerne pas le système de santé; |
|
E. |
considérant que l'abus d'alcool cause 3,3 millions de décès par an dans le monde, soit 5,9 % des décès; considérant qu'environ 25 % des décès des 20-39 ans sont imputables à l'abus d'alcool; considérant que ces décès font souvent suite à des accidents, des actes de violence ou des maladies du foie; |
|
F. |
considérant que 5 à 9 millions d'enfants vivent dans un environnement familial soumis aux effets nocifs de la consommation d'alcool; |
|
G. |
considérant que la consommation d'alcool peut entraîner des conséquences variables, dans la mesure où celles-ci dépendent largement du mode de consommation, notamment du produit consommé et de la manière de le consommer; considérant que les modes de consommation et les tendances en la matière varient fortement d'une région de l'Union européenne à l'autre, avec des spécificités sous-régionales importantes en ce qui concerne la consommation et les effets sur la santé résultant d'une consommation d'alcool nocive; considérant que les différences sociales, culturelles, géographiques et économiques que présentent les États membres de l'Union conduisent à distinguer différents modes de consommation et tendances; |
|
H. |
considérant que la mise en place d'une politique visant à réduire les dommages liés à l'alcool et encourageant une consommation d'alcool responsable, adaptée aux spécificités locales et régionales, contribuerait à réduire les dépenses sanitaires et sociales liées aux effets directs et indirects de l'alcoolisme, tels que l'assuétude, l'apparition de maladies chroniques, la mortalité et les violences domestiques — ainsi qu'à la réduction des coûts liés à l'alcool; considérant qu'une politique de réduction des dommages liés à l'alcool devrait non seulement associer le secteur de la santé, mais également les acteurs concernés, notamment les associations venant en aide aux personnes souffrant d'alcoolisme, et devrait être pleinement conforme au principe de subsidiarité et au principe de l'intégration des questions de santé dans toutes les politiques, tout en assurant une amélioration significative de la santé publique; |
|
I. |
considérant que la consommation abusive et nocive d'alcool peut conduire à l'alcoolisme, un phénomène contre lequel il convient de lutter en accordant davantage d'attention et de soutien dans le cadre des systèmes de soins de santé des États membres; |
|
J. |
considérant qu'il convient de souligner que certains groupes risquent davantage d'adopter de mauvais comportements eu égard à la consommation d'alcool, en particulier les jeunes, que les décès liés à l'alcool représentent environ 25 % des décès chez les jeunes hommes âgés entre 15 et 29 ans et un décès sur 10 chez les jeunes femmes; considérant que la consommation excessive d'alcool chez les jeunes est une pratique de plus en plus répandue dans les États membres en revêtant des formes de consommation particulières, comme le «binge-drinking»(ou «biture expresse»); considérant qu'en moyenne, le foie des hommes transforme l'alcool beaucoup plus rapidement que le foie des femmes, ce qui signifie que ces dernières risquent de sombrer dans l'alcoolisme chronique beaucoup plus vite et avec une quantité d'alcool moindre; |
|
K. |
considérant que les dommages liés à l'alcool sont associés à divers facteurs, tels que le niveau socioéconomique, le contexte culturel et les modes de consommation, ainsi que l'influence des parents et des pairs, mais aussi l'étendue et le niveau de mise en œuvre et d'application de politiques appropriées en la matière; considérant que les vulnérabilités au sein d'une même société peuvent parfois être aussi différentes qu'entre des sociétés différentes; |
|
L. |
considérant que, dans certaines régions d'Europe, la production artisanale d'alcool est le pilier du tourisme local; |
|
M. |
considérant l'impact de la publicité et du marketing sur le niveau de consommation d'alcool, particulièrement chez les jeunes; considérant que la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE sur les services de médias audiovisuels est fondamentale pour une réelle protection du développement physique, mental et moral des enfants et des mineurs; considérant qu'il existe une corrélation entre la consommation précoce d'alcool et la probabilité de rencontrer des problèmes liés à l'alcool à l'âge adulte; considérant que l'éducation, l'information et les campagnes de prévention sont les moyens les plus efficaces pour prévenir la consommation excessive d'alcool chez les jeunes; considérant que la Commission européenne doit élaborer sans délai une nouvelle stratégie européenne destinée à réduire la consommation excessive d'alcool et à informer les citoyens, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux effets néfastes de la consommation d'alcool sur la santé; |
|
N. |
considérant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne qu'il faut approfondir les connaissances et les actions sur des sujets tels que le lien entre la consommation d'alcool et le fœtus, l'alcool et les personnes âgées, les effets sur les personnes socialement défavorisées et l'exclusion sociale liée à l'abus d'alcool; |
|
O. |
considérant que les différents facteurs sociaux, culturels, géographiques et économiques au sein de l'Union européenne créent des habitudes et tendances de consommation d'alcool qui varient même au niveau local, entraînant ainsi des comportements divergents en la matière; |
|
P. |
considérant qu'il convient d'établir une distinction claire entre une consommation d'alcool responsable et une consommation d'alcool nocive; considérant qu'une consommation d'alcool responsable est compatible avec un mode de vie sain; |
|
Q. |
considérant que la conduite en état d'ivresse est à l'origine de près d'un accident de la route sur quatre, et que plus de 5 200 personnes meurent chaque année des suites d'accidents de la route liés à l'alcool dans l'Union européenne; considérant que l'alcool au volant demeure la deuxième cause de mortalité sur les routes de l'Union; |
|
R. |
considérant que de nombreux citoyens de l'Union européenne, en particulier les jeunes, ne sont pas suffisamment informés des dangers que comportent l'abus d'alcool et l'assuétude pour la santé, et que la prévention et la sensibilisation sont donc essentielles dans la nouvelle stratégie européenne en matière d'alcool; considérant que la détection précoce et les conseils aux personnes ayant adopté un mode de consommation d'alcool néfaste ont démontré leur efficacité; considérant que d'énormes progrès peuvent être faits pour protéger les mineurs contre la publicité sur l'alcool; |
|
S. |
considérant que le règlement (CE) no 178/2002 du 28 janvier 2002 (4) dispose qu'une denrée alimentaire est dite dangereuse si elle est considérée comme préjudiciable à la santé; |
|
T. |
considérant que les différentes classes d'âge présentent des habitudes de consommation différentes, qui n'ont pas été étudiées de la même manière jusqu'à présent; |
|
U. |
considérant que le règlement (UE) no 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (5) exclut les boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume de deux de ses dispositions, à savoir celles relatives à l'obligation de fournir la liste des ingrédients et à l'étiquetage nutritionnel; considérant que la nature des risques liés à l'alcool exige pourtant un niveau élevé d'information sur les boissons alcoolisés; |
|
V. |
considérant qu'en vertu du règlement (UE) no 1169/2011, la Commission était tenue de présenter, en décembre 2014 au plus tard, un rapport visant à déterminer si les boissons alcoolisées devraient à l'avenir être soumises aux exigences applicables en matière d'informations sur la valeur énergétique et les raisons justifiant d'éventuelles exemptions, ainsi que, s'il y avait lieu, une proposition législative définissant les règles applicables à la liste des ingrédients ou à l'obligation de fournir une déclaration nutritionnelle pour ces produits; |
|
W. |
considérant que la stratégie de l'Union en matière d'alcool a contribué à aider les États membres à réduire les dommages liés à l'abus d'alcool, et en particulier par l'échange de bonnes pratiques, dans des domaines tels que la protection des jeunes, la réduction des accidents de la route liés à l'abus d'alcool et les opérations de sensibilisation à la consommation d'alcool, à élaborer une base de données commune et à mettre en place un suivi au niveau de l'Union, ainsi qu'à améliorer la coordination entre la Commission et les États membres, qui a finalement abouti à l'élaboration du «Action Plan on Youth Drinking and Heavy Episodic Drinking» (plan d'action sur la consommation d'alcool chez les jeunes et la consommation ponctuelle immodérée d'alcool) (2014-2016) par le comité de politique et d'action nationales en matière d'alcool (CNAPA); |
|
X. |
considérant que la participation d'un large éventail de parties prenantes au sein du forum européen «Alcool et santé» (EAHF) et au-delà a favorisé l'élaboration de mesures tangibles et mesurables visant à réduire, dans toute l'Union européenne, les dommages liés à l'abus d'alcool au niveau local; |
|
Y. |
considérant que le troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) encourage le recours à des bonnes pratiques reconnues dans le domaine des mesures de prévention rentables axées sur les principaux facteurs de risque, notamment l'abus d'alcool; |
|
Z. |
considérant que l'évaluation externe de la stratégie, réalisée en 2012, a confirmé la pertinence et l'utilité de l'approche de la stratégie actuelle et de ses thèmes prioritaires; |
|
1. |
relève que le 22 octobre 2013, lors de la réunion du comité de politique et d'action nationales en matière d'alcool (CNAPA), la Commission a annoncé son intention d'œuvrer en étroite coopération avec les États membres en vue de mettre au point un plan d'action européen visant à réduire les dommages liés à l'alcool; prend acte de l'adoption, en septembre 2014, d'un plan d'action axé sur la consommation d'alcool chez les jeunes et la consommation ponctuelle immodérée d'alcool («binge drinking») (2014-2016), et appelle la Commission à étudier attentivement sa mise en œuvre par les États membres; |
|
2. |
demande à la Commission de fournir des conseils en matière de lutte contre les dommages liés à l'alcool et de continuer de soutenir les autorités compétentes dans les États membres où cela apporte une plus-value, tout en respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité; |
|
3. |
souligne que la réduction des problèmes de santé et de sécurité et des problèmes socioéconomiques imputables à l'alcool nécessiterait d'agir sur le degré, le mode et le contexte de la consommation d'alcool, ainsi que sur les déterminants sociaux plus larges associés de la santé, par le biais de l'éducation, et de campagnes d'information; |
|
4. |
invite la Commission à commencer immédiatement à travailler à la nouvelle stratégie de l'Union en matière d'alcool (2016-2022) avec les mêmes objectifs, en mettant à jour le cadre règlementaire afin d'aider les gouvernements nationaux à s'occuper des dommages liés à l'alcool, de favoriser le suivi et la collecte de données fiables, d'encourager la prévention, la promotion de la santé et l'éducation, le diagnostic précoce, l'amélioration de l'accès aux traitements et l'apport d'une aide constante aux personnes concernées et à leurs familles (y compris au moyen de programmes d'assistance psychologique), de réduire les accidents de la route provoqués par l'alcool au volant et de mieux faire la distinction entre les modes de consommation, les comportements et attitudes en matière de consommation d'alcool; |
|
5. |
considère qu'il conviendrait de renouveler la stratégie actuelle de l'Union visant à soutenir les États membres dans la lutte contre les dommages liés à l'alcool en conservant essentiellement sa forme actuelle et en gardant les mêmes objectifs, à savoir lutter contre les dommages liés à l'alcool au niveau des États membres, l'orientation vers l'action et la promotion d'une approche multilatérale participative; |
|
6. |
prie instamment la Commission d'élaborer sans attendre le rapport dont le règlement (UE) no 1169/2011 prévoyait la présentation en décembre 2014 au plus tard, visant à déterminer si les boissons alcoolisées ne devraient pas à l'avenir être soumises aux exigences applicables en matière d'informations sur les ingrédients et le contenu nutritionnel, tout en considérant en particulier les conséquences pour les PME et la production artisanale; |
|
7. |
prie instamment la Commission de demander sans attendre à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de réévaluer l'utilisation de l'acétaldéhyde en tant que substance aromatisante dans les boissons alcoolisées et non alcoolisées; |
|
8. |
souligne la nécessité de mentionner clairement et dès que possible au moins la teneur calorique des boissons alcoolisées sur les étiquettes; invite la Commission à présenter la proposition législative en la matière au plus tard en 2016; |
|
9. |
invite la Commission à entamer immédiatement les travaux sur une nouvelle stratégie de l'Union en matière d'alcool pour la période allant de 2016 à 2022, en tenant compte du plan d'action du CNAPA et des conclusions de l'évaluation indépendante de la stratégie de l'Union contre les dommages liés à l'alcool, afin de pérenniser les résultats atteints à ce jour, et à continuer de soutenir les gouvernements nationaux à prévenir les dommages liés à l'alcool sur le long terme; |
|
10. |
souligne que la complémentarité entre la législation et les codes de conduite relatifs à la protection des mineurs contre les conséquences néfastes de l'abus d'alcool est indispensable à une réelle protection des mineurs; invite les États membres à appliquer strictement la législation nationale en vigueur concernant les limites d'âge afférentes à la consommation d'alcool et à évaluer la nécessité de nouvelles exigences juridiquement contraignantes, indispensables à une réelle protection des mineurs; |
|
11. |
invite les États membres à mettre en œuvre des stratégies et des traitements qui réduisent l'alcoolisme, dans le cadre de leurs systèmes de soins de santé; |
|
12. |
demande aux États membres d'intensifier leurs efforts d'éducation du grand public, en particulier des jeunes et des femmes enceintes, sur les méfaits de la consommation d'alcool, et, en cas de besoin, d'adopter des lois en conséquence; |
|
13. |
reconnaît les différences entre les modes de consommation entre les États membres et les aspects culturels d'une consommation d'alcool responsable; |
|
14. |
souligne la nécessité de mettre en place à l'échelle de l'Union une campagne d'information mettant en garde les femmes enceintes contre la consommation d'alcool, et invite la Commission à examiner l'effet de l'étiquetage sur cette question et à présenter une proposition législative en la matière au plus tard en 2016; |
|
15. |
exhorte les États membres, qui sont les premiers responsables dans ce domaine, d'élaborer, de mettre en œuvre et d'évaluer les politiques de santé publique visant à réduire la consommation nocive d'alcool, à mettre en place des règlementations strictes concernant la commercialisation des boissons alcoolisées, en particulier auprès des mineurs; |
|
16. |
invite la Commission à envisager la mise en place d'un étiquetage à l'échelle de l'Union qui avertirait les consommateurs sur les dangers de l'alcool au volant; |
|
17. |
incite la Commission à évaluer et, le cas échéant, à réformer le rôle et le fonctionnement du forum européen «Alcool et santé», pour que sa composition soit réellement et équitablement représentative de toutes les parties prenantes concernées avec une représentation adéquate des opérateurs économiques et des ONG, et à s'efforcer d'encourager et de soutenir leur participation au forum ainsi que leur engagement à élaborer des actions tangibles et efficaces en vue de réduire les dommages liés à l'alcool et soutenir des actions ciblées qui soient pertinentes aux niveaux national, régional et local; |
|
18. |
invite la Commission à apporter des améliorations opérationnelles supplémentaires à la mise en œuvre de la stratégie actuelle de l'Union, par exemple en étendant le forum européen «Alcool et santé» (EAHF) pour inclure toutes les parties prenantes concernées, en renforçant l'interaction avec le CNAPA au niveau de l'Union, en promouvant les bonnes pratiques pour la conception, le suivi et l'évaluation des engagements, en collectant de meilleurs indicateurs dressant un tableau objectif, à jour et réaliste des modes de consommation et des dommages liés à l'alcool, et en soutenant des actions ciblées qui soient pertinentes au niveau local et qui respectent pleinement les dispositions fondamentales du traité sur l'Union européenne; |
|
19. |
souligne que la nouvelle stratégie de l'Union en matière d'alcool ne devrait pas fixer de nouveaux objectifs, mais devrait plutôt soutenir ceux déjà approuvés dans le plan d'action européen visant à réduire la consommation nocive d'alcool 2012-2020 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS); |
|
20. |
note qu'une nouvelle stratégie de l'Union peut être très utile en offrant aux États membres des moyens d'actions fondés sur des données concrètes, étant donné qu'il incombe aux autorités nationales, régionales et locales d'utiliser l'approche la mieux adaptée pour réduire les dommages liés à l'alcool; prie instamment la Commission de maintenir son rôle précieux dans la promotion d'une recherche de qualité et le partage de données concrètes; |
|
21. |
réaffirme l'importance d'un engagement politique fort de la Commission européenne, du Conseil et des États membres de l'Union afin de mettre tout en œuvre pour prévenir les dommages liés à l'alcool et apporter une réponse politique adéquate et fondée sur des éléments probants, qui traduise la gravité et la variété des conséquences des dommages liés à l'alcool sur les plans sanitaire et socioéconomique ainsi que leur interaction avec d'autres facteurs de risque; |
|
22. |
rappelle l'importance d'objectifs mesurables et rigoureux ainsi que de mécanismes pluriannuels appropriés pour le suivi des progrès d'une mise en œuvre efficace de la stratégie dans les États membres; souligne la nécessité d'assurer un suivi de la mise en œuvre de la législation en matière d'alcool au niveau national; |
|
23. |
engage la Commission et les États membres à promouvoir activement l'amélioration des indicateurs, la collecte de données fiables, leur comparabilité et leur analyse en temps opportun, dans le domaine de la consommation d'alcool et ses conséquences sanitaires et sociales, à affecter les ressources nécessaires pour réduire la charge liée à l'abus d'alcool et les coûts directs et indirects pour la société, des dommages liés à l'alcool, mais aussi à favoriser la bonne intégration des données en la matière dans les politiques nationales et de l'Union dans le domaine de l'alcool à partir d'éléments communs; |
|
24. |
prie instamment les États membres d'accroître leurs efforts visant à protéger les jeunes contre les dommages liés à l'alcool, notamment en appliquant à la lettre la législation nationale sur l'âge limite, et en garantissant une publicité responsable; |
|
25. |
demande à la Commission et aux États membres d'investir dans l'éducation, afin de souligner les effets sur la santé et la société d'une consommation d'alcool nocive tout en encourageant la modération et la responsabilité dans la consommation de boissons alcoolisées; |
|
26. |
rappelle que les fonds publics ne devraient pas être utilisés pour promouvoir la consommation d'alcool, à l'exception des mesures de promotion couvertes par le règlement (UE) no 1144/2014 et le règlement (UE) no 1308/2013; |
|
27. |
souligne la nécessité pour les États membres de limiter la vente d'alcool chez les jeunes n'ayant pas l'âge requis, en appliquant des mesures de contrôle régulières en particulier à proximité des écoles; appelle la Commission à traiter de manière adéquate la question de la vente d'alcool transfrontalière sur internet; demande à la Commission et aux États membres d'organiser des campagnes de sensibilisation aux dangers de la «biture expresse» en particulier à l'intention des mineurs, et d'intensifier les efforts déployés en vue de réduire le nombre d'accidents de la route liés à l'alcool au volant; |
|
28. |
prie instamment la Commission de suivre de près la mise en œuvre de la directive 2010/13/UE relative aux services de médias audiovisuels et d'envisager de réviser les dispositions portant sur la publicité pour l'alcool adressée aux jeunes et au parrainage en faveur de l'alcool de façon à réduire l'exposition des jeunes à la publicité pour les boissons alcoolisées; |
|
29. |
incite les États membres et la Commission, ainsi que toutes les autres parties prenantes concernées, à revoir et à intensifier les campagnes de sensibilisation relatives à l'abus d'alcool, en particulier chez les femmes enceintes, et aux effets de l'alcool sur le fœtus; |
|
30. |
demande à la Commission et aux États membres de réfléchir à des mesures concrètes pour limiter la consommation d'alcool, notamment chez les mineurs et les individus souffrant de troubles sévères, de maladies chroniques ou de fortes dépendances liés à la consommation d'alcool; |
|
31. |
prie la Commission de conserver dans sa stratégie le soutien financier à des projets efficaces et scientifiques de lutte contre les dommages liés à l'abus d'alcool et l'étude des causes sous-jacentes de l'abus d'alcool dans le cadre du nouveau programme dans le domaine de la santé et du programme «Horizon 2020»; demande à la Commission de s'assurer que son soutien financier est uniquement consacré à des projets fondés sur une solide méthodologie scientifique et menés avec objectivité; |
|
32. |
appelle les États membres, la Commission et les autres parties prenantes à diversifier les campagnes d'information concernant les dangers de la consommation d'alcool pour les différentes classes d'âge, ainsi que leur conduite et les effets de l'alcool au volant, à les adapter aux différentes classes d'âge et à les renforcer; |
|
33. |
invite les États membres à mettre en place des mesures ciblées de sensibilisation et d'éducation en faveur des jeunes dans le cadre de leurs stratégies de prévention des abus et de diffusion des bonnes pratiques; |
|
34. |
demande aux États membres de s'inspirer de la stratégie en matière d'alcool de l'OMS et d'améliorer la détection précoce de l'abus d'alcool dans les soins de santé primaires, en encourageant le dépistage et en fournissant des services d'assistance adéquats pour le traitement des troubles liés à l'alcool et des maladies chroniques associées; |
|
35. |
souligne que les réglementations mises en place par les autorités respectives dans les États membres doivent permettre de sensibiliser aux conséquences de l'abus d'alcool, de fournir des traitements accessibles à un coût abordable aux personnes souffrant de troubles liés à la consommation excessive d'alcool et de mettre en œuvre des programmes de dépistage et d'interventions brèves en cas de consommation d'alcool nocive et dangereuse; demande aux États membres de coopérer afin de trouver des solutions pour accompagner les personnes souffrant de troubles, de maladies chroniques ou de fortes dépendances liés à la consommation d'alcool, de les aider à se soigner et mettre fin à leur situation de dépendance; |
|
36. |
déplore la réduction des principaux services chargés de l'alcoolisme dans certains États membres; |
|
37. |
exhorte les États membres et toutes les parties prenantes concernées à poursuivre, à intensifier ou à élaborer des politiques et des mesures en faveur de modes de vie sains, dont la promotion d'une bonne alimentation et d'activités sportives et de loisirs saines, tout en reconnaissant qu'une consommation modérée de boissons alcoolisées fait partie intégrante de la vie culturelle dans de nombreux États membres et ne s'oppose pas nécessairement à un mode de vie sain; |
|
38. |
encourage les États membres à examiner attentivement la pertinence de l'introduction de politiques nationales destinées à empêcher la vente d'alcool très bon marché, pour autant que ces mesures garantissent une protection efficace de la santé et respectent les principes de proportionnalité et de subsidiarité et l'avis devant être prochainement émis par la Cour de justice de l'Union européenne sur la compatibilité de la politique de prix minimal du gouvernement écossais avec le droit de l'Union; |
|
39. |
prie instamment les États membres d'examiner leur législation et les initiatives existantes relatives à l'information des consommateurs et à une culture de consommation d'alcool acceptable, afin d'éduquer et de sensibiliser aux conséquences de l'abus d'alcool, ainsi que de réduire les dommages liés à l'abus d'alcool; recommande en particulier aux États membres de suivre les campagnes de publicité pour l'alcool et leurs effets sur les jeunes et de prendre les mesures appropriées afin de limiter l'exposition des jeunes; |
|
40. |
demande à la Commission d'évaluer la législation européenne existante au vu de la nécessité d'améliorer l'information des consommateurs en matière d'alcool, en veillant à ce que les consommateurs aient connaissance de la teneur en alcool et en calories sans que le marché unique en soit entravé; insiste sur l'importance d'une information claire, concise et efficace sur les effets de la consommation d'alcool et ses risques pour la santé; invite la Commission à envisager l'adoption à l'échelle de l'Union européenne d'une étiquette avertissant les consommateurs des dangers liés aux boissons alcoolisées pendant la grossesse et au volant; |
|
41. |
engage la Commission et les États membres à concevoir des stratégies adéquates et à intensifier les contrôles pour résoudre le problème de la contrefaçon d'alcool ainsi que de la vente d'alcool illégale et au marché noir qui ont des effets particulièrement néfastes dans les couches sociales les plus défavorisées et chez les jeunes et à protéger les indications géographiques au sein de l'Union et dans le monde au moyen d'accords commerciaux internationaux; |
|
42. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission. |
(1) JO L 86 du 21.3.2014, p. 1.
(2) JO C 199 E du 7.7.2012, p. 25.
(3) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 160.
(4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(5) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/39 |
P8_TA(2015)0175
Deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et état d'avancement du pacte sur la durabilité
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur le deuxième anniversaire de l'effondrement du bâtiment Rana Plaza et l'état d'avancement du pacte sur la durabilité (2015/2589(RSP))
(2016/C 346/06)
Le Parlement européen,
|
— |
vu ses résolutions précédentes sur le Bangladesh, notamment celles du 18 septembre 2014 (1), du 16 janvier 2014 (2), du 21 novembre 2013 (3) et du 14 mars 2013 (4), |
|
— |
vu ses résolutions du 25 novembre 2010 sur les droits de l'homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (5) et sur la responsabilité sociale des entreprises dans les accords commerciaux internationaux (6), |
|
— |
vu l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement (7), |
|
— |
vu le pacte pour l'amélioration constante des droits du travail et de la sécurité des usines de l'industrie de la confection et de la bonneterie au Bangladesh, également appelé «pacte de durabilité», |
|
— |
vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, de la commissaire chargée du commerce, Cecilia Malmström, de la commissaire chargée de l'emploi, des affaires sociales, des compétences et de la mobilité des travailleurs, Marianne Thyssen, et du commissaire chargé de la coopération international et du développement, Neven Mimica, à l'occasion du deuxième anniversaire de la tragédie du Rana Plaza, |
|
— |
vu la déclaration de Johannesburg des Nations unies sur le développement durable, notamment son point concernant les modes de consommation et de production durables propres à promouvoir le développement économique et social, |
|
— |
vu la convention C-187 de 2006 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, ainsi que la convention C-155 de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs, que le Bangladesh n'a pas ratifiées, de même que les recommandations y afférentes (R-197); vu également la convention de1947 (C-081) sur l'inspection du travail, que le Bangladesh a signée, ainsi que les recommandations qui s'y rapportent (R-164), |
|
— |
vu le volet du programme «Better Work» [Pour un travail meilleur] de l'OIT consacré au Bangladesh, ouvert en octobre 2013, |
|
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Responsabilité sociale des entreprises: une nouvelle stratégie de l'UE pour la période 2011-2014» (COM(2011)0681) et les résultats de la consultation publique sur les travaux de la Commission concernant l'établissement de sa politique sur la responsabilité sociale des entreprises au-delà de 2014, |
|
— |
vu ses résolutions du 6 février 2013 sur «La responsabilité sociale des entreprises: comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable» (8), ainsi que sur «La responsabilité sociale des entreprises: promouvoir les intérêts de la société et une voie de relance durable et inclusive» (9), |
|
— |
vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui fixent un cadre de protection et de respect des droits de l'homme à l'intention des gouvernements et des entreprises et que le Conseil des droits de l'homme a approuvés en juin 2011, |
|
— |
vu la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations unies du 26 juin 2014, qui porte création d'un groupe de travail intergouvernemental dont la mission est d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les activités des sociétés transnationales; |
|
— |
vu la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, |
|
— |
vu le pacte mondial des Nations unies sur les droits de l'homme, le droit du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption, |
|
— |
vu la proposition de règlement de la Commission instaurant, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d'approvisionnement (COM(2014)0111), un système européen destiné à transposer dans la législation le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, |
|
— |
vu la proposition de loi no 2578 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale française le 30 mars 2015, |
|
— |
vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que, le 24 avril 2013, l'immeuble Rana Plaza, de huit étages, situé dans la ville de Savar à la périphérie de Dacca, qui abritait plusieurs ateliers de confection, s'est effondré, faisant plus de 1 100 morts et quelque 2 500 blessés; que l'effondrement du Rana Plaza est la pire catastrophe industrielle qu'ait connue le Bangladesh et la défaillance accidentelle de la structure d'un bâtiment la plus meurtrière de l'histoire moderne; |
|
B. |
considérant qu'au moins 112 personnes ont péri dans l'incendie de l'usine de Tazreen, dans le district d'Ashulia de Dacca, au Bangladesh, le 24 novembre 2012; que les incendies d'usines, les effondrements de bâtiments et d'autres accidents relevant du domaine de la santé et de la sécurité au travail ne surviennent pas uniquement dans le secteur du prêt-à-porter au Bangladesh, mais demeurent un fléau dans d'autres pays en développement ou pays parmi les moins avancés dotés d'un secteur du prêt-à-porter très présent et très orienté vers l'exportation, tels le Pakistan ou le Cambodge; |
|
C. |
considérant que, l'accord multifibres ayant pris fin et le secteur du prêt-à-porter exigeant une forte intensité de main-d'œuvre, les pays en développement tels que la Chine, le Bangladesh, l'Inde et le Viêt Nam sont devenus des producteurs mondiaux; que le Bangladesh était devenu le deuxième exportateur de textiles au monde derrière la Chine, payant les plus faibles salaires de ce secteur, qui représente près de 85 % des exportations du pays; que 60 % de sa production textile est exportée à destination de l'Union européenne, celle-ci étant son principal marché d'exportation; |
|
D. |
considérant que le secteur bangladais du prêt-à-porter emploie quelque 4 millions de personnes et génère des revenus indirects pour non moins de 40 millions de personnes, soit environ un quart de la population du Bangladesh; que le secteur du prêt-à-porter a contribué de manière significative à la réduction de la pauvreté; que le Bangladesh a accompli d'importants progrès en matière de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans la société, puisqu'il a atteint le troisième objectif du Millénaire pour le développement relatif à la promotion de l'égalité des sexes; que le secteur du prêt-à-porter a contribué de manière significative à cette avancée, puisque 3,2 millions des 4 millions de travailleurs qu'il emploie sont des femmes; que l'emploi des femmes a, dans de nombreux cas, contribué à leur émancipation; |
|
E. |
considérant que la réorganisation du secteur du prêt-à-porter autour du modèle de la chaîne de valeur intégrée a pour conséquence que les commandes ne peuvent être garanties que par une augmentation de la productivité et des coûts de production toujours plus faibles, ce qui rend la main-d'œuvre du Bangladesh et d'autres pays en développement particulièrement vulnérables; que le Cambodge et le Sri Lanka, dont l'économie dépend fortement du secteur du prêt-à-porter, ont connu une baisse des salaires, malgré une forte hausse du nombre d'installations de production et d'emplois; qu'au Bangladesh, le salaire minimum a été augmenté sensiblement à la suite du drame du Rana Plaza, mais qu'il demeure encore bien au-dessous de ce qui est considéré comme suffisant pour couvrir les besoins essentiels des travailleurs; |
|
F. |
considérant que, selon diverses sources, plus de 600 ouvriers du textile ont péri dans des incendies d'usines au Bangladesh entre 2006 et le début de l'année 2013 et que, selon les rapports d'organisations de défense des droits de l'homme, ni les propriétaires ni les gérants de ces usines n'ont jamais été traduits en justice; |
|
G. |
considérant que le Rana Plaza, qui hébergeait des usines, avait été construit illégalement et ne respectait pas les normes de sécurité; qu'après ce drame, 32 usines ont été définitivement fermées au Bangladesh en raison de graves problèmes de sécurité et que 26 autres ont fait l'objet d'une fermeture partielle; qu'un nombre considérable d'usines doivent encore améliorer la sécurité de leurs installations afin qu'elle atteigne le niveau minimal exigé par la loi; que l'OIT soutient l'initiative du gouvernement bangladais consistant à mener des inspections de sécurité en matière d'intégrité structurelle, de protection contre l'incendie et de sûreté des installations électriques dans quelque 1 800 usines du secteur du prêt-à-porter, dont de nombreuses sont converties en bâtiments commerciaux ou résidentiels; |
|
H. |
considérant que, le 24 avril 2013, les représentants du gouvernement du Bangladesh, de fabricants de textiles locaux, de marques internationales de vêtements, de syndicats locaux et internationaux, et d'ONG internationales ont signé un accord sur les modalités pratiques de versement d'indemnisations au victimes de l'accident du Rana Plaza et à leur familles (Fonds des donateurs) qui vise à indemniser les victimes de la catastrophe et leurs familles; que le montant fixé pour couvrir les coûts de toutes les demandes s'élève à 30 millions de dollars des États-Unis; qu'à la date du deuxième anniversaire de la catastrophe, le montant total des contributions volontaires versées par des entreprises avoisinait les 27 millions de dollars, 3 millions restant donc à payer; |
|
I. |
considérant que l'indemnisation est un appui économique indispensable et que le fonds d'indemnisation, s'il demeure dans son état d'insuffisance actuel, ne permettra pas de payer les frais médicaux des victimes nécessitant des soins à long terme; que le Parlement a déploré que l'accord en matière de compensation volontaire par l'intermédiaire d'un Fonds des donateurs n'eût pas atteint son objectif, et a conclu qu'un mécanisme obligatoire bénéficierait davantage aux survivants et aux familles des victimes; |
|
J. |
considérant que la catastrophe du Rana Plaza, avec l'indignation de l'opinion publique qu'elle a suscité et les appels à l'action du Parlement européen, a amené l'Union européenne à lancer, le 8 juillet 2013, en coopération avec le gouvernement bangladais et l'OIT, le «pacte pour l’amélioration constante des droits du travail et de la sécurité des usines de l’industrie de la confection et de la bonneterie au Bangladesh» (connu également sous le nom de «pacte sur la durabilité», par lequel le Bangladesh s'est engagé à prendre des mesures pour améliorer les normes et les conditions de travail dans son secteur du prêt-à-porter; |
|
K. |
considérant qu'avant l'accident, le Bangladesh ne comptait que 92 inspecteurs pour contrôler près de 5 000 usines de prêt-à-porter et autres industries dans le pays; que le gouvernement bangladais s'était engagé à recruter 200 inspecteurs supplémentaires d’ici la fin de l'année 2013; |
|
L. |
considérant que le premier réexamen du pacte a eu lieu en octobre 2014 et a abouti à la conclusion que des progrès honorables avaient été réalisés, mais qu'il incombait au gouvernement bangladais de prendre des mesures supplémentaires, notamment quant à l'amélioration et à l'application du code du travail, au renforcement du droit du travail dans les zones franches industrielles pour l'exportation et au recrutement de davantage d'inspecteurs du travail; considérant que le deuxième réexamen du pacte aura lieu à l'automne 2015; |
|
M. |
considérant que le code du travail du Bangladesh (loi sur le travail) a été modifié en juillet 2013, que la loi bangladaise sur le travail, qui comprend des réformes positives, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail notamment, reste toutefois très insuffisante au regard des normes internationales relatives à la liberté syndicale et au droit à la négociation collective, comme le souligne la commission d'experts de l'OIT dans ses observations sur les conventions 87 et 98, notamment en ce qu'elle limite considérablement le droit d'élire librement des représentants et le droit de grève et confère de larges pouvoirs aux administrations pour annuler la création d'un syndicat; que le gouvernement bangladais a déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune intention d'y apporter de nouvelles modifications; |
|
N. |
considérant que la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies au Bangladesh, accord juridiquement contraignant, a été signée le 13 mai 2013 par de sociétés de prêt-à-porter, des syndicats au niveau mondial et local, des ONG et des groupes militant pour les droits des travailleurs et que l'Alliance pour la sécurité des travailleurs au Bangladesh, qui regroupe 26 marques principalement nord-américaines mais ne fait pas participer les syndicats, a été créée le 9 juillet 2013; qu'à l’heure actuelle, 175 marques et enseignes du secteur de l'habillement ont signé la convention; que la fondation Accord, créée en vertu de la convention, et l'Alliance ont mené à bien l'inspection des 1 904 usines qui sont orientées vers l'exportation; |
|
O. |
considérant que le gouvernement bangladais n'a pas encore publié de règles ou de règlements d'application de la loi sur le travail, bien qu'il s'y soit engagé de manière répétée, sa dernière déclaration en ce sens promettant d'adopter ces textes au plus tard à l'été 2015; que l'application de la loi sur le travail constitue une condition nécessaire pour bénéficier du programme «Better Work» de l'OIT et pour assurer le fonctionnement adéquat du programme de formation prévu par la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies; |
|
P. |
considérant qu'au Bangladesh, 10 % de la main-d'œuvre est employée dans le secteur du prêt-à-porter dans les zones franches industrielles pour l'exportation; qu'un nouveau code du travail pour les zones franches industrielles pour l'exportation a été adopté par le cabinet en juillet 2014, mais qu'il n'accorde aucunement aux travailleurs de ces zones les mêmes droits dont jouissent les travailleurs dans d'autres régions du pays; que, si la suspension du droit de grève a certes pris fin le 1er janvier 2014, les associations de défense du bien-être des travailleurs ne jouissent pas des mêmes droits et privilèges que les syndicats; |
|
Q. |
considérant que près de 300 nouveaux syndicats ont été enregistrés dans le secteur de l'habillement depuis le début de l'année 2013; qu'en 2014, 66 demandes — soit 26 % du total des demandes introduites — ont été rejetées; que la discrimination syndicale reste un grave problème et connaît un essor rapide; que, d'après les syndicats, le gouvernement bangladais travaille activement à empêcher les travailleurs et les employeurs qui le souhaitent (conformément à la convention susmentionnée) de créer leurs propres comités de sécurité; |
|
R. |
considérant que le Bangladesh se classe 136e, sur 177 pays, en fonction de l'indice de perception de la corruption établi par l'ONG Transparency International, et que la corruption est endémique au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale du secteur du prêt-à-porter, impliquant tant la classe politique que des sociétés locales et multinationales; |
|
S. |
considérant que, selon l'organisation Bangladeshi Worker Rights Consortium, l'adoption par les 5 000 ateliers de confection du pays des normes de sécurité occidentales dans les cinq prochaines années se traduirait par une augmentation de moins de 10 centimes du prix départ usine des 7 milliards de vêtements que le Bangladesh vend aux marques occidentales; que rien n'indique que les prix des vêtements et des articles textiles aient augmenté au cours des deux dernières années; |
|
T. |
considérant que le secteur du prêt-à-porter est clairement dominé par les grandes enseignes, les fabricants et les négociants de produits de marque qui contrôlent les réseaux mondiaux de production et fixent directement les conditions de l'offre; que, dans le contexte de la mondialisation de l'industrie, les fabricants de produits textiles et de vêtements n'ont souvent d’autre choix que d'accepter de baisser les prix, d'améliorer les normes de qualité, de raccourcir les délais de livraison, de réduire les quantités minimales et de prendre un maximum de risques; que la chaîne d'approvisionnement mondial présente de sérieuses lacunes en termes de transparence et de traçabilité; que le travail décent dans la chaîne d'approvisionnement internationale constituera un point clé de l'ordre du jour de la conférence de l'OIT en 2016; |
|
U. |
considérant qu'après le drame du Rana Plaza, les consommateurs européens ont plus que jamais demandé à être mieux informés sur l'origine des produits et les conditions dans lesquelles ils sont manufacturés; que les citoyens européens ont soumis de nombreuses pétitions et organisé des campagnes pour exiger que les marques de vêtements soient davantage responsables de garantir que leurs produits sont fabriqués de manière éthique; |
|
V. |
considérant que le Bangladesh, en tant que pays parmi les moins avancés, bénéficie d'un accès en franchise de droits et sans contingent au marché de l'Union pour l'ensemble de ses produits au titre de l'initiative «Tout sauf les armes», qui concerne 55 % des exportations du pays, soit principalement du prêt-à-porter et des produits textiles, et se trouve par conséquent tenu de garantir l'application effective de plusieurs conventions de base des Nations unies et de l'OIT relatives aux droits de l'homme et au droit du travail; |
|
1. |
salue la mémoire des victimes du drame du Rana Plaza à l'occasion du deuxième anniversaire de la catastrophe industrielle, qui a été l'une des plus dévastatrices de l'Histoire; présente de nouveau ses condoléances aux familles en deuil, ainsi que toute sa sympathie aux blessés et aux handicapés; souligne que ces pertes pourraient être évitées avec des systèmes de garantie de la sécurité au travail de meilleure qualité; |
|
2. |
rappelle que le comité de coordination du Rana Plaza a mis en place le Fonds des donateurs, destiné à recueillir des donations volontaires des entreprises afin d'indemniser les victimes et leurs familles; déplore que 3 millions de dollars des États-Unis restassent encore à payer, en avril 2015, sur la somme totale de 30 millions de dollars prévue pour l'indemnisation, et exhorte les marques internationales qui faisaient confectionner leurs produits au Rana Plaza, ou qui ont des liens avec le Bangladesh, le gouvernement bangladais ou l'association bangladaise des fabricants et exportateurs de vêtements, à veiller à ce que les indemnisations dues soient versées séance tenante; |
|
3. |
dénonce le fait que près d'un tiers des entreprises réputées avoir des liens avec l'usine, telles qu'Adler Modemarkte, Ascena Retail, Carrefour, Grabalok, J. C. Penney, Manifattura Corona, NKD, PWT ou YesZee, n'aient pas encore versé le moindre sou au Fonds des donateurs; déplore vivement que le groupe Benetton, après des mois d'atermoiements, n'ait au final versé qu'1,1 million de dollars au fonds d'indemnisation des victimes, alors que le montant de sa contribution devrait être bien supérieur étant donné sa capacité à payer et ses responsabilités dans la catastrophe; regrette, de même, qu'aucune des différentes marques impliquées dans la catastrophe n'ait versé de dons suffisants et qu'elles manquent ainsi toutes à leurs responsabilités envers les victimes, notamment Mango, Matalan et Inditex, qui ont refusé de publier le montant de leur don, ou d'autres, telles que Walmart et The Children's Place, qui n'ont versé qu'une contribution minime; |
|
4. |
relève que les négociations relatives à l'indemnisation des victimes de l'incendie de Tazreen se déroulent actuellement avec l'accord du Rana Plaza pour modèle; déplore vivement les retards qui s'accumulent et demande qu'il soit procédé à l'indemnisation dans les meilleurs délais; |
|
5. |
salue les mesures prises en vue de mettre en place un régime permanent d'assurance pour les accidents du travail au Bangladesh et encourage le gouvernement bangladais à honorer ses engagements à cet égard au titre du plan d'action tripartite national; demande à la Commission de soutenir de telles initiatives s'il y a lieu; observe cependant que tant que l'indemnisation des victimes n'aura pas eu entièrement lieu, de réels progrès ne pourront être effectués dans ce domaine; |
|
6. |
invite la Commission et les gouvernements des États membres de l'Union et des pays tiers à envisager des propositions d'élaboration de cadres contraignants qui garantiront l'accès à un recours et à une indemnisation en fonction du besoin et de la responsabilité, et non de la réussite plus ou moins grande des groupes de soutien lorsqu'ils utilisent la technique du pilori ou de la bonne volonté des entreprises; |
|
7. |
se félicite du lancement, mené par l'Union, du pacte sur la durabilité, qui vise à faire prendre un nouveau départ au secteur du prêt-à-porter bangladais en matière de santé et sécurité au travail, d'amélioration des conditions de travail, de respect des droits des travailleurs et de promotion d'une conduite responsable en affaires; |
|
8. |
prend acte des conclusions du premier réexamen du pacte en octobre 2014, qui font état des progrès honorables accomplis par les autorités du Bangladesh, et reconnaît la contribution du pacte à l'amélioration de la santé et de la sécurité dans les usines et des conditions de travail dans le secteur du prêt-à-porter; invite instamment, néanmoins, le gouvernement bangladais à consentir davantage d'efforts pour tenir tous les engagements qu'il a pris dans le pacte en d'en faire la plus grande priorité; a confiance dans la possibilité d'accomplir des avancées considérables dans toutes les questions liées à la santé et à la sécurité au travail — en particulier en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs, les inspections du travail, le versement d'une rémunération décente, l'intégrité structurelle des bâtiments, la santé et la sécurité au travail et la conduite responsable en affaires — d'ici au deuxième réexamen du pacte, prévu à l'automne 2015; |
|
9. |
prend acte de la modification de la loi sur le travail bangladaise à la suite du drame du Rana Plaza, qui renforce davantage les droits fondamentaux dans les domaines de la santé et la sécurité au travail et des droits des travailleurs; déplore toutefois qu'un certain nombre d'entraves à la liberté syndicale n'aient pas été modifiées et que la loi ne satisfasse toujours pas aux conventions fondamentales de l'OIT; |
|
10. |
prie le gouvernement bangladais d'adopter sans plus tarder, en accordant à la question l'extrême priorité qu'elle mérite, conformément aux engagements pris dans le pacte sur la durabilité, les règles ou règlements nécessaires à la bonne application de la loi sur le travail, en étroite concertation avec le conseil consultatif tripartite, en prêtant une attention particulière aux conventions no 87 et 98 de l'OIT sur la liberté syndicale et la négociation collective et en s'assurant qu'elles s'appliquent également; |
|
11. |
se dit préoccupé par la situation au sein des zones franches industrielles pour l'exportation, où les syndicats sont toujours interdits et les conditions de travail, ainsi que les normes en matière de santé et de sécurité, sont réputées extrêmement précaires; souligne que les travailleurs employés dans ces zones devraient bénéficier des mêmes libertés fondamentales garanties par la loi et des mêmes normes de sécurité dont jouissent les autres travailleurs au Bangladesh; déplore vivement que le code du travail proposé pour ces zones franches contiennent toujours l'interdiction des syndicats, et signale que les associations de défense du bien-être des travailleurs ne jouissent absolument pas des mêmes droits et privilèges que les syndicats; invite instamment le gouvernement du Bangladesh à étendre séance tenante le champ d'application de la loi sur le travail, dans son intégralité, à ces zones franches; |
|
12. |
salue la hausse récente de 77 % du salaire minimum (qui passe de 35 à 62 euros par mois) dans le secteur du prêt-à-porter et plaide en faveur d'une application plus universelle; relève cependant que, dans la pratique, le salaire minimum dans le secteur du prêt-à-porter demeure encore insuffisant pour couvrir les besoins essentiels des travailleurs, et qu'il devrait être porté au moins à 104 euros par mois pour y suffire, et invite le gouvernement du Bangladesh à fixer le salaire minium en consultation avec les syndicats et les employés; prie en outre instamment le gouvernement de s'assurer que les usines de confection paient réellement les salaires dus; |
|
13. |
salue l'enregistrement de près de 300 nouveaux syndicats dans le secteur de l'habillement depuis le début de l’année 2013, ce qui double le nombre de syndicats présents dans le secteur, mais s'inquiète de ce qu'en 2014 et 2015, le rythme des enregistrements ait décru; encourages les autorités bangladaises à poursuivre leurs avancées, dans l'espoir d'atteindre l'objectif d'une représentation adéquate des 4 millions de travailleurs du secteur du prêt-à-porter; |
|
14. |
se déclare extrêmement préoccupé par les informations concernant les discriminations, les licenciements et les représailles qui ont suivi la formation de nouveaux syndicats; est consterné par la discrimination syndicale généralisée qui sévit au Bangladesh, comme le soulignent les menaces, le harcèlement et les actes de violence physique subis par les travailleurs syndiqués — d'après des témoignages établis –, et notamment par l'assassinat d'Aminul Islam, dirigeant syndical; invite instamment le gouvernement du Bangladesh à éradiquer efficacement les pratiques contraires aux droits des travailleurs en appliquant les mesures nécessaires pour prévenir les actes répréhensibles, enquêter sur ces actes et poursuivre les responsables en justice, le tout avec diligence et de manière transparente, de sorte à mettre fin à l'impunité et faire répondre de leurs actes les meurtriers d'Aminul Islam; est convaincu qu'un moyen efficace de réduire la discrimination syndicale réside dans une campagne de formation et de sensibilisation appropriée en matière de droits des travailleurs; |
|
15. |
estime que l'existence de structures syndicales démocratiques joue un grand rôle dans la mise au point de normes plus élevées en matière de santé et de sécurité, par le développement continu, par exemple, de comités de sécurité dirigés par des travailleurs dans toutes les usines; souligne également l'importance d'octroyer aux syndicats l'accès aux usines pour qu'ils puissent informer les travailleurs des moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits et leur sécurité, notamment le droit de refuser d'effectuer un travail risqué; |
|
16. |
salue l'engagement pris par le gouvernement du Bangladesh de rétablir le département d'inspection des usines et des établissements industriels, qu'il a prévu de doter de 993 employés et de 23 bureaux de district, la mise à niveau de ses services d'inspection en janvier 2014, et l'adoption d'une politique nationale en matière de santé et de sécurité, ainsi que de normes unifiées pour l'inspection de santé et de sécurité dans toutes les usines; invite la Commission et les partenaires internationaux à fournir une assistance technique et à mettre en commun leurs bonnes pratiques pour aider à mettre le département à niveau; demande au gouvernement bangladais de respecter ses engagements concernant l'inspection du travail ainsi que la convention no 81 de l'OIT; salue la fermeture des usines qui ne répondent pas aux normes de sécurité; |
|
17. |
continue de s'inquiéter de l'existence d'allégations de corruption endémique impliquant, au Bangladesh, les inspecteurs de la santé et de la sécurité et les propriétaires d'usines textiles, et demande que davantage soit fait pour lutter contre ces pratiques; |
|
18. |
reconnaît les difficultés inhérentes à la poursuite du recrutement d'inspecteurs du fait de la nécessité de les former, avant toute entrée en fonctions, de manière adéquate pour qu'ils adhèrent à un seul ensemble de normes et à des procédures opératoires harmonisées; déplore néanmoins que l'objectif de recrutement de 200 inspecteurs, prévu pour la fin de l'année 2013, n'ait pas encore été atteint, les recrues actuelles étant au nombre de 173, et souligne que le nombre de 200 inspecteurs est lui-même bien insuffisant pour surveiller un secteur qui compte 4 millions de travailleurs; |
|
19. |
salue le fait que la fondation Accord et l'Alliance ont mené à bien l'inspection de toutes les usines relevant de leur compétence qu'elles ont établi plus de 400 plans de mesures correctives; invite instamment le gouvernement bangladais à prêter son concours à cette initiative en menant à bien rapidement l'inspection des usines relevant de sa compétence et à adopter les mesures correctives qui s'imposent; soutient le travail indispensable de l'OIT, qui permet de veiller à ce que ces inspections aient lieu; salue l'engagement des fabricants qui souhaitent améliorer les normes et invite l'ensemble des parties prenantes à veiller à la pleine et correcte mise en application des plans de mesures corrective; |
|
20. |
salue la signature, par plus de 250 marques et enseignes du secteur de la mode et de l'habillement qui font confectionner leurs articles au Bangladesh, de la convention sur la sécurité des bâtiments et la protection contre les incendies, ou leur adhésion à l'Alliance, afin de coordonner leurs efforts d'amélioration de la sécurité dans les usines du Bangladesh qui les fournissent; encourage donc d'autres sociétés, y compris des PME, à signer la convention; souligne qu'il importe, pour que la convention soit appliquée efficacement, que toutes les parties prenantes s'engagent de manière adéquate; encourage l'adoption d'initiatives similaires dans d'autres pays à risque; |
|
21. |
encourage la fondation Accord et l'Alliance à améliorer leur coopération et à échanger systématiquement des rapports sur les inspections réalisées dans les usines, afin d'éviter tout chevauchement des travaux et toute inégalité de traitement; invite l'Alliance à publier ses rapports également en bengali et à les assortir de photographies, afin que tous puissent y avoir accès dans le pays; |
|
22. |
estime que les enseignes mondiales et les fabricants de produits de marque ont une large part de responsabilité, compte tenu des modes de production actuels, dans les difficultés rencontrées pour améliorer les conditions de travail et des salaires dans les pays producteurs; est convaincu qu'il serait possible de créer une structure de marché et des conditions sociales si ces entreprises garantissaient, tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement, le respect plein et entier des normes fondamentales de l'OIT dans le domaine du droit du travail, des normes internationalement reconnues en matière de responsabilité des entreprises, en particulier les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, récemment mis à jour, les dix principes définis dans le Pacte mondial des entreprises (Global Compact) des Nations unies, la norme d'orientation sur la responsabilité sociale ISO 26000, la déclaration de principes tripartite de l'OIT sur les principes concernant les entreprises multinationales et la politique sociale, et les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme; se félicite du lancement, par la Commission, d'une initiative européenne phare sur la gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur du prêt-à-porter, qui tiendra compte des initiatives existantes au niveau national, par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas au Danemark et en France, et estime que l'Union a la capacité et le devoir de se faire le héraut de la gestion responsable des chaînes d'approvisionnement; |
|
23. |
estime que c'est le manque d'accès à l'information dans le secteur du prêt-à-porter qui fait le plus souvent obstacle à la lutte contre les atteintes aux droits de l'homme dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, et qu'il est nécessaire de mettre en place un système de notification obligatoire qui fournisse des informations reliant tous les acteurs de la chaîne de valeur d'un même produit, du lieu de production au lieu de vente; juge nécessaire d'adopter, au niveau de l'Union, de nouveaux textes législatifs juridiquement contraignants à l'égard des entreprises de l'Union, pour obliger celles-ci à respecter le devoir de diligence en matière de droits de l'homme lorsqu'elles délocalisent leur production dans un pays tiers, y compris en prévoyant des mesures visant à assurer la traçabilité et la transparence conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, et aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales; |
|
24. |
invite le Conseil et la Commission à inclure dans tous les accords bilatéraux de commerce et d'investissement signés par l'Union une clause obligatoire et à force exécutoire relative à la responsabilité sociale des entreprises, qui obligerait les investisseurs européens à respecter les principes de la RSE tels qu'ils ont été définis au niveau international, notamment par les principes directeurs de l'OCDE dans leur version révisée en 2010 et les normes élaborées par les Nations unies, l'OIT et l'Union européenne; demande qu'à l'avenir, les accords commerciaux conclus par l'Union européenne avec des pays tiers accordent une place plus importante à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, en tant que partie intégrante du programme pour un travail décent, et que l'Union fournisse une assistance technique dans le cadre de l'application de ces dispositions, afin qu'elles ne fassent pas obstacle au commerce; |
|
25. |
reconnaît que le secteur textile a procuré un emploi à des millions de femmes pauvres des régions rurales du Bangladesh et d'ailleurs et leur a permis d'échapper à leur situation de dénuement et de dépendance vis-à-vis des hommes; relève que la main-d'œuvre non syndiquée se compose essentiellement de travailleurs et de femmes non qualifiés dans le secteur de la confection des pays en développement; estime qu'il est vital d'accomplir des progrès en matière de droits et de protection des travailleurs si l'on veut renforcer la capacité d'action des femmes, insiste sur la nécessité d'accroître la représentation des femmes dans les syndicats, y compris les nouveaux syndicats fondés au Bangladesh, et se félicite de ce que le pacte reconnaisse l'importance de l'autonomisation des femmes dans le cadre de l'amélioration des normes en matière de travail; |
|
26. |
fait observer que l'initiative «Tout sauf les armes» a joué un rôle important dans le développement économique du Bangladesh et contribué à l'amélioration de la situation matérielle de millions de personnes, en particulier des femmes; est convaincu, cependant, que sans un système de conditionnalité à toute épreuve dans le domaine des droits de l'homme et des droits des travailleurs, l'initiative «Tout sauf les armes» et le système de préférences généralisées risquent d'encourager des normes au rabais en matière de protection des travailleurs et de nuire au travail décent; demande à la Commission de déterminer si le Bangladesh respecte bien les conventions en matière de droits de l'homme, de droit du travail et d'environnement au titre du système de préférences généralisées, et de présenter un rapport au Parlement à ce sujet; souligne que les pays qui enregistrent de bons progrès en matière de normes sociales et de droit du travail devraient se voir récompensés par le maintien d'un plein accès au marché pour leurs produits; |
|
27. |
encourage Federica Mogherini, vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et la commissaire Malmström à continuer d'aborder les thèmes de la ratification des normes fondamentales de l'OIT, de l'inspection de la santé et de la sécurité et de la liberté syndicale dans le cadre des négociations avec le Bangladesh concernant l'accès permanent au système de préférences généralisées; |
|
28. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Service européen pour l'action extérieure, à la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, au gouvernement et au Parlement de la République populaire du Bangladesh ainsi qu'au directeur général de l'OIT. |
(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0024.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0045.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0516.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0100.
(5) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 31.
(6) JO C 99 E du 3.4.2012, p. 101.
(7) JO L 118 du 27.4.2001, p. 48.
(8) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0049.
(9) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0050.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/47 |
P8_TA(2015)0176
Réunion extraordinaire du Conseil européen (23 avril 2015) — Récentes tragédies dans la Méditerranée et politiques de migration et d'asile de l'UE
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur les récentes tragédies dans la Méditerranée et les politiques de migration et d'asile de l'Union européenne (2015/2660(RSP))
(2016/C 346/07)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, |
|
— |
vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, |
|
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
|
— |
vu la convention de Genève de 1951 et son protocole additionnel, |
|
— |
vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur les flux migratoires en Méditerranée, en particulier à la lumière des événements tragiques survenus au large de Lampedusa (1), |
|
— |
vu le document de travail de la Commission du 22 mai 2014 sur la mise en œuvre de la communication sur les travaux de la task-force pour la Méditerranée, |
|
— |
vu le débat qui a eu lieu au Parlement le 25 novembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations, |
|
— |
vu sa résolution du 17 décembre 2014 sur la situation en Méditerranée et sur la nécessité d'une approche globale de l'Union européenne de la question des migrations (2), |
|
— |
vu l'initiative pour la mer Méditerranée centrale du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les propositions de celui-ci en vue de faire face aux arrivées actuelles et futures de demandeurs d'asile, de réfugiés et de migrants en Europe, |
|
— |
vu le plan d'action en dix points sur les migrations du Conseil conjoint des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur du 20 avril 2015, |
|
— |
vu les conclusions du sommet spécial du Conseil de l’Union sur la crise des réfugiés en Méditerranée du 22 avril 2015, |
|
— |
vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 1 500 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis le début de cette année; |
|
B. |
considérant que, selon l'OIM, 23 918 migrants ont atteint les côtes italiennes depuis le 1er janvier 2015; considérant que selon les autorités grecques, 10 445 migrants ont été secourus en mer Égée par les gardes-côtes grecs au cours du premier trimestre de 2015; |
|
C. |
considérant que les forces maritimes italiennes, les gardes-côtes italiens, la marine italienne et plusieurs navires marchands ont mené sans relâche des opérations de sauvetage des migrants en détresse en mer Méditerranée, et sont venus à l'aide de quelque 10 000 migrants en l'espace de six jours, du vendredi 10 avril au jeudi 16 avril 2015; |
|
D. |
considérant que l'opération Mare Nostrum, qui visait uniquement à patrouiller et à intervenir en Méditerranée pour les opérations de sauvetage a porté secours à 150 810 migrants sur une période de 364 jours; considérant que les premières estimations ne montrent pas de baisse dans le nombre de migrants traversant la Méditerranéenne à l'heure actuelle; |
|
E. |
considérant que la majorité des personnes tentant de traverser la Méditerranéenne fuyait les conflits ou les persécutions en Syrie, en Iraq, en Érythrée, en Somalie et en Libye; considérant que près de 700 migrants sont portés disparus et qu’il est à craindre qu’ils se soient noyés après que le bateau de pêche en bois sur lequel ils étaient entassés a chaviré près de la Libye alors qu'un navire marchand portugais venait à leur aide, le samedi 18 avril 2015; que l’un des survivants aurait informé les autorités italiennes qu’il pouvait y avoir 950 personnes à bord; considérant que, début avril, il s'était déjà produit une tragédie du même ordre, dans laquelle quelque 400 migrants auraient péri en mer à la suite du naufrage d'un bateau de pêche en bois transportant 550 personnes environ; |
|
F. |
considérant que l'opération conjointe Triton coordonnée par Frontex est devenue pleinement opérationnelle le 1er novembre 2014 et qu'elle était au départ dotée d'un budget mensuel ne dépassant les 2 900 000 EUR, comparés aux quelque 9 000 000 EUR mensuels de l'opération Mare Nostrum; considérant que plus de 24 400 migrants clandestins ont été sauvés en Méditerranée centrale depuis le début de l'opération conjointe «Triton» en novembre 2014, dont près de 7 860 avec l'aide de moyens cofinancés par Frontex; |
|
G. |
considérant que les passeurs et les trafiquants d’êtres humains exploitent les migrations clandestines et que ces réseaux mettent en péril la vie des migrants pour leur propre profit, sont responsables de la mort de milliers de personnes et représentent un défi majeur pour l’Union et les États membres; considérant que les trafiquants dégagent un bénéfice annuel estimé à 20 milliards d'EUR; considérant que, selon Europol, les groupes criminels organisés qui interviennent dans le transport de migrants irréguliers à travers la Méditerranée entretiennent des rapports avec la traite des êtres humains, le trafic de drogue et des armes à feu et le terrorisme; considérant que, le 17 mars 2015, Europol a lancé son équipe conjointe opérationnelle «MARE» pour lutter contre ces groupes criminels organisés; |
|
H. |
considérant que l’instabilité régionale et les conflits ont un impact sur l'afflux massif de migrants et les flux de personnes déplacées et, par conséquent sur le nombre de personnes tentant d'atteindre l'Union européenne; considérant que l’expansion rapide de l'État islamique et de Daech dans les zones de conflit voisines aura en fin de compte une incidence sur l’afflux massif de migrants et les flux de personnes déplacées; |
|
1. |
exprime sa profonde tristesse et déplore les pertes tragiques de vies humaines survenues en Méditerranée; prie instamment l'Union européenne et les États membres de développer la coopération existante et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que d'autres personnes ne périssent en mer; appelle l'Union et les États membres à mettre tout en œuvre pour identifier les corps et les personnes disparues et informer leurs proches; |
|
2. |
appelle l'Union et les États membres à fournir les ressources nécessaires pour garantir que les obligations en matière de recherche et de sauvetage sont effectivement exécutées et, par conséquent, dûment financées; demande aux États membres de continuer de faire preuve de solidarité et de manifester leur engagement en augmentant leur contribution aux budgets et aux opérations de ces agences et s’engage à fournir à ces agences les ressources nécessaires (en personnel et en équipements) pour s’acquitter des obligations qui leur incombent, par l'intermédiaire du budget de l’Union et de ses fonds; |
|
3. |
réaffirme qu'il est nécessaire que l'Union européenne réponde aux récentes tragédies survenues en Méditerranée en se basant sur le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, conformément à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), ainsi que sur une approche européenne globale; réaffirme qu'il est nécessaire que l'Union européenne accentue le partage équitable de responsabilité et la solidarité envers les États membres qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile, aussi bien en valeur absolue que relative; |
|
4. |
se félicite de la volonté du Conseil européen de donner une nouvelle dimension à l'opération Triton de l'Union en augmentant son financement et ses moyens; invite instamment l'Union à conférer à l'opération Triton un mandat clair afin d'accroître sa zone d'opération et d'élargir son mandat pour les opérations de recherche et de sauvetage au niveau de l'Union; |
|
5. |
appelle de ses vœux la mise sur pied d'une opération européenne de sauvetage permanente et humanitaire qui, comme Mare Nostrum, s'effectuerait en haute mer et à laquelle contribueraient tous les États membres, que ce soit financièrement ou en fournissant du matériel et des moyens; invite instamment l'Union à cofinancer une telle opération; |
|
6. |
se félicite de la proposition du Conseil de traiter conjointement, avec l'aide des équipes du Bureau européen d'appui en matière d'asile, les demandes d'asile; appelle la Commission à élargir le mandat du Bureau européen d'appui en matière d'asile et à renforcer son rôle opérationnel dans le traitement des demandes d'asile; |
|
7. |
appelle les États membres à utiliser pleinement les possibilités existantes pour la délivrance de visas humanitaires dans leurs ambassades et bureaux consulaires; souligne à cet égard que le Conseil devrait envisager sérieusement la possibilité d'appliquer la directive de 2001 relative à la protection temporaire ou l'article 78, paragraphe 3, du traité FUE, qui proposent tous deux un mécanisme de solidarité en cas d'afflux soudain de personnes déplacées; |
|
8. |
demande aux États membres d'augmenter leur contribution aux programmes de réinstallation, en particulier les États membres qui n'ont pas encore contribué; |
|
9. |
invite la Commission à établir un quota contraignant pour la répartition des demandeurs d’asile entre les États membres; |
|
10. |
souligne la nécessité d'encourager les politiques de retour volontaire, tout en assurant la protection des droits de tous les migrants et en garantissant un accès sûr et légal au régime d'asile européen, en respectant pleinement le principe de non-refoulement; |
|
11. |
salue le fait que la VP/HR et la présidence lettone aient immédiatement convoqué à Luxembourg un conseil extraordinaire conjoint des ministres des affaires étrangères et des ministres de l'intérieur et se félicite que les États membres aient convoqué sans tarder un sommet extraordinaire pour trouver des solutions communes destinées à répondre à la situation de crise en Méditerranée; observe qu'un premier débat élargi s'est tenu sur les options permettant de sauver des vies, de lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains ainsi que sur le partage des responsabilités entre les États membres en ce qui concerne les modalités de réception et de protection; souligne que les États membres doivent s'engager plus avant et déplore le manque d'engagement du Conseil européenne en faveur de la mise en place d'un mécanisme crédible et contraignant de solidarité au niveau de l'Union; |
|
12. |
demande la transposition rapide et intégrale ainsi que la mise en œuvre effective du régime d'asile européen commun par tous les États membres participants, garantissant ainsi des normes européennes communes, y compris des conditions d'accueil pour les demandeurs d'asile et le respect des droits fondamentaux, conformément à la législation existante; |
|
13. |
appelle à une coordination plus étroite entre les politiques de l'Union et celles des États membres en vue de traiter les causes profondes des migrations; souligne la nécessité d’une approche globale de l’Union, qui renforcera la cohérence de ses politiques intérieures et extérieures et, en particulier, de sa politique étrangère et de sécurité commune, de sa politique de développement et de sa politique migratoire; demande que la coopération de l’Union avec les pays partenaires du Proche-Orient et d’Afrique soit renforcée afin de promouvoir la démocratie, les libertés et les droits fondamentaux, la sécurité et la prospérité; |
|
14. |
prie instamment les États membres et les pays tiers de prévoir les sanctions pénales les plus rigoureuses possible contre la traite des êtres humains et les filières de passeurs, au niveau de l’entrée comme de la circulation dans l’Union, mais aussi à l’encontre d’individus ou de groupes qui exploitent les migrants vulnérables dans l’Union, tout en veillant à ce que les personnes qui viennent en aide aux demandeurs d'asile et aux navires en péril ne soient pas poursuivies; |
|
15. |
invite les États membres à collaborer étroitement avec l’agence Frontex, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, Europol et Eurojust afin de lutter contre la traite des êtres humains et les réseaux criminels de passeurs et d'identifier et de localiser leurs financements et d'analyser leurs modes opératoires de façon à les empêcher de faire du profit en mettant en danger la vie des migrants; souligne que la coopération des pays tiers, en particulier ceux qui entourent la Libye, est indispensable pour que ces réseaux criminels soient démantelés avec succès, tant en termes de formation des services répressifs que de mise à disposition de services d'information; souligne qu'il est impératif que les pays tiers respectent le droit international en ce qui concerne le sauvetage en mer et garantissent la protection des réfugiés et le respect des droits fondamentaux; |
|
16. |
insiste sur le fait que les causes profondes de la violence et du sous-développement doivent être abordées dans les pays d’origine afin d’endiguer l’afflux de réfugiés et de migrants économiques; souligne, à cet égard, que les principales priorités de tous les gouvernements des pays d’origine devraient être de renforcer les structures de gouvernance en mettant en place des institutions publiques efficaces et inclusives, d'assurer le renforcement des capacités dans les systèmes d'asile des pays tiers, d'instaurer l’état de droit et de lutter contre la corruption endémique à tous les niveaux, ainsi que de promouvoir les droits de l’homme et l'approfondissement de la démocratie; |
|
17. |
réaffirme son soutien à toutes les négociations menées par les Nations unies en vue du rétablissement de l’autorité du gouvernement démocratiques en Libye et maintient son ferme engagement d’intensifier les efforts visant à régler les conflits et l’instabilité en Libye et en Syrie; souligne que la création d'une stabilité régionale dans les zones de conflit est essentielle pour réduire les flux de déplacement des personnes; |
|
18. |
rappelle que l'objectif de la présente résolution est de répondre aux évènements tragiques survenus récemment en Méditerranée et aux conclusions du Conseil européen du 23 avril 2015 tout en proposant un ensemble de mesures urgentes à adopter immédiatement, sachant que la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente en la matière, s'attelle à élaborer un projet de rapport traduisant les orientations à moyen et à long termes du Parlement sur la question des migrations; |
|
19. |
demande à la Commission d'élaborer et de proposer un programme européen ambitieux dans le domaine des migrations, qui prenne en compte tous les aspects du phénomène; |
|
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0448.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0105.
Jeudi 30 avril 2015
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/51 |
P8_TA(2015)0178
Persécution des chrétiens dans le monde, en liaison avec le meurtre d'étudiants au Kenya par le groupe terroriste Al-Chebab
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la persécution des chrétiens dans le monde, et notamment le meurtre d'étudiants au Kenya par le groupe terroriste Al-Chebab (2015/2661(RSP))
(2016/C 346/08)
Le Parlement européen,
|
— |
vu ses résolutions précédentes sur le Kenya, |
|
— |
vu le deuxième accord de partenariat révisé entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 («accord de Cotonou»), et notamment ses articles 11 et 26, |
|
— |
vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, du 23 novembre 2014 sur le massacre de 28 voyageurs civils et du 3 avril 2015 sur la boucherie de l'université de Garissa, |
|
— |
vu le communiqué de presse du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA) publié lors de sa 497e réunion du 9 avril 2015 concernant l'attaque terroriste commise à Garissa, au Kenya, |
|
— |
vu le raid effectué par la force aérienne kényane sur des camps d'entraînement d'Al-Chebab en Somalie en réaction au carnage de l'université de Garissa, |
|
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme, |
|
— |
vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, |
|
— |
vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, |
|
— |
vu les lignes directrices de l'Union européenne sur le droit humanitaire international, |
|
— |
vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que le dernier attentat terroriste en date commis à Garissa, au Kenya, a ciblé les jeunes, l'éducation et donc l'avenir du pays; que les jeunes représentent l'espoir et la paix, et qu'ils sont les garants du futur développement du pays; que l'éducation est essentielle pour lutter contre l'extrémisme violent et contre le fondamentalisme; |
|
B. |
considérant que le nombre d'attaques visant des minorités religieuses de par le monde, en particulier les chrétiens, a connu une augmentation exponentielle ces derniers mois; que des chrétiens sont, tous les jours, massacrés, battus et arrêtés par des terroristes djihadistes, le plus souvent dans certaines régions du monde arabe; |
|
C. |
considérant que les chrétiens constituent la communauté religieuse la plus persécutée; que l'extrémisme et ce type de persécution s'affirment comme des éléments forts accompagnant le phénomène, qui se développe, de la migration de masse; que les chiffres montrent que le nombre de chrétiens assassinés chaque année dépasse les 150 000; |
|
D. |
considérant que Daech/EI a décapité 21 chrétiens coptes égyptiens le 15 février 2015 en Libye; |
|
E. |
considérant que les assaillants de Garissa ont intentionnellement ciblé des non-musulmans et choisi les chrétiens pour les exécuter de manière brutale; que Al-Chebab a ouvertement et publiquement affirmé vouloir faire la guerre aux chrétiens de la région; |
|
F. |
considérant que la protection des droits des enfants et des jeunes et le renforcement des compétences, de l'éducation et de l'innovation sont d'une importance primordiale pour améliorer leurs possibilités économiques, sociales et culturelles et pour stimuler le développement du pays; |
|
G. |
que Al-Chebab a régulièrement visé des étudiants, des écoles et d'autres établissements d'enseignement; qu'en décembre 2009 notamment, un attentat suicide a causé la mort de 19 personnes lors de la remise des diplômes des étudiants en médecine de Mogadiscio, en Somalie, et que, en octobre 2011, ce groupe terroriste a revendiqué un attentat à la bombe qui a tué 70 personnes, notamment des étudiants attendant le résultat de leur examen au ministère somalien de l'éducation, également à Mogadiscio; |
|
H. |
considérant que, le 25 mars 2015, 15 personnes au moins ont péri dans un attentat commis par Al-Chebab dans un hôtel de Mogadiscio et que Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, le représentant permanent de la Somalie aux Nations unies à Genève, en Suisse, a été l'une des victimes de cet attentat; |
|
I. |
considérant que le Kenya est confronté à un nombre croissant d'attaques visant des civils depuis octobre 2011, date à laquelle ses troupes sont entrées dans le sud de la Somalie pour participer, au côté des forces armées somaliennes, à une opération coordonnée dans une zone contrôlée par Al-Chebab, et ce après la prise de quatre otages; |
|
J. |
considérant que, depuis novembre 2011, des troupes kényanes participent à la mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM), créée le 19 janvier 2007 par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et autorisée le 20 février 2007 par le Conseil de sécurité des Nations unies (résolution 1744(2007)13), celui-ci ayant récemment donné le feu vert à l'UA pour poursuivre sa mission jusqu'au 30 novembre 2015 (résolution 2182(2014)); |
|
K. |
considérant que l'armée éthiopienne et, dans une moindre mesure, l'armée ougandaise ont apporté certaines des contributions les plus importantes à la lutte contre le groupe terroriste Al-Chebab; |
|
L. |
considérant qu'Al-Chebab a noué des liens avec d'autres groupes islamistes en Afrique, tels que Boko Haram au Nigeria et Al-Qaida au Maghreb islamique; |
|
M. |
considérant que le groupe terroriste Al-Chebab lance régulièrement des attentats à la bombe et tue principalement des civils en Somalie ainsi que dans les pays voisins, par exemple à Kampala, en Ouganda, en juillet 2010, et nettement plus souvent au Kenya, où seuls les attentats de grande envergure ont attiré l'attention de la communauté internationale, mais où des attentats de moindre envergure ne cessent de se produire; |
|
N. |
considérant qu'Al-Chebab a revendiqué les raids lancés en juillet 2014 contre les villages d'Hindi, Gamba, Lamu et de Tana River sur la côte kényane, au cours desquels plus de 100 personnes ont été exécutées, ainsi que deux attaques dans le comté de Mandela fin 2014 qui ont fait 64 victimes; |
|
O. |
considérant que, au lendemain de l'attaque terroriste de l'université de Garissa, le gouvernement kényan a menacé l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de fermer dans les trois mois le camp de réfugiés de Dadaab; que le HCR a mis en garde contre les conséquences pratiques et humanitaires terribles d'une telle décision; que la convention des Nations unies relatives au statut des réfugiés interdit le retour forcé des réfugiés dans des régions où leur vie ou leur liberté est menacée; |
|
P. |
considérant que la Force africaine en attente (FAA) n'est pas encore opérationnelle, et que l'Union européenne a exprimé sa volonté de soutenir les capacités africaines de maintien de la paix dans le cadre de sa stratégie de sécurité pour l'Afrique; |
|
Q. |
considérant que, aux termes de l'article 11 de l'accord de partenariat ACP-UE, «les activités dans le domaine de la consolidation de la paix, de la prévention et du règlement des conflits visent notamment à assurer un équilibre des opportunités politiques, économiques, sociales et culturelles offertes à tous les segments de la société, à renforcer la légitimité démocratique et l’efficacité de la gestion des affaires publiques, à établir des mécanismes efficaces de conciliation pacifique des intérêts des différents groupes, […] à combler les fractures entre les différents segments de la société ainsi qu’à encourager une société civile active et organisée», |
|
1. |
condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste perpétrée délibérément par Al-Chebab le 2 avril 2015 à Garissa qui s'est soldée par 147 jeunes étudiants innocents assassinés et 79 blessés; condamne avec force toutes les violations des droits de l'homme, notamment l'assassinat de personnes en raison de leur religion, de leurs convictions ou de leur origine ethnique; |
|
2. |
condamne une fois de plus les attaques menées par Al-Chebab durant l'été 2014 contre plusieurs villages côtiers du Kenya, parmi lesquels Mpeketoni, où 50 personnes ont été exécutées; condamne avec force l'attaque du centre commercial Westgate de Nairobi le 24 septembre 2013, où 67 corps ont été découverts; condamne l'attaque d'Al-Chebab du 25 mars 2015 à Mogadiscio qui a vu la mort de l'épouse de S.E. Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, représentant permanent de la Somalie auprès des Nations unies à Genève; |
|
3. |
présente ses condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la République du Kenya; est solidaire de la population du Kenya face à ces agressions abjectes; |
|
4. |
rappelle que la liberté de religion est un droit fondamental et condamne avec fermeté toute forme de violence ou de discrimination fondée sur la religion; |
|
5. |
condamne les récentes attaques commises dans différents pays contre les communautés chrétiennes, notamment le fait que 12 chrétiens aient été jetés à la mer lors de la récente traversée d'une embarcation venant de Libye, ainsi que le massacre de 30 chrétiens éthiopiens le 19 avril 2015; exprime sa solidarité avec les familles des victimes; |
|
6. |
exprime sa grande préoccupation face à l'invocation abusive de la religion par les auteurs d'actes terroristes dans plusieurs régions du monde et fait part de sa profonde inquiétude face à la prolifération des actes d'intolérance, de répression et de violence visant les chrétiens, notamment dans certaines régions du monde arabe; dénonce l'instrumentalisation de la religion dans divers conflits politiques; condamne le nombre croissant d'attaques contre des églises de par le monde, notamment l'attaque qui a tué 14 personnes au Pakistan le 15 mars 2015; condamne avec force l'incarcération, la disparition, la torture, la réduction en esclavage et l'exécution publique de chrétiens en Corée du Nord; confirme et promeut le droit inaliénable de toutes les minorités religieuses et ethniques d'Iraq et de Syrie, dont les chrétiens, de continuer à vivre sur leurs terres d'origine dans des conditions dignes, sur un pied d'égalité et en sécurité; observe que les membres de différentes communautés religieuses ont cohabité en paix dans la région pendant des siècles; |
|
7. |
invite instamment les institutions de l'Union européenne à respecter l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 17 du traité FUE de maintenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises et les associations ou communautés religieuses ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles, afin de veiller à ce la question de la persécution des communautés chrétiennes et des autres communautés religieuses soit une priorité de l'Union; |
|
8. |
condamne l'utilisation, par Daech/EI, d'une ancienne loi (dhimmi) en Syrie et en Iraq pour assujettir les chrétiens à un impôt religieux et à certaines restrictions sous peine de mort; |
|
9. |
réaffirme sa solidarité avec tous les chrétiens persécutés dans différentes régions d'Afrique, notamment au regard des récentes atrocités commises en Libye, au Nigeria et au Soudan; |
|
10. |
condamne et rejette toute interprétation erronée d'un message de l'islam censé véhiculer une idéologie violente, cruelle, totalitaire, opprimante et expansionniste, justifiant l'extermination des minorités chrétiennes; invite instamment les responsables musulmans à condamner sans réserve l'ensemble des attaques terroristes, notamment celles visant les communautés et les minorités religieuses, en particulier les chrétiens; |
|
11. |
demande qu'une enquête rapide, impartiale et efficace soit diligentée afin d'identifier les responsables et de traduire en justice les auteurs, les organisateurs, les bailleurs de fonds et les complices qui facilitent ces actes répréhensibles; |
|
12. |
reconnaît que la vraie réponse doit être organisée autour d'actions coordonnées menées avec d'autres pays africains, et invite la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que le Conseil à lutter contre les menaces pour la sécurité et les menaces terroristes dans cette région en collaboration avec l'Union africaine à l'appui des efforts vitaux déployés par l'UA pour combattre Al-Chebab par le biais de la mission AMISOM; prie instamment l'Union européenne de soutenir la mise en place de mécanismes continentaux et régionaux de gestion des conflits, et notamment la Force africaine en attente (FAA); |
|
13. |
invite le gouvernement kényan à prendre ses responsabilités en luttant contre les violences auxquelles se livre Al-Chebab et en s'attaquant à leurs causes profondes; estime que la sécurité ne peut être assurée qu'en s'attaquant, comme il se doit, aux divisions au sein des sociétés politiques et civiles du Kenya, ainsi qu'à ses déséquilibres régionaux en matière de développement; déplore la réponse tardive des forces de police; prie instamment, en particulier, le gouvernement de s'efforcer de ne pas utiliser les attentats terroristes comme prétexte pour porter atteinte aux libertés civiles; invite les autorités kényanes à axer leur stratégie de lutte contre le terrorisme sur l'état de droit et le respect des droits fondamentaux; insiste sur la nécessité d'un contrôle démocratique et judiciaire des politiques de lutte contre le terrorisme; |
|
14. |
prie instamment les autorités kényanes d'empêcher toute fracture entre les différentes religions et l'assimilation de la communauté musulmane à Al-Chebab, et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour préserver l'unité du pays, dans l'intérêt de sa stabilité et de sa croissance économiques et sociales, et afin de protéger la dignité et les droits fondamentaux de sa population; invite le gouvernement kényan, les dirigeants de l'opposition et les autorités religieuses à répondre aux sentiments de marginalisation hérités de l'histoire, à s'attaquer aux fractures régionales dans le pays et aux discriminations établies, et à veiller à ce que les opérations menées contre le terrorisme ne visent que ceux qui s'en rendent coupables et non des communautés ethniques et religieuses dans leur ensemble; |
|
15. |
rappelle au Service européen pour l'action extérieure et aux États membres qu'ils se sont engagés, dans le plan d'action de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie adopté en juin 2012, à veiller à ce que les droits de l'homme figurent à l'avant-plan de toutes les formes de dialogue avec les pays tiers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme; |
|
16. |
invite l'Union européenne à mettre en œuvre un programme de formation militaire au Kenya, à fournir des équipements modernes, à collaborer avec les forces armées et la police kényanes et à les former afin de lutter contre le terrorisme et d'empêcher l'expansion d'Al-Chebab; |
|
17. |
prie instamment le gouvernement kényan de tout mettre en œuvre pour respecter l'état de droit, les droits de l'homme, les principes démocratiques et les libertés fondamentales, et demande à l'Union de guider son partenaire international dans cette voie et de réunir une contribution financière pour renforcer les programmes de gouvernance existants afin de garantir la sécurité nationale et de ramener la paix et la stabilité dans le pays et dans la région; insiste sur la nécessité de combattre le déchaînement de violence d'Al-Chebab en collaboration avec les pays voisins; demande à l'Union de fournir tout l'appui financier, logistique et spécialisé nécessaire à cet effet, en offrant notamment la possibilité de recourir à la Facilité de paix pour l'Afrique et aux outils européens de gestion de crise; |
|
18. |
demande aux forces de sécurité kényanes de combattre la menace terroriste par des moyens légaux; invite le gouvernement kényan à garantir la sécurité et la protection des camps de réfugiés situés sur son territoire; |
|
19. |
souligne que le terrorisme international est financé par le blanchiment de capitaux, par le paiement de rançons, par l'extorsion de fonds, par le trafic de stupéfiants et par la corruption; demande à la Commission et aux États membres de renforcer leur collaboration avec les pays tiers en matière d'échange de renseignements relatifs au blanchiment d'argent dans le cadre du financement du terrorisme; |
|
20. |
réitère son soutien à toutes les initiatives visant à promouvoir le dialogue et le respect mutuel entre les communautés religieuses et les autres communautés; invite toutes les autorités religieuses à promouvoir la tolérance et à prendre des initiatives contre la haine et la radicalisation violente et extrémiste; |
|
21. |
dénonce le fait que des établissements et des locaux d'enseignement aient été la cible d'attaques terroristes destinées à porter atteinte tant à l'éducation qu'à la dignité de tous les citoyens et à instiller un climat de méfiance et de division entre les communautés; rappelle l'enlèvement et la disparition de jeunes filles chrétiennes dans la ville nigériane de Chibok par le groupe terroriste djihadiste Boko Haram en 2014, actes qui ont été condamnés dans le monde entier; |
|
22. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement du Kenya, aux institutions de l'Union africaine, à l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), au Secrétaire général des Nations unies, à l'Assemblée générale des Nations unies et aux coprésidents de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. |
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/55 |
P8_TA(2015)0179
Destruction de sites culturels par le groupe État islamique
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique (2015/2649(RSP))
(2016/C 346/09)
Le Parlement européen,
|
— |
vu les questions avec demande de réponse orale adressées au Conseil et à la Commission sur la destruction de sites culturels par le groupe État islamique (O-000031/2015 — B8-0115/2015 et O-000032/2015 — B8-0116/2015), |
|
— |
vu l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que «l'action de l'Union vise à encourager la coopération entre États membres», notamment dans le domaine de «la conservation et la sauvegarde du patrimoine culturel d'importance européenne» et que «l'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture», |
|
— |
vu le règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (1), |
|
— |
vu le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) no 2465/1996 du Conseil (2), |
|
— |
vu le règlement (UE) n 1332/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (3), adopté sur la base de la décision 2013/760/PESC du Conseil du 13 décembre 2013 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (4), et notamment son article 11 quater relatif à l'importation, à l'exportation ou au transfert de biens culturels syriens, |
|
— |
vu l'action commune 2001/555/PESC du Conseil du 20 juillet 2001 relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (5), modifiée par l'action commune 2009/834/PESC du Conseil (6), |
|
— |
vu la résolution du Conseil d'octobre 2012 sur la création d'un réseau informel d'autorités et d'experts en matière répressive, compétents dans le domaine des biens culturels (EU CULTNET) (14232/2012), |
|
— |
vu le deuxième protocole de 1999 relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, |
|
— |
vu la convention de l'Unesco du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, |
|
— |
vu la convention de l'Unesco du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, |
|
— |
vu la convention de l'Unesco du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, |
|
— |
vu la convention de l'Unesco du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, |
|
— |
vu la convention d'Unidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, |
|
— |
vu la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies du 12 février 2015 sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d'actes de terrorisme (7), |
|
— |
vu la charte de Venise de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, qui crée un cadre international pour la préservation et la restauration des bâtiments anciens, |
|
— |
vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, et notamment son article 8, paragraphe 2, point b), sous-point ix), qui dispose que l'acte de «diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires» constitue un crime de guerre, |
|
— |
vu sa résolution du 12 mars 2015 sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde en 2013 et sur la politique de l'Union européenne en la matière (8) et notamment son paragraphe 211, qui dispose que «les formes intentionnelles de destruction du patrimoine culturel et artistique, telles qu'elles se déroulent actuellement en Syrie et en Iraq, devraient être poursuivies en tant que crimes de guerre et crimes contre l'humanité» |
|
— |
vu la communication conjointe au Parlement européen et au Conseil du 6 février 2015 intitulée «Éléments relatifs à une stratégie régionale de l'UE pour la Syrie et l'Iraq ainsi que pour la menace que constitue Daech» (JOIN(2015)0002), dans laquelle la Commission et la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité reconnaissent la gravité des destructions et des pillages de biens culturels dans le cadre des actions visant à mettre un terme aux crises en Syrie et en Iraq et à lutter contre la menace que constitue Daech, |
|
— |
vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que de nombreux sites archéologiques, religieux et culturels en Syrie et en Iraq ont récemment fait l'objet de destructions ciblées par des groupes d'extrémistes liés notamment au groupe État islamique (EI), et que la directrice générale de l'Unesco, Mme Irina Bokova, a qualifié ces attaques systématiques contre le patrimoine culturel de «nettoyage culturel»; |
|
B. |
considérant que selon l'Unesco, l'expression «nettoyage culturel» désigne une stratégie visant à supprimer intentionnellement la diversité culturelle en ciblant délibérément des personnes en fonction de leur appartenance culturelle, ethnique ou religieuse, alliée à des attaques délibérées de leurs lieux de culte, de mémoire et d'enseignement, et que la stratégie de nettoyage culturel que l'on peut observer en Iraq et en Syrie se reflète dans les attaques contre le patrimoine culturel, à la fois contre des expressions de la culture physiques, matérielles et édifiées telles que des monuments et des bâtiments, et contre des minorités et des expressions immatérielles de la culture telles que les coutumes, les traditions et les croyances (9); |
|
C. |
considérant que dans certaines circonstances, des actes de destruction du patrimoine culturel ont déjà été considérés comme des crimes contre l'humanité (10); que, notamment lorsque ces actes sont dirigés contre les membres d'un groupe religieux ou ethnique, ils peuvent être assimilés au crime de persécution, comme l'établit l'article 7, paragraphe 1, point h), du statut de la Cour pénale internationale; |
|
D. |
considérant que de tels actes de destruction de sites et d'objets culturels et historiques ne sont pas un phénomène récent et ne se limitent pas à l'Iraq et à la Syrie; que selon l'Unesco, «le patrimoine culturel est une composante importante de l'identité culturelle des communautés, groupes et individus, et de la cohésion sociale, de sorte que sa destruction intentionnelle peut avoir des conséquences préjudiciables sur la dignité humaine et les droits de l'homme» (11); rappelant que, comme l'a exposé entre autres l'Unesco, le produit du pillage de sites culturels et religieux et du trafic d'objets culturels et religieux en Iraq et en Syrie par l'EI est utilisé pour financer ses activités terroristes, si bien que les objets d'art et culturels deviennent de fait des «armes de guerre»; |
|
E. |
considérant que, grâce aux fonds alloués par l'Union européenne, l'Unesco et d'autres partenaires stratégiques ont lancé, le 1er mars 2014, le projet de «sauvegarde d'urgence du patrimoine syrien» pour une période de trois ans, destiné en particulier à assurer la protection d'urgence du patrimoine culturel syrien; |
|
F. |
considérant que l'Union européenne a ratifié la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée le 20 octobre 2005, qui a été le premier instrument international à reconnaître la double nature, économique et culturelle, des biens culturels, qui «ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale»; |
|
G. |
considérant que la convention de l'Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, adoptée le 17 novembre 1970, et la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée le 24 juin 1995, constituent des instruments essentiels pour renforcer la protection du patrimoine culturel mondial; |
|
H. |
considérant que le commerce illégal de biens culturels occupe désormais la troisième place après celui de la drogue et des armes, que ce commerce illicite est dominé par les réseaux criminels organisés et qu'il manque aux mécanismes nationaux et internationaux en place l'équipement et le soutien nécessaires pour lutter contre ce phénomène (12); |
|
I. |
considérant que, même si la lutte contre le commerce illicite des biens culturels n'est pas une compétence spécifique de l'Union, dans la mesure où elle n'est pas inscrite comme telle dans les traités, elle relève cependant de plusieurs domaines de compétence de l'Union, comme le marché intérieur, l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), la culture et la politique étrangère et de sécurité commune (PESC); |
|
J. |
considérant qu'il est urgent de mieux coordonner la lutte contre le commerce illicite des biens culturels et de collaborer étroitement afin de promouvoir la sensibilisation et le partage d'informations ainsi que de renforcer les cadres juridiques; rappelant, dans ce contexte, que dans ses conclusions de décembre 2011 relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la lutte contre ce phénomène, le Conseil recommandait entre autres aux États membres de renforcer la coordination entre les services répressifs et les autorités chargées de la culture ainsi que les entités privées; |
|
K. |
considérant qu'en octobre 2012, une résolution du Conseil a créé un réseau informel d'autorités et d'experts en matière répressive, compétents dans le domaine des biens culturels (EU CULTNET), dont le principal objectif consiste à renforcer l'échange d'informations pour la prévention du commerce illégal de biens culturels, ainsi qu'à recenser et à partager les informations relatives aux réseaux criminels soupçonnés d'être impliqués dans un tel trafic; |
|
L. |
considérant que le 28 mars 2015, la directrice générale de l'Unesco, Mme Irina Bokova, a lancé à Bagdad la campagne #Unite4Heritage, qui entend mobiliser à l'échelle mondiale un soutien en faveur de la protection du patrimoine culturel grâce à la puissance des réseaux sociaux; |
|
1. |
condamne fermement les destructions de sites culturels, archéologiques et religieux par l'EI en Syrie et en Iraq; |
|
2. |
invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à prendre des mesures appropriées au niveau politique, conformément à la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies du 12 février 2015, afin de mettre fin au commerce illégal des biens culturels dérobés à la Syrie et à l'Iraq durant des périodes de conflit sur ces territoires, de manière à empêcher qu'ils soient utilisés comme sources de financement; |
|
3. |
invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à recourir à la diplomatie culturelle et au dialogue interculturel pour réconcilier les différentes communautés et reconstruire les sites détruits; |
|
4. |
demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l'Union et à ses États membres de mettre en œuvre des mesures de sécurité aux frontières de l'Union pour empêcher que des biens culturels provenant de Syrie ou d'Iraq ne soient introduits illégalement dans l'Union et de collaborer effectivement à une action commune contre le commerce de biens culturels d'origine syrienne ou iraquienne en Europe, étant donné qu'une grande partie du commerce d'œuvres d'art du Moyen-Orient est actuellement destinée au marché européen, aux États-Unis et aux pays du Golfe; |
|
5. |
suggère, dans ce contexte, que conformément au paragraphe 17 de la résolution 2199 du Conseil de sécurité des Nations unies du 12 février 2015, la Commission se concentre sur la lutte contre le commerce illégal des biens culturels, notamment en ce qui concerne les pièces du patrimoine culturel sorties illégalement d'Iraq depuis le 6 août 1990 et de Syrie depuis le 15 mars 2011; invite la Commission à définir une stratégie coordonnée de lutte contre ce commerce illicite en collaboration avec les responsables nationaux des services d'enquête et en étroite collaboration avec l'Unesco et d'autres organisations internationales comme le Conseil international des musées (ICOM), le comité international du bouclier bleu de l'ICOM (ICBS), Europol, Interpol, l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), l'Organisation mondiale des douanes (OMD), le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) et le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM); |
|
6. |
invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à faire intervenir le Centre satellitaire de l'Union européenne basé à Torrejón, dont la mission est de soutenir le processus décisionnel de l'Union dans le cadre de la PESC en fournissant du matériel résultant de l'analyse de l'imagerie satellitaire, ce afin de surveiller et de recenser les sites archéologiques et culturels de Syrie et d'Iraq ainsi que de soutenir les activités des archéologues syriens dans le but d'empêcher tout nouveau pillage et de protéger la vie des civils; |
|
7. |
demande à la Commission de mettre en place un mécanisme rapide et sécurisé d'échange d'informations et de partage de bonnes pratiques entre les États membres afin de combattre avec succès le commerce illicite de biens culturels sortis illégalement d'Iraq et de Syrie, et lui demande de prier instamment les États membres d'utiliser les instruments internationaux de lutte contre le trafic illicite de biens culturels dont disposent les services policiers et douaniers, comme la base de données spécialisée I-24/7 d'Interpol pour les œuvres d'art volées ou l'outil de communication en ligne du programme ARCHEO de l'Organisation mondiale des douanes; |
|
8. |
demande que soit envisagée la mise en place de programmes européens de formation à l'intention des magistrats, des agents de police et des douanes, des administrations publiques et des acteurs du marché en général, afin de permettre aux personnes chargées de la lutte contre le commerce illicite de biens culturels de développer et d'améliorer leur expertise, mais aussi afin de soutenir les initiatives telles que le programme de formation en ligne pour les professionnels du patrimoine syrien mis en place par l'Icomos en janvier 2013, lequel enseigne la gestion du risque de catastrophe, les premières mesures d'urgence à prendre pour les collections culturelles et les techniques de documentation; |
|
9. |
invite la Commission à s'associer à des projets internationaux mis en place par des organisations de la société civile pour la protection des biens culturels en péril et l'information en la matière, tels que le projet de l'Association américaine pour l'avancement des sciences (AAAS) sur les technologies géospatiales, et à continuer à soutenir les activités des communautés de chercheurs, telles que le projet Mossoul conçu par le programme Initial Training Network for Digital Cultural Heritage (financé par une bourse des actions Marie Skłodowska-Curie); |
|
10. |
demande à la Commission de soutenir davantage l'Observatoire international du trafic illicite des biens culturels du Conseil international des musées (ICOM), qui a publié une liste rouge d'urgence des antiquités syriennes et iraquiennes en péril afin d'aider les musées, les agents des douanes et de police, les négociants en œuvres d'arts et les collectionneurs et qui compte se servir de l'imagerie satellite pour surveiller la situation sur le terrain, en coopération avec l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (Unitar); |
|
11. |
invite l'Union européenne et les États membres à lancer des campagnes de sensibilisation afin de dissuader d'acheter ou de vendre des biens culturels provenant de zones de conflit et issus du commerce illégal; |
|
12. |
demande aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour associer les universités, les organismes de recherche et les institutions culturelles, notamment à travers des codes de déontologie, à la lutte contre le commerce illégal de biens culturels provenant de zones de conflit; |
|
13. |
demande à la Commission de soutenir la campagne #Unite4Heritage de l'Unesco en lançant une campagne d'information sur l'Iraq et la Syrie, afin de mieux faire connaître l'importance du patrimoine culturel de ces pays, la façon dont le produit des pillages sert à financer les activités terroristes et les sanctions susceptibles d'être associées à l'importation illicite de biens culturels originaires de ces pays ou d'autres pays tiers; |
|
14. |
demande à la Commission de renforcer et d'améliorer le fonctionnement du réseau informel d'autorités et d'experts en matière répressive, compétents dans le domaine des biens culturels (EU CULTNET), créé par la résolution du Conseil d'octobre 2012 et dont le but est d'améliorer l'échange d'informations pour la prévention du commerce illicite de biens culturels, ainsi que d'envisager la création d'un instrument supplémentaire de contrôle des importations, dans l'Union européenne, de biens culturels sortis illégalement de Syrie et d'Iraq; |
|
15. |
invite le Conseil à renforcer les unités d'Eurojust et d'Europol chargées d'appuyer les enquêtes en cours, la prévention et l'échange de renseignements sur le commerce illégal de biens culturels; |
|
16. |
encourage la relance des activités du comité international du bouclier bleu de l'ICOM; |
|
17. |
demande à l'Union européenne de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec l'Unesco et la Cour pénale internationale, afin que la catégorie des crimes contre l'humanité dans le droit international soit élargie et inclue les actes délibérés de dégradation ou de destruction à grande échelle du patrimoine culturel de l'humanité; |
|
18. |
demande aux États membres qui ne l'ont pas encore fait de ratifier la convention de l'Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, la convention d'Unidroit de 1995 ainsi que la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et son deuxième protocole de 1999; |
|
19. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la directrice générale de l'Unesco, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 39 du 10.2.2009, p. 1.
(2) JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.
(3) JO L 335 du 14.12.2013, p. 3.
(4) JO L 335 du 14.12.2013, p. 50.
(5) JO L 200 du 25.7.2001, p. 5.
(6) JO L 297 du 13.11.2009, p. 18.
(7) http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc= y&docid=54ef1f934.
(8) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0076.
(9) http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/.
(10) Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Kordić et Čerkez, 26 février 2001, IT-95-14/2, points 207 et 208.
(11) Déclaration de l'Unesco de 2003 concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel.
(12) http://www.africa-eu-partnership.org/fr/newsroom/all-news/maroc-atelier-dechanges-sur-la-protection-des-biens-culturels-contre-le-pillage-le.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/60 |
P8_TA(2015)0180
Situation aux Maldives
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la situation dans les Maldives (2015/2662(RSP))
(2016/C 346/10)
Le Parlement européen,
|
— |
vu ses précédentes résolutions sur les Maldives, |
|
— |
vu la déclaration locale conjointe de l'Union européenne du 20 janvier 2012 sur l'évolution récente aux Maldives, dont l'arrestation d'un juge pénal, |
|
— |
vu la déclaration locale conjointe de l'Union européenne du 30 septembre 2014 sur les menaces pour la société civile et les droits de l'homme aux Maldives, |
|
— |
vu la déclaration locale conjointe de l'Union européenne du 24 février 2015 sur l'état de droit aux Maldives, |
|
— |
vu la déclaration du porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 30 avril 2014 sur l'application de la peine de mort aux Maldives, |
|
— |
vu la déclaration de la porte-parole de la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 14 mars 2015 sur la condamnation de l'ancien président des Maldives, M. Mohamed Nasheed, |
|
— |
vu la déclaration du haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, du 18 mars 2015 sur le procès de l'ancien président Mohamed Nasheed, |
|
— |
vu la déclaration du 19 mars 2015 de la rapporteure spéciale de l'ONU, Gabriela Knaul, sur l'indépendance des juges et des avocats, selon laquelle aucune démocratie n'est possible aux Maldives sans une justice indépendante et équitable, |
|
— |
vu le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne du 22 mars 2014 sur les élections législatives aux Maldives, |
|
— |
vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel les Maldives sont partie, |
|
— |
vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que, le 13 mars 2015, Mohamed Nasheed, ancien président des Maldives, a été condamné pour terrorisme à treize ans d'emprisonnement pour avoir fait arrêter en janvier 2012 le président de la cour pénale; que l'Union s'est déclarée préoccupée par cette condamnation; |
|
B. |
considérant que le procès controversé ne s'est pas déroulé conformément aux normes judiciaires nationales et internationales, bien que l'ONU et l'Union européenne aient réclamé une procédure juste et transparente à l'encontre de l'ancien président; |
|
C. |
considérant que Mohamed Nasheed, militant non violent de longue date prônant la défense des droits de l'homme et le pluralisme démocratique, a été incarcéré plusieurs fois durant les trente ans qu'a duré le régime dictatorial du président Maumoon Abdul Gayoon et a quitté le pouvoir quatre ans après avoir été le premier président élu démocratiquement aux Maldives; |
|
D. |
considérant que l'absence d'indépendance politique et de formation de la justice maldivienne nuisent à la crédibilité nationale et internationale du système judiciaire du pays; |
|
E. |
considérant que les anciens ministres de la défense, Tholhath Ibrahim et Mohamed Nazim, ont récemment été condamnés respectivement à 10 et 11 ans de prison, et que l'ancien vice-président du Parlement, Ahmed Nazim, a été condamné à 25 ans de prison; que ces procès auraient également été entachés d'irrégularités; |
|
F. |
considérant que les personnalités politiques de l'opposition continuent de faire l'objet d'intimidations systématiques et qu'un récent rapport du comité des droits de l'homme des parlementaires de l'union interparlementaire a reconnu les Maldives comme étant l'un des pires pays du monde en matière d'agressions, de tortures et de manœuvres d'intimidation à l'encontre des parlementaires de l'opposition; |
|
G. |
considérant que, le 30 mars 2015, le Parlement maldivien a adopté un amendement à la loi sur les peines de prison et la libération conditionnelle, interdisant aux détenus d'adhérer à un parti politique; que cet amendement entraînera de facto l'éviction de Mohamed Nasheed de la vie politique et l'empêchera de se présenter à l'élection présidentielle de 2018; |
|
H. |
considérant qu'au moins 140 manifestants pacifiques ont été arrêtés depuis février 2015 et qu'ils n'ont été libérés que dans des conditions qui limitent fortement leurs droits de participer à d'autres manifestations; |
|
I. |
considérant que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l'homme sont de plus en plus souvent confrontés au harcèlement, à des menaces et à des attaques, y compris la commission des droits de l'homme des Maldives (CDHM), qui a été traduite devant la Cour suprême pour haute trahison et atteinte à la Constitution après avoir présenté un rapport sur la situation des droits de l'homme en vue de l'examen périodique universel du conseil des droits de l'homme de l'ONU; que des ONG ont été menacées de radiation; |
|
J. |
considérant que la liberté de la presse a été considérablement réduite ces dernières années, que trois journalistes ont été arrêtés alors qu'ils couvraient les manifestations politiques organisées pour réclamer la libération de Mohamed Nasheed, et que Ahmed Rilwan, journaliste ayant critiqué le gouvernement a disparu en août 2014, n'a toujours pas été retrouvé et pourrait être mort; |
|
K. |
considérant que l'agitation politique vient s'ajouter à l'inquiétude qui règne sur l'augmentation du nombre de militants islamistes aux Maldives et le nombre de jeunes hommes radicalisés qui auraient rejoint le groupe «État islamique»; |
|
L. |
considérant que, le 27 avril 2014, le Parlement des Maldives, en votant la fin du moratoire sur la peine de mort qui était en vigueur depuis 1954, a autorisé la condamnation des mineurs dès l'âge de sept ans, lesquels peuvent être tenus responsables et exécutés dès leur dix-huitième anniversaire et croupissent en prison jusqu'à leur exécution; que cette situation est contraire aux obligations internationales en matière de droits de l'homme qui incombent aux Maladives en tant qu'État partie à la convention relative aux droits de l'enfant; |
|
M. |
considérant que les travailleurs immigrés sont soumis au travail forcé, se voient confisquer leurs documents d'identité et de voyage et retenir tout ou partie de leurs salaires, sont soumis au système de servitude pour dettes, et ont été menacés d'expulsion par les autorités maldiviennes pour avoir protesté contre les discriminations et les violences à la suite d'une série d'attaques contre les travailleurs immigrés; |
|
N. |
considérant qu'un petit nombre de femmes originaires du Sri Lanka, de Thaïlande, d'Inde, de Chine, des Philippines, d'Europe de l'Est, des anciennes républiques soviétiques, du Bangladesh et des Maldives sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle aux Maldives, et que certains enfants maldiviens seraient la cible d'abus sexuels et seraient soumis au travail forcé; |
|
1. |
exprime sa profonde inquiétude face aux dérives autoritaires de plus en plus marquées aux Maldives, à la répression des opposants politiques et à l'intimidation des médias et de la société civile, ce qui pourrait mettre en péril les progrès accomplis ces dernières années dans l'établissement des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans le pays; demande à toutes les parties d'éviter toute action risquant d'aggraver cette crise, et de respecter la démocratie et l'état de droit; |
|
2. |
déplore les graves irrégularités dans le procès de l'ancien président Mohamed Nasheed; exige que ce dernier soit immédiatement libéré et que ces droits, si sa condamnation est renvoyée en appel, soient pleinement respectés, conformément aux obligations internationales qui incombent aux Maldives, à la Constitution du pays et à toutes les garanties d'un procès équitable reconnues par la communauté internationale; demande instamment à la délégation de l'Union au Sri Lanka et aux Maldives de réclamer l'autorisation de suivre de près la procédure d'appel; |
|
3. |
souligne que le respect de l'état de droit, le droit à un procès équitable, la régularité de la procédure judiciaire régulière et l'indépendance de l'appareil judiciaire, conformément aux dispositions du PIDCP, sont des éléments fondamentaux du processus démocratique; rappelle que tout citoyen maldivien, y compris l'ancien président Nasheed, doit être traité conformément à ces principes, qui jouent un rôle important dans une société pluraliste; |
|
4. |
demande un processus politique crédible et ouvert qui associe toutes les forces démocratiques, en vue de restaurer et de préserver la stabilité aux Maldives et de remettre le pays sur la voie de la transition démocratique; demande l'arrêt immédiat des actes d'intimidation des opposants politiques; demande au gouvernement maldivien de prendre les mesures qui s'imposent pour rétablir la confiance dans l'engagement qu'il a pris en faveur de la démocratie, de l'indépendance judiciaire et de l'état de droit, y compris le respect des libertés d'expression et de réunion et le respect d'une procédure régulière; |
|
5. |
demande l'arrêt immédiat des ingérences politiques et la dépolitisation du système judiciaire des Maldives; demande des réformes urgentes pour garantir l'indépendance et l'impartialité de la justice maldivienne en vue de restaurer la confiance nationale et internationale dans son fonctionnement; souligne que ces réformes devraient être approuvées et mises en œuvre le plus rapidement possible; |
|
6. |
rappelle au gouvernement maldivien que la Constitution du pays garantit le droit de manifester et que des conditions de libération qui interdisent la participation à une manifestation sont illégales; |
|
7. |
demande la fin immédiate de toute forme de violence contre les manifestants pacifiques et rappelle aux forces de sécurité qu'il est de leur devoir de protéger les manifestants pacifiques contre les bandes violentes; demande au gouvernement maldivien de mettre fin à l'impunité des milices ayant recours à la violence contre les personnes militant pour la tolérance religieuse, contre les manifestants pacifiques, contre les médias critiques et contre la société civile; demande que les auteurs de ces attaques violentes soient traduits en justice; |
|
8. |
demande au gouvernement maldivien d'autoriser l'ouverture d'une enquête en bonne et due forme sur la disparition d'Ahmed Rilwan; |
|
9. |
condamne le rétablissement de la peine de mort aux Maldives et prie instamment le gouvernement et le Parlement des Maldives de réinstituer le moratoire sur la peine de mort; |
|
10. |
encourage tous les protagonistes des Maldives à coopérer de manière constructive dans tous les domaines, et en particulier en matière de changement climatique, lequel est susceptible de déstabiliser le pays; |
|
11. |
demande aux autorités locales de respecter intégralement les normes minimales visant à l'éradication de la traite des êtres humains; se félicite des mesures mises en place pour enrayer ce phénomène et salue les progrès réalisés, mais exige que les dispositions de la loi contre la traite des êtres humaines soient rapidement mises en œuvre car de graves problèmes persistent dans l'application de la loi et dans la protection des victimes; |
|
12. |
demande au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et aux États membres de publier sur leurs sites de conseils aux voyageurs des mises en garde concernant le bilan des Maldives au regard des droits de l'homme; |
|
13. |
prie instamment la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union européenne et le SEAE de continuer à surveiller étroitement la situation politique aux Maldives et de jouer un rôle actif dans les relations bilatérales de l'Union avec le pays et dans les forums multilatéraux afin de rétablir la stabilité, de renforcer la démocratie et l'état de droit, et d'assurer le respect intégral des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays; |
|
14. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux parlements et aux gouvernements des États membres, ainsi qu'au parlement et au gouvernement de la République des Maldives. |
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/63 |
P8_TA(2015)0181
Rapport de suivi 2014 concernant l'Albanie
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur le rapport de suivi 2014 concernant l'Albanie (2014/2951(RSP))
(2016/C 346/11)
Le Parlement européen,
|
— |
vu les conclusions de la Présidence à la suite du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 à Thessalonique concernant la perspective d'adhésion des pays des Balkans occidentaux à l'Union européenne, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 et du Conseil «Affaires générales» du 16 décembre 2014, |
|
— |
vu l'avis de la Commission du 9 novembre 2010 sur la candidature de l'Albanie à l'adhésion à l'Union européenne et le rapport de la Commission du 4 juin 2014 sur les progrès réalisés par l'Albanie dans les domaines de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée et de la réforme judiciaire (COM(2014)0331), |
|
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2014-2015» du 8 octobre 2014 (COM(2014)0700), le document de travail des services de la Commission intitulé «Albania 2014 Progress Report» qui l'accompagne (SWD(2014)0304), ainsi que le document de stratégie indicatif pour les années 2014-2020, adopté le 18 août 2014, |
|
— |
vu la résolution du Parlement albanais du 24 décembre 2014 sur l'accord politique entre la majorité au pouvoir et l'opposition, |
|
— |
vu ses résolutions antérieures sur l'Albanie, |
|
— |
vu les travaux de Knut Fleckenstein en tant que rapporteur permanent de la commission des affaires étrangères sur l'Albanie, |
|
— |
vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement, |
|
A. |
considérant que, ces dernières années, l'Albanie a réalisé des progrès spectaculaires sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et qu'elle a donc obtenu le statut de pays candidat en juin 2014; que des difficultés persistent et doivent être surmontées rapidement et efficacement pour que l'Albanie puisse progresser sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne; |
|
B. |
considérant que l'adoption systématique et la réalisation de réformes à long terme dans les cinq domaines prioritaires participent à la transformation démocratique de l'Albanie et ouvrent la voie aux négociations d'adhésion à l'Union européenne; que le processus d'adhésion à l'Union européenne est devenu un moteur pour les réformes en Albanie et que son calendrier sera déterminé par le rythme et par la qualité des réformes en Albanie; que l'ouverture des négociations d'adhésion stimulerait de nouvelles réformes en offrant une perspective européenne tangible et crédible; |
|
C. |
considérant que l'adhésion à l'Union européenne est un processus global qui s'applique à l'ensemble du pays candidat et concerne tous ses citoyens; que, sur la durée, un dialogue politique constructif sur les réformes liées à l'Union européenne, mené dans un esprit de coopération et de compromis entre les principales forces politiques, est crucial pour progresser davantage dans le processus d'adhésion; que le processus d'intégration à l'Union européenne bénéficie d'un consensus politique et d'un vaste soutien populaire; que le succès du programme des réformes dépend dans une large mesure de l'existence d'un environnement politique démocratique; |
|
D. |
considérant que le Parlement européen a joué un rôle important dans les efforts visant à mettre en place un climat politique sain dans le pays; |
|
E. |
considérant que l'Union européenne a placé l'état de droit au cœur de son processus d'élargissement; que des progrès tangibles concernant l'indépendance de la justice et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée sont indispensables pour l'avancement du processus d'intégration; qu'un soutien politique fort est essentiel pour réaliser des progrès dans ces domaines; |
|
F. |
considérant que des étapes importantes dans les réformes et la mise en œuvre des réformes du système judiciaire sont nécessaires; que, malgré les progrès accomplis, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée représente encore un défi majeur; que la liberté d'expression et l'indépendance des médias restent à garantir; |
|
G. |
considérant que l'existence d'une administration publique professionnelle, efficace et fondée sur le mérite constitue la base du processus d'intégration pour tout pays souhaitant devenir membre de l'Union européenne; |
|
H. |
considérant que les relations de l'Albanie avec ses voisins sont constructives et qu'elles sont conformes en tous points à la politique étrangère de l'Union européenne; |
|
1. |
se félicite que l'Albanie ait obtenu le statut de pays candidat; souligne qu'il convient de considérer cette étape comme une incitation à poursuivre les efforts de réforme; exprime son soutien indéfectible au processus d'intégration de l'Albanie à l'Union européenne; estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures concrètes et de faire preuve d'un engagement politique dans la durée pour consolider la transformation démocratique et poursuivre avec succès les réformes inhérentes au processus d'adhésion à l'Union européenne; encourage l'Albanie à aboutir à des résultats convaincants pour ce qui est de ces réformes; |
|
2. |
juge essentiel que tous les partis politiques poursuivent une véritable coopération politique — à savoir notamment qu'ils se livrent une concurrence loyale pour développer les meilleures idées et notions politiques –, et œuvrent à l'avènement d'une culture politique démocratique fondée sur le principe selon lequel les processus politiques démocratiques reposent sur un dialogue et sur la capacité à rechercher et à accepter des compromis; est convaincu que, dans cette perspective, les citoyens auront une plus grande confiance dans les institutions publiques; prie instamment la coalition au pouvoir de faciliter l'exercice par l'opposition de son droit au contrôle démocratique et insiste pour que l'opposition exerce ce droit pleinement et en toute responsabilité; |
|
3. |
salue la création, au titre du dialogue à haut niveau sur les domaines prioritaires, de groupes de travail conjoints ayant pour mission de mettre au point un mécanisme global pour la réalisation des réformes et le suivi des progrès accomplis dans les cinq domaines prioritaires, notamment la réforme des services publics, le renforcement de l'appareil judiciaire, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée ainsi que l'amélioration de la protection des droits de l'homme; encourage les autorités à intensifier leurs efforts dans leur travail sur ces priorités et à établir une base solide pour leur mise en œuvre; |
|
4. |
demande la création à bref délai d'un conseil national ouvert pour l'intégration européenne qui compte parmi ses membres des représentants de la société civile et des institutions indépendantes et qui œuvre en faveur d'un large consensus national sur les réformes liées à l'Union européenne et le processus d'adhésion à l'Union; demande aux autorités compétentes d'informer, de manière exhaustive et en temps utile, les parties intéressées ainsi que le grand public quant au déroulement du processus d'intégration; |
|
5. |
souligne le rôle du Parlement en tant qu'institution démocratique essentielle et demande par conséquent que sa mission de contrôle soit renforcée et que le processus consultatif au sujet des projets de législation soit plus institutionnalisé; salue à cet égard l'adoption, le 5 mars 2015, de la loi révisée sur «le rôle du Parlement dans le processus d'intégration européenne de l'Albanie», de même que la résolution parlementaire, adoptée par consensus le 24 décembre 2014, par laquelle il a été décidé que l'opposition reprendrait ses activités parlementaires tandis que la majorité au pouvoir chercherait à parvenir à un consensus avec l'opposition au sujet des réformes importantes, que les décisions de la Cour constitutionnelle seraient respectées et que la question des personnes aux antécédents judiciaires titulaires ou candidates à des fonctions officielles serait examinée; demande son application rapide dans un esprit constructif; invite tous les partis politiques à renforcer le consensus démocratique, qui est essentiel pour avancer dans la voie de l'adhésion; estime important que toute la société civile de l'Albanie ainsi que les médias et les citoyens tiennent leurs dirigeants pour responsables des conséquences de certaines politiques; |
|
6. |
se déclare préoccupé par le clivage permanent et persistant des forces politiques albanaises, qui risque de torpiller les efforts d'intégration européenne; rappelle à la coalition dirigeante et à l'opposition qu'elles sont toutes les deux garantes, devant les citoyens, du dialogue politique stable, constructif et global qui ouvrira la voie à l'adoption et à la mise en œuvre des réformes clés; demande à la majorité au pouvoir et à l'opposition de poursuivre leurs efforts en vue d'instaurer un véritable dialogue politique et de coopérer de manière constructive; |
|
7. |
souligne qu'une administration publique professionnelle est nécessaire à la réussite de toutes les autres réformes; se félicite, par conséquent, que la loi sur la fonction publique ait commencé à être appliquée et demande que son application se poursuive comme il se doit afin que les capacités administratives soient renforcées, que l'administration publique soit dépolitisée et libérée de la corruption, que les nominations, les promotions et les licenciements soient liés au mérite, et que l'efficacité, la transparence, la responsabilisation, la professionnalisation et la viabilité financière de la fonction publique ainsi que la bonne gouvernance à tous les échelons soient renforcées; demande le renforcement de la gestion des ressources humaines, la mise en place d'un système d'évaluation pour les fonctionnaires et un suivi indépendant de la mise en œuvre de la législation relative à la fonction publique; appelle de ses vœux l'élaboration d'une stratégie globale de réforme de la fonction publique et la poursuite des efforts de dépolarisation et de connaissance du droit et des processus de décision de l'Union européenne; souligne la nécessité de renforcer l'intégrité publique et d'améliorer les services publics ainsi que la gestion des ressources publiques; demande que le public bénéficie d'un meilleur accès aux services et à l'information; se réjouit à cet égard de la nouvelle loi sur l'accès à l'information; demande le renforcement de l'institution du Médiateur, ce qui suppose que ses conclusions et recommandations soient respectées; |
|
8. |
rappelle la nécessité de remédier au morcellement des collectivités locales et de mettre sur pied une structure fonctionnelle de gestion des affaires locales à même de répondre aux besoins des citoyens par une offre de services publics opérationnels; appelle de ses vœux un renforcement de la capacité administrative des collectivités locales, afin de leur permettre d'exercer leurs pouvoirs et de mettre en œuvre la législation d'une façon viable sur le plan financier; demande que la transparence, l'efficacité et le caractère participatif des collectivités locales se traduisent dans les faits; prend acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur le recours juridique contre la réforme relative à la division administrative et territoriale du pays;; |
|
9. |
insiste sur l'importance des élections locales à venir et invite les autorités compétentes à appliquer les recommandations formulées par le BIDDH et la Commission électorale centrale; plaide en faveur du renforcement de l'indépendance et des capacités des organes électoraux; |
|
10. |
souligne la nécessité de renforcer l'état de droit et de réformer l'appareil judiciaire afin d'accroître la confiance de la population et des entreprises dans la justice; salue l'engagement pris par l'Albanie de réformer la justice mais déplore toujours que le fonctionnement de la justice reste confronté à des problèmes tels que la politisation de ses organes, son degré limité de responsabilisation, la corruption à grande échelle, le manque de ressources et le nombre d'affaires en souffrance; rappelle la nécessité d'intensifier les efforts en vue de l'indépendance, de l'efficacité et de la responsabilisation de la justice et d'améliorer le système de nomination et de promotion des juges, des procureurs et des avocats ainsi que la procédure disciplinaire à leur encontre; invite les autorités à poursuivre les réformes dans un esprit de coopération constructive avec l'ensemble des parties prenantes, dont les organisations de la société civile concernées, et à participer à la commission de Venise en élaborant et en mettant en œuvre une stratégie de réforme judiciaire à long terme; |
|
11. |
rappelle la résolution du Parlement albanais de novembre 2013 sur l'intégration européenne du pays, qui a entériné un certain nombre de mesures importantes, essentiellement dans le domaine de l'état de droit; souligne l'importance de respecter rigoureusement l'état de droit et l'indépendance et la transparence des institutions judiciaires comme le Conseil supérieur de la justice; souligne la nécessité de respecter les décisions de la Cour constitutionnelle en la matière; invite les autorités compétentes à promouvoir l'intégrité et l'indépendance des institutions démocratiques fondamentales et à dépolitiser l'appareil judiciaire; demande aux autorités compétentes de rendre justice, sans délai injustifié, aux victimes des événements du 21 janvier 2011; |
|
12. |
attire l'attention sur l'état non satisfaisant de la justice pour mineurs; demande aux autorités responsables d'élaborer des plans en vue d'améliorer la situation; |
|
13. |
se déclare préoccupé par la corruption, qui demeure un grave problème, y compris au sein de la justice; demande instamment à l'Albanie de renforcer sérieusement les mesures de lutte contre la corruption à tous les niveaux et d'améliorer le cadre législatif, les capacités institutionnelles ainsi que les échanges d'informations et la coopération entre les institutions; salue la nomination d'un coordonnateur national pour la lutte contre la corruption qui sera chargé, au niveau central, de coordonner les mesures et de superviser leur application; demande l'adoption d'une stratégie de lutte contre la corruption et de plans d'action pour la période 2014-2020; rappelle la nécessité de développer un cadre de lutte anticorruption plus solide en y incluant un vaste panel d'institutions; se réjouit des mesures prises pour accroître la transparence, dont la publication des déclarations d'intérêt de hauts fonctionnaires, et note avec satisfaction la création, dans tous les ministères, de points de contact pour la lutte contre la corruption; |
|
14. |
rappelle la nécessité de parvenir à des résultats probants dans les enquêtes, poursuites et condamnations à tous les échelons, y compris dans les affaires de corruption à grande échelle; juge essentiel d'améliorer l'efficacité des enquêtes et que les services de lutte contre la corruption puissent compter sur suffisamment de ressources, de formations et de personnels spécialisés, en particulier dans les domaines des marchés publics, de la santé, de la fiscalité, de l'éducation, de la police, des douanes et de l'administration locale; encourage la participation des organisations de la société civile à la lutte contre la corruption et les incite à exercer un rôle d'observateur; préconise le recours systématique aux saisies de biens criminels et aux condamnations pour blanchiment d'argent ainsi que l'ouverture systématique d'enquêtes financières; invite les autorités compétentes à consolider la législation actuelle sur la protection des lanceurs d'alerte; |
|
15. |
se déclare préoccupé par le fait que la lutte contre la criminalité organisée demeure un défi de taille, malgré les avancées dans le domaine, notamment dans la lutte contre le trafic et la production de drogues; invite l'Albanie à élaborer une stratégie globale et à prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à l'efficacité des enquêtes en vue de parvenir à des résultats probants dans les enquêtes, poursuites et condamnations dans tous les secteurs et à tous les niveaux, tout en reconnaissant que les forces de police du pays ont mené récemment des opérations avec succès; encourage le renforcement de la coordination entre agences, y compris à l'échelon local, ainsi que de la coopération policière et judiciaire sur le plan régional et international; recommande de renforcer, en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, la coopération entre les services des États membres et les instances des pays partenaires dans les Balkans occidentaux; |
|
16. |
salue les efforts déployés dans la lutte contre la traite des êtres humains, qui reste un problème de taille; demande aux autorités compétentes d'élaborer une stratégie globale axée sur les victimes afin d'améliorer la coordination interinstitutionnelle et de renforcer les moyens humains (procureurs, juges et policiers); rappelle le besoin, sur la durée, d'activités de formation spécialisées conjointes destinées aux procureurs, aux juges et aux officiers de police; salue la coopération de la police et du bureau du procureur albanais avec les États membres, qui donne de bons résultats; |
|
17. |
félicite le Médiateur pour son travail de promotion des droits de l'homme, son ouverture aux personnes vulnérables et sa coopération avec les organisations de la société civile; déplore le fait que les rapports annuels et spéciaux du Médiateur n'aient pas fait l'objet d'un débat au parlement et qu'ils ne puissent donc pas être publiés et bénéficier d'une reconnaissance officielle; demande au gouvernement et au parlement de renforcer l'indépendance, l'efficience et l'efficacité des structures relatives aux droits de l'homme ainsi que d'accroître la coopération avec les services du Médiateur et de continuer à l'appuyer politiquement et financièrement; |
|
18. |
souligne les problèmes de sécurité liés au retour de combattants étrangers; se félicite des mesures visant à éviter la radicalisation et à faire face au phénomène des combattants étrangers; insiste sur la nécessité de mettre en œuvre la stratégie et le plan d'action de lutte contre le terrorisme; salue l'augmentation du personnel de l'unité de police antiterroriste et souhaite la poursuite de la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme; se félicite du nouvel accord opérationnel conclu avec Europol et demande sa mise en œuvre immédiate; |
|
19. |
souligne la nécessité de renforcer la participation civique dans les affaires publiques et la planification et l'élaboration des politiques ainsi que dans le processus d'intégration européenne afin de susciter un large consensus national sur les réformes et le processus d'adhésion à l'Union européenne; recommande de continuer à mettre au point des mécanismes de consultation de la société civile et des communautés locales, qui permettent aussi à la première de consulter les secondes et inversement; se déclare préoccupé par la politisation des organisations de la société civile, qui peut affaiblir leur rôle dans le développement d'une culture de la démocratie; |
|
20. |
se félicite de l'harmonie entre les religions et du climat général de tolérance religieuse et de bonnes relations interethniques dans le pays; demande aux autorités compétentes de continuer à améliorer le climat d'inclusion et de tolérance pour toutes les minorités du pays; invite le gouvernement à adopter, à l'issue d'un large processus de consultation, une loi générale sur les minorités afin de combler les failles juridiques, conformément aux recommandations du Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l'Europe, ainsi qu'à appliquer avec succès la loi sur la protection contre les discriminations et à bâtir une solide jurisprudence antidiscriminations; salue la contribution du commissaire à la protection contre les discriminations dans la lutte contre les discriminations, notamment fondées sur le genre, en particulier en matière d'emploi, d'éducation et d'accès aux services sociaux; préconise l'adoption d'autres mesures visant à améliorer les conditions de vie des Roms en leur facilitant l'inscription sur les listes électorales ainsi que l'accès au logement, à l'éducation, à l'emploi et aux services sociaux et de santé; souligne que les conditions de vie de la population rom doivent être améliorées via une meilleure coordination entre le gouvernement central et les gouvernement locaux, et par la coopération entre ministères; |
|
21. |
salue la création du conseil national sur l'égalité entre les sexes et la nomination, dans ce domaine, de coordonnateurs dans tous les ministères; réclame d'autres mesures pour éradiquer la violence domestique et résoudre les questions de l'accès difficile des femmes à la justice et du sexisme dans le milieu du travail; se félicite de l'inclusion de la communauté LGBTI dans la stratégie 2015-2020 en faveur de l'inclusion sociale, la création d'un groupe de travail sur les droits des LGBTI au sein du ministère des affaires sociales et de l'ouverture du premier foyer d'hébergement LGBTI; salue l'adoption d'amendements au Code pénal punissant les crimes et discours de haine motivés par des préjugés fondés sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre; |
|
22. |
encourage, en outre, le gouvernement à travailler sur une loi sur la reconnaissance du genre, et à veiller à ce que les conditions de reconnaissance du genre soient conformes aux normes visées par la recommandation CM/Rec(2010) du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre; estime que les droits fondamentaux des personnes LGBTI seront probablement mieux protégés si ces dernières ont accès à des institutions juridiques telles que le concubinage, le partenariat enregistré ou le mariage, et encourage les autorités albanaises à envisager ces options; |
|
23. |
demande aux autorités albanaises de répondre à la demande des Nations unies et aux recommandations du Médiateur en faveur de la création d'une base de données homogène et fiable, d'activer le Conseil de coordination pour la lutte contre les vendettas créé en 2005, et de développer un plan d'action consacré à la question de l'état de droit dans la lutte contre les vendettas; |
|
24. |
souligne l'importance capitale que revêtent les organismes publics de radiodiffusion professionnels, indépendants et pluralistes ainsi que les médias privés, pierres angulaires de la démocratie; s'inquiète du manque de véritable indépendance des médias et de l'opacité en matière de propriété et de financement des médias; encourage l'Albanie à garantir aux journalistes un environnement leur permettant de travailler librement; souligne que des efforts restent à faire pour garantir l'indépendance de l'autorité de régulation des médias et de l'organisme public de radiodiffusion; se déclare préoccupé par le manque de transparence en matière de propriété et de financement des médias, le clivage médiatique et l'autocensure; demande que les journalistes répondent à des normes professionnelles et éthiques plus rigoureuses; demande instamment l'application correcte de la loi sur la diffamation; prend acte du fait que l'élection du nouveau président et des membres du conseil d'administration de l'autorité des médias audiovisuels soit remise en question par l'opposition; encourage le gouvernement à garantir son indépendance et son soutien, de façon à ce que l'autorité puisse pleinement exercer ses fonctions, notamment en ce qui concerne la facilitation du passage au numérique et l'amélioration de l'application de la loi sur les médias audiovisuels; |
|
25. |
se réjouit de l'amélioration du climat des affaires et de la recherche d'une économie de marché fonctionnelle mais demande au gouvernement de continuer à corriger les insuffisances en matière de respect des contrats et d'état de droit et à résoudre le problème immense de l'économie souterraine; demande la poursuite des réformes en vue de faire face à la pression compétitive sur le marché commun européen; invite le gouvernement à renforcer la protection des droits de propriété et à accélérer la mise en place d'une politique cohérente et durable en matière de légalisation, de restitution et de compensation foncières; souligne l'importance de la création de conditions favorables au développement du secteur privé et des investissements étrangers directs; |
|
26. |
souligne la nécessité d'améliorer l'éducation et la formation pour lutter contre l'inadéquation des compétences et augmenter l'employabilité, notamment chez les jeunes; demande à la Commission de travailler en étroite coopération avec le gouvernement afin de résoudre les problèmes liés aux conditions sur le marché du travail, y compris la hausse du chômage, et de proposer des solutions qui cadrent avec la stratégie Europe 2020; salue le document de stratégie indicatif pour l'Albanie (2014-2020), dans lequel il est noté que l'éducation, l'emploi et les politiques sociales sont des secteurs où l'instrument d'aide de préadhésion est nécessaire; |
|
27. |
demande aux autorités compétentes d'élaborer une stratégie énergétique nationale mettant notamment l'accent sur les énergies renouvelables et la sécurité énergétique, notamment la diversification des sources d'énergie; estime que l'Albanie devrait investir davantage dans des projets d'énergie renouvelable et les infrastructures y afférentes; invite l'Albanie à tenir compte de l'incidence écologique des projets hydroélectriques sur le patrimoine naturel national; demande le respect de la directive-cadre de l'Union sur l'eau visant au bon état écologique et chimique de tous les plans d'eau naturels de surface; |
|
28. |
prie instamment les autorités albanaises de développer des plans de gestion complets pour les parcs nationaux dans le respect des lignes directrices relatives à la qualité et à la gestion des aires protégées de catégorie II publiées par la Commission mondiales des aires protégées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN); prie instamment les autorités d'abandonner tout plan de développement portant atteinte au réseau d'aires protégées du pays et demande l'abandon des plans de construction de centrales hydroélectriques de petite et de grande taille, notamment au sein des parcs nationaux; demande plus particulièrement aux autorités de repenser les projets de construction de centrales hydroélectriques sur le cours du fleuve Vjosa et de ses affluents, car ces projets porteraient atteinte à l'un des derniers grands écosystèmes fluviaux intacts et quasiment naturels; |
|
29. |
se félicite que l'Albanie se soit toujours montrée constructive et prompte à prendre des initiatives dans ses relations de coopération régionale et bilatérale; souligne son rôle important dans le renforcement de la stabilité régionale; salue sa volonté politique d'améliorer ses relations avec la Serbie; encourage l'Albanie et la Serbie à prendre de nouvelles mesures et de formuler des déclarations en faveur de la stabilité régionale et de la coopération ainsi que des relations de bon voisinage; se dit préoccupé par les déclarations du premier ministre albanais dans lesquelles ce dernier spéculait sur l'unification des Albanais d'Albanie et du Kosovo; encourage l'Albanie à maintenir sa position constructive dans la région et à échanger avec les autres pays des Balkans occidentaux les connaissances et l'expérience acquises durant leur processus d'adhésion à l'Union européenne, ceci dans le but d'intensifier la coopération et de renforcer la stabilité dans la région; se félicite que l'Albanie ait pleinement respecté les positions de l'Union européenne en matière de politique étrangère, y compris les mesures de restriction à l'égard de la Russie, et qu'elle ait participé aux opérations de gestion de crise relevant de la PSDC; prend acte de ses ambitions à l'heure où le président en exercice du processus de coopération en Europe du Sud-Est encourage de nouveau le dialogue entre pays participants; demande à l'Albanie de contribuer activement à la réalisation de la stratégie de l'Union européenne pour la région de l'Adriatique et de la mer Ionienne; |
|
30. |
demande le renforcement de la coopération interparlementaire entre le Parlement européen et l'Albanie; recommande l'harmonisation, dans la mesure du possible, du prochain calendrier des réunions de la commission parlementaire de stabilisation et d'association UE-Albanie avec celui du dialogue à haut niveau sur les domaines prioritaires, afin de renforcer le contrôle parlementaire du processus d'adhésion à l'Union européenne; |
|
31. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement et au Parlement albanais. |
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/69 |
P8_TA(2015)0182
Rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur le rapport de suivi 2014 concernant la Bosnie-Herzégovine (2014/2952(RSP))
(2016/C 346/12)
Le Parlement européen,
|
— |
vu l'accord de stabilisation et d'association conclu le 16 juin 2008 entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, et ratifié par tous les États membres de l'Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil européen des 19 et 20 juin 2003 sur les Balkans occidentaux et l'annexe intitulée «L'Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne», |
|
— |
vu les conclusions du Conseil du 20 octobre, des 17 et 18 novembre ainsi que des 15 et 16 décembre 2014, |
|
— |
vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2014-2015» du 8 octobre 2014 (COM(2014)0700), ainsi que le document de travail des services de la Commission intitulé «Bosnia and Herzegovina 2014 Progress Report» qui l'accompagne (SWD(2014)0305), et le document de stratégie indicatif sur la Bosnie-Herzégovine (2014-2017) adopté le 15 décembre 2014, |
|
— |
vu l'engagement écrit en faveur de l'intégration européenne adopté par la présidence de la Bosnie-Herzégovine le 29 janvier 2015 et approuvé par l'Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine le 23 février 2015, |
|
— |
vu la décision du Conseil du 19 janvier 2015 portant nomination de Lars-Gunnar Wigemark au poste de représentant spécial de l'Union européenne et de chef de la délégation de l'Union pour la Bosnie-Herzégovine, |
|
— |
vu ses précédentes résolutions sur le pays, |
|
— |
vu le travail accompli par Cristian Dan Preda en tant que rapporteur permanent de la commission des affaires étrangères sur la Bosnie-Herzégovine, |
|
— |
vu l'article 123, paragraphe 2, de son règlement, |
|
A. |
considérant que l'Union européenne a exprimé à plusieurs reprises son attachement sans équivoque à la perspective européenne de la Bosnie-Herzégovine et à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son unité; |
|
B. |
considérant que l'Union européenne offre à la Bosnie-Herzégovine de nouvelles perspectives grâce à une démarche coordonnée visant à aider le pays à reprendre son processus de réforme, à améliorer sa situation sociale et économique et à se rapprocher de l'Union européenne; qu'il est désormais demandé aux élites politiques du pays qu'elles fassent preuve d'un engagement et d'une détermination tout aussi clairs; que l'adhésion à l'Union européenne est un processus global qui s'applique à l'ensemble du pays et de ses citoyens et requiert un consensus national sur le programme de réforme; |
|
C. |
considérant que l'architecture institutionnelle trop complexe et inefficace, le manque de coopération et de coordination entre les dirigeants politiques de la Bosnie-Herzégovine et tous les niveaux de gouvernement, l'absence de vision commune et de volonté politique et les mentalités ethnocentriques ont sérieusement entravé l'évolution du pays; que les désaccords selon des clivages politiques et ethniques ont eu des répercussions négatives considérables sur les travaux des assemblées au niveau national; |
|
D. |
considérant que l'impasse politique prolongée dans laquelle est plongé le pays constitue un sérieux obstacle à sa stabilisation et à son développement et prive ses citoyens d'un avenir sûr et prospère; que l'inertie politique, le chômage, les niveaux très élevés de corruption et le mécontentement à l'égard des élites politiques ont donné lieu à des troubles civils, qui se sont propagés de Tuzla à l'ensemble du pays en février 2014; |
|
E. |
considérant que l'Union européenne a placé l'état de droit au cœur de son processus d'élargissement; qu'un soutien politique fort est indispensable pour réaliser des progrès dans ces domaines; |
|
F. |
considérant que la corruption est généralisée, que l'administration publique est fragmentée, que la multiplicité des systèmes juridiques pose problème, que les mécanismes de coopération avec la société civile restent faibles, que le paysage médiatique est polarisé et que l'égalité des droits n'est pas assurée pour l'ensemble des peuples constitutifs et des citoyens; |
|
G. |
considérant que plus de 50 % des recettes publiques de la Bosnie-Herzégovine servent à assurer le fonctionnement de l'administration à de nombreux niveaux; que, selon les indicateurs de la Banque mondiale, la Bosnie-Herzégovine est le pays ayant obtenu les résultats les plus faibles en Europe pour ce qui est de la facilité à faire des affaires et l'un des moins bien classés selon l'indice de perception de la corruption; que la Bosnie-Herzégovine présente le taux de chômage des jeunes le plus élevé d'Europe (59 % de la population active âgée de 15 à 24 ans); |
|
1. |
se félicite que le Conseil ait répondu à son appel en vue d'un réexamen de l'approche de l'Union à l'égard de la Bosnie-Herzégovine; encourage les nouveaux dirigeants de la Bosnie-Herzégovine à s'engager pleinement à réaliser les réformes institutionnelles, économiques et sociales nécessaires pour améliorer le niveau de vie des citoyens de Bosnie-Herzégovine et accomplir des progrès sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne; souligne que des progrès tangibles dans la mise en œuvre du programme de réforme, notamment du pacte pour la croissance et l'emploi, seront nécessaires pour qu'une demande d'adhésion soit examinée; souligne que la Bosnie-Herzégovine, comme tous les autres pays candidats (potentiels), devrait être jugée sur ses propres mérites et que le calendrier d'adhésion dépendra de la rapidité et de la qualité des réformes requises; |
|
2. |
souligne que la Commission devrait accorder une attention particulière à la mise en œuvre de l'arrêt Sejdić-Finci lorsque le Conseil lui demandera d'élaborer un avis sur une demande d'adhésion à l'Union; invite la Commission à se tenir prête à faciliter un accord sur sa mise en œuvre afin de garantir l'égalité des droits pour tous les citoyens et à jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des objectifs du programme de l'Union, notamment en ce qui concerne l'instauration d'un système opérationnel de bonne gouvernance, le développement de la démocratie, la prospérité économique et le respect des droits de l'homme; |
|
3. |
soutient fermement l'intégration européenne de la Bosnie-Herzégovine et estime que l'engagement accru de l'Union devrait être axé, entre autres, sur les questions socioéconomiques, l'environnement des entreprises, le cadre institutionnel, l'état de droit et la gouvernance, la politique en matière d'application de la législation, l'indépendance du système judiciaire, la lutte contre la corruption, la réforme de l'administration publique, la société civile et la jeunesse, et que, parallèlement, l'Union européenne devrait maintenir inchangées les conditions posées en vue de l'adhésion; demande à la haute représentante/vice-présidente, à la Commission et aux États membres d'assurer une position coordonnée et cohérente de l'Union et de démontrer que l'intégration européenne de la Bosnie-Herzégovine constitue une priorité de la politique étrangère de l'Union; souligne que l'Union devrait chercher à réunir l'ensemble des bailleurs de fonds afin de soutenir la mise en œuvre efficace de la nouvelle approche de l'Union et de l'engagement écrit; |
|
4. |
se félicite de l'engagement écrit en faveur de l'intégration européenne adopté par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, signé par les dirigeants de tous les partis politiques et approuvé par le parlement national le 23 février 2015, sur des mesures visant à mettre en place des institutions fonctionnelles et efficaces, à lancer des réformes à tous les niveaux de gouvernance, à accélérer le processus de réconciliation et à renforcer la capacité administrative; reconnaît que l'engagement a ouvert la voie à l'accord obtenu au Conseil le 16 mars 2015 afin d'engager la procédure en vue de la conclusion et de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association; se réjouit de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association, prévue le 1er juin 2015, qui permettra à la Bosnie-Herzégovine et à l'Union européenne de collaborer plus étroitement et d'approfondir leurs relations; invite l'ensemble des dirigeants politiques à collaborer pleinement à la mise en œuvre approfondie et efficace de l'engagement, notamment en ce qui concerne le renforcement de l'état de droit et la lutte contre la corruption et la criminalité organisée; rappelle que l'engagement politique et l'appropriation véritable du processus de réforme sont essentiels; invite les nouveaux dirigeants de Bosnie-Herzégovine à s'accorder avec l'Union sur une feuille de route bien définie en vue d'établir un calendrier de réforme large et ouvert qui permettra au pays d'avancer sur la voie de l'intégration européenne; appelle à la transparence dans le processus de planification et de mise en œuvre des réformes et demande instamment que la société civile soit incluse dans le processus de réforme; |
|
5. |
se dit vivement préoccupé par la déclaration adoptée le 25 avril 2015 par le congrès de l'Alliance des sociaux-démocrates indépendants (SNSD) à Sarajevo-Est qui demande notamment l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Republika Sprska en 2018; souligne que l'accord de Dayton ne donne pas le droit à la Republika Srpska de faire sécession; rappelle qu'en adoptant l'engagement écrit, toutes les forces politiques, dont le SNSD, se sont engagées à respecter «la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine»; exhorte les nouveaux responsables politiques à éviter toute rhétorique nationaliste et séparatiste conflictuelle qui polarise la société, à entreprendre sérieusement des réformes en vue d'améliorer la vie des citoyens de la Bosnie-Herzégovine, à créer un État démocratique, pluriel et opérationnel et à rapprocher le pays de l'Union européenne; |
|
6. |
invite les dirigeants politiques à se concentrer en priorité sur la mise en place d'un mécanisme de coordination de l'Union efficace, permettant de rapprocher les institutions de manière effective à tous les niveaux de gouvernance, afin de garantir la mise en conformité avec l'acquis de l'Union ainsi que son application à travers le pays, dans l'intérêt des citoyens et pour leur prospérité générale; souligne qu'en l'absence d'un tel mécanisme, le processus d'adhésion à l'Union restera au point mort, étant donné que l'organisation actuelle du pays est trop inefficace et dysfonctionnelle; souligne que l'établissement d'un tel mécanisme permettrait à la Bosnie-Herzégovine de bénéficier pleinement des fonds disponibles; insiste sur la nécessité d'entreprendre des réformes concrètes et de fournir une orientation claire au pays et à ses citoyens; |
|
7. |
souligne qu'il convient en priorité de répondre aux besoins socioéconomiques des citoyens; estime toutefois qu'il est également essentiel de poursuivre parallèlement les réformes politiques et la démocratisation du système politique; souligne que la prospérité économique n'est possible que si elle repose sur une société et un État démocratiques dans lesquels chacun a sa place; souligne également que la candidature de la Bosnie-Herzégovine à l'adhésion à l'Union européenne ne sera pas retenue tant que des conditions institutionnelles appropriées n'auront pas été établies; note qu'une réforme constitutionnelle visant à consolider, à rationaliser et à renforcer le cadre institutionnel demeure essentielle pour faire en sorte que la Bosnie-Herzégovine devienne un État efficace, soucieux de n'exclure personne et pleinement opérationnel; rappelle que la future réforme constitutionnelle devrait également tenir compte des principes de fédéralisme, de décentralisation, de subsidiarité et de représentation légitime pour garantir l'intégration fluide et efficace de la Bosnie-Herzégovine dans l'Union européenne; prie instamment tous les dirigeants politiques de travailler à la mise en œuvre des changements nécessaires; |
|
8. |
se félicite des initiatives prises par la Commission pour accélérer la mise en œuvre des projets dans le cadre de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) et renforcer la gouvernance économique; déplore que l'inaction puisse avoir des conséquences sur la répartition des fonds de l'Union pour le développement politique et socioéconomique au titre de l'IAP-II; demande instamment aux autorités compétentes de s'accorder sur des stratégies sectorielles à l'échelle nationale, notamment dans les domaines prioritaires des transports, de l'énergie, de l'environnement et de l'agriculture, en tant qu'éléments centraux devant permettre de bénéficier pleinement des fonds de l'IAP; |
|
9. |
se félicite du bon déroulement des élections d'octobre 2014; constate toutefois que, pour la deuxième fois de suite, le processus électoral s'est déroulé sans que chaque citoyen soit autorisé à se porter candidat pour toute fonction élective; souligne l'importance cruciale de mettre en place de toute urgence tous les nouveaux organes parlementaires et les administrations, à tous les niveaux; invite instamment les nouveaux dirigeants à respecter le suffrage universel, égal et direct, à se tenir à l'écoute de la population, à dialoguer avec la société civile et à répondre de façon responsable et immédiate à leurs préoccupations légitimes; demande aux autorités compétentes d'enquêter sur les très graves allégations contre la Première ministre de la République serbe de Bosnie, suspectée d'implication dans l'achat des votes de deux députés n'appartenant pas à son parti pour obtenir une majorité à l'Assemblée nationale de la République serbe de Bosnie; |
|
10. |
se félicite de l'immense solidarité nationale et internationale témoignée en réponse aux catastrophes naturelles de 2014, notamment dans le cadre du programme européen de reconstruction à la suite des inondations (EU Floods Recovery Program); se félicite que l'Union européenne ait immédiatement et massivement contribué aux opérations de sauvetage et de secours, à la demande de la Bosnie-Herzégovine, et organisé une conférence des donateurs en juillet 2014, préparée conjointement par la France et la Slovénie dans les locaux de la Commission; fait remarquer que la Commission a invité la Bosnie-Herzégovine à adhérer au mécanisme de protection civile de l'Union; demande que des mesures préventives efficaces et coordonnées soient prises à tous les niveaux pour faire face aux conséquences de ces catastrophes et prévenir de telles catastrophes à l'avenir; salue les nombreux exemples positifs de coopération et de soutien interethniques très étroits qui ont suivi les inondations et qui prouvent que la réconciliation est possible; estime que la coopération régionale et des relations étroites avec les pays voisins sont essentiels pour faire face à de telles catastrophes à l'avenir; |
|
11. |
rappelle qu'une administration publique hautement qualifiée, efficace et axée sur le mérite constitue le fondement du processus d'intégration de la Bosnie-Herzégovine et de tout pays aspirant à devenir membre de l'Union européenne; est vivement préoccupé par le fait que l'administration publique, qui est censée aider la Bosnie-Herzégovine à progresser sur la voie de l'adhésion à l'Union européenne et améliorer les conditions de vie des citoyens, reste fragmentée, politisée et dysfonctionnelle; demeure préoccupé quant à sa viabilité financière et au fait que l'absence de volonté politique en vue de réformer l'administration puisse avoir une incidence sur la fourniture de services publics; prie instamment tous les acteurs compétents d'adopter une nouvelle stratégie de réforme de l'administration publique ainsi qu'un plan d'action pour l'après-2014 afin de simplifier la structure institutionnelle complexe, de rationaliser les coûts et de rendre l'État plus fonctionnel; |
|
12. |
exhorte les autorités à faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue, étant donné qu'elle n'a pas encore abouti à des améliorations satisfaisantes et que la corruption touche tous les secteurs, y compris la santé et l'éducation, et qu'elle pèse sur les personnes les plus vulnérables, ce qui se traduit par une montée du pessimisme ainsi qu'une perte de confiance d'un nombre croissant de citoyens dans leurs institutions; appelle de ses vœux des mécanismes efficaces de lutte contre la corruption et de suivi judiciaire indépendant ainsi que des consultations ouvertes avec toutes les parties concernées, qui devraient garantir, en temps voulu, l'adoption d'un nouveau cadre stratégique pour la période 2015-2019; demande, de manière générale, la mise en œuvre efficace des mesures de lutte contre la corruption; salue l'adoption d'un ensemble de lois anticorruption, notamment en vue d'encourager la protection des lanceurs d'alerte à l'échelle nationale et de créer des organismes de prévention au niveau fédéral; condamne les tentatives de porter atteinte aux principes de l'état de droit existants et s'inquiète du fait que la nouvelle loi sur les conflits d'intérêts affaiblisse le cadre juridique et constitue un retour en arrière dans la prévention des conflits d'intérêts, dans la mesure où elle accroît le risque d'ingérence politique et n'incite pas les fonctionnaires à respecter leurs obligations; appelle au renforcement des instances parlementaires pour la prévention des conflits d'intérêts; exhorte les autorités compétentes à améliorer leurs résultats en ce qui concerne l'efficacité des enquêtes, des poursuites et des condamnations dans les affaires de corruption de haut niveau, en particulier dans le cadre des marchés publics et de la privatisation; |
|
13. |
demeure gravement préoccupé par l'inefficacité du système judiciaire, le risque d'ingérence politique dans les procédures judiciaires, la politisation des procédures de nomination, le caractère fragmenté de la procédure budgétaire dans le système judiciaire et le parquet et le risque de conflits d'intérêts au sein de l'appareil judiciaire; prie instamment les nouveaux dirigeants du pays d'entreprendre les réformes structurelles et institutionnelles portant notamment sur l'harmonisation des quatre systèmes juridiques différents; les invite à tenir compte des recommandations de la Commission, notamment sur une réforme institutionnelle du système judiciaire au niveau de l'État, y compris en ce qui concerne l'adoption d'une loi sur les tribunaux de Bosnie-Herzégovine; prie instamment le prochain Conseil des ministres d'adopter la nouvelle stratégie de réforme de la justice d'ores et déjà élaborée; renouvelle son soutien au bureau du Médiateur; note que le moratoire sur la peine capitale reste inscrit dans la Constitution de la République serbe de Bosnie et exhorte les autorités de la République serbe de Bosnie à abolir sans délai la peine de mort; |
|
14. |
est préoccupé par le fait que l'accès à l'aide juridique gratuite soit très limité et que le droit de bénéficier de ce service ne soit toujours pas pleinement réglementé sur le plan juridique dans toute la Bosnie-Herzégovine, ce qui limite le droit à la justice des personnes les plus vulnérables; exhorte les autorités compétentes à adopter une loi nationale relative à l'aide juridique gratuite et à définir clairement le rôle de la société civile dans la prestation de ce service; |
|
15. |
se félicite de l'élargissement du dialogue structuré sur la justice UE-Bosnie-Herzégovine afin d'intégrer davantage de questions relatives à l'état de droit, en particulier la corruption et la discrimination, et se réjouit qu'il produise des résultats positifs en matière de coopération régionale, de traitement des crimes de guerre ainsi que de professionnalisme et d'efficacité du système judiciaire; salue l'inclusion de la société civile dans le processus; observe que les conditions se sont améliorées au sein de plusieurs juridictions dans les entités, y compris en matière de protection des témoins; |
|
16. |
est préoccupé par le fait que certaines déclarations aient remis en cause la légitimité des condamnations du TPIY, ce qui nuit au tribunal de La Haye; demande que des mesures soient prises pour renforcer la protection des victimes et améliorer les travaux du parquet de Bosnie-Herzégovine par un réexamen du traitement des dossiers de crimes de guerre de catégorie II; salue les progrès accomplis en matière de réduction du retard dans le traitement des crimes de guerre; constate une amélioration en matière de poursuites contre des cas de crimes de guerre impliquant des violences sexuelles et demande que ce processus se poursuive à l'avenir; souligne la nécessité, pour les autorités compétentes, d'adopter le programme établi de longue date au niveau de l'État pour améliorer le statut des victimes de ces crimes de guerre, y compris leur droit à compensation, ce afin de veiller à ce qu'elles aient effectivement accès à la justice et de faire en sorte que les dispositions du droit pénal de la Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne les violences sexuelles soient conformes aux normes internationales; |
|
17. |
est préoccupé par le nombre toujours élevé de personnes disparues et la lenteur des progrès en la matière; invite les autorités à engager une coopération intense entre les deux entités et à redoubler d'efforts dans la recherche de personnes disparues; |
|
18. |
salue la mémoire de toutes les victimes du génocide de Srebrenica en 1995 et présente ses sincères condoléances aux familles et aux survivants; marque son soutien aux associations telles que l'association des mères des enclaves de Srebrenica et Žepa pour le rôle central qu'elles ont joué dans la sensibilisation et le renforcement des fondements de la réconciliation entre tous les citoyens du pays; invite tous les citoyens de Bosnie-Herzégovine, à l'occasion du 20e anniversaire du massacre de Srebrenica, à promouvoir la réconciliation et la coopération, qui sont des conditions préalables essentielles pour que tous les pays de la région puissent avancer sur la voie européenne; |
|
19. |
constate avec inquiétude qu'il y a encore 84 500 personnes déplacées à l'intérieur du pays ainsi que 6 853 réfugiés en Bosnie-Herzégovine; est préoccupé par les violations des droits des personnes rapatriées dans la République serbe de Bosnie; se félicite toutefois des nouvelles mesures adoptées par le parlement de la Fédération qui permettent aux rapatriés de la République serbe de Bosnie d'accéder aux prestations de retraite et de soins de santé dans la Fédération, tout en estimant qu'un accès équitable aux allocations sociales pour tous les citoyens est important; demande à tous les niveaux du gouvernement, en particulier aux autorités de la République serbe de Bosnie, de faciliter et d'accélérer le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés en instaurant et en appliquant toutes les mesures administratives et législatives nécessaires; demande instamment l'instauration d'une coopération sur cette question et l'établissement de conditions propices à leur réintégration pacifique et durable; appelle à la mise en œuvre effective de la stratégie révisée en ce qui concerne l'annexe VII de l'accord de paix de Dayton; appelle à la poursuite d'une bonne coopération régionale dans le cadre du processus de la déclaration de Sarajevo; réclame instamment une approche globale en vue de relever les défis qui subsistent pour débarrasser le pays des mines d'ici à 2019; |
|
20. |
réaffirme son soutien à la libéralisation du régime des visas, qui a produit des effets positifs visibles pour les citoyens de Bosnie-Herzégovine; rappelle son engagement à garantir le droit des citoyens des Balkans occidentaux à se déplacer sans obligation de visa; demande également l'adoption de mesures au niveau national, notamment des mesures socioéconomiques en faveur des catégories les plus vulnérables, des mesures énergiques pour renforcer la coopération et l'échange d'informations en vue de réprimer les réseaux de criminalité organisée, ainsi que la mise en place de contrôles renforcés aux frontières et de campagnes de sensibilisation; invite la Commission à adopter des mesures pour maintenir l'intégrité du régime d'exemption de visa et pour lutter contre les violations potentielles du régime d'asile de l'Union, en coopération avec les États membres; |
|
21. |
note que la lutte contre la criminalité organisée et la corruption est fondamentale pour faire échec à l'infiltration des systèmes politique, juridique et économique par les réseaux criminels; constate que des progrès ont été accomplis dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme; rappelle l'importance que revêt le respect des recommandations du GRECO; est préoccupé par les informations faisant état d'une radicalisation croissante des jeunes de Bosnie-Herzégovine, dont un nombre relativement élevé, par rapport à d'autres pays de la région, rejoignent les combattants terroristes de l'EIIL; prie instamment les autorités de modifier le code pénal afin de renforcer la répression à l'égard du financement du terrorisme; se félicite de la modification du code pénal visant à interdire et à sanctionner l'adhésion à des groupes paramilitaires étrangers afin de prévenir la radicalisation d'ordre religieux; souligne également qu'il importe de prévenir toutes les formes d'extrémisme et de radicalisation violente; se félicite également des opérations de police à grande échelle qui ont été menées dans l'ensemble du pays et ont conduit à l'arrestation de personnes suspectées d'organisation, d'accompagnement et de financement d'activités terroristes, y compris des combattants étrangers; demande l'inclusion d'une disposition sur les crimes de haine dans le code pénal de la Fédération de Bosnie-Herzégovine; félicite les agences concernées de Bosnie-Herzégovine pour le professionnalisme dont elles ont fait preuve dans leur travail et pour leur détermination à lutter contre les menaces croissantes qui pèsent sur la sécurité; invite la Commission à fournir une aide aux autorités compétentes en vue de supprimer l'ensemble des risques pour la sécurité et des menaces terroristes; |
|
22. |
condamne fermement l'attaque terroriste commise le 27 avril 2015 contre un poste de police de Zvornik, dans l'Est de la Bosnie, au cours de laquelle un policier a perdu la vie et deux autres ont été blessés; exprime sa solidarité avec les victimes et leurs familles; condamne dans les termes les plus forts l'idéologie extrémiste violente qui se trouve derrière cette attaque; invite les autorités compétentes, les agences responsables de la sécurité et les autorités judiciaires à coopérer dans la conduite d'une enquête rapide et complète et pour la prévention d'autres attaques; exprime son espoir que les institutions et les citoyens de Bosnie-Herzégovine s'uniront dans la lutte contre la menace terroriste et la violence extrémiste; |
|
23. |
constate que la Bosnie-Herzégovine reste un pays d'origine, de transit et de destination dans la traite des êtres humains; recommande aux autorités de prendre des mesures efficaces, y compris législatives, pour lutter contre le trafic de drogue et la traite des êtres humains et assurer la protection des victimes de la traite des êtres humains; |
|
24. |
estime qu'il est essentiel de renforcer le rôle de la société civile en lui permettant d'exprimer les intérêts des citoyens, notamment des jeunes, comme ce fut le cas lors des «plénums» de l'année passée; rappelle que la société civile peut compléter le développement d'une société fondée sur la cohésion sociale et la démocratie en offrant des services sociaux essentiels; constate que les représentants de la société civile devraient jouer un rôle important en facilitant le processus d'adhésion; prie instamment la Commission de continuer à mettre les fonds européens à la disposition des organisations de la société civile; constate que les mécanismes institutionnels de coopération avec la société civile demeurent faibles et entravent le développement d'une démocratie plus participative, plurielle et dynamique dans le pays; demande, par conséquent, la mise en place de mécanismes de consultation publique transparents et ouverts associant l'ensemble des acteurs publics concernés en vue de l'établissement d'un cadre consacré aux débats publics sur les décisions législatives importantes et de l'adoption d'une stratégie nationale en faveur de la société civile; s'inquiète des cas signalés d'intimidation lors des troubles sociaux de l'année passée; |
|
25. |
estime qu'il est essentiel de promouvoir en Bosnie-Herzégovine une société ouverte et tolérante, dans laquelle les minorités et les catégories vulnérables soient protégées; rappelle la discrimination ouverte dont sont victimes les citoyens de Bosnie-Herzégovine en raison de la non-application de l'arrêt Sejdić-Finci; demande instamment que des mesures soient prises pour renforcer le rôle du médiateur des droits de l'homme et mettre au point, en coopération avec la société civile, une stratégie de lutte contre toutes les formes de discrimination au niveau de l'État; invite les autorités compétentes à harmoniser davantage les lois du pays avec l'acquis, en accordant une attention particulière à la discrimination fondée sur l'âge ou le handicap, comme cela a été mis en évidence dans le cadre du dialogue structuré; invite le ministère des droits de l'homme et des réfugiés de Bosnie-Herzégovine à créer sans plus tarder un groupe de travail chargé de rédiger des amendements à la loi contre les discriminations de Bosnie-Herzégovine; s'inquiète que les discours et les crimes de haine, les menaces, le harcèlement et les discriminations à l'encontre des personnes LGBTI continuent d'être monnaie courante; encourage les autorités à mettre en œuvre des mesures de sensibilisation sur les droits des personnes LGBTI au sein des instances judiciaires et des services répressifs, ainsi qu'auprès du grand public; s'inquiète que des cas de discrimination pour motifs religieux continuent d'être signalés; |
|
26. |
déplore vivement la marginalisation continue des Roms et les discriminations dont ils font l'objet; salue les progrès accomplis en ce qui concerne les besoins des Roms en matière de logement; encourage toutefois à prendre des mesures supplémentaires pour améliorer les conditions de vie des Roms en favorisant leur accès à l'emploi, à la santé et à l'éducation; |
|
27. |
constate que, malgré l'existence de dispositions juridiques garantissant les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes, seuls des progrès limités ont été accomplis pour ce qui est de leur mise en œuvre; invite les autorités compétentes à poursuivre activement leurs efforts en vue d'accroître la participation des femmes à la vie politique et au marché du travail, à lutter contre les discriminations professionnelles liées à la maternité, à améliorer la situation sociale et économique des femmes, à promouvoir, protéger et renforcer les droits des femmes et, de manière générale, à sensibiliser l'opinion publique aux droits des femmes et à mieux faire comprendre ces droits; prie instamment les autorités d'adopter une stratégie de mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique et de mettre en place un système harmonisé pour le suivi et la collecte d'informations sur les cas de violence à l'égard des femmes; |
|
28. |
prie instamment la Bosnie-Herzégovine d'inclure aussi rapidement que possible l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans la loi sur les crimes haineux et de permettre ainsi de juger les personnes qui exercent diverses formes d'oppression fondée sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre; |
|
29. |
observe que des dispositions juridiques relatives à la liberté d'expression existent; s'inquiète toutefois des pressions politiques et financières exercées sur les médias ainsi que des menaces et des manœuvres d'intimidation à l'encontre des journalistes et des éditeurs, y compris en période préélectorale; condamne les tentatives visant à porter atteinte aux règles existantes, qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la liberté d'expression et la liberté des médias, y compris en ligne; souligne que les événements tels que l'attaque par les forces de police des bureaux de Klix.ba à Sarajevo ou la récente adoption par l'Assemblée nationale de la République serbe de Bosnie de la loi controversée sur l'ordre public et la paix suscitent de vives inquiétudes quant à la liberté d'expression et des médias, y compris des médias sociaux; souligne que la capacité des médias à fonctionner sans crainte est essentielle pour la vitalité de la démocratie; demande instamment que la liberté d'expression et la liberté des médias soient pleinement respectées et que les journalistes soient autorisés à obtenir des informations sur les questions d'intérêt public; souligne que le financement stable et durable, l'indépendance éditoriale, la diffusion dans toutes les langues officielles et le pluralisme sont essentiels pour les médias de service public; invite les autorités à combler toutes les lacunes législatives qui font systématiquement obstacle à la transparence totale de la propriété des médias et à élaborer une réglementation afin de garantir qu'aucune influence politique injustifiée ne soit exercée; demande instamment aux autorités compétentes de garantir l'indépendance politique, institutionnelle et financière de la télévision et de la radio du service public et de faire en sorte que les lois des entités sur la télévision et la radio publiques soient conformes avec la législation au niveau de l'État; demande instamment que la nomination du directeur du conseil de l'Agence de régulation des communications de Bosnie-Herzégovine s'opère en fonction du mérite; |
|
30. |
demeure préoccupé par la ségrégation continue des enfants dans les écoles publiques en fonction de critères ethniques; relève que l'existence de trois programmes différents fait obstacle à l'étude commune, participative et objective de l'histoire commune et des récents événements historiques; prie instamment les autorités de mettre en œuvre de manière effective des principes éducatifs qui n'écartent personne, à commencer par les enfants handicapés; demande instamment aux nouveaux dirigeants du pays de promouvoir sans plus tarder un système éducatif ouvert à tous et non discriminatoire dans les deux entités et le district de Brčko, de mettre fin à la ségrégation des différents groupes ethniques et de faire progresser la réforme de l'éducation, qui vise à améliorer les normes dans l'enseignement et à instaurer un programme scolaire commun; demande également d'intensifier la mise en œuvre du plan d'action sur les besoins éducatifs des enfants Roms et leur intégration dans le système éducatif; |
|
31. |
rappelle que les manifestations de février 2014 ont mis clairement en évidence les revendications populaires des citoyens de Bosnie-Herzégovine en faveur de réformes socioéconomiques dans le pays; est fermement convaincu que la mise en œuvre de mesures dans les six domaines de réforme essentiels du pacte pour la croissance et l'emploi donnera un nouvel élan aux réformes socioéconomiques, au point mort, y compris au niveau de la croissance et de l'emploi et des réformes des marchés publics; invite les nouvelles administrations aux niveaux de l'État, des entités et des cantons à collaborer étroitement afin de faire de la gouvernance économique et dudit pacte une priorité essentielle des réformes; souligne la nécessité de poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de réforme économique; |
|
32. |
estime que la Bosnie-Herzégovine a progressé de manière limitée sur la voie d'une économie de marché viable; souligne qu'il importe de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché; est préoccupé par le fait que de graves lacunes dans l'environnement des entreprises continuent à avoir un effet négatif sur le développement du secteur privé et les investissements directs étrangers; prie instamment les autorités compétentes de remédier aux lacunes dans l'application de l'état de droit, à l'importance du secteur informel et aux niveaux élevés de corruption, qui nuisent à l'environnement des entreprises; demande instamment une harmonisation avec la directive «Solvabilité II»; |
|
33. |
souligne la nécessité de réformer et d'harmoniser les systèmes, fragmentés, de protection sociale en fonction des besoins des citoyens afin d'assurer un traitement égal pour tous, d'atténuer la pauvreté et de créer un filet de protection sociale qui cible davantage les plus démunis et les personnes exclues de la société; souligne que la prospérité économique et les perspectives d'emploi, en particulier pour les jeunes, sont essentielles pour le développement du pays; demande aux administrations de mettre en œuvre des réformes du marché du travail afin de lutter contre le taux de chômage très élevé, en mettant l'accent sur les jeunes, les femmes et les chômeurs de longue durée; constate que les droits syndicaux et du travail restent limités; demande aux autorités de renforcer davantage et d'harmoniser les lois afférentes dans le pays; souligne la nécessité d'améliorer l'éducation et la formation pour lutter contre l'inadéquation des compétences et augmenter l'employabilité, notamment chez les jeunes; |
|
34. |
souligne qu'il importe d'harmoniser et de renforcer les droits syndicaux existants et les règles relatives aux conditions de travail, qui ne sont actuellement pas au même niveau dans tous les secteurs; note également que les prestations sociales et les pensions ne sont pas attribuées de manière équitable; |
|
35. |
relève que des progrès limités ont été accomplis dans les domaines de l'environnement et du changement climatique et invite les autorités à renforcer la protection environnementale conformément aux normes de l'Union européenne; invite la Bosnie-Herzégovine à respecter toutes ses obligations contractuelles au titre du traité instituant la Communauté de l'énergie et de l'accord de stabilisation et d'association, et à garantir un rapprochement rapide et approprié avec l'acquis environnemental de l'Union, y compris en matière de prévention de la pollution, notamment pour agir contre la surpollution atmosphérique engendrée par la raffinerie de Bosanski Brod; insiste sur la nécessité pour la Bosnie-Herzégovine de mettre pleinement en œuvre ses obligations au titre de la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (Espoo, 1991) et de son protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale (Kiev, 2003), notamment en ce qui concerne les activités exercées dans les bassins fluviaux de la Neretva et de la Trebišnjica; |
|
36. |
salue l'attitude volontariste et constructive de la Bosnie-Herzégovine en matière de promotion de la coopération régionale; se félicite de l'organisation fréquente de patrouilles communes aux frontières avec les pays voisins; souligne l'importance capitale de bonnes relations de voisinage; invite les nouveaux dirigeants à poursuivre et à intensifier leurs efforts en vue de résoudre les différends frontaliers et les désaccords de propriété avec les pays voisins; encourage la Bosnie-Herzégovine à achever, de bonne foi, le processus de démarcation avec le Monténégro sur la base de l'accord conclu en mai 2014; |
|
37. |
déplore que la politique étrangère du pays soit toujours caractérisée par des positions divergentes, ce qui se traduit par un faible taux d'alignement sur les positions de l'Union (52 %); rappelle l'importance cruciale d'une politique étrangère unifiée pour la Bosnie-Herzégovine; est préoccupé par les conséquences du rejet, par la Russie, de la formulation type du Conseil de mise en œuvre de la paix sur l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine et sa rhétorique négative sur les aspirations européennes de la Bosnie-Herzégovine; se félicite du maintien, dans le cadre d'un nouveau mandat de l'ONU, de l'opération Althea axée sur le renforcement des capacités et la formation; |
|
38. |
invite les institutions nouvellement élues de Bosnie-Herzégovine à mettre à profit la nouvelle approche de l'Union pour conclure l'accord sur l'adaptation de l'accord intérimaire/de l'accord de stabilisation et d'association, compte tenu de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne et du maintien des échanges commerciaux traditionnels; |
|
39. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la haute représentante/vice-présidente de la Commission, au Conseil, à la Commission, à la présidence de la Bosnie-Herzégovine, au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, à l'Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine et aux gouvernements et aux parlements de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République serbe de Bosnie, ainsi qu'aux administrations des 10 comtés/cantons. |
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/77 |
P8_TA(2015)0183
Banque européenne d'investissement — rapport annuel 2013
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la Banque européenne d'investissement — Rapport annuel 2013 2014/2156(INI).
(2016/C 346/13)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le rapport annuel 2013 de la Banque européenne d'investissement, |
|
— |
vu le rapport financier annuel 2013 du Groupe européen d'investissement, |
|
— |
vu les articles 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et son protocole no 5 sur les statuts de la BEI, |
|
— |
vu sa résolution du 26 octobre 2012 sur les instruments financiers novateurs dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel (1), |
|
— |
vu sa résolution du 7 février 2013 sur le rapport annuel 2011 de la Banque européenne d'investissement (2), |
|
— |
vu sa résolution du 11 mars 2014 sur la Banque européenne d'investissement (BEI) — rapport annuel 2012 (3), |
|
— |
vu le rapport du président du Conseil européen du 26 juin 2012, intitulé «Vers une véritable Union économique et monétaire», |
|
— |
vu sa résolution du 3 juillet 2012 sur l'attrait de l'investissement en Europe (4), |
|
— |
vu sa résolution du 26 février 2014 sur le financement à long terme de l'économie européenne (5), |
|
— |
vu la communication de la Commission sur «Le financement à long terme de l'économie européenne» (COM(2014)0168) du 27 mars 2014, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012 qui proposaient notamment une augmentation de 10 milliards d'EUR du capital de la BEI, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil européen des 27 et 28 juin 2013 qui préconisaient la création d'un nouveau plan d'investissement pour soutenir les PME et dynamiser le financement de l'économie, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 qui énonçaient l'objectif consistant à mettre toutes les politiques de l'Union au service de la compétitivité, de l’emploi et de la croissance, |
|
— |
vu les communications de la Commission sur les instruments financiers innovants intitulées «Un cadre pour la prochaine génération d'instruments financiers innovants» (COM(2011)0662) et «Une phase pilote pour l'initiative relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le cadre d'Europe 2020» COM(2011)0660), |
|
— |
vu l'augmentation de capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), notamment en ce qui concerne la question des relations entre la BEI et la BERD, |
|
— |
vu la décision relative à l'extension de la zone d'action de la BERD à la région méditerranéenne (6), |
|
— |
vu le nouveau protocole d'accord entre la BEI et la BERD signé le 29 novembre 2012, |
|
— |
vu la décision no 1080/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 (7) relative au mandat extérieur de la BEI de la période 2007-2013, |
|
— |
vu la communication de la Commission sur un plan d'investissement pour l'Europe (COM(2014)0903) du 26 novembre 2014, |
|
— |
vu l'article 52 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission du contrôle budgétaire et de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0057/2015), |
|
A. |
considérant que toutes les ressources possibles des États membres et de l'Union, y compris celles de la BEI, doivent être efficacement mobilisées sans délai pour soutenir les investissements publics et privés, stimuler la compétitivité, rétablir une croissance économique durable et inclusive et promouvoir la création d'emplois et d'infrastructures de qualité, conformément à la stratégie Europe 2020 et en tenant compte du fait que la BEI a pour mission de soutenir la cohésion sociale et est en mesure d'apporter un soutien significatif aux États membres confrontés à des difficultés dans le contexte social et économique difficile que nous connaissons actuellement; |
|
B. |
considérant que la crise économique et financière, combinée aux politiques d'austérité, a sévèrement touché la croissance économique de plusieurs États membres et dégradé de manière fulgurante les conditions sociales, avec pour effet l'augmentation continue des inégalités et des déséquilibres entre les régions européennes et la non-réalisation de l'objectif de cohésion sociale et de véritable convergence, déstabilisant ainsi l'intégration européenne et la démocratie; |
|
C. |
considérant que la BEI n'est pas une banque d'affaires et doit poursuivre sa mission essentielle de catalyseur pour le financement d'investissements publics et privés judicieux à long terme, tout en continuant à appliquer les meilleures pratiques prudentielles dans ses activités bancaires, de façon à préserver sa très forte position en capitaux propres, afin d'accéder aux meilleures conditions de financement; |
|
D. |
considérant que des efforts particuliers doivent être consentis pour développer des interventions conjointes (combinant le FEI ou d'autres outils de garantie) pour le financement des PME ou des infrastructures matérielles et immatérielles durables, étant donné que l'une des raisons de la réduction des investissements et du crédit est la perte de compétitivité des économies européennes; |
|
E. |
considérant que la BEI doit continuer à remplir son mandat pour le financement de projets qui font partie de l'action extérieure de l'Union, en respectant des normes sociales et environnementales élevées; |
|
F. |
considérant que le choix des investissements de la BEI doit se faire de manière indépendante et sur la base de leur viabilité, de leur valeur ajoutée et de leur incidence sur la relance économique; |
|
G. |
considérant que la BEI doit évoluer vers le modèle de banque de développement, dans le cadre d'une coordination macroéconomique plus importante avec les États membres; |
|
H. |
considérant que la BEI doit être un pôle de connaissances et de bonnes pratiques et pas uniquement une entité financière; |
|
I. |
considérant que le marché de la titrisation dans l'Union européenne est relativement limité et particulièrement concentré, avec une titrisation limitée des prêts des PME et qu'il présente une baisse, du fait de la crise; |
Investissements
|
1. |
prend note du rapport annuel 2013 de la BEI et de l'augmentation des activités de financement du groupe de 37 %, pour atteindre 75,1 milliards d'euros, ainsi que de la mise en œuvre de l'augmentation de capital de la BEI opérée en 2013; est vivement préoccupé par la situation de paralysie économique actuelle dans l'Union européenne, et en particulier par la baisse significative des investissements publics et privés — qui ont été réduits de quelque 18 % depuis 2007 — et par la chute dramatique de 35 % des prêts aux PME entre 2008 et 2013; souligne qu'un tel déclin constitue un obstacle majeur à une reprise durable et à de véritables progrès dans le cadre des objectifs de la stratégie Europe 2020; |
|
2. |
souligne, de ce point de vue, que les projections nationales montrent que près de la moitié des États membres n'atteindront pas leurs objectifs nationaux en matière d'éducation et de réduction des gaz à effet de serre d'ici 2020 et que les tendances en ce qui concerne l'emploi et la réduction de la pauvreté sont pires encore; |
|
3. |
conclut que l'amélioration des instruments financiers de la BEI ne remplace pas les réformes en matière de politique économique et structurelles opérées au niveau national axées sur une croissance durable et la création d'emplois; |
|
4. |
prend acte de la communication de la Commission sur un plan d’investissement pour l’Europe (COM(2014)0903), qui inclut les fonds existants et compte sur un effet multiplicateur de 1:15 en capitaux privés; prend acte de la volonté de relancer l'économie européenne à travers la mobilisation de 315 milliards d'euros sur les trois prochaines années dans le cadre du nouveau fonds européen pour les investissements stratégiques; attire l'attention sur le fait que la mise en œuvre du plan d'investissement nécessitera que la BEI dispose de ressources humaines supplémentaires pour remplir son mandat; |
|
5. |
prend note, dans ce contexte, de la mise en place d'une task-force, placée sous la conduite de la Commission et de la Banque européenne d'investissement, ainsi que des propositions législatives qui seront adoptées suivant la procédure législative ordinaire pour la création du fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI); souligne la nécessité d'insister, dans ces propositions législatives, sur la qualité de la gouvernance et du processus de sélection, ainsi que sur un cadre de suivi et d'évaluation responsable sur le plan démocratique pour soutenir le fonds, avec l'établissement dans le cadre le plus transparent possible des critères qui seront utilisés pour décider de l'opportunité d'inclure des projets dans la réserve; |
|
6. |
est d'avis que le plan d'investissement de la Commission européenne encouragera et facilitera l'accès au financement dans les États membres et les régions; rappelle que la coopération entre la BEI et les Fonds européens est nécessaire, notamment dans ces États membres et ces régions, afin de réaliser des investissements publics productifs et des projets d'infrastructure essentiels nécessaires; |
|
7. |
estime qu'il convient d'accorder la priorité aux projets présentant une valeur ajoutée européenne et un bilan coûts-avantages positif; souligne qu'il importe de lancer des projets susceptibles d'avoir des incidences maximales sur le plan de la création d'emplois; souligne la nécessité de se concentrer sur des projets qui n'accèdent que très difficilement au financement bancaire; met en garde contre le fait que la task-force pourrait subir des pressions politiques afin qu'elle soutienne des projets défendus par des groupes d'intérêts spécifiques, ce qui pourrait conduire à une allocation inappropriée des fonds en faveur d'investissements non rentables et ne servant pas l'intérêt public; |
|
8. |
insiste sur le fait que les garanties que la Commission prévoit de mettre en place pour l'EFSI ne sont pas alimentées par de l'argent frais, mais par des ressources qui ont été réaffectées; souligne qu'il est de la plus haute importance de définir les coûts d'opportunité générés par une telle réaffectation et, par conséquent, d'établir explicitement la mesure dans laquelle les rendements globaux découlant des investissements supplémentaires prévus cofinancés par l'EFSI seraient supérieurs à ceux qu'aurait permis l'affectation des dépenses initiales des ressources réaffectées; |
|
9. |
souligne que le processus de sélection des projets doit avoir pour but d'éviter les effets de substitution et de remaniement et doit dès lors se concentrer sur des projets qui apportent une valeur ajoutée européenne et affichent un potentiel d'innovation important, qui respectent le critère d'additionnalité; souligne la nécessité de prendre en compte le potentiel d'emploi des projets sélectionnés dans les pays de l'Union touchés par un chômage massif; |
|
10. |
demande à cet égard à la Commission d'évaluer prudemment dans sa proposition législative à venir les parties du cadre budgétaire de l'Union censées apporter des garanties à l'EFSI, en vue de réduire au minimum les coûts d'opportunité liés au redéploiement de ces ressources; demande également au Conseil, à la Commission et au conseil des gouverneurs de la BEI d'évaluer correctement les effets de redistribution du plan d'investissement, et plus particulièrement l'éventuelle augmentation des bénéfices des investisseurs au détriment des consommateurs qui doivent payer pour utiliser les nouvelles infrastructures afin d'assurer un retour sur investissement adéquat; invite la BEI et la Commission à approfondir l'évaluation du déficit d'investissement dans l'Union européenne en ce qui concerne sa composition, notamment pour savoir si ce sont les investissements privés ou publics qui font défaut, et à préciser les types d'investissements, privés ou publics, susceptibles de faire l'objet d'un soutien et l'ampleur attendue des effets productifs des investissements; |
|
11. |
relève que la Banque centrale européenne a fait savoir qu'elle était prête à acheter, sur le marché secondaire, des obligations émises par l'EFSI, si ce dernier devait en émettre lui-même ou si la BEI devait le faire en son nom; |
|
12. |
souligne qu'il est nécessaire d'établir un nouvel équilibre entre une meilleure évaluation et le meilleur investissement possible, et de mettre l'économie sur une trajectoire de croissance durable et de création d'emplois; |
|
13. |
rappelle l'importance de la stratégie Europe 2020; souligne que le futur paquet d'investissements doit mieux prendre en considération les objectifs généraux en matière de politique de cohésion, de durabilité et d'efficacité énergétique; invite la Commission et le conseil des gouverneurs de la BEI à améliorer leurs indicateurs de performance pour les investissements de qualité dans cette perspective; |
|
14. |
souligne que la BEI est appelée à jouer un rôle déterminant dans le financement du plan d'investissement pour l'Europe en engageant 5 milliards d'euros pour l'établissement d'un nouveau fonds européen pour les investissements stratégiques; invite, par conséquent, le Conseil, la Commission et le Conseil des gouverneurs de la BEI à dûment évaluer la cohérence entre les nouvelles tâches confiées à la BEI dans le cadre d'un tel plan et les ressources de la BEI; |
|
15. |
est d'avis, à cet égard, qu'une implication appropriée de la BEI dans le plan d'investissement nécessitera une augmentation substantielle des plafonds de prêt et d'emprunt de la BEI au cours des cinq prochaines années en vue d'accroître sensiblement la taille de son bilan; estime qu'un niveau d'endettement excessif minera les objectifs du plan d'investissement; |
|
16. |
est d'avis que faire avancer le cadre juridique pour le fonctionnement du marché unique des capitaux contribuera de manière positive à accélérer la réalisation du plan d'investissement; |
|
17. |
souligne, cependant, que le plan d'activité actuel de la BEI prévoit une réduction des flux de prêts à 67 milliards d'euros en 2014 et 2015, tandis que le milieu de la fourchette prévue pour 2016 est de 58,5 milliards d'euros; |
|
18. |
souligne que la capacité de prêt supplémentaire résultant de la récente augmentation de capital de la BEI de 10 milliards d'euros a été sous-utilisée; invite instamment la task-force à promouvoir de la meilleure manière possible des actions visant à élargir les prêts auprès de la BEI; |
|
19. |
invite la Commission à encourager la coopération multilatérale entre la BEI et les banques nationales de développement, afin de favoriser les synergies, de partager les risques et les coûts, et de garantir des prêts appropriés aux projets de l'Union ayant une incidence positive sur la productivité, la création d'emplois, la protection de l'environnement et la qualité de vie; |
|
20. |
invite la Commission et la BEI à favoriser l'inclusion, dans le cadre de leur action, des investissements présentant des avantages d'ordre social indéniables, notamment l'accroissement des niveaux d'emploi, à encourager, par des prêts, les activités visant à faire baisser le chômage, en accordant un intérêt particulier à la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, et à soutenir les investissements publics et productifs ainsi que les projets d'infrastructure nécessaires, en particulier dans les États membres enregistrant des taux de chômage élevés et un PIB inférieur à la moyenne; |
|
21. |
renouvelle son soutien prudent au développement de partenariats publics-privés (PPP) qui, s'ils sont bien conçus, peuvent jouer un rôle important dans les investissements à long terme, l'économie numérique, la recherche et l'innovation, le capital humain, ainsi que les réseaux européens de transport, d'énergie ou de télécommunications; regrette que certains PPP critiquables soient devenus des systèmes onéreux de financement public du secteur privé générateurs de dettes publiques; souligne toutefois que de telles opérations sont régulièrement confrontées à des problèmes d'opacité et d'informations asymétriques dans les clauses de mise en œuvre entre les agents publics et privés, généralement en faveur du secteur privé; |
|
22. |
suggère à la BEI de renforcer ses capacités d'analyse sectorielle, ainsi que son travail d'analyse macroéconomique; |
Instruments de répartition des risques et emprunts obligataires
|
23. |
souligne que les instruments de partage des risques impliquant à terme l'allocation de subventions publiques ne devraient être envisagés que lorsque des défaillances du marché génèrent des coûts externes ou pour l'exécution de missions d'intérêt général, telles que la fourniture de biens et de services publics d'intérêt économique général, en gardant bien à l'esprit que cela entraîne toujours un risque de socialisation des pertes et de privatisation des profits; relève qu'en cas d'échec, le secteur public sera conduit à couvrir les pertes; |
|
24. |
souligne que toute implication de ressources publiques dans des instruments de répartition des risques, et plus précisément dans les premières tranches de perte des structures d'investissement, devrait être explicitement liée soit à la réduction des coûts externes négatifs mesurables, soit à la génération de coûts externes positifs mesurables, soit à la mise en œuvre d'obligations de service public et de services d'intérêt économique général; souligne que l'article 14 du traité FUE fournit une base juridique pour l'établissement d'un tel lien à travers une simple proposition législative; |
PME
|
25. |
souligne que les PME sont l'épine dorsale de l'économie européenne et doivent, en tant que telle, être une cible privilégiée pour les investissements; s'inquiète que l'accès au financement reste l'une des difficultés les plus pressantes auxquelles les PME européennes sont confrontées; souligne la nécessité de répartir plus efficacement le financement des PME, en faisant reposer ce financement sur un large éventail d'investisseurs privés; |
|
26. |
exhorte la BEI à effectuer une analyse complète de la chute du financement des PME et à proposer un plan global encourageant les PME à travers toute l'Europe à demander un financement sous les auspices de la BEI, lorsque cela est possible; invite la Commission et la BEI à apprécier les effets de la crise économique sur le système bancaire et les bénéficiaires finaux du financement de la BEI, en particulier les PME, le secteur de l'économie sociale et les entreprises publiques; demande à la BEI d'évaluer et de détailler les incidences sur l'économie réelle et les résultats de son soutien aux PME en Europe et les résultats pour la période 2010-2014; |
|
27. |
attire l'attention sur le fort taux de microentreprises dans l'économie européenne et salue les avancées de la BEI en matière d'octroi de crédits sous forme de microfinancement en Europe; appelle à poursuivre l'investissement dans ce secteur eu égard à l'importance des microentreprises en termes de création d'emplois; |
|
28. |
attire en particulier l'attention sur les bénéfices réels qui découlent d'un recours au mécanisme de partage des risques dans le cadre de la promotion du financement des PME et de l'innovation en Europe; |
|
29. |
prend note du soutien accru accordé aux PME dans l'Union européenne, qui s'est élevé à 21,9 milliards d'euros et a permis de financer plus de 230 000 PME; |
|
30. |
invite la BEI à accroître plus encore ses capacités de prêts aux PME et aux start-up innovantes; souligne qu'il importe de renforcer d'autres instruments de la BEI, notamment le mécanisme européen de microfinancement «Progress»; |
|
31. |
salue la mise en œuvre et le développement de nouvelles activités dans le secteur du financement des aides au commerce dans les pays touchés par la crise économique, notamment grâce à la facilité de financement des exportations pour les PME ou à des solutions de financement sur mesure comme l'instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'inclusion financière; encourage la BEI à étendre les avantages de ces nouveaux instruments à de nouveaux bénéficiaires au niveau européen; |
|
32. |
insiste sur le fait que l'évaluation effectuée par la Commission en décembre 2014 tient compte des incidences aussi bien négatives que positives des projets de la phase pilote de l'initiative relative aux emprunts obligataires; juge regrettable que la BEI ait soutenu certains projets d'infrastructures qui se sont révélés non viables et non durables; juge que la BEI devrait investir dans des projets qui créent des profits économiques tangibles, qui respectent le climat et répondent aux besoins et aux intérêts de la population qu'ils sont censés servir; |
|
33. |
regrette le rôle joué par la BEI et la Commission dans le projet Castor, lequel a été financé dans le cadre de l'initiative relative aux emprunts obligataires qui prévoyait une évaluation des risques ne tenant pas compte du risque d'augmentation de l'activité sismique associé à l'injection de gaz, en dépit de l'existence d'études avertissant clairement des dangers potentiels (8); demande instamment à la Commission et à la BEI de prendre des mesures en vue d'éviter aux citoyens espagnols de payer, que ce soit par un déficit plus important ou une augmentation des coûts de l'énergie, 1,3 milliard d'euros de dédommagement pour un projet qui a été évalué de manière désastreuse; demande à la Commission de suivre les recommandations du médiateur européen et de mener une enquête pour déterminer si les décisions du gouvernement espagnol sur Castor peuvent être considérées comme des aides d'État interdites; |
|
34. |
regrette que la BEI ait financé le contournement autoroutier «Passante di Mestre», après l'annonce publique effectuée par les autorités italiennes de l'arrestation du directeur général de sa principale entreprise sous-traitante pour fraude fiscale; à la lumière des enquêtes toujours en cours menées par les autorités italiennes sur le scandale de corruption lié à la construction et à la gestion du «Passante di Mestre», invite la BEI à ne plus financer ce projet par le recours à l'initiative relative aux emprunts obligataires ou tout autre instrument financier et à veiller à appliquer sa politique de tolérance zéro en matière de lutte contre la fraude lorsque des emprunts obligataires sont en jeu; |
|
35. |
invite la BEI à accroître sa capacité de prise de risque en promouvant des prêts aux secteurs de l'économie qui ont le potentiel de générer de la croissance et de créer des emplois, mais qui ont des difficultés à obtenir un financement sans les garanties adéquates; |
|
36. |
plaide, par conséquent, pour une évaluation globale des projets pilotes sur la base d'une procédure de consultation inclusive et ouverte, à laquelle participeront les instances publiques, nationales et locales; relève également la nécessité d'évaluer les projets financés en termes de valeur ajoutée, d'environnement, de productivité et d'emplois; souligne que l'initiative relative aux emprunts obligataires en est encore à sa phase pilote; demande également à la Commission de présenter, par l'intermédiaire de la procédure législative ordinaire, une proposition législative qui permettra de mieux encadrer la future stratégie des emprunts obligataires, y compris une amélioration du cadre des indicateurs de performance de la BEI pour l'investissement de qualité, de manière à identifier et à mesurer l'impact des projets financés en termes de coûts externes et de bénéfices sociaux et environnementaux de la façon la plus large possible; |
|
37. |
s'inquiète d'une possible généralisation des initiatives relatives aux emprunts obligataires comme moyen de réduire les coûts pour l'investissement privé, par le recours à une réduction des taux d'intérêt ou une socialisation des pertes, plutôt qu'une concentration sur des investissements d'intérêt public lorsqu'il est démontré que l'investissement privé apporte une expertise ou un savoir-faire indispensable que le secteur public est incapable d'offrir; |
Énergie et climat
|
38. |
invite la BEI à veiller à la bonne mise en œuvre de ses nouveaux critères énergétiques applicables à l'octroi de prêts et à publier des rapports réguliers sur leur mise en œuvre; |
|
39. |
invite la BEI à intensifier ses efforts d'investissement en vue de réduire considérablement ses émissions de carbone, et à travailler sur les politiques qui aideraient l'Union à atteindre ses objectifs climatiques; se félicite que la BEI entende effectuer et demander la publication d'une évaluation et d'une analyse climatique de l'ensemble de ses activités en 2015, qui peuvent déboucher sur une nouvelle politique de protection du climat; espère que la politique énergétique de la BEI sera effectivement soutenue par sa norme de performance en matière d'émissions, qui s'applique à tous les projets de génération d'énergie à partir des combustibles fossiles pour exclure les investissements dont les émissions de carbone prévues dépassent un certain seuil; demande à la BEI de suivre l'application de la norme de performance en matière d'émissions et d'appliquer des engagements plus stricts; |
|
40. |
se félicite de l'ensemble des progrès réalisés par la BEI en direction d'une transition vers les énergies renouvelables; plaide pour la rectification des déséquilibres régionaux dans les prêts aux énergies renouvelables, notamment en vue de soutenir des projets dans les États membres qui dépendent de sources d'énergie non renouvelables et en tenant compte des disparités entre les économies des États membres, et demande qu'une plus grande attention soit accordée à l'avenir aux projets d'énergie renouvelable hors réseau, décentralisés, de moins grande envergure, impliquant les citoyens et les collectivités; estime que ces sources d'énergie réduiraient l'importante dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de l'extérieur, amélioreraient la sécurité de l'approvisionnement et favoriseraient une croissance verte et la création d'emplois verts; souligne l'importance du financement de l'efficacité énergétique, des réseaux énergétiques ainsi que des recherches et innovations qui y sont liées; |
|
41. |
invite la BEI à accroître son volume de prêts accordés aux projets d'efficacité énergétique dans tous les secteurs, notamment ceux relatifs à l'optimisation de processus, aux PME, aux bâtiments et à l'environnement urbain; invite la BEI à privilégier davantage les régions en grande difficulté au profit de la politique de cohésion; |
|
42. |
prie instamment la BEI de présenter une évaluation de la possibilité de cesser progressivement ses prêts à des projets d'énergie non renouvelable; |
Infrastructures
|
43. |
souligne qu'il est essentiel d'investir dans des projets durables d'infrastructure pour améliorer la compétitivité, relancer la croissance et créer de l'emploi en Europe; invite par conséquent la BEI à financer les secteurs les plus affectés par le chômage massif; souligne que le financement de la BEI doit avant tout se concentrer sur les pays enregistrant un retard en termes de qualité des infrastructures de développement; |
|
44. |
encourage la BEI à davantage axer ses investissements urbains sur la viabilité sociale; salue l'amélioration du financement des logements sociaux par la BEI mais souligne qu'il faut davantage développer la recherche et les activités sur la viabilité sociale dans le cadre de la réhabilitation urbaine durable; |
Recherche et innovation
|
45. |
salue le lancement des premières opérations de l'initiative de financement de la croissance (IFC) et souligne l'importance d'accorder un financement adéquat aux projets de recherche et d'innovation et aux start-up innovantes; |
Emploi et affaires sociales
|
46. |
prend acte du lancement de l'initiative «Compétences et emplois — Investir pour la jeunesse» et invite instamment la BEI à accélérer la mise en œuvre de cette initiative et à envisager sa généralisation; |
Gouvernance, transparence et responsabilité
|
47. |
invite la BEI à surveiller plus étroitement la mise en œuvre de projets en coopération avec les États membres, afin d'assurer une plus grande efficacité et une gestion saine des ressources allouées; |
|
48. |
souligne que la répartition géographique du financement fourni par la BEI révèle des différences considérables dans les prêts accordés aux différents États membres; invite par conséquent la BEI à évaluer les raisons de ces différences et à veiller à ce que les institutions financières dans tous les États membres soient pleinement capables de gérer et de mettre en œuvre les programmes de la BEI; plaide en outre pour que des campagnes d'information ciblées soient menées dans tous les États membres en vue de les sensibiliser aux programmes spécifiques de la BEI; défend par ailleurs le renforcement de la coopération entre la BEI et les autorités nationales en vue de s'attaquer aux goulets d'étranglement qui limitent l'adhésion aux projets de la BEI et leur mise en œuvre; |
|
49. |
rappelle que le Conseil et le Parlement européen ont convenu que l'heure était venue de se pencher sur la rationalisation du système des institutions financières publiques européennes (9); |
|
50. |
demande instamment à la BEI d'améliorer l'indépendance et l'efficacité de sa division Mécanisme des plaintes; invite le comité de direction de la BEI à prendre en considération les recommandations de cette division; invite la BEI à agir conformément aux avis de la Médiatrice européenne et à intensifier la coopération, afin d'éviter des situations telles que l'enquête concernant la plainte 178/2014/AN contre la Banque européenne d'investissement (10); |
|
51. |
estime qu'il reste, aujourd'hui encore, une importante marge de manœuvre pour améliorer la transparence, évaluer les répercussions économiques et sociales des prêts et l'effectivité de la mise en œuvre des mesures de diligence; renouvelle sa demande adressée à la Banque de fournir des détails sur son approche visant à accélérer les mesures censées s'attaquer à ces problèmes et demande à la BEI d'établir, avec la Commission, une liste de critères rigoureuse pour sélectionner ces intermédiaires financiers et de les rendre publics; |
|
52. |
déplore le résultat de l'examen de la politique de transparence de la BEI; estime que la nouvelle politique de transparence n'est pas aussi stricte que la précédente et qu'elle ne met pas fin à la culture du secret de la BEI, exhorte la BEI à fonctionner sur la base du «principe de diffusion des informations», plutôt que sur le «principe de confidentialité»,; rappelle l'obligation qui incombe à la BEI d'assurer la conformité de sa politique de transparence avec les dispositions du règlement (CE) no 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; regrette également le fait que l'indice 2013 de la transparence de l'aide (11) montre que la BEI a obtenu de mauvais résultats en matière de transparence et de responsabilité; |
|
53. |
prie la BEI de s'abstenir de coopérer avec des intermédiaires financiers dont le bilan est négatif en termes de transparence, d'évasion fiscale ou de pratiques d'évitement fiscal abusives, de recours à des pratiques fiscales préjudiciables telles que le «tax ruling» et la facturation intra-groupe abusive, de fraude, de corruption et d'incidences environnementales et sociales, ou qui ne jouissent pas d'un enracinement local fort, tout en mettant à jour ses politiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent; souligne la nécessité d'une transparence plus complète en ce qui concerne les prêts globaux, afin de garantir un contrôle rigoureux de l'impact de ce type de prêts indirects; encourage la BEI à conditionner le financement direct et le financement par les intermédiaires à la divulgation des données fiscales pertinentes pays par pays au regard de la disposition de la directive sur les exigences de fonds propres (DFP IV) relative aux institutions de crédit, ainsi que des informations relatives à la propriété effective; à cet effet, invite la BEI à mettre en place une nouvelle politique fiscale responsable, en se basant sur l'examen de sa politique sur les juridictions non coopératives (politique JNC) en 2015; |
|
54. |
demande instamment à la BEI de ne pas coopérer avec des entités opérant à partir de juridictions opaques «caractérisées notamment par l’absence d’impôt ou le prélèvement d’impôts minimes, l’absence d’un véritable échange d’informations avec les autorités fiscales étrangères, et un manque de transparence des dispositions législatives, juridiques ou administratives, ou identifiées comme tel par l'Organisation de coopération et de développement économiques ou le Groupe d’action financière» (12); |
|
55. |
invite la BEI à jouer un rôle de premier plan et d'exemple sur les questions de transparence et de responsabilité fiscales; invite plus particulièrement la BEI à recueillir des données précises sur le paiement des impôts résultants d'opérations d'investissements et de prêts, notamment sur l'impôt sur les bénéfices des entreprises et en particulier dans les pays en développement, et à analyser et publier ces données chaque année; |
|
56. |
se félicite de la création d'un registre public des documents en 2014, conformément au règlement (CE) no 1367/2006; |
|
57. |
déplore le fait que, dans le contexte d'un scandale récent (Mopani/Glencore), la BEI refuse de publier les conclusions de son enquête interne; prend note avec attention des recommandations de la Médiatrice européenne dans la plainte 349/2014/OV (13), qui invitent la BEI à reconsidérer son refus d'autoriser l'accès à son rapport d'enquête dans le cadre des allégations d'évasion fiscale de Glencore en ce qui concerne le financement de la mine de cuivre de Mopani en Zambie; demande à la BEI de suivre les recommandations de la Médiatrice européenne; |
|
58. |
regrette le manque de diversité au sein du comité de direction, du conseil des gouverneurs et du conseil des directeurs de la BEI, en particulier en matière d'égalité entre les hommes et les femmes; invite la BEI à appliquer l'esprit de la directive sur les exigences de fonds propres, qui oblige les banques, dans son article 88, paragraphe 2, à fixer «un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction et [à élaborer] une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l'organe de direction afin d'atteindre cet objectif. L'objectif, ainsi que les modalités de sa mise en œuvre, sont rendus publics»; |
|
59. |
rappelle qu'il a été convenu que le gouverneur de la BERD pour l'Union présente annuellement au Parlement européen un rapport sur l'utilisation du capital, sur les mesures prises pour assurer la transparence sur la manière dont la BERD contribue aux objectifs de l'Union, sur la prise de risques et sur la coopération entre la BEI et la BERD hors de l'Union; regrette que le gouverneur et la Commission n'aient pas agi de façon proactive pour mettre en œuvre cette disposition juridique (14); |
|
60. |
se réjouit que la BEI ait signé l'initiative internationale pour la transparence de l'aide (IITA) et qu'elle ait commencé à divulguer des informations dans ce cadre sur ses prêts accordés en dehors de l'Union européenne; |
Politiques externes
|
61. |
rappelle que la politique extérieure de la BEI, et en particulier les lignes directrices techniques opérationnelles régionales, doit être compatible avec les objectifs de l'Union concernant son action extérieure, tels que définis à l'article 21 du traité UE; plaide pour le respect intégral de la législation des pays bénéficiaires; |
|
62. |
se félicite de la mise en place du cadre de mesure des résultats (CMR) pour les activités en dehors de l'Union européenne, et des rapports de sa mise en œuvre; |
|
63. |
invite la BEI à évaluer la possibilité d'accroître le financement externe destiné au voisinage oriental et sud-méditerranéen de l'Union européenne dans le cadre du mandat actuel; |
|
64. |
se félicite du fait que le nouveau mandat de financement extérieur 2014-2020 exige de la BEI qu'elle publie des rapports d'achèvement de projet; s'attend à ce que la BEI satisfasse à cette exigence dès 2015; |
|
65. |
demande à nouveau à la Cour des comptes européenne de présenter un rapport spécial sur la performance des activités de prêt de la BEI à l'extérieur de l'Union et leur alignement sur les politiques européennes, avant l'examen à mi-parcours du mandat extérieur de la BEI, et de comparer leur valeur ajoutée par rapport aux ressources propres utilisées par la BEI; demande également à la Cour des comptes de dissocier, dans son analyse, les garanties octroyées par le budget de l'Union, la facilité d'investissement garantie par le FED, les différentes formes de financements mixtes utilisées dans le fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures, le fonds d'investissement de la Caraïbe et la facilité d'investissement pour le Pacifique, et l'utilisation des remboursements de ces investissements; demande également à la Cour des comptes européenne d'inclure dans son analyse la gestion par la BEI des fonds issus du budget de l'Union dans le cadre de son mécanisme d'investissement, via le fonds européen de développement, et à travers les différentes formes de mixité, via les mécanismes de mixité, et l'utilisation des remboursements pour ces investissements; |
Autres recommandations
|
66. |
demande à la BEI et au Parlement européen de mettre en place une plateforme de dialogue entre la BEI et les commissions du Parlement compétentes; demande sur cette base à la BEI de se rendre chaque trimestre au Parlement européen pour présenter les progrès et les activités de la BEI et en discuter; propose l'instauration, sur le modèle du dialogue monétaire trimestriel entre la BCE et le Parlement, d'un dialogue structuré régulier entre le président de la BEI et le Parlement afin d'assurer un meilleur contrôle parlementaire des activités de la BEI et de faciliter une coopération et une coordination renforcées entre les deux institutions; |
|
67. |
fait observer que les plaintes, émanant notamment des petites entreprises, persistent en ce qui concerne l'absence d'accès au financement provenant des capacités de prêt de la BEI à l'extérieur ou au financement soutenu par le FEI; demande par conséquent qu'une analyse annuelle répertorie le nombre de PME, et notamment de microentreprises, ayant bénéficié de ces instruments ainsi que les mesures prises par la BEI à l'égard des politiques des intermédiaires auxquels la BEI a recours afin d'améliorer l'accès réel des PME au financement; |
|
68. |
demande une évaluation exhaustive et un rapport sur les risques et les systèmes de contrôle associés à des financements mixtes avec la Commission européenne, en tenant compte de l'incidence des activités de cofinancement non seulement en termes de contrôle, mais également de choix du mode de gouvernance; |
|
69. |
salue la qualité élevée des actifs de la BEI, avec un taux de prêts douteux proche de 0 % (0,2 %) dans le portefeuille total des prêts; estime qu'il est essentiel de veiller à ce que la BEI conserve sa notation de crédit triple A, afin de continuer à bénéficier des meilleures conditions de financement sur les marchés internationaux de capitaux, ce qui aura des incidences positives sur le cycle de vie des projets, pour les parties intéressées comme pour le modèle économique de la BEI; |
|
70. |
fait observer que l'accord tripartite visé à l'article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et régissant la coopération entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes en ce qui concerne les modalités de contrôle, par la Cour des comptes, de l'activité de gestion des recettes et des dépenses de l'Union et des États membres exercée par la BEI doit être reconduit en 2015; demande à la BEI d'actualiser les compétences de la Cour des comptes européenne en la matière en intégrant tout nouvel instrument de la BEI faisant appel à des moyens publics de l'Union européenne ou du Fonds européen de développement; |
|
71. |
salue l'adoption, en 2013, par le conseil d'administration de la BEI, d'une politique anti-fraude mise à jour, qui confirme la politique de tolérance zéro de la banque; |
|
72. |
demande une approche plus efficace, moins réglementée et plus flexible dans l'attribution des fonds de la BEI; |
|
73. |
invite la BEI à engager un processus de dialogue structuré avec les parlements, les gouvernements et les partenaires sociaux, afin d'identifier, à intervalles réguliers, les initiatives pouvant créer des emplois et contribuer à accroître durablement la compétitivité de l'Europe; |
|
74. |
se félicite du soutien apporté aux PME dans les régions où le chômage des jeunes dépasse 25 %; |
|
75. |
salue l'attention portée aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) (entreprises employant entre 250 et 3 000 personnes) dans le cadre de l'initiative en faveur des ETI et de l'initiative de financement de la croissance, qui favorisent l'octroi de prêts, notamment aux ETI innovantes; |
|
76. |
salue la nouvelle initiative de la BEI intitulée «Compétences et emplois — Investir pour la jeunesse», qui est axée sur les mécanismes de financement en faveur de la formation professionnelle et de la mobilité des étudiants/apprentis et vise à offrir aux jeunes des possibilités d'emploi durables, et demande qu'une attention accrue soit portée à la formation professionnelle et que les investissements dans ce programme de prêt soient renforcés dans les années à venir; estime cependant que ce programme ne devrait pas entraîner une réaffectation des fonds du système de bourse actuel, notamment dans le cadre du programme Erasmus+; souligne que la mobilité doit être considérée comme une possibilité et rester un choix, et non pas devenir un instrument qui contribue au dépeuplement et à la marginalisation des zones touchées par le chômage; demande qu'une attention soit portée aux projets qui permettront de créer des emplois de qualité, en se concentrant notamment sur les projets liés à la création d'emplois pour les jeunes, qui améliorent la participation des femmes au marché du travail, qui réduisent le chômage à long terme et qui améliorent la sécurité de l'emploi des groupes défavorisés; |
|
77. |
se félicite que la BEI contribue, depuis longtemps, au financement de l'enseignement et de la formation par des opérations de prêts aux étudiants menées en Europe, notamment afin que les garanties de prêts pour les étudiants mobiles en master Erasmus soient rendues opérationnelles par le groupe BEI en 2015; souligne l'importance de règles avantageuses en matière de remboursement afin de faciliter pleinement l'accès des étudiants aux prêts, quelle que soit leur situation financière; |
|
78. |
invite la BEI à porter une attention particulière au critère du premier pilier, à savoir la contribution à la croissance et à l'emploi, notamment à l'emploi des jeunes, lors du choix de ses projets selon la méthode d'évaluation en trois piliers; souligne l'importance de l'emploi, de la formation et de l'apprentissage des jeunes pour le passage à un modèle durable et créateur d'emplois; |
|
79. |
rappelle que le vice-président Katainen s'est engagé à accroître le potentiel de la BEI en ce qui concerne non seulement les infrastructures mais également l'emploi et l'éducation des jeunes, et demande à la BEI de faire état de l'évolution de la situation dans ce domaine dans son prochain rapport annuel; est d'avis que les mesures déjà engagées en faveur de l'emploi des jeunes devraient être mises en œuvre plus rapidement et étendues progressivement; |
|
80. |
estime que la BEI devrait investir massivement dans des mesures créant des emplois durables pour les jeunes, en sus des mesures qui ont déjà été prises dans le cadre de l'initiative pour l'emploi des jeunes; |
o
o o
|
81. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres. |
(1) JO C 72 E du 11.3.2014, p. 51.
(2) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0057.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0201.
(4) JO C 349 E du 29.11.2013, p. 27.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0161.
(6) JO L 177 du 7.7.2012, p. 1.
(7) JO L 280 du 27.10.2011, p. 1.
(8) Voir: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL). Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Réf.: GAD/13/05) -«Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) Tarragona); IAM 2109-07 — Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambienta y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de almacén subterráneo de gas natural Castor»; et Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch et Torsten Dahm (2014): «The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?», Geophysical Journal International, 198, 941–953.
(9) Considérant 8 de la décision no 1219/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relative à la souscription, par l'Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à la suite de la décision d'augmenter ce capital (JO L 313 du 26.11.2011, p. 1).
(10) Décision de la Médiatrice européenne de clore l'enquête concernant la plainte 178/2014/AN contre la Banque européenne d'investissement — http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/en/58171/html.bookmark
(11) http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/
(12) Considérant 13 de la décision no 1219/2011/UE.
(13) http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/58471/html. bookmark
(14) Article 3 de la décision no 1219/2011/UE.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/88 |
P8_TA(2015)0184
Exposition universelle 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur l'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie (2015/2574(RSP))
(2016/C 346/14)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la décision du Bureau international des expositions d'organiser une exposition universelle à Milan, du 1er mai au 30 octobre 2015, sur le thème «Nourrir la planète, énergie pour la vie», |
|
— |
vu la décision de la Commission du 3 mai 2013 sur la participation de la Commission à l'exposition universelle de 2015 à Milan (C(2013)2507), |
|
— |
vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 3 mai 2013 intitulée «Participation de l'Union européenne à l'exposition universelle de 2015 à Milan “Nourrir la planète: de l'énergie pour la vie”» (COM(2013)0255), |
|
— |
vu les travaux du comité de pilotage scientifique de l'Union européenne chargé de préparer l'exposition universelle de 2014, appuyés par la Commission européenne et le Parlement européen et entamés le 21 mars 2014, dont le but est de fournir un avis éclairé sur les problèmes liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de formuler des orientations relatives au programme d'événements de l'exposition universelle de 2015, |
|
— |
vu les objectifs du Millénaire pour le développement, adoptés par les Nations unies en septembre 2000, et les objectifs de développement durable actuellement en préparation, qui seront adoptés lors de la prochaine assemblée générale des Nations unies en septembre 2015, |
|
— |
vu la publication de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) intitulée «World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision» (version 2012 de l'étude «Agriculture mondiale: horizon 2030/2050») |
|
— |
vu que la FAO a proclamé 2014 Année internationale de l’agriculture familiale, |
|
— |
vu que la FAO a proclamé 2015 Année internationale des sols, |
|
— |
vu sa résolution du 18 janvier 2011 sur la reconnaissance de l'agriculture comme secteur stratégique dans le cadre de la sécurité alimentaire (1), |
|
— |
vu la résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur le thème «Éviter le gaspillage des denrées alimentaires: stratégies pour une chaîne alimentaire plus efficace dans l'Union européenne» (2), |
|
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, notamment son article 25, qui reconnaît le droit à l'alimentation en tant que partie intégrante du droit à un niveau de vie suffisant, |
|
— |
vu la question à la Commission sur l'exposition universelle de 2015 à Milan: nourrir la planète, énergie pour la vie (O-000016/2015 — B8-0109/2015), |
|
— |
vu la proposition de résolution de la commission de l'agriculture et du développement rural, |
|
— |
vu l'article 128, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 2, de son règlement, |
|
A. |
considérant que le thème de l'exposition universelle de 2015 à Milan est «Nourrir la planète, énergie pour la vie» et que cette manifestation pourrait donner une impulsion sensible au débat sur l'amélioration de la production alimentaire et de la répartition des aliments, à la lutte contre le gaspillage, au soutien et au développement des stratégies concrètes existantes de lutte contre les problèmes d'insécurité alimentaire, de malnutrition et de déséquilibre alimentaire, ainsi qu'à la recherche d'un juste équilibre entre l'offre et la demande; |
|
B. |
considérant que le thème de l'exposition universelle de 2015 à Milan est l'occasion de passer en revue les solutions envisageables pour remédier aux contradictions d'une société mondialisée où, d'après des données de la FAO, d'une part, 898 millions de personnes sont sous-alimentées et souffrent de la faim tandis que, d'autre part, 1,4 milliard de personnes sont en surpoids, dont 500 millions sont obèses, ce qui a des retombées sociales et économiques néfastes, sans parler des conséquences très négatives sur la santé humaine; |
|
C. |
considérant que l'exposition universelle de 2015 à Milan coïncide avec l'échéance fixée pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et avec l'Année internationale des sols proclamée par l'ONU, et qu'elle devrait alimenter le débat sur les nouveaux objectifs de développement durable, dont le projet définitif est en phase de négociation; que l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle y tiennent une place prépondérante; |
|
D. |
considérant que les thèmes de l'exposition universelle de 2015à Milan portent essentiellement sur l'alimentation, y compris la pêche qui, comme l'agriculture, est liée aux questions de l'autonomie et de la durabilité alimentaires; |
|
E. |
considérant qu'une «charte de Milan» est en cours de préparation dans le contexte de l'exposition universelle de 2015, et qu'elle sera remise au secrétaire général des Nations unies à titre de legs de l'exposition et de contribution au débat international sur les objectifs du Millénaire pour le développement; |
|
F. |
considérant que les thèmes de l'exposition universelle de 2015 concernent principalement le secteur agricole, qui demeure l'un des piliers de l'économie de l'Union, sachant que les exportations agricoles représentent deux tiers de son commerce extérieur, que l'Union reste le premier exportateur de produits agricoles au monde, et que le secteur alimentaire de l'Union réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 1 000 milliards d'euros et emploie plus de quatre millions de personnes; |
|
G. |
considérant que, tout comme l'agriculture, la pêche est une composante essentielle de l'économie, d'abord pour ses importations — l'Union européenne est le plus gros importateur mondial de produits de la pêche et de l'aquaculture — et pour ses exportations, qui s'élèvent à 4,1 milliards d'euros par an, et ensuite en raison nombre de travailleurs employés dans ce secteur, à savoir 116 094 pour la pêche, 85 000 pour l'aquaculture et 115 651 pour la transformation des produits de la pêche; |
|
H. |
considérant que «Nourrir la planète, énergie pour la vie» est un thème général englobant toutes les activités économiques et de production qui contribuent à garantir la nutrition et la durabilité; |
|
I. |
considérant que le secteur de la pêche doit participer au débat sur la façon dont nourrir la planète dans la mesure où elle fournit des produits de la mer, en trouvant un juste équilibre entre l'offre et la consommation de ressources; |
|
J. |
considérant que, selon le comité de pilotage scientifique de l'Union européenne chargé de préparer l'exposition universelle de 2015, il est nécessaire de suivre de nouvelles pistes de réflexion dans certains domaines et de familiariser davantage l'opinion publique, par l'éducation et la communication, aux problématiques des denrées et de la production alimentaires dans les secteurs agricole, de l'économie bleue et de la pêche afin de sensibiliser les citoyens aux répercussions des choix alimentaires personnels à l'échelle mondiale; |
|
K. |
considérant que l'expérience de la société civile et sa participation au débat sur les thèmes abordés par l'exposition universelle de 2015 sont essentielles, et qu'il convient de valoriser les expériences et les initiatives qui en émanent afin d'engager un véritable débat à l'échelle internationale et d'élaborer des lignes directrices visant à atténuer les crises mondiales en matière de denrées alimentaires et d'alimentation; |
|
L. |
considérant que des sols sains sont non seulement indispensables à la production de denrées alimentaires, de combustibles, de fibres et de médicaments, mais qu'ils sont aussi essentiels pour nos écosystèmes, eu égard au rôle fondamental qu'ils jouent dans le cycle du carbone, dans le stockage et le filtrage de l'eau, ainsi que dans la lutte contre les inondations et la sécheresse; |
|
M. |
considérant que nos océans, nos mers et nos voies navigables intérieures sont précieuses sur le plan de la nutrition, et que leur protection est essentielle à notre survie; que la pêche et l'aquaculture assurent la subsistance de 10 à 12 % de la population mondiale; |
|
N. |
considérant que dans un souci de transparence totale de l'exposition universelle 2015, la plate-forme «Open Expo» publie au format ouvert l'ensemble des informations relatives à la gestion, à l'organisation et au déroulement de la manifestation et qu'à ce titre, elle peut être considérée comme exemplaire en matière de transparence; |
|
O. |
considérant que, selon la FAO, la population mondiale passera de 7 à 9,1 milliards de personnes à l'horizon 2050 et que l'approvisionnement alimentaire devra progresser de 70 % en conséquence, tandis que l'augmentation de la production ne suffira pas à elle seule à garantir la sécurité alimentaire pour tous; |
|
P. |
considérant que, selon la FAO, 925 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim en 2010; que plus d'un tiers des décès d'enfants de moins de cinq ans sont imputables à la sous-alimentation; |
|
Q. |
considérant que la FAO table sur une progression de seulement 4,3 % des terres arables exploitées; |
|
R. |
considérant que l'augmentation du revenu par habitant dans les pays émergents modifie les régimes alimentaires dans le sens d'une consommation accrue de produits riches en protéines, notamment d'origine animale, et de produits transformés, évolution qui favorise l'émergence à l'échelle mondiale du phénomène de convergence alimentaire que connaissent les populations les plus riches; |
|
S. |
considérant que la production de protéines est l'un des principaux défis à relever en matière de sécurité alimentaire, et que le secteur de la pêche a donc un rôle de premier plan à jouer à cet égard, tout comme l'économie bleue dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne la recherche en matière d'algues; |
|
T. |
considérant que le poisson est une source essentielle de protéines et de micronutriments pour les communautés pauvres ne disposant pas d'un accès immédiat à d'autres sources d'alimentation; que, dans de nombreuses régions du monde, les moyens de subsistance et les bienfaits nutritionnels des ressources marines sont obtenus localement, au sein de communautés pêchant le long des côtes ou dans les eaux intérieures alentour; |
|
U. |
considérant que les régimes alimentaires qui contiennent une forte proportion de produits d'origine animale nécessitent beaucoup plus de ressources que ceux qui ont une teneur élevée en produits d'origine végétale; |
|
V. |
considérant que dans les pays en développement, l'agriculture procure un emploi et des moyens de subsistance à plus de 70 % de la main-d'œuvre, principalement des femmes; que, selon les estimations de la Banque mondiale, la croissance du secteur agricole est deux fois plus efficace pour réduire la pauvreté que celle d'autres secteurs; |
|
W. |
considérant que, selon la FAO, en 2012, quelque 58,3 millions de personnes travaillaient dans le secteur primaire de la pêche de capture et de l'aquaculture; que cette même année, les femmes représentaient 15 % de toutes les personnes employées directement par ce secteur; que, globalement, la pêche et l'aquaculture assurent la subsistance de 10 à 12 % de la population mondiale; |
|
X. |
considérant qu'au sein même de l'Union subsistent des poches d'insécurité alimentaire et que 79 millions de personnes y vivent encore sous le seuil de pauvreté, tandis que 124,2 millions de personnes, soit 24,8 % de la population, sont exposées au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, contre 24,3 % en 2011; |
|
Y. |
considérant qu'un peu plus de la moitié seulement des pays en développement (62 sur 118) sont en passe de réaliser les OMD; |
|
Z. |
considérant que le droit universel à une alimentation adéquate est essentiel pour la réalisation des OMD; que l'alimentation intervient dans la plupart, voire dans tous les OMD, qui sont eux-mêmes étroitement liés; |
|
AA. |
considérant que plusieurs instruments juridiques internationaux lient le droit à l'alimentation à d'autres droits de l'homme, notamment au droit à la vie, au droit à un revenu, au droit à la santé, au droit à la propriété, au droit à l'éducation et au droit à l'eau; |
|
AB. |
considérant que la part de l'aide publique au développement allouée à l'agriculture au niveau international a chuté de façon spectaculaire au cours des trente dernières années; |
|
AC. |
considérant que le concept de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) renvoie non seulement à la disponibilité de denrées alimentaires, mais aussi au droit à l'alimentation, à une information précise sur les produits consommés, ainsi qu'à un accès universel à une alimentation saine, elle-même tributaire d'autres facteurs comme l'assainissement des eaux, l'hygiène, la vaccination et les traitements vermifuges; |
|
AD. |
considérant que la faim et la malnutrition constituent la première cause de mortalité et la principale menace pour la paix et la sécurité dans le monde; |
|
AE. |
considérant que l'instabilité des prix des denrées alimentaires a des retombées négatives sur la sécurité et la chaîne d'approvisionnement alimentaires; |
|
AF. |
considérant que récession économique mondiale ainsi que la hausse du prix des denrées alimentaires et des carburants ont aggravé la situation alimentaire dans de nombreux pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, anéantissant partiellement les progrès accomplis au cours des dix dernières années en matière de réduction de la pauvreté; |
|
AG. |
considérant que la fragilité des marchés agricoles et des produits de la pêche dans les pays en développement rend l'approvisionnement alimentaire extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles, aux conflits et aux crises sanitaires; |
|
AH. |
considérant que le système alimentaire contribue au changement climatique en même temps qu'il en subit les répercussions, ce qui joue sur la disponibilité des ressources naturelles et les conditions de production agricole, industrielle et de la pêche; |
|
AI. |
considérant que les catastrophes naturelles dues au changement climatique ont de graves conséquences pour les États membres et le reste du monde, et qu'elles menacent la sécurité et la souveraineté alimentaires, notamment dans les régions déjà vulnérables; |
|
AJ. |
considérant que d'après les estimations de la Commission, 30 % des denrées alimentaires dans le monde sont perdues ou gaspillées, et que le gaspillage alimentaire dans l'Union, qui avoisine actuellement 89 millions de tonnes par an (soit 179 kg par habitant), devrait atteindre quelque 126 millions de tonnes par an d'ici 2020 (soit une augmentation de 40 %) si aucune mesure préventive n'est prise; |
|
AK. |
considérant qu'une meilleure gestion de la filière alimentaire entraînerait une utilisation plus efficace des terres, une meilleure gestion des ressources hydriques ainsi que des retombées bénéfiques pour l'ensemble du secteur agricole et de la pêche au niveau mondial, et contribuerait à la lutte contre la sous-alimentation et la malnutrition dans les régions en voie de développement; |
|
AL. |
considérant que les rejets en mer constituent un gaspillage de ressources vivantes précieuses et joue un rôle important dans l'épuisement des stocks halieutiques; que les rejets peuvent avoir des conséquences écologiques néfastes pour les écosystèmes marins à cause des changements survenus dans la structure globale des réseaux trophiques et des habitats, qui pourraient à leur tour mettre en péril la pérennité des pêches actuelles; |
|
AM. |
considérant que la faim, la malnutrition et la sous-alimentation coexistent avec des niveaux paradoxalement élevés d'obésité et des pathologies imputables à une alimentation déséquilibrée qui, outre des retombées sociales et économiques, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé; |
|
AN. |
considérant que les accords d'investissement peuvent être préjudiciables à la sécurité alimentaire et aggraver la malnutrition si l'affermage ou la vente de terres arables à des investisseurs privés a pour effet d'empêcher l'accès des populations locales aux ressources productives indispensables à leur subsistance ou de déboucher sur l'exportation et la vente sur les marchés internationaux d'une grande partie des denrées, avec pour conséquence une dépendance accrue et une plus grande vulnérabilité du du pays bénéficiaire aux fluctuations des prix des produits de base sur ces marchés; |
|
AO. |
considérant qu'il ne suffit pas de fournir suffisamment de denrées alimentaires à tous pour juguler durablement la faim; que cet objectif ne pourra être atteint qu'en permettant aux petits paysans et à la pêche artisanale de garder et d'exploiter leurs terres et leurs eaux de pêche, en recourant à des systèmes de commerce équitable, et en partageant les connaissances, les innovations et les pratiques durables; |
|
AP. |
considérant qu'il convient de reconnaître le rôle fondamental des agriculteurs et des pêcheurs , et plus particulièrement celui de l'agriculture et de la pêche familiales, dans la sécurité alimentaire mondiale; |
|
AQ. |
considérant qu'il importe tout particulièrement de reconnaître le rôle essentiel des pêcheurs et des pisciculteurs exerçant leurs activités sur les territoires côtiers et les îles d'Europe; |
|
AR. |
considérant qu'il convient de reconnaître les fonctions multiples de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche qui non seulement assurent la production alimentaire mais sont également essentielles au bien-être des populations pour ce qui est de la qualité des paysages, de la biodiversité, de la stabilité du climat et de l'atténuation des catastrophes naturelles comme les inondations, les sécheresses et les incendies; |
|
1. |
souligne le caractère essentiel des aspects ci-après pour la résolution du problème de la sécurité alimentaire: des secteurs agricole et de la pêche forts et viables dans toute l'Union, une économie rurale prospère et diversifiée, un environnement propre, ainsi que des exploitations agricoles familiales bénéficiant de l'appui d'une politique agricole commune dynamique, plus équitable, durable à l'échelle internationale et correctement financée; |
|
2. |
insiste sur le fait qu'il importe également de mettre en œuvre une PCP durable et adéquatement financée, et de veiller à la cohérence entre les politiques de l'Union en matière de commerce et de pêche; |
|
3. |
estime que la viabilité économique des exploitations agricoles ainsi que l'accès des agriculteurs aux terres, au crédit et à la formation sont les conditions sine qua non de la viabilité environnementale et de l'aboutissement des efforts d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ce dernier; |
|
4. |
presse la Commission et les États membres de mettre à profit la thématique de l'exposition universelle de 2015 à Milan — «nourrir la planète, énergie pour la vie» — pour prendre des engagements en vue du respect du droit à une alimentation adéquate, saine, durable et reposant sur des informations fiables; |
|
5. |
appelle la Commission à veiller à ce que le pavillon où sera représentée l'Union lors de l'exposition universelle 2015 soit un lieu de sensibilisation à la nécessité de résoudre d'urgence les problèmes qui touchent la totalité de la chaîne alimentaire, notamment la viabilité à long terme de la production, de la répartition et de la consommation alimentaires, de mettre fin au gaspillage et de lutter contre les problèmes de malnutrition, de déséquilibre alimentaire et d'obésité. |
|
6. |
souligne que le droit à l'alimentation est un droit fondamental de l'humanité et qu'il n'est respecté que lorsque tous ont accès à des aliments adaptés, sains et nutritifs propres à satisfaire les besoins alimentaires pour une vie saine et active; |
|
7. |
insiste sur le fait que l'accès à des denrées alimentaires est un préalable à la réduction de la pauvreté et des inégalités, ainsi qu'à la réalisation des OMD; |
|
8. |
souligne que la lutte contre la malnutrition et la garantie d'un accès universel à des denrées adéquates et nutritives devraient encore figurer, après 2015, parmi les objectifs phare de l'action pour l'éradication de la faim, qui devrait viser, en particulier, à mettre un terme à toutes les formes de malnutrition d'ici 2030; |
|
9. |
estime que la forte instabilité des marchés des denrées alimentaires est préjudiciable à la durabilité et exige une multiplication des mesures de renforcement de la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et de la viabilité environnementale de la production alimentaire, par la résolution des problèmes de pénurie de ressources naturelles et l'action en faveur de la recherche et de l'innovation dans l'agriculture et la pêche; |
|
10. |
estime que des cadres institutionnels et réglementaires ainsi que des cadres de surveillance adaptés peuvent favoriser la mise en place d'un environnement propice à l'élaboration de systèmes de marchés agricoles et de la pêche dynamiques, pérennes, équitables, accessibles et diversifiés; |
|
11. |
insiste sur le fait que la Commission doit veiller à la cohérence entre les décisions politiques prises par ses directions générales du commerce, de l'agriculture et de la pêche, afin de garantir la réciprocité des normes en matière d'hygiène et de durabilité; |
|
12. |
est d'avis qu'il convient de promouvoir l'agriculture à petite échelle, l'agriculture biologique à haute valeur naturelle ou encore l'agroforesterie en tant que modèles éprouvés pour assurer la viabilité de la production alimentaire mondiale; |
|
13. |
demande à la Commission d'encourager le recours à des pratiques agronomiques plus efficaces, comme l'agroécologie et la diversification, ainsi que l'amélioration de la gestion durable des ressources agricoles, afin de réduire les coûts de production dans l'agriculture et le gaspillage de nutriments, de développer le transfert de connaissances et d'innovations, de favoriser l'efficacité des ressources, et d'améliorer la diversité des cultures et la viabilité des systèmes d'exploitation agricole; |
|
14. |
appelle la Commission à soutenir la recherche sur la qualité des eaux côtières, la gestion des sols et l'intensification durable en favorisant une utilisation plus efficace des nutriments, de l'eau et de l'énergie, en mettant l'accent sur la conservation des ressources hydriques et des ressources des sols, en poursuivant l'adaptation des mesures écologiques de lutte contre les nuisibles (lutte intégrée contre les organismes nuisibles), et en favorisant les recherches en vue d'améliorer les rendements tout en réduisant l'incidence environnementale; |
|
15. |
est préoccupé par l'émergence du phénomène d'accaparement des terres et par ses conséquences sur la sécurité alimentaire dans les pays en développement et sur l'avenir de l'agriculture et des agriculteurs; |
|
16. |
fait part de son inquiétude quant à l'émergence de la pêche illégale dans le monde entier, qui a des effets dévastateurs sur l'environnement, la biodiversité et l'économie; |
|
17. |
invite la Commission à sensibiliser les États membres et à les encourager à œuvrer pour une exploitation durable des sols, ressource nécessaire à la sécurité alimentaire et à une bonne alimentation, pour l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ce phénomène, ainsi que pour le développement durable en général; |
|
18. |
souligne l'importance de la lutte contre la dégradation des sols, qui aggrave encore la pauvreté et l'insécurité alimentaire; |
|
19. |
demande à la Commission d'encourager l'application à l'échelle mondiale, tant par les investisseurs que par les pays bénéficiaires, des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts; |
|
20. |
demande au gouvernement italien de proposer et de développer des projets de réutilisation durable des sites de l'exposition universelle de 2015; |
|
21. |
appelle la Commission à contribuer à la réalisation des objectifs de la FAO à l'échelle mondiale pour soutenir l'élaboration de politiques agricoles, environnementales et sociales favorables à une agriculture familiale durable; |
|
22. |
souligne que les déséquilibres actuels de la chaîne d'approvisionnement alimentaire menacent la viabilité de la production alimentaire; appelle de ses vœux davantage de transparence et d'équité dans la chaîne ainsi que l'éradication des pratiques commerciales déloyales et autres distorsions du marché afin de garantir des bénéfices équitables aux agriculteurs, des marges et des prix équitables tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et de veiller à la viabilité d'un secteur agricole en mesure d'assurer la sécurité alimentaire; demande par conséquent à la Commission de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour s'assurer que ces objectifs seront atteints dans les meilleurs délais; |
|
23. |
estime que la Commission et les États membres devraient promouvoir des politiques de lutte contre les pratiques déloyales dont l'existence a été reconnue dans le cadre du forum à haut niveau de la Commission sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; |
|
24. |
souligne que, pour garantir la sécurité alimentaire, il convient de lutter avec détermination contre la perte de sols et l'abandon des terres agricoles marginales; |
|
25. |
souligne que pour parvenir à la sécurité alimentaire, il convient de lutter énergiquement contre la pêche illégale; |
|
26. |
souligne le rôle prépondérant du développement rural pour la croissance économique et sociale des territoires et exhorte à soutenir les jeunes agriculteurs; |
|
27. |
demande à la Commission d'œuvrer, en amont des discussions internationales à venir dans le cadre de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra à Paris en 2015, à la conclusion d'un accord international ambitieux portant notamment sur l'alimentation du point de vue de l'atténuation du changement climatique; |
|
28. |
invite le Conseil à reconnaître le rôle de l'ensemble du secteur agricole dans l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à ce dernier; |
|
29. |
demande à la Commission de lutter contre le gaspillage alimentaire en fixant des objectifs ambitieux, clairement définis et contraignants pour encourager les États membres à agir contre le gaspillage tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, du champ à l'assiette; |
|
30. |
encourage les États membres à sensibiliser les citoyens, à promouvoir et à diffuser des pratiques exemplaires, à mener des études ainsi que des actions sociales et des campagnes éducatives sur le gaspillage alimentaire et sur l'importance d'une alimentation saine et équilibrée donnant la priorité aux produits agricoles locaux, et à proclamer l'année 2016 Année européenne de lutte contre le gaspillage alimentaire; |
|
31. |
estime qu'il importe d'entamer un dialogue avec les parties prenantes pour veiller à ce que les denrées alimentaires invendues mais comestibles sans risque soient systématiquement mises à la disposition d'organisations caritatives; |
|
32. |
presse les États membres et la Commission de promouvoir davantage une alimentation saine et réfléchie, et ce dès le plus jeune âge dans le cadre scolaire, de promouvoir des normes de qualité et de viabilité alimentaires dans la recherche et l'éducation — afin d'encourager des styles de vie responsables et sains — ainsi que de poursuivre l'élaboration de stratégies pour l'éradication de la malnutrition et des déséquilibres alimentaires et la prévention de l'obésité; |
|
33. |
souligne qu'il importe d'encourager l'éducation à une alimentation saine et équilibrée et de sensibiliser aux produits locaux et aux régimes traditionnels, qu'il convient de promouvoir; |
|
34. |
préconise que tout le système alimentaire, dont l'agriculture fait partie au même titre que les politiques en matière de commerce, de santé, d'éducation, de climat et d'énergie, adopte une démarche fondée sur les droits de l'homme, dont l'Union devrait se faire le héraut; |
|
35. |
appelle, par conséquent, à tenir compte de la dimension de genre et à promouvoir le développement des moyens d'action des femmes dans toutes les politiques de lutte contre l'insécurité alimentaire; |
|
36. |
rappelle qu'il importe d'encourager l'agriculture et la pêche dans les pays en développement et de l'allocation d'une part adéquate de l'aide européenne au développement au secteur agricole; déplore la baisse spectaculaire, depuis les années 1980, de la part de l'aide au développement octroyée à l'agriculture et se félicite que la nécessité d'inverser cette tendance ait été reconnue; |
|
37. |
estime qu'il importe d'améliorer la situation des femmes dans le domaine de l'agriculture, notamment dans les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), car il a été démontré que le développement des moyens d'action des femmes en zone rurale et les investissements dont elles sont les bénéficiaires se traduisent par une hausse sensible de la productivité et par un recul de la malnutrition; |
|
38. |
invite la Commission et les États membres à privilégier les programmes de coopération qui s'appuient sur le microcrédit pour aider les petites exploitations viables sur le plan environnemental à alimenter les populations locales; |
|
39. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil ainsi qu'aux commissaires d'exposition des États membres participants responsables de l'exposition universelle qui se tiendra à Milan en 2015. |
(1) JO C 136 E du 11.5.2012, p. 8.
(2) JO C 227 E du 6.8.2013, p. 25.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/95 |
P8_TA(2015)0185
Situation au Nigeria
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la situation au Nigeria (2015/2520(RSP))
(2016/C 346/15)
Le Parlement européen,
|
— |
vu ses résolutions antérieures sur le Nigeria, et notamment le tout dernier débat ayant eu lieu sur le sujet en séance plénière le mercredi 14 janvier 2015, |
|
— |
vu les déclarations de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini, y compris celles du 8 janvier, du 19 janvier, du 31 mars, du 14 avril et du 15 avril 2015, |
|
— |
vu les conclusions du Conseil du 9 février 2015, |
|
— |
vu le règlement d'exécution (UE) no 583/2014 de la Commission du 28 mai 2014 (1) qui a ajouté Boko Haram sur la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques, |
|
— |
vu le cinquième dialogue ministériel Nigeria-UE qui s'est tenu à Abuja le 27 novembre 2014, |
|
— |
vu les conclusions préliminaires des missions d'observation des élections de l'Union européenne et du Parlement européen, |
|
— |
vu la conférence régionale sur la sécurité qui s'est tenue le 20 janvier 2015 à Niamey, |
|
— |
vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies, Ban Ki-moon, sur la poursuite de la violence et la dégradation de la situation de sécurité dans le nord-est du Nigeria, |
|
— |
vu les déclarations du Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme évoquant la possibilité d'accuser de crimes de guerre les combattants de Boko Haram, |
|
— |
vu la déclaration des Nations unies de 1981 sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, |
|
— |
vu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, ratifiée par le Nigeria le 22 juin 1983, |
|
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Nigeria le 29 octobre 1993, |
|
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948, |
|
— |
vu la constitution de la République fédérale du Nigeria adoptée le 29 mai 1999, et en particulier les dispositions de son chapitre IV, |
|
— |
vu la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le protocole facultatif s'y rapportant, |
|
— |
vu l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres (l'accord de Cotonou), |
|
— |
vu l'article 208 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose de tenir compte du principe de cohérence des politiques au service du développement dans l'ensemble des politiques extérieures de l'Union, |
|
— |
vu l'article 123, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que le Nigeria est le pays d'Afrique le plus peuplé et le plus hétérogène sur le plan ethnique, et qu'il se caractérise par des clivages régionaux et religieux et par un antagonisme nord-sud sur fond de profondes disparités économiques et sociales; |
|
B. |
considérant que le Nigeria représente l'économie la plus importante du continent africain et est un partenaire commercial majeur de l'Union européenne, mais qu'en dépit de ses vastes ressources, il fait partie des pays les plus inégalitaires du monde, plus de 70 % de sa population vivant avec moins de 1,25 dollar américain par jour et 10 % de la population du pays contrôlant plus de 90 % de sa richesse et de ses ressources; |
|
C. |
considérant que Boko Haram a lancé, entre le 3 et le 8 janvier 2015, des attaques contre Baga et seize villes et villages aux alentours, qui se sont soldées, images satellites à l'appui, par la destruction de près de 3 700 bâtiments et la mort de milliers de personnes; |
|
D. |
considérant que Boko Haram a pris le contrôle de plusieurs villes dans le nord-est du Nigeria et qu'il continue de forcer des civils, dont de nombreux enfants, à rejoindre ses rangs; que les actes de violence perpétrés par Boko Haram ont causé plus de 22 000 morts depuis 2009, et qu'ils visent sans distinction des chrétiens, des musulmans et quiconque n'adhère pas à ses convictions dogmatiques extrêmes; qu'en mars 2015 Boko Haram a revendiqué son allégeance au groupe État islamique; que, le 27 mars 2015, des centaines de corps ont été découverts dans la ville de Damasak, au nord-est du pays, et qu'il s'agit apparemment de victimes du groupe Boko Haram; |
|
E. |
considérant qu'en avril 2014, plus de 270 jeunes filles ont été enlevées dans une école publique de la ville de Chibok, dans l'État de Borno; que la majorité d'entre elles sont toujours portées disparues et risquent fortement d'être victimes de violences sexuelles, d'esclavage et de mariages forcés; que, depuis, des centaines d'autres personnes ont été enlevées par Boko Haram; que, le 28 avril 2015, près de 300 filles et femmes ont été secourues dans la forêt de Sambisa; |
|
F. |
considérant que les Nations unies estiment à 1,5 million, y compris 800 000 enfants, le nombre de personnes déplacées du fait des violences dans les États de Borno, Yobe et Adamawa, et à plus de 3 millions le nombre de personnes touchées par les actions du groupe rebelle armé; |
|
G. |
considérant que plus de 300 000 Nigérians se sont réfugiés au nord-ouest du Cameroun et au sud-ouest du Niger pour échapper à la violence, et que des centaines de Nigérians risquent leur vie sur les routes migratoires à destination de l'Union dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions de vie sur les plans économique et social, ainsi que davantage de sécurité; |
|
H. |
considérant que Boko Haram cherche à instaurer un État islamique radical dans le nord du Nigeria prévoyant notamment l'instauration de tribunaux de la charia, et qu'il interdit toute forme d'éducation occidentale; |
|
I. |
considérant que, eu égard à l'insécurité grandissante, les populations ne peuvent plus cultiver leurs terres ou récolter leurs produits de peur d'être attaquées par les combattants de Boko Haram, situation qui aggrave encore l'insécurité alimentaire; |
|
J. |
considérant que le nombre d'attaques, parmi lesquelles des attentats suicides perpétrés en utilisant des enfants, est en augmentation et que les attaques sont commises sur des zones étendues, ainsi que dans les pays voisins que sont le Tchad et le Cameroun; |
|
K. |
considérant que la réponse initiale des autorités nigérianes a été très insuffisante et a provoqué un sentiment de méfiance de la population à l'égard des institutions du pays; considérant que, sous le gouvernement précédent, les autorités nigérianes ont procédé à des incarcérations et à des arrestations à grande échelle ainsi qu'à des exécutions extrajudiciaires, et qu'un grand nombre de violations du droit international ont été commises; |
|
L. |
considérant que l'extension de la rébellion de Boko Haram aux pays voisins démontre l'importance d'une plus grande coopération régionale et d'une réponse plus ferme; |
|
M. |
considérant que le Nigeria tient une place centrale dans le paysage politique régional et africain et qu'il joue un rôle moteur dans l'intégration régionale par l'intermédiaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO); |
|
N. |
considérant que les recettes du pétrole ont baissé de manière constante et qu'une crise économique menace, et que, selon certaines estimations, les vols annuels de pétrole se chiffreraient entre 3 et 8 milliards de dollars américains; considérant que des décennies de mauvaise gestion économique, d'instabilité et de corruption ont pénalisé les investissements dans le système éducatif et les services sociaux du pays; |
|
O. |
considérant que l'éducation, l'alphabétisation, les droits des femmes, la justice sociale et une répartition équitable des recettes publiques dans la société via les systèmes fiscaux, la réduction des inégalités et la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale sont essentiels pour lutter contre le fondamentalisme, la violence et l'intolérance; |
|
P. |
considérant que le terrorisme représente une menace mondiale, mais que les efforts de la communauté internationale pour intensifier la lutte contre Boko Haram au Nigeria dépendaient, dans une certaine mesure, de la tenue d'élections menées de manière totalement crédible, responsable et transparente; |
|
Q. |
considérant que le Nigeria est une démocratie encore jeune et fragile, qui a été confrontée à des violences extrêmes à la suite des résultats des élections de 2011 et des accusations de trucage; |
|
R. |
considérant que la commission électorale nationale indépendante a reporté les élections, initialement prévues les 14 et 28 février 2015, au 28 mars et au 11 avril 2015, afin de permettre au gouvernement de lancer des actions militaires contre Boko Haram, et qu'une réponse régionale a été lancée en mars 2015; |
|
S. |
considérant que l'armée tchadienne, avec le Niger et le Cameroun, est la principale force intervenant contre Boko Haram, et que son implication totale contre les terroristes de Boko Haram dans les villes nigérianes de Gamboru Ngala, Malam Fatori et Kangalam est reconnue; considérant le lourd tribu payé par cette armée dans la guerre contre le terrorisme; considérant que le Parlement européen exprime toute sa solidarité avec les blessés et les familles des victimes; |
|
T. |
considérant que la campagne électorale a eu lieu dans un environnement tendu et qu'il a, dans ce contexte, été signalé des incidents violents dans l'ensemble du pays, surtout dans le sud et le sud-ouest, ainsi que des attaques de Boko Haram visant à dissuader les électeurs, des violations du code électoral et des tentatives d'intimidation des électeurs; |
|
U. |
considérant que les observateurs locaux et internationaux, y compris des observateurs de l'Union européenne, ont relevé des manquements dans l'application de la procédure, notamment des irrégularités au stade du recueil des résultats, des abus de pouvoir et des cas de recours à la violence; que, malgré cela, aucune manipulation systématique n'a été observée; |
|
V. |
considérant que l'Union européenne a déployé une mission d'observation électorale à long terme à l'invitation du gouvernement, qui incluait une délégation du Parlement européen; considérant que des missions semblables ont également été déployées par l'Union africaine, le Commonwealth et la CEDEAO; |
|
W. |
considérant que, le 31 mars 2015, le général Muhammadu Buhari, candidat du parti d'opposition APC (All Progressive Congress), a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle et que le président en place a reconnu sa défaite sans incidents; que le parti d'opposition APC a recueilli la majorité des voix aux élections présidentielles, au sénat et à la chambre des représentants dans quatre des six zones géopolitiques; |
|
X. |
considérant que le nombre de femmes élues a reculé par rapport à 2011, où la tendance était déjà à la baisse; |
|
Y. |
considérant que 17 % de jeunes filles sont mariées avant leurs 15 ans, et que les mariages d'enfants représentent 76 % des mariages dans la région du nord-ouest; que c'est au Nigeria que l'on comptabilise en chiffres absolus le plus grand nombre de victimes de mutilations génitales féminines au monde, soit environ le quart des 115-130 millions estimés de victimes dans le monde; |
|
1. |
condamne fermement les violences actuelles et croissantes, y compris la vague continue d'attaques armées et d'attentats à la bombe, d'attentats suicides, d'esclavage sexuel et autres violences sexuelles, d'enlèvements et d'autres actes de violence commis par la secte terroriste Boko Haram contre des cibles civiles, gouvernementales et militaires, qui ont causé des milliers de morts et de blessés et le déplacement de centaines de milliers de personnes, et qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité; |
|
2. |
déplore le massacre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents et se tient aux côtés du peuple nigérian, déterminé à lutter contre toutes les formes de terrorisme dans son pays; salue le travail de tous les journalistes et défenseurs des droits de l'homme qui cherchent à attirer l'attention du monde entier sur l'extrémisme de Boko Haram et sur les innocentes victimes de sa violence; |
|
3. |
rappelle qu'une année s'est écoulée depuis l'enlèvement de 276 jeunes filles dans une école près de Chibok et que, d'après des groupes de défense des droits de l'homme, 2 000 filles et femmes supplémentaires ont été enlevées; demande au gouvernement et à la communauté internationale de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour retrouver les personnes enlevées et les libérer; |
|
4. |
invite le président nouvellement élu à tenir ses promesses électorales et à déployer tous les moyens dont il dispose pour mettre fin aux violences perpétrées par Boko Haram, rétablir la stabilité et la sécurité dans l'ensemble du pays et s'attaquer aux causes profondes de cette forme de terrorisme, et, notamment, à prendre des mesures plus fermes pour lutter contre la corruption interne, la mauvaise gestion et le manque d'efficacité dans les institutions publiques et l'armée, qui ont rendue cette dernière incapable de combattre le fléau de Boko Haram dans le nord du pays, ainsi qu'à prendre des mesures visant à priver le groupe Boko Haram de ses sources de revenus illégales à travers une coopération avec les pays voisins, en particulier en ce qui concerne la contrebande et la traite des êtres humains; |
|
5. |
demande aux autorités et chefs religieux du Nigeria de coopérer activement avec la société civile et les autorités publiques pour lutter contre l'extrémisme et la radicalisation; |
|
6. |
demande également aux nouvelles autorités nigérianes d'adopter une feuille de route sur le développement social et économique des États du nord et du sud dans le but de faire face aux problèmes de pauvreté et aux inégalités, qui constituent l'une des causes de la montée de la violence, de garantir des possibilités d'éducation et l'accès aux soins de santé, en favorisant une répartition équitable des revenus pétroliers dans un cadre décentralisé; invite également les autorités nigérianes à prendre des mesures résolues pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines, aux mariages d'enfants et au travail des enfants; demande à l'Union européenne d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour promouvoir ces mesures, tarir efficacement les flux financiers illicites, faire reculer la fraude et l'évasion fiscales, et renforcer la coopération internationale démocratique en matière fiscale; |
|
7. |
se félicite de la détermination affichée par les 13 pays qui ont participé au sommet régional de Niamey les 20 et 21 janvier 2015, notamment de la volonté du Tchad, appuyé par le Cameroun, le Niger et le Nigeria, d'apporter une réponse militaire aux menaces terroristes de Boko Haram; encourage un renforcement de cette réponse régionale, à l'aide de tous les outils existants et dans le respect plein et entier du droit international; demande en particulier à la CEDEAO de continuer à rendre opérationnelle sa nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme en attachant une attention particulière à endiguer les flux transfrontaliers illicites d'armement, d'armes, de combattants et de produits de contrebande; souligne que faute d'une telle coopération, les violences risquent de se poursuivre, mettant en péril la paix et la stabilité de l'ensemble de la région; met en avant, à cet égard, le serment d'allégeance de Boko Haram envers le groupe État islamique et la nécessité d'empêcher toute nouvelle coordination ou coopération entre les deux organisations terroristes, de même que l'expansion de cette menace; |
|
8. |
se félicite des initiatives du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et invite cette dernière à entreprendre de toute urgence, avec l'ensemble des pays concernés, des actions concrètes pour coordonner la lutte contre les groupes terroristes présents dans la région du Sahel; invite instamment l'Union européenne à soutenir la création de mécanismes régionaux de gestion des conflits comme la Force africaine en attente, et à offrir la possibilité de recourir à la Facilité de paix pour l'Afrique et aux outils européens de gestion de crise; |
|
9. |
invite instamment la communauté internationale à redoubler d'efforts pour aider le gouvernement nigérian à lutter contre Boko Haram et à combattre les causes profondes du terrorisme, étant entendu que seule une réponse globale pourra faire cesser définitivement la violence et le fondamentalisme; |
|
10. |
demande à l'Union européenne et à ses États membres d'honorer leur engagement d'apporter au Nigeria et à sa population un soutien à tous les niveaux — politique, en matière de développement et humanitaire — pour les aider à lutter contre la menace que constitue Boko Haram et à assurer le développement du pays; prie instamment l'Union de poursuivre son dialogue politique avec le Nigeria, conformément à l'article 8 de l'accord de Cotonou révisé, et de régler, dans ce cadre, les questions liées aux droits de l'homme universels, notamment à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, et à la lutte contre toutes les formes de discrimination, tels qu'ils sont inscrits dans les instruments universels, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l'homme; |
|
11. |
invite la communauté internationale à aider également les Nigérians qui ont trouvé refuge dans les pays voisins; demande instamment aux États membres de l'Union de mettre en place sans délai un système européen crédible et global pour gérer les routes migratoires qui relient l'Afrique sub-saharienne au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord, offrir des solutions pour le développement durable des pays d'origine tels que le Nigeria et mettre un terme aux tragédies humaines qui ont lieu sur ces routes; |
|
12. |
exhorte en outre l'Union à enquêter sur le financement de Boko Haram et à promouvoir la transparence des échanges pour l'ensemble des ressources naturelles, notamment le pétrole, afin d'éviter qu'une entreprise n'alimente les conflits; demande aux autorités nigérianes et aux entreprises étrangères de contribuer au renforcement de la gouvernance dans le secteur des industries d'extraction en respectant l'initiative en faveur de la transparence dans les industries extractives et en publiant les sommes que les entreprises versent au gouvernement nigérian; |
|
13. |
estime que le gouvernement nigérian a tant le droit que la responsabilité de défendre son peuple contre le terrorisme, mais insiste sur la nécessité de veiller à ce que les actions menées à cette fin respectent les droits de l'homme et l'état de droit; |
|
14. |
demande que les accusations de violations des droits de l'homme, parmi lesquelles des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture, des arrestations arbitraires et des infractions relevant de l'extorsion, fassent l'objet d'enquêtes approfondies et estime que de telles actions ne peuvent être présentées comme des moyens justifiés de lutter contre la menace que constituent Boko Haram ou d'autres organisations terroristes; estime nécessaire et urgente une réforme du système judiciaire nigérian, afin qu'il soit doté d'une justice pénale efficace pour lutter contre le terrorisme, tout comme est nécessaire une réforme des forces de sécurité d'État du Nigeria; |
|
15. |
demande instamment que les soldats blessés reçoivent les soins appropriés, et que les filles et les femmes qui ont été victimes de viol dans le cadre d'un conflit armé se voient offrir toute la palette de services de santé sexuelle et reproductive dans des centres humanitaires financés par l'Union européenne, conformément à l'article 3 commun aux conventions de Genève, qui garantit tout soin médical nécessaire en raison de la condition de blessé ou de malade, sans aucune distinction de caractère défavorable; |
|
16. |
félicite le général Muhammadu Buhari, candidat du parti APC, pour son élection au poste de président, ainsi que les candidats de tous les partis qui ont obtenu un siège au sénat ou à la chambre des représentants, ou bien ont été élus gouverneurs ou membres des parlements des États; salue l'attitude des candidats qui ont reconnu leur défaite de bonne grâce, en commençant par le président sortant et candidat à la présidentielle Goodluck Jonathan, salue l'engagement continu de l'ensemble des partis politiques et des candidats en faveur de la tenue d'élections pacifiques et leur demande instamment de continuer à accepter les résultats dans le calme; |
|
17. |
félicite le peuple nigérian pour son enthousiasme démocratique et la mobilisation dont il a fait preuve tout au long du processus électoral, et demande aux autorités nigérianes de renforcer la bonne gouvernance et de promouvoir une plus grande responsabilité des institutions démocratiques; est convaincu que le transfert de pouvoir via les urnes démontre le renforcement de la démocratie au Nigeria, qui pourrait servir de modèle pour d'autres nations africaines; |
|
18. |
salue la détermination de la commission électorale nationale indépendante à s'engager sur la voie d'un processus électoral équitable, transparent et relativement crédible (autant que possible), malgré les contraintes internes et externes et les pressions auxquelles elle doit faire face, et en particulier le fait qu'elle inclue les personnes handicapées; |
|
19. |
encourage les victimes à porter plainte par l'intermédiaire de mécanismes officiels de résolution des différends, et prie les autorités nigérianes de répondre à chacune d'entre elles au moyen d'une enquête complète et crédible et des recours prévus par la loi; demande à l'Union d'appuyer la mise en place de tels mécanismes; |
|
20. |
invite le gouvernement nigérian à encourager la participation des femmes à la vie publique et politique; |
|
21. |
demande à nouveau l'abrogation de la loi interdisant l'homosexualité et l'abolition de la peine de mort; |
|
22. |
demande aux autorités nigérianes de prendre des mesures d'urgence dans le delta du Niger, y compris des actions visant à mettre un terme aux activités pétrolières illégales, et d'aider les personnes exposées à la pollution; demande à l'Union européenne et à ses États membres de fournir une expertise technique et des ressources pour contribuer à la restauration de cette zone; demande à toutes les entreprises internationales actives dans la région de respecter les normes internationales les plus élevées et de s'abstenir de toute action qui pourrait nuire à l'environnement et aux communautés locales; |
|
23. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au gouvernement et au parlement du Nigeria, ainsi qu'aux représentants de la CEDEAO et de l'Union africaine. |
(1) JO L 160 du 29.5.2014, p. 27.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/101 |
P8_TA(2015)0186
Le cas de Nadiya Savchenko
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur le cas de Nadia Savtchenko (2015/2663(RSP))
(2016/C 346/16)
Le Parlement européen,
|
— |
vu ses précédentes résolutions sur la Russie et l'Ukraine, en particulier celles sur l'assassinat de Boris Nemtsov, figure de l'opposition russe, et l'état de la démocratie en Russie (1) du 12 mars 2015, et sur la situation en Ukraine (2) du 15 janvier 2015, |
|
— |
vu la déclaration de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 4 mars 2015 sur le maintien en détention de Nadia Savtchenko, |
|
— |
vu les mesures en vue de l'application des accords de Minsk adoptées et signées à Minsk le 12 février 2015 et approuvées dans leur ensemble par la résolution 2202(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies du 17 février 2015, |
|
— |
vu la déclaration de l'Union européenne sur l'enlèvement et détention illégale de citoyens ukrainiens par la Fédération de Russie du 16 avril 2015, |
|
— |
vu les dispositions du droit international humanitaire et en particulier la troisième convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, |
|
— |
vu la déclaration commune du Président ukrainien, du Président du Conseil européen et du Président de la Commission européenne adoptée à l'occasion du 17e sommet UE-Ukraine, qui appelle à la libération de tous les otages et de toutes les personnes détenues illégalement, y compris Nadia Savtchenko, |
|
— |
vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que les militants pro-russes de la «République populaire de Louhansk», dans les régions orientales de l'Ukraine, ont illégalement enlevé le lieutenant Nadia Savtchenko, pilote militaire et ancien officier des forces armées ukrainiennes sur le territoire ukrainien le 18 juin 2014; que celle-ci est toujours détenue et a été illégalement transférée vers la Fédération de Russie; |
|
B. |
considérant que Mme Savtchenko, née en 1981, a déjà mené une brillante carrière militaire, qu'elle a été la seule femme soldat parmi les troupes ukrainiennes de maintien de la paix en Iraq et la première femme à entrer à l'académie ukrainienne des forces aériennes, et qu'elle a été capturée alors qu'elle s'était portée volontaire pour prendre part aux combats en Ukraine orientale au sein du bataillon Aïdar; |
|
C. |
considérant que, le 24 avril 2015, la commission d'enquête russe a inculpé Nadia Savtchenko pour complicité et tentative de meurtre sur au moins deux personnes et pour avoir franchi illégalement la frontière de la Fédération de Russie; |
|
D. |
considérant que Nadia Savtchenko est membre du parlement ukrainien et de la délégation ukrainienne à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; que la commission des immunités et des affaires institutionnelles de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a confirmé son immunité; que la Fédération russe rejette l'immunité diplomatique accordée à Nadia Savtchenko en tant que membre du parlement ukrainien alors que la communauté internationale a déployé des efforts considérables pour la faire libérer, en particulier en adoptant la résolution 2034(2015) de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe par laquelle elle demande sa libération immédiate ainsi que le respect de son immunité parlementaire en tant que membre de la délégation ukrainienne à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; |
|
E. |
considérant que la Fédération de Russie a accepté l'échange de tous les otages politiques et de toutes les personnes détenues illégalement en application des accords de Minsk sur la base du principe «tous contre tous», et qu'elle était censée s'exécuter au plus tard cinq jours après le retrait des armes lourdes; que Nadia Savtchenko s'est vue à plusieurs reprises proposer l'amnistie à condition de reconnaître sa culpabilité; |
|
F. |
considérant que Nadia Savtchenko a entamé une grève de la faim il y a plus de trois mois pour protester contre sa détention arbitraire; qu'elle a fait l'objet d'examens et de traitement psychiatriques auxquels elle n'avait pas donné son accord; que les juridictions moscovites ont rejeté les recours introduits par Nadia Savtchenko contre sa détention préventive; que, dans l'intervalle, sa santé s'est dégradée; que l'Union européenne et plusieurs États membres ont fait part de préoccupations réellement humanitaires à cet égard; que plusieurs appels ont été lancés au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et à la Croix-Rouge internationale pour la faire libérer; |
|
1. |
demande la libération immédiate et sans condition de Nadia Savtchenko; condamne la Fédération de Russie pour l'enlèvement et la détention depuis près d'un an de Nadia Savtchenko ainsi que pour les poursuites lancées à son égard, et ce en toute illégalité; demande aux autorités russes de respecter leurs engagements internationaux dans le cadre des accords de Minsk et en particulier les mesures en vue de l'application des accords de Minsk adoptées et signées à Minsk; considère que la Russie ne dispose d'aucune base juridique ni d'aucune compétence pour engager des poursuites à l'encontre de Nadia Savtchenko ou la maintenir en détention; |
|
2. |
est d'avis que la détention de Nadia Savtchenko en tant que prisonnière de guerre en Russie constitue une violation de la convention de Genève; souligne que les personnes responsables de sa détention arbitraire en Russie pourraient faire l'objet de sanctions ou de poursuites judiciaires internationales; |
|
3. |
rappelle aux autorités russes que les conditions de santé de Mme Savtchenko demeurent extrêmement fragiles et qu'elle sont directement responsables de sa sécurité et de son bien-être; appelle les autorités russes à permettre à des médecins internationaux impartiaux d'examiner Mme Savtchenko et à veiller à ce que tout examen médical ou psychologique ne soit réalisé qu'avec l'accord de celle-ci et en tenant compte du fait qu'elle poursuit une grève de la faim depuis plusieurs mois; demande à la Russie de permettre aux organisations humanitaires internationales de la rencontrer à tout moment; |
|
4. |
demande la libération immédiate de tous les citoyens ukrainiens, y compris le réalisateur Oleg Sentsov et Khaizer Dzhemilev, détenus arbitrairement en Russie; |
|
5. |
prie instamment le président français et la chancelière allemande ainsi que leurs ministres des affaires étrangères d'évoquer le cas de Nadia Savtchenko lors des prochaines réunions du groupe de contact sur l'application des accords de Minsk en format «Normandie»; appelle la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) à continuer à suivre de près la situation de Nadia Savtchenko, à l'évoquer dans le cadre de différents formats et de différentes réunions avec les autorités russes et à tenir le Parlement européen informé des résultats obtenus; |
|
6. |
souligne que la libération de Nadia Savtchenko ne constitue pas seulement une étape nécessaire pour l'amélioration des relations entre l'Ukraine et la Russie, mais qu'elle montrerait que les autorités russes reconnaissent et respectent les droits fondamentaux; |
|
7. |
rappelle que Nadia Savtchenko a été élue au parlement ukrainien lors des élections législatives d'octobre 2014 et fait partie de la délégation à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, et qu'elle bénéficie de l'immunité internationale; rappelle que la Russie est tenue de respecter son immunité en tant que membre de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; |
|
8. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au président, au gouvernement et au parlement de la Fédération russe, au président, au gouvernement et au parlement d'Ukraine et au président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. |
(1) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0074.
(2) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0011.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/103 |
P8_TA(2015)0187
Situation du camp de réfugiés de Yarmouk en Syrie
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur la situation du camp de réfugiés de Yarmouk en Syrie (2015/2664(RSP))
(2016/C 346/17)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le droit humanitaire international, |
|
— |
vu ses précédentes résolutions sur la Syrie, |
|
— |
vu la déclaration du 10 avril 2015 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et du commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises, sur la situation à Yarmouk (Syrie), |
|
— |
vu la déclaration du 18 avril 2015 de la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l'Union européenne, sur la situation du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk en Syrie, |
|
— |
vu les résolutions 2139 (2014), 2165 (2014) et 2191 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, |
|
— |
vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que l'EI/Daesh a attaqué le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk le 1er avril 2015; que le régime d'Assad a poursuivi le pilonnage et le bombardement aérien du camp en réponse à l'offensive de l'EI et que des batailles de rue intenses entre des groupes d'opposition armée anti-Assad, Aknaf Bait al-Makdis d'un côté et l'EI/Daesh et le Front al-Nosra de l'autre, ont eu lieu dans l'ensemble du camp; que le 16 avril 2015, des unités militaires palestiniennes, avec l'assistance de rebelles syriens, ont obligé les combattants de l'EI/Daesh à se retirer du camp; qu'après le retrait de l'EI/Daesh, le camp se trouve dans une large mesure sous le contrôle du Front al-Nosra, affilié à Al-Qaïda; |
|
B. |
considérant que Yarmouk, le plus grand camp de réfugiés palestiniens de Syrie, créé en 1957 pour accueillir des personnes fuyant le conflit isarélo-arabe, a sombré dans des luttes entre le gouvernement syrien et des groupes armés tels que le Front al-Nosra et l'Armée syrienne libre; que plus de 160 000 civils vivaient dans le camp avant le conflit syrien, alors qu'il n'en reste que 18 000 aujourd'hui; |
|
C. |
considérant que les 480 000 réfugiés palestiniens demeurent un groupe particulièrement vulnérable dans une Syrie en crise; qu'ils sont éparpillés dans plus de 60 camps dans l'ensemble de la région; que 95 % des réfugiés palestiniens dépendent actuellement de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) pour assurer leur alimentation quotidienne et satisfaire leurs besoins en eau et en soins de santé; |
|
D. |
considérant que la population civile du camp de Yarmouk est assiégée depuis décembre 2012 et soumise à des bombardements et pilonnages aveugles du régime d'Assad, et qu'elle demeure piégée à l'intérieur du camp; que, selon l'UNRWA, 18 000 civils palestiniens et syriens de Yarmouk, y compris 3 500 enfants, ont besoin de l'aide humanitaire la plus élémentaire; |
|
E. |
considérant que le camp est en situation de crise sanitaire permanente, une épidémie de typhoïde ayant eu lieu en 2014 et l'hépatite A ainsi que les maladies liées à l'eau étant endémiques, de même que la malnutrition, avec toutes les conséquences connues; |
|
F. |
considérant que le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé que toutes les parties à la guerre civile syrienne laissent un accès humanitaire au camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk et permettent à l'aide humanitaire d'atteindre ce camp sans obstruction; |
|
G. |
considérant que la Commission a dégagé un financement d'urgence immédiat de 2,5 millions d'euros pour les opérations menées par l'UNRWA afin d'apporter aux réfugiés palestiniens en danger de mort en Syrie l'assistance dont ils ont besoin, sous forme d'une aide en espèces et d'une distribution d'articles de première urgence; |
|
H. |
considérant que l'aide accordée dans le cadre de l'enveloppe humanitaire allouée par l'UE à la Syrie pour 2015 facilitera en outre une intervention humanitaire rapide destinée à répondre aux besoins des familles vulnérables; que ce financement s'étend à toutes les régions de Syrie touchées par le conflit, avec une attention toute particulière pour Yarmouk, Idlib, Dara'a et Alep, théâtres de violences récentes; |
|
I. |
considérant qu'en continuant d'empêcher l'accès humanitaire aux réfugiés qui vivent dans le camp de Yarmouk, le régime syrien et les autres belligérants vont à l'encontre du droit humanitaire international; considérant que la capacité de l'UNRWA à pourvoir à des interventions d'urgence vitales, répondant à des événements urgents tels que ceux qui frappent le camp de Yarmouk, est gravement compromise par le sous-financement chronique des interventions humanitaires à l'intérieur de la Syrie; |
|
1. |
exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration continue de la sécurité et de la situation humanitaire en Syrie, et en particulier dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk et dans d'autres camps palestiniens; répète sa vive détermination à venir en aide aux victimes du conflit syrien; |
|
2. |
condamne la prise de contrôle du camp de Yarmouk et les actes de terrorisme perpétrés par l'EI/Daesh et le Front al-Nosra, ainsi que le siège de Yarmouk par le régime d'Assad et le bombardement du camp, y compris au moyen de barils remplis d'explosifs, qui causent des souffrances horribles à la population touchée; demande la levée immédiate du siège et la fin de toutes les attaques contre la population civile; |
|
3. |
exprime sa préoccupation pour tous les défenseurs des droits de l'homme détenus au camp de Yarmouk et pour ceux qui sont actuellement aux mains des forces de sécurité syriennes; demande à tous les groupes armés du camp de Yarmouk de ne plus cibler les défenseurs des droits de l'homme; |
|
4. |
demande instamment le respect de la neutralité de Yarmouk et la protection des civils à l'intérieur du camp, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que la préservation des infrastructures médicales, des établissements scolaires et des lieux de refuge; |
|
5. |
souligne que la guerre en cours en Syrie et la menace que constitue l'EI/Daech mettent sérieusement en danger la population syrienne, ainsi que le Moyen-Orient en général; demande à l'Union européenne de contribuer aux efforts communs pour atténuer la crise humanitaire et de jouer un rôle pour ce qui est d'aider les pays voisins à fournir un abri aux réfugiés qui fuient le conflit en Syrie, dont beaucoup perdent la vie sur des bateaux en Méditerranée; |
|
6. |
demande la mise en œuvre des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014) et 2191 (2014) adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU sur tout le territoire de la Syrie; presse toutes les parties au conflit de permettre à l'UNRWA, au CICR et aux autres organisations d'aide internationale d'accéder sans restriction au camp de réfugiés de Yarmouk, de permettre un accès humanitaire immédiat et sans condition, d'évacuer les civils blessés et de permettre un passage en toute sécurité à tous les civils qui souhaitent quitter le camp; demande la mise en place de couloirs humanitaires qui ne soient contrôlés ni par le régime syrien, ni par l'EI/Daesh et le Front al-Nosra, vu leurs violations flagrantes et permanentes du droit humanitaire international; |
|
7. |
se félicite de ce que la Commission ait dégagé un financement d'urgence immédiat de 2,5 millions d'euros pour les opérations menées par l'UNRWA afin d'apporter aux réfugiés palestiniens en danger de mort en Syrie l'assistance dont ils ont besoin; salue l'UNRWA pour le travail important qu'il accomplit et exprime sa vive détermination à continuer de coopérer avec le Commissaire général de l'UNRWA, Pierre Krähenbühl, et tous les autres partenaires afin de contribuer à soulager les souffrances des personnes qui sont dans le plus grand dénuement; souligne que l'Union européenne et ses États membres doivent accroître leur soutien à l'UNRWA pour l'aide d'urgence en faveur des civils de Yarmouk et d'autres régions de la Syrie, en veillant à ce que tous les réfugiés palestiniens, les communautés d'accueil et d'autres reçoivent l'assistance dont ils ont besoin; presse l'Union européenne de participer au financement de l'appel d'urgence de 30 millions USD lancé par l'UNRWA et d'apporter un soutien diplomatique et politique à celui-ci; |
|
8. |
condamne fermement les exactions à l'encontre des enfants, les massacres, la torture, les meurtres et la violence sexuelle dont la population syrienne est victime; souligne qu'il importe de prendre des mesures appropriées pour assurer la sécurité de civils innocents, y compris les femmes et les enfants; reconnaît que les femmes et les filles sont fréquemment victimes de viols utilisés comme arme de guerre dans le conflit syrien, y compris dans les prisons du régime; souligne l'article 3 commun aux conventions de Genève, qui garantit tout soin médical nécessaire en raison de sa condition de blessé ou de malade, sans aucune distinction de caractère défavorable; presse les fournisseurs d'aide humanitaire d'apporter toute la palette des services de santé dans des centres humanitaires financés par l'Union européenne; |
|
9. |
dit son plein soutien aux efforts déployés par l'envoyé spécial des Nations unies en Syrie, Staffan de Mistura, afin d'obtenir des cessez-le-feu locaux et de mettre en œuvre des pauses humanitaires respectées par toutes les parties en vue de permettre la fourniture d'une assistance humanitaire; demande à nouveau à l'Union de prendre l'initiative d'engager des efforts diplomatiques à cette fin; |
|
10. |
répète son appel en faveur d'une solution viable au conflit syrien au moyen d'un processus politique sans exclusive et mené par les Syriens, sur la base du communiqué de Genève de juin 2012, devant conduire à une véritable transition politique qui réponde aux aspirations légitimes du peuple syrien et lui permette de déterminer son propre avenir, de manière indépendante et démocratique; se félicite de l'annonce de nouveaux pourparlers de Genève qui auront lieu en mai entre le régime d'Assad, l'opposition, les membres du Conseil de sécurité des Nations unies et les puissances régionales, y compris l'Iran; |
|
11. |
demeure convaincu qu'il ne peut y avoir de paix durable en Syrie sans que soient établies les responsabilités pour les crimes commis par toutes les parties durant le conflit, y compris en ce qui concerne le camp de Yarmouk; renouvelle son appel au renvoi devant la Cour pénale internationale de la situation en Syrie; invite l'Union européenne et ses États membres à examiner sérieusement la recommandation récente de la commission d'enquête des Nations unies, qui demande d'étudier la mise en place d'un tribunal spécial pour les crimes commis en Syrie; |
|
12. |
pense que le Parlement doit procéder à une visite ad hoc du camp de réfugiés de Yarmouk afin d'évaluer de manière indépendante la situation humanitaire, dès que les conditions de sécurité le permettront, en coordination avec les Nations unies et indépendamment du régime d'Assad ou de toute autre partie au conflit; |
|
13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Secrétaire général des Nations unies, au représentant spécial conjoint des Nations Unies et de la Ligue des États arabes pour la Syrie, au secrétaire général du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe, au Président de l'Autorité palestinienne, au Conseil législatif palestinien ainsi qu'à toutes les parties impliquées dans le conflit syrien. |
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/106 |
P8_TA(2015)0188
Incarcération de militants des droits de l'homme et des travailleurs en Algérie
Résolution du Parlement européen du 30 avril 2015 sur l'incarcération de militants des droits de l'homme et des travailleurs en Algérie (2015/2665(RSP))
(2016/C 346/18)
Le Parlement européen,
|
— |
vu ses résolutions antérieures sur l'Algérie, et notamment celle du 9 juin 2005 sur la liberté de la presse en Algérie (1) et celle du 10 octobre 2002 sur la conclusion d'un accord d'association avec l'Algérie (2), |
|
— |
vu sa résolution du 12 mars 2015 concernant le rapport annuel 2013 sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde et la politique de l'Union européenne en la matière (3) et sa résolution du 23 octobre 2013 sur la politique européenne de voisinage, vers un renforcement du partenariat: position du Parlement européen sur les rapports de suivi 2012 (4), |
|
— |
vu les conclusions du Conseil «Affaires étrangères» du 20 avril 2015 sur le réexamen de la politique européenne de voisinage, |
|
— |
vu la déclaration de l'Union européenne du 13 mai 2014 à la suite du huitième Conseil d'association UE-Algérie, |
|
— |
vu la communication conjointe du 15 mai 2012 de la Commission et de la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Tenir les engagements de la nouvelle politique européenne de voisinage» (JOIN(2012)0014), |
|
— |
vu la note de politique européenne de voisinage de la Commission de mars 2014 sur l'Algérie, |
|
— |
vu la déclaration du Conseil européen de juin 2011 sur le voisinage méridional, |
|
— |
vu la déclaration de Navi Pillay, haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, lors de sa visite en Algérie en septembre 2012, |
|
— |
vu l'accord d'association UE-Algérie, entré en vigueur le 1er septembre 2005, |
|
— |
vu l'article 2 de cet accord d'association, qui stipule que le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel de l'accord, |
|
— |
vu la constitution algérienne, adoptée par référendum le 28 novembre 1996, et notamment ses articles 34, 35, 36, 39, 41 et 43, |
|
— |
vu le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne du 5 août 2012 sur les élections législatives en Algérie, |
|
— |
vu les lignes directrices de l'Union européenne sur les défenseurs des droits de l'homme, |
|
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auxquels l'Algérie est partie, |
|
— |
vu la convention no 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention no 98 de l'OIT de 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective, |
|
— |
vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, |
|
— |
vu l'article 135, paragraphe 5, et l'article 123, paragraphe 4, de son règlement, |
|
A. |
considérant que des manifestations contre le chômage ont eu lieu récemment en Algérie; que les autorités algériennes reconnaissent que les revendications des manifestants sont légitimes; que depuis quatre ans, néanmoins, et avec une intensité renouvelée depuis début 2015, les défenseurs des droits de l'homme, dont les militants des droits des travailleurs, notamment dans le sud de l'Algérie, ont été menacés et agressés verbalement et ont fait l'objet de mauvais traitements et de tracasseries judiciaires dans un contexte de manifestations à caractère économique, social et environnemental de plus en plus violentes; |
|
B. |
considérant que Mohamed Rag, militant pour le droit au travail du Comité national pour la défense des droits des chômeurs (CNDDC) de la ville de Laghouat, a été arrêté le 22 janvier 2015 et condamné à 18 mois de prison et à une amende de 20 000 DZD pour avoir «assailli un agent des forces de sécurité dans l'exercice de ses fonctions», et que ce verdict a été confirmé en appel le 18 mars 2015; |
|
C. |
considérant que le 28 janvier 2015, dans la ville de Laghouat, huit militants pour le droit au travail membres du CNDDC — Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar et Djaballah Abdelkader — ont été arrêtés alors qu'ils étaient rassemblés en face du tribunal de Laghouat pour exiger la libération de Mohamed Rag; que ces huit activistes ont ensuite été condamnés à une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis, et à une amende de 5 000 DZD chacun pour «rassemblement non autorisé/illégal» et «pressions exercées sur les décisions de magistrats»; |
|
D. |
considérant que lors de l'audience de ces activistes du CNDDC à Laghouat le 11 mars 2015, un nombre anormalement élevé de policiers avaient été déployés, empêchant le public et les témoins de la défense d'entrer dans la salle d'audience, et qu'à l'extérieur du tribunal, la police a arrêté puis relâché près de 50 manifestants pacifiques qui exprimaient leur solidarité avec les neufs détenus; |
|
E. |
considérant que si l'état d'urgence a été levé en février 2011 en réponse à la vague de manifestations massives en faveur de la démocratie, des restrictions de droit et de fait aux rassemblements pacifiques demeurent, notamment un décret du 18 juin 2001, en vertu duquel les manifestations publiques dans la ville d'Alger restent interdites, ou la loi 91-19 du 2 décembre 1991 sur les réunions publiques et les manifestations, qui soumet toute manifestation publique à une autorisation préalable; que le ministère de l'intérieur autorise rarement les réunions publiques; |
|
F. |
considérant que toute personne qui participe à des manifestations non autorisées peut être poursuivie et risque une peine de prison de deux mois à cinq ans en vertu des articles 99 et 100 du code pénal algérien; qu'en janvier 2014 — date limite d'inscription des nouvelles associations –, toutes les associations qui n'avaient pas été acceptées ont été déclarées illégales; que des manifestations pacifiques sont dispersées de force par la police, quelquefois avec violence, et que les manifestants pacifiques peuvent être arrêtés avant les manifestations afin que celles-ci n'aient pas lieu; |
|
G. |
considérant qu'en 2014, le gouvernement algérien a procédé à des révisions de la constitution favorables à la démocratie et promis de nouvelles réformes pour protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales; que la mise en œuvre de ces réformes n'a pas donné satisfaction à ce jour; |
|
H. |
considérant qu'en mars 2015, quatre autres militants pour le droit au travail — Rachid Aouine, Youssef Sultani, Abdelhamid Brahimi et Ferhat Missa –, membres du CNDDC de la ville d'El Oued, ont été arrêtés et accusés d'instiguer un rassemblement; que deux d'entre eux ont été acquittés, mais que Rachid Aouine a été condamné et que Youssef Sultani a été relâché dans l'attente d'un jugement; |
|
I. |
considérant qu'en janvier 2012, une nouvelle loi sur les associations (12-06) est entrée en vigueur et qu'elle impose des restrictions aux organisations non gouvernementales et aux groupements de la société civile en matière de création, de fonctionnement, d'enregistrement et d'accès à des fonds étrangers; qu'elle pénalise également les membres d'associations non enregistrées, suspendues ou dissoutes, lesquels peuvent faire l'objet de six mois de prison et d'une lourde amende, ce qui empêche la liberté de réunion; |
|
J. |
considérant que si la loi 90-14 du 2 juin 1990 sur les conditions d'exercice des droits syndicaux autorise les travailleurs à constituer des syndicats sans en demander l'autorisation pourvu qu'ils en informent les autorités par écrit, les autorités ont refusé à diverses reprises de délivrer un accusé de réception, sans lequel le syndicat ne peut pas légalement représenter les travailleurs; |
|
K. |
considérant que l'Algérie, dont la demande d'adhésion à la convention no 87 de l'OIT en juin 2014 est en cours d'examen, a été épinglée par des experts de l'OIT dans plusieurs de leurs rapports pour violation des droits des travailleurs à faire grève et à constituer les syndicats de leur choix; |
|
L. |
considérant que les négociations du plan d'action entre l'Union européenne et l'Algérie dans le cadre de la politique européenne de voisinage ont débuté en 2012; que tout en reconnaissant l'intérêt des deux parties au renforcement du dialogue et de la coopération en matière de sécurité et de questions régionales, la Commission a néanmoins fait part, en mars 2014, de préoccupations face au manque d'indépendance de la justice et à la détérioration de la situation en ce qui concerne la liberté de réunion, d'association et d'expression en Algérie; |
|
M. |
considérant que l'Algérie est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies depuis janvier 2014; |
|
1. |
se déclare préoccupé par l'arrestation et la détention des militants Rachid Aouine, Mohamed Rag, Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazouzi Benallal, Azzouzi Boubakeur, Korini Belkacem, Bekouider Faouzi, Bensarkha Tahar, Djaballah Abdelkader, détenus alors que leurs activités sont pleinement autorisées par le droit algérien et qu'elles sont conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que l'Algérie a ratifiés;; |
|
2. |
rappelle que l'Algérie est liée par l'article 2 de l'accord d'association, qui stipule qu'un élément essentiel de l'accord est le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, par le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et que l'Algérie a donc l'obligation de respecter les droits de l'homme universels, dont la liberté de réunion et d'association; |
|
3. |
estime que le harcèlement et l'intimidation de militants pour le droit au travail et défenseurs des droits de l'homme, y compris au niveau judiciaire, ne sont pas des pratiques conformes conformément aux dispositions de la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme; |
|
4. |
estime que le droit à un procès équitable et la garantie minimum du droit à la défense de tous les détenus, dont les défenseurs des droits de l'homme et les militants pour le droit au travail, sont conformes à l'article 14, paragraphe 3, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Algérie; |
|
5. |
demande de même aux autorités algériennes d'assurer et de garantir le droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique et de prendre les mesures voulues pour assurer la sûreté et la sécurité des militants de la société civile et des défenseurs des droits de l'homme ainsi que leur liberté à poursuivre leurs activités pacifiques légitimes; |
|
6. |
rappelle que le rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression a recommandé au gouvernement algérien de révoquer le décret du 18 juin 2001 interdisant les manifestations pacifiques et toute forme de manifestation publique à Alger et de mettre en place un simple système de notification en lieu et place d'une autorisation préalable pour les manifestations publiques; |
|
7. |
demande aux autorités algériennes d'abroger la loi 12-06 sur les associations et d'engager un véritable dialogue avec les organisations de la société civile afin de définir une nouvelle loi conforme aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et à la constitution algérienne; |
|
8. |
salue le fait que, depuis 2012, douze organisations syndicales ont reçu leur agrément; rappelle que les formalités administratives ne doivent pas avoir pour but de refuser l'octroi du statut légal aux syndicats indépendants qui tentent de fonctionner en dehors des organisations syndicales existantes; demande aux autorités algériennes d'autoriser de nouveaux syndicats à s'enregistrer légalement et de respecter les conventions de l'OIT qui ont été ratifiées par l'Algérie, notamment la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention no 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective; |
|
9. |
salue le fait que l'Algérie ait ratifié la plupart des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme; encourage les autorités algériennes à s'engager davantage et à améliorer leur coopération avec les Nations unies, et notamment avec l'Organisation internationale du travail et le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme; demande aux autorités algériennes de coopérer avec les Nations unies dans le cadre des procédures spéciales, notamment en invitant des rapporteurs spéciaux à visiter le pays, ainsi qu'à tenir compte des recommandations de ces derniers; demande également à l'Algérie de coopérer activement avec les mécanismes de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme, et notamment avec le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme; |
|
10. |
invite la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi que les États membres de l'Union à s'assurer de l'existence d'une politique européenne claire à l'égard de l'Algérie, qui repose sur des principes et comporte un dialogue sur les droits de l'homme observées, conformément au cadre stratégique de l'Union en matière de droits de l'homme et de démocratie;; demande à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ainsi qu'aux États membres de veiller à donner plus de substance au dialogue avec l'Algérie en matière de politique, de sécurité et de droits de l'homme et invite par conséquent le Service européen pour l'action extérieure à définir des critères et des indicateurs précis pour suivre les objectifs de l'Union et évaluer les progrès réalisés en Algérie dans le domaine des droits de l'homme, de l'impunité, de la liberté de réunion, d'association et d'expression, de l'état de droit et de la situation des défenseurs des droits de l'homme; |
|
11. |
demande instamment aux autorités algériennes, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et au Service européen pour l'action extérieure d'inclure, dans le futur plan d'action UE-Algérie, un chapitre important sur les droits de l'homme qui exprime la volonté politique ferme d'encourager ensemble, de jure et de facto, la promotion et la protection des droits de l'homme conformément à la constitution algérienne et aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'aux instruments régionaux africains relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Algérie est partie; est d'avis que des objectifs spécifiques en matière de droits de l'homme devraient être adoptés dans le plan d'action UE-Algérie et qu'ils devraient s'accompagner d'un calendrier de réformes à entreprendre par l'Algérie, avec la participation essentielle de la société civile indépendante; demande la définition d'indicateurs permettant l'évaluation objective et régulière de la situation des droits de l'homme en Algérie; |
|
12. |
demande au Service européen pour l'action extérieure et aux États membres de suivre de près l'ensemble des procès et procédures judiciaires à l'encontre des défenseurs des droits de l'homme et des militants pour le droit au travail en assurant la présence de représentants de la délégation de l'Union européenne et des ambassades des États membres à Alger, ainsi que d'en informer le Parlement; |
|
13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, à la délégation de l'Union européenne à Alger, au gouvernement algérien, au Secrétaire général des Nations unies et au Conseil des droits de l'homme des Nations unies. |
(1) JO C 124 E du 25.5.2006, p. 567.
(2) JO C 279 E du 20.11.2003, p. 115.
(3) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0076.
(4) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0446.
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE
Parlement européen
Mardi 28 avril 2015
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/110 |
P8_TA(2015)0096
Examen des déclarations d'intérêts financiers des commissaires désignés (interprétation du paragraphe 1, point a), de l'annexe XVI du règlement)
Décision du Parlement européen du 28 avril 2015 concernant l'examen des déclarations d'intérêts financiers des commissaires désignés (interprétation du paragraphe 1, point a), de l'annexe XVI du règlement) (2015/2047(REG))
(2016/C 346/19)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la lettre du 9 avril 2015 de la présidente de la commission des affaires constitutionnelles, |
|
— |
vu l'article 226 de son règlement, |
|
1. |
décide de reprendre l'interprétation suivante sous le paragraphe 1, point a), de l'annexe XVI de son règlement: «L'examen, par la commission compétente pour les affaires juridiques, de la déclaration d'intérêts financiers d'un commissaire désigné consiste non seulement à vérifier que la déclaration a été dûment complétée, mais aussi à évaluer si le contenu de la déclaration pourrait laisser supposer un conflit d'intérêts. Il incombe alors à la commission compétente pour l'audition de décider si elle demande de plus amples informations au commissaire désigné.» |
|
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission. |
III Actes préparatoires
PARLEMENT EUROPÉEN
Mardi 28 avril 2015
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/111 |
P8_TA(2015)0097
Convention internationale sur les normes applicables au personnel des navires de pêche ***
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 sur le projet de décision du Conseil autorisant les États membres à devenir partie, dans l'intérêt de l'Union européenne, à la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale (15528/2014 — C8-0295/2014 — 2013/0285(NLE))
(Approbation)
(2016/C 346/20)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (15528/2014), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 46, à l'article 53, paragraphe 1, à l'article 62 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et paragraphe 8, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0295/2014), |
|
— |
vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, l'article 99, paragraphe 2, et l'article 108, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A8-0064/2015), |
|
1. |
donne son approbation au projet de décision du Conseil; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/112 |
P8_TA(2015)0098
Projet de budget rectificatif no 2/2015: révision du CFP pour la période 2014-2020
Résolution du Parlement européen du 28 avril 2015 relative à la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2015 de l'Union européenne pour l'exercice 2015, section III — Commission (07660/2015 — C8-0098/2015 — 2015/2013(BUD))
(2016/C 346/21)
Le Parlement européen,
|
— |
vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, |
|
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), notamment son article 41, |
|
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015, définitivement adopté le 17 décembre 2014 (2), |
|
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «règlement sur le CFP») (3), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (4), |
|
— |
vu le projet de budget rectificatif no 2/2015, adopté par la Commission le 20 janvier 2015 (COM(2015)0016), |
|
— |
vu la position sur le projet de budget rectificatif no 2/2015, adoptée par le Conseil le 21 avril 2015 et transmise au Parlement européen le 22 avril 2015 (07660/2015), |
|
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2015/623 du Conseil du 21 avril 2015 modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (5), |
|
— |
vu les articles 88 et 91 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du développement régional (A8-0138/2015), |
|
A. |
considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2015 porte sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement sur le CFP (COM(2015)0015), ainsi que le prévoit son article 19; |
|
B. |
considérant que l'article 19 du règlement sur le CFP prévoit une révision du cadre financier pluriannuel en cas d'adoption tardive de règles ou de programmes en gestion partagée, de sorte que les dotations non utilisées en 2014 soient transférées aux années ultérieures, au-delà des plafonds correspondants de dépenses; |
|
C. |
considérant que des crédits d'engagement pour les programmes en gestion partagée au sens de l'article 19 du règlement sur le CFP sont tombés en annulation en 2014 pour un montant de 21 043 639 478 EUR en prix courants, qui correspond aux tranches 2014 des programmes qui n'ont pu être ni engagées en 2014, ni reportées à 2015; |
|
D. |
considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2015 prévoit le transfert de la plus grande part de ces dotations vers le budget 2015, des transferts plus limités devant être inscrits dans les projets de budget pour les exercices 2016 et 2017; |
|
E. |
considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2015 propose une augmentation des crédits d'engagement à hauteur de 16 476,4 millions d'euros en 2015 pour les différents Fonds en gestion partagée relevant de la sous-rubrique 1b, de la rubrique 2 et de la rubrique 3; |
|
F. |
considérant que le projet de budget rectificatif no 2/2015 propose par ailleurs une augmentation de 2,5 millions d'euros pour l'instrument d'aide de préadhésion (IAP II) au titre de la rubrique 4, afin qu'un traitement semblable continue d'être appliqué aux contributions de la rubrique 4 et de la sous-rubrique 1b en faveur des programmes du Fonds européen de développement régional (FEDER) — Coopération territoriale européenne (CTE); |
|
1. |
prend acte du projet de budget rectificatif no 2/2015 tel que présenté par la Commission, et de la position du Conseil concernant celui-ci; |
|
2. |
rappelle que la révision du règlement sur le CFP est une procédure normale au début de chaque période du CFP et que le projet de budget rectificatif correspondant doit la refléter; |
|
3. |
rappelle qu'il est essentiel, pour les citoyens européens et pour l'économie de tous les États membres, que les crédits de 2014 restés inutilisés puissent être transférés aux exercices suivants, afin de contribuer à la création d'emplois et de croissance; |
|
4. |
se félicite du transfert, à concurrence du maximum possible, des crédits non utilisés en 2014 à l'exercice 2015, en ce qu'il permettra d'éviter toute inégalité de traitement entre certains États membres, régions et programmes opérationnels, d'accélérer la mise en œuvre et l'exécution de la politique de cohésion et de contribuer à éviter la concentration des paiements à la fin de la période couverte par le CFP; |
|
5. |
s'inquiète cependant de l'incidence à long terme de ce report d'un an sur la situation générale des paiements; invite par conséquent la Commission à suivre de près sa mise en œuvre et à ne pas ménager ses efforts pour éviter l'effet «boule de neige» des factures impayées, en présentant des propositions adaptées afin d'ajuster, si nécessaire, les montants annuels des crédits de paiement, conformément aux dispositions pertinentes du règlement sur le CFP; |
|
6. |
attire l'attention sur le fait que la décision de transférer la majorité des crédits non utilisés de l'exercice 2014 vers l'exercice 2015 pourrait exiger de la Commission une démarche flexible, qui permette de faire face aux difficultés susceptibles de découler d'un profil financier irrégulier, ce qui pourrait conduire à des engagements non utilisés au cours de la période 2014-2020; invite la Commission à proposer des mesures adéquates, pour le cas où cette situation se présenterait, en se fondant sur des exemples passés semblables, où l'approbation tardive des programmes avait été prise en compte; |
|
7. |
souligne la nécessité de s'accorder en temps utile sur ce projet de budget rectificatif afin que tous les programmes concernés puissent être adoptés rapidement; |
|
8. |
approuve la position du Conseil sur le projet de budget rectificatif no 2/2015; |
|
9. |
charge son Président de constater que le budget rectificatif no 1/2015 est définitivement adopté et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
10. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(4) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(5) JO L 103 du 22.4.2015, p. 1.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/114 |
P8_TA(2015)0099
Déploiement du système eCall embarqué ***II
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (05130/3/2015 — C8-0063/2015 — 2013/0165(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2016/C 346/22)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position du Conseil en première lecture (05130/3/2015 — C8-0063/2015), |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 2013 (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0316), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 76 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0053/2015), |
|
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
|
2. |
constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.
(2) Textes adoptés du 26.2.2014, P7_TA(2014)0154.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/115 |
P8_TA(2015)0100
Directive sur la qualité du carburant et directive sur les énergies renouvelables ***II
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (10710/2/2014 — C8-0004/2015 — 2012/0288(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2016/C 346/23)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position du Conseil en première lecture (10710/2/2014 — C8-0004/2015), |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 avril 2013 (1), |
|
— |
après consultation du Comité des régions, |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0595), |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 1er avril 2015, d'approuver la position arrêtée par le Parlement européen en deuxième lecture, conformément à l'article 294, paragraphe 8, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 69 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0025/2015), |
|
1. |
arrête la position en deuxième lecture figurant ci-après; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 198 du 10.7.2013, p. 56.
(2) Textes adoptés du 11.9.2013, P7_TA(2013)0357.
P8_TC2-COD(2012)0288
Position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 28 avril 2015 en vue de l’adoption de la directive (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la directive (UE) 2015/1513.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/116 |
P8_TA(2015)0101
Réduire la consommation de sacs en plastique légers***II
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (05094/1/2015 — C8-0064/2015 — 2013/0371(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2016/C 346/24)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position du Conseil en première lecture (05094/1/2015 — C8-0064/2015), |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 26 février 2014 (1), |
|
— |
vu l'avis du Comité des régions du 3 avril 2014 (2), |
|
— |
vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0761), |
|
— |
vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 76 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0130/2015), |
|
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
|
2. |
approuve la déclaration annexée à la présente résolution; |
|
3. |
constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
|
4. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 214 du 8.7.2014, p. 40.
(2) JO C 174 du 7.6.2014, p. 43.
(3) Textes adoptés du 16.4.2014, P7_TA(2014)0417.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration du Parlement européen:
Le Parlement européen prend note de la déclaration faite par la Commission sur l'adoption d'un accord modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers.
Ainsi que la Commission l'a indiqué dans son exposé des motifs, sa proposition initiale avait pour objectif de «limiter les effets négatifs sur l'environnement, notamment en termes de déchets sauvages, de favoriser la prévention des déchets et une utilisation plus efficace des ressources, tout en limitant les conséquences socioéconomiques néfastes. Concrètement, la proposition vise à réduire dans l'Union européenne la consommation des sacs en plastique à poignées d'une épaisseur inférieure à 50 microns (0,05 millimètre)».
Le Parlement européen considère que le texte approuvé par les colégislateurs est en tout point conforme aux objectifs de la proposition de la Commission.
La Commission a conclu dans son analyse d'impact que l'option qui combine «un objectif de prévention à l’échelle de l’UE, assorti d'une recommandation explicite d'utiliser des instruments économiques et de la possibilité pour les États membres d’appliquer des restrictions de commercialisation par dérogation à l’article 18 […] est le scénario le plus susceptible de produire des résultats probants sur le plan environnemental, tout en ayant des incidences économiques positives, en limitant les incidences négatives sur l'emploi, en garantissant l'acceptation par le grand public et en contribuant à une meilleure sensibilisation à la consommation durable».
Le Parlement européen considère que le texte final approuvé se base sur l'option privilégiée dans l'analyse d'impact de la Commission et qu'il établit des dispositions appropriées pour que les États membres veillent à la réduction effective de la consommation de sacs en plastique dans l'Union.
Le Parlement européen rappelle en outre que, conformément au paragraphe 30 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» de 2003, il appartient aux colégislateurs de décider de faire procéder ou non à des analyses d'impact préalables à l'adoption d'un amendement substantiel.
Le Parlement européen rappelle que, en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, «les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale». Le Parlement apprécie les efforts déployés par la Commission afin de conclure les négociations interinstitutionnelles. Il déplore cependant que la déclaration de la Commission porte sur des questions qui ont déjà été traitées de manière adéquate lors de la procédure législative.
Enfin, le Parlement rappelle que la Commission, en tant que gardienne des traités, est entièrement responsable de la bonne application du droit de l'Union par les États membres.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/118 |
P8_TA(2015)0102
Émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes ***II
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports maritimes et modifiant la directive 2009/16/CE (17086/1/2014 — C8-0072/2015 — 2013/0224(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2016/C 346/25)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position du Conseil en première lecture (17086/1/2014 — C8-0072/2015), |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 octobre 2013 (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0480), |
|
— |
vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 76 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A8-0122/2015), |
|
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
|
2. |
constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
|
4. |
charge son secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 67 du 6.3.2014, p. 70.
(2) Textes adoptés du 16.4.2014, P7_TA(2014)0424.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/119 |
P8_TA(2015)0103
Statistiques européennes ***II
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes (05161/2/2015 — C8-0073/2015 — 2012/0084(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2016/C 346/26)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la position du Conseil en première lecture (05161/2/2015 — C8-0073/2015), |
|
— |
vu les avis motivés soumis par le Congrès des députés espagnol, le Sénat espagnol et le Conseil fédéral autrichien, dans le cadre du protocole no 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, |
|
— |
vu l'avis de la Banque centrale européenne du 6 novembre 2012 (1), |
|
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2012)0167), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 76 de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0137/2015), |
|
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
|
2. |
constate que l'acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
|
3. |
charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
|
4. |
charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne; |
|
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 374 du 4.12.2012, p. 2.
(2) Textes adoptés du 21.11.2013, P7_TA(2013)0505.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/120 |
P8_TA(2015)0104
Plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 28 avril 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (COM(2014)0614 — C8-0174/2014 — 2014/0285(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/27)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 19 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le plan s'applique également à la plie, au flet, au turbot et à la barbue dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 capturés lors d'activités de pêche ciblant les stocks concernés . |
2. Le présent règlement prévoit également des mesures concernant les captures accessoires de plie, de flet, de turbot et de barbue dans les sous-divisions CIEM 22 à 32 , qui s'appliquent lors d'activités de pêche ciblant les stocks visés au paragraphe 1 . |
Amendement 27
Proposition de règlement
Article 2 — points b et c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
|
Amendements 63, 28 et 56
Proposition de règlement
Article 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
1. Le plan vise à contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, et notamment: |
1. Le plan assure la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche établis à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 et de la directive-cadre 2008/56/CE «stratégie pour le milieu marin» , et notamment: |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
2. Le plan vise à contribuer à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les stocks concernés et pour la plie. |
2. Le plan contribue à mettre fin aux rejets, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles, en évitant et en réduisant les captures accidentelles, et contribue à la mise en œuvre de l'obligation de débarquement établie à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les stocks concernés et pour la plie. |
Amendement 29
Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Article 3 bis |
||
|
|
Compatibilité avec la législation environnementale de l'Union |
||
|
|
1. Le plan applique l'approche écosystémique de la gestion des pêches. |
||
|
|
2. Pour faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et que les activités de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin, le plan est compatible avec la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin», et contribue à la réalisation de ses objectifs, de manière à parvenir à un bon état écologique à l'échéance de 2020. En particulier, il: |
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche sera atteint d’ici à 2015 et maintenu pour les stocks concernés à l’intérieur des fourchettes suivantes: |
1. L'objectif ciblé de mortalité par pêche tient compte des avis scientifiques les plus récents; il sera atteint , dans la mesure du possible, d'ici à 2015 et , au plus tard, en 2020, progressivement et par paliers, et maintenu par la suite pour les stocks concernés . La mortalité par pêche pour les stocks concernés est fixée à l'intérieur des fourchettes suivantes: |
||
|
Stock |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche |
Stock |
Fourchette des objectifs ciblés de mortalité par pêche |
|
Cabillaud de la Baltique occidentale |
0,23 -0,29 |
Cabillaud de la Baltique occidentale |
0 à FRMD |
|
Cabillaud de la Baltique orientale |
0,41 -0,51 |
Cabillaud de la Baltique orientale |
0 à FRMD |
|
Hareng de la Baltique centrale |
0,23 -0,29 |
Hareng de la Baltique centrale |
0 à FRMD |
|
Hareng du golfe de Riga |
0,32 -0,39 |
Hareng du golfe de Riga |
0 à FRMD |
|
Hareng de la mer de Botnie |
0,13 -0,17 |
Hareng de la mer de Botnie |
0 à FRMD |
|
Hareng de la baie de Botnie |
non défini |
Hareng de la baie de Botnie |
0 à FRMD |
|
Hareng de la Baltique occidentale |
0,25 -0,31 |
Hareng de la Baltique occidentale |
0 à FRMD |
|
Sprat de la mer Baltique |
0,26 -0,32 |
Sprat de la mer Baltique |
0 à FRMD |
|
|
Les valeurs du FRMD (taux de mortalité par pêche garantissant le rendement maximal durable) sont tirées des derniers avis scientifiques fiables disponibles et il convient de viser un taux de mortalité par pêche égal à 0,8 X FRMD. |
||
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Les possibilités de pêche sont déterminées de sorte à garantir que la probabilité qu'elles dépassent les valeurs FRMD du tableau visé au paragraphe 1 soit inférieure à 5 %. |
Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 ter. Le présent règlement permet l'arrêt temporaire des activités de pêche au sens de l'article 33 du règlement (UE) no 508/2014, assorti d'une aide financière au titre dudit règlement. |
Amendement 32
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
1. Les niveaux de référence de conservation exprimés en niveau minimal de biomasse féconde qui correspondent à la pleine capacité de reproduction pour les stocks concernés sont fixés comme suit: |
1. Les niveaux de référence de conservation qui correspondent à la pleine capacité de reproduction pour les stocks concernés sont fixés comme suit: |
||
|
Stock |
Niveau minimal de biomasse féconde (en tonnes) |
Stock |
Niveau minimal de biomasse féconde (en tonnes) |
|
Cabillaud de la Baltique occidentale |
36 400 |
Cabillaud de la Baltique occidentale |
36 400 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
|
Cabillaud de la Baltique orientale |
88 200 |
Cabillaud de la Baltique orientale |
88 200 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
|
Hareng de la Baltique centrale |
600 000 |
Hareng de la Baltique centrale |
600 000 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
|
Hareng du golfe de Riga |
non défini |
Hareng du golfe de Riga |
non défini pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
|
Hareng de la mer de Botnie |
non défini |
Hareng de la mer de Botnie |
non défini pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
|
Hareng de la baie de Botnie |
non défini |
Hareng de la baie de Botnie |
non défini pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
|
Hareng de la Baltique occidentale |
110 000 |
Hareng de la Baltique occidentale |
110 000 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
|
Sprat de la mer Baltique |
570 000 |
Sprat de la mer Baltique |
570 000 pour 2015 et BRMD pour les années restantes |
Amendement 33
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque la biomasse féconde de l'un des stocks concernés pour une année donnée est inférieure aux niveaux minimaux de biomasse féconde fixés au paragraphe 1, des mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux de précaution . En particulier, par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement et conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux inférieurs à ceux qui débouchent sur les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche prévues à l'article 4, paragraphe 1. Ces mesures correctives peuvent également inclure, le cas échéant, la présentation de propositions législatives par la Commission et des mesures d'urgence adoptées par la Commission au titre de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013. |
2. Lorsque la biomasse féconde de l'un des stocks concernés pour une année donnée est inférieure aux niveaux minimaux de biomasse fixés au paragraphe 1, des mesures correctives appropriées sont adoptées pour assurer le plus rapidement possible le retour des stocks concernés à des niveaux supérieurs aux niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable . En particulier, par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche sont fixées à des niveaux inférieurs à ceux qui débouchent sur les fourchettes d'objectifs ciblés de mortalité par pêche prévues à l’article 4, paragraphe 1 du présent règlement . Ces mesures correctives peuvent également inclure, le cas échéant, la présentation de propositions législatives par la Commission et des mesures d'urgence adoptées par la Commission au titre de l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
|
2 bis. Lorsque la biomasse de l'un des stocks concernés pour une année donnée tombe en dessous des niveaux indiqués dans le tableau ci-après, des mesures adaptées sont prises en vue d'interrompre la pêche ciblant le stock en question: |
|
|
|
Stock |
Niveau de biomasse limite (en tonnes) |
|
|
Cabillaud de la Baltique occidentale |
26 000 |
|
|
Cabillaud de la Baltique orientale |
63 000 |
|
|
Hareng de la Baltique centrale |
430 000 |
|
|
Hareng du golfe de Riga |
non défini |
|
|
Hareng de la mer de Botnie |
non défini |
|
|
Hareng de la baie de Botnie |
non défini |
|
|
Hareng de la Baltique occidentale |
90 000 |
|
|
Sprat de la mer Baltique |
410 000 |
Amendement 34
Proposition de règlement
Article 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
Article 6 |
Article 6 |
||||
|
Mesures à prendre en cas de menace pour la plie, le flet, le turbot et la barbue |
Mesures techniques de conservation pour la plie, le flet, le turbot et la barbue |
||||
|
1. Lorsque des avis scientifiques indiquent que la conservation des stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique est menacée , le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 en ce qui concerne les mesures de conservation spécifiques concernant le stock menacé et concernant l'un des éléments suivants : |
1. Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctrices sont requises pour que les stocks de plie, de flet, de turbot ou de barbue de la Baltique soient gérés conformément au principe de précaution , le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 en ce qui concerne les mesures de conservation spécifiques pour les captures accessoires de plie, de flet, de turbot et de barbue et concernant les mesures techniques suivantes : |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b), et sont fondées sur un avis scientifique . |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b), et la compatibilité avec la législation environnementale de l'Union conformément à l'article 3 bis , et sont fondées sur les meilleurs avis scientifiques disponibles . |
||||
|
3. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les mesures de conservation spécifiques visées au paragraphe 1. |
3. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 pour les mesures de conservation spécifiques visées au paragraphe 1. |
||||
|
|
3 bis. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte le Parlement européen et les comités consultatifs concernés. |
||||
|
|
3 ter. La Commission, en consultation avec les États membres concernés, analyse l'impact des actes délégués visés au paragraphe 1 un an après leur adoption, puis une fois par an. Si cette analyse montre qu'un acte délégué n'est pas approprié pour gérer la situation actuelle, les États membres concernés peuvent présenter une recommandation commune conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 35
Proposition de règlement
Article 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux stocks concernés et à la plie lorsque la pêche est effectuée au moyen des engins suivants: filets pièges, casiers et nasses. |
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas au cabillaud lorsque la pêche est effectuée au moyen des engins suivants: filets pièges, casiers et nasses , verveux et parcs en filet. |
Amendement 36
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre l'objectif défini à l'article 3 et en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs. |
2. Les mesures visées au paragraphe 1 visent à atteindre les objectifs définis à l'article 3 et en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs ainsi que la compatibilité avec la législation environnementale de l'Union, visée à l'article 3 bis, et à faire en sorte de réduire au minimum les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin . |
Amendement 37
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3 — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 39
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 bis. En outre, la Commission s'efforce de tenir compte des études scientifiques les plus récentes, parmi lesquelles celles émanant du CIEM, avant d'adopter des mesures techniques. |
Amendement 40
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 4 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
4 ter. Pendant la période de frai du cabillaud, la pêche pélagique avec du matériel de pêche statique ayant des mailles de moins de 110 mm, ou de 120 mm pour les chalutiers à tangons, est interdite. |
Amendement 41
Proposition de règlement
Chapitre VI bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
CHAPITRE VI bis |
||||
|
|
MESURES SPÉCIFIQUES |
||||
|
|
Article 9 bis |
||||
|
|
Mesures spécifiques |
||||
|
|
1. Toute activité de pêche est interdite du 1er mai au 31 octobre dans les zones délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes, mesurées selon le système de coordonnées WGS84: |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
2. Tout navire de l'Union dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à huit mètres et qui détient à son bord ou utilise tout engin autorisé pour la pêche du cabillaud en mer Baltique conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 2187/2005 est muni d'un permis de pêche spécial pour le cabillaud en mer Baltique. |
||||
|
|
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 modifiant le présent article, si nécessaire pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3, en particulier la protection des juvéniles ou des reproducteurs. |
Amendement 42
Proposition de règlement
Article 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Article 10 |
Article 10 |
||
|
Coopération régionale |
Coopération régionale |
||
|
1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures adoptées au titre du présent chapitre . |
1. L'article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 s'applique aux mesures visées aux articles 6, 8 et 9 du présent règlement . |
||
|
2. Les États membres concernés peuvent soumettre des recommandations communes conformément à l' article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 dans les délais suivants: |
2. Les États membres concernés peuvent , après consultation des conseils consultatifs régionaux, soumettre les éventuelles recommandations communes visées à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 4, pour la première fois au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement et, par la suite, douze mois après chaque soumission de l'évaluation du plan conformément à l' article 14, mais au plus tard le 1er septembre pour des mesures qui concernent les États membres. Ils peuvent également soumettre de telles recommandations en cas de changement soudain de la situation de l'un des stocks relevant du plan, si les mesures recommandées sont jugées nécessaires ou justifiées par des avis scientifiques. |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
2 bis. Les conseils consultatifs concernés peuvent également soumettre des recommandations conformément aux délais prévus au paragraphe 2. |
||
|
|
2 ter. Toute dérogation de la Commission aux recommandations communes est soumise au Parlement européen et au Conseil et doit pouvoir faire l'objet d'un contrôle. |
Amendement 43
Proposition de règlement
Article 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Article 12 |
Article 12 |
||
|
Notifications préalables |
Notifications préalables |
||
|
1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l'obligation de notification préalable établie à l'article précité s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union d'une longueur minimale hors tout de huit mètres qui détiennent à bord au moins 300 kg de cabillaud ou deux tonnes de stocks pélagiques. |
1. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, l'obligation de notification préalable établie à l'article précité s'applique: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable prévu par cet article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. |
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, le délai de notification préalable prévu par cet article est d'au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port. Les autorités compétentes des États membres côtiers peuvent, au cas par cas, autoriser le navire à entrer plus tôt au port pour autant que les conditions nécessaires aux mesures de contrôle appropriées soient réunies. |
Amendement 45
Proposition de règlement
Article 13 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 46
Proposition de règlement
Article 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 14 |
Article 14 |
|
Évaluation du plan |
Évaluation du plan |
|
La Commission veille à la réalisation d'une évaluation de l'impact du plan sur les stocks couverts par le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment pour tenir compte des changements intervenus dans les avis scientifiques, six ans après l'entrée en vigueur du plan et, par la suite, tous les six ans . La Commission transmet les résultats de ces évaluations au Parlement européen et au Conseil. |
Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l'impact du plan pluriannuel sur les stocks couverts par le présent règlement et sur les pêcheries exploitant ces stocks, notamment en ce qui concerne les progrès enregistrés sur la voie du rétablissement et du maintien des stocks de poissons au-dessus des niveaux permettant d'obtenir le rendement maximal durable . La Commission transmet les résultats de cette évaluation au Parlement européen et au Conseil et peut, le cas échéant et compte tenu des conseils scientifiques les plus récents, proposer des adaptations au plan pluriannuel ou entreprendre des modifications des actes délégués . |
Amendement 47
Proposition de règlement
Chapitre IX bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
CHAPITRE IX bis |
|
|
AIDE FINANCIÈRE DU FONDS EUROPÉEN POUR LES AFFAIRES MARITIMES ET LA PÊCHE |
|
|
Article 14 bis |
|
|
Aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche |
|
|
Aux fins de l'article 33, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 508/2014, le plan pluriannuel qu'établit le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au titre des articles 9 et 10 du règlement (UE) no 1380/2013. |
Amendement 48
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 8 et 9 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, 8 et 9 est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er septembre 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 49
Proposition de règlement
Article 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 2187/2005 sont supprimés. |
Le règlement (CE) no 2187/2005 est modifié comme suit: |
|
|
1. À l'article 13, le paragraphe 3 est supprimé. |
|
|
2. À l'annexe IV, dans la colonne intitulée «Tailles minimales», l'entrée «38 cm» correspondant à la taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud est remplacée par «35 cm». |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0128/2015).
(16) JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.
(16) JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.
(1bis) Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(19) ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
(19) ICES technical services, September 2014 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2014/Special%20Requests/EU_Fmsy_range_for_Baltic_cod_and_pelagic_stocks.pdf
(20) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
(20) Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).
(1bis) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/142 |
P8_TA(2015)0105
Obligation de débarquement ***I
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil en ce qui concerne l'obligation de débarquement (COM(2013)0889 — C7-0465/2013 — 2013/0436(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/28)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2013)0889), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0465/2013), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 avril 2014 (1), |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 20 février 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de la pêche (A8-0060/2014), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 311 du 12.9.2014, p. 68.
P8_TC1-COD(2013)0436
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements du Conseil (CE) no 850/98, (CE) no 2187/2005, (CE) no 1967/2006, (CE) no 1098/2007, (CE) no 254/2002, (CE) no 2347/2002 et (CE) no 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1379/2013 et (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) no 1434/98 du Conseil
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/812.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/143 |
P8_TA(2015)0106
Protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat CE-Russie, visant à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'UE ***
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2015 sur le projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, du protocole à l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Fédération de Russie, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (11878/2014 — C8-0006/2015 — 2014/0052(NLE))
(Approbation)
(2016/C 346/29)
Le Parlement européen,
|
— |
vu le projet de décision du Conseil (11878/2014), |
|
— |
vu le projet de protocole à l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (11513/2014), |
|
— |
vu la demande d'approbation présentée par le Conseil conformément à l'article 91, à l'article 100, paragraphe 2, aux articles 207 et 212 et à l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (C8-0006/2015), |
|
— |
vu l'article 99, paragraphe 1, premier et troisième alinéas, et paragraphe 2, ainsi que l'article 108, paragraphe 7, de son règlement, |
|
— |
vu la recommandation de la commission des affaires étrangères (A8-0129/2015), |
|
1. |
donne son approbation à la conclusion de l'accord; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et à la Fédération de Russie. |
Mercredi 29 avril 2015
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/144 |
P8_TA(2015)0110
Préfinancement des programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des jeunes ***I
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen afin d'augmenter le montant du préfinancement initial versé aux programmes opérationnels soutenus par l'initiative pour l'emploi des jeunes (COM(2015)0046 — C8-0036/2015 — 2015/0026(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/30)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2015)0046), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 164 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0036/2015), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 18 mars 2015 (1), |
|
— |
vu l'avis de la commission des budgets sur la compatibilité financière de la proposition, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 avril 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu les articles 59 et 41 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et l'avis de la commission de la culture et de l'éducation (A8-0134/2015), |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) Non encore paru au Journal officiel.
P8_TC1-COD(2015)0026
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1304/2013 en ce qui concerne un montant de préfinancement initial supplémentaire versé aux programmes opérationnels soutenus par l’initiative pour l’emploi des jeunes
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/779.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/145 |
P8_TA(2015)0111
Abrogation du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (COM(2014)0707 — C8-0271/2014 — 2014/0334(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/31)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0707), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0271/2014), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 11 mars 2015, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'article 59 et l'article 50, paragraphe 1, de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0026/2015), |
|
1. |
arrête sa position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
P8_TC1-COD(2014)0334
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/937.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/146 |
P8_TA(2015)0112
Mesures de sauvegarde prévues à l'accord avec la Norvège ***I
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (texte codifié) (COM(2014)0304 — C8-0010/2014 — 2014/0159(COD))
(Procédure législative ordinaire — codification)
(2016/C 346/32)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0304), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0010/2014), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1), |
|
— |
vu les articles 103 et 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0046/2015), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance; |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
P8_TC1-COD(2014)0159
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de sauvegarde prévues à l'accord entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège (texte codifié)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/938.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/147 |
P8_TA(2015)0113
Accord de stabilisation et d'association avec l’Albanie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié) (COM(2014)0375 — C8-0034/2014 — 2014/0191(COD))
(Procédure législative ordinaire — codification)
(2016/C 346/33)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0375), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0034/2014), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1), |
|
— |
vu les articles 103 et 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0047/2015), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance; |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
P8_TC1-COD(2014)0191
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part (texte codifié)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/939.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/148 |
P8_TA(2015)0114
Accord de stabilisation et d'association et accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement avec la Bosnie-Herzégovine ***I
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part (texte codifié) (COM(2014)0443 — C8-0087/2014 — 2014/0206(COD))
(Procédure législative ordinaire — codification)
(2016/C 346/34)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0443), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0087/2014), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1), |
|
— |
vu les articles 103 et 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0017/2015), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance; |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
P8_TC1-COD(2014)0206
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (texte codifié)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/940.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/149 |
P8_TA(2015)0115
Accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ***I
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (texte codifié) (COM(2014)0394 — C8-0041/2014 — 2014/0199(COD))
(Procédure législative ordinaire — codification)
(2016/C 346/35)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0394), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0041/2014), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1), |
|
— |
vu les articles 103 et 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0132/2015), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance; |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
P8_TC1-COD(2014)0199
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (texte codifié)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/941.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/150 |
P8_TA(2015)0116
Application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales *
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié) (COM(2014)0377 — C8-0139/2014 — 2014/0192(NLE))
(Consultation — codification)
(2016/C 346/36)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0377), |
|
— |
vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0139/2014), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1), |
|
— |
vu les articles 103 et 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0029/2014), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance; |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/151 |
P8_TA(2015)0117
Modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne *
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié) (COM(2014)0534 — C8-0212/2014 — 2014/0246(NLE))
(Consultation — codification)
(2016/C 346/37)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0534), |
|
— |
vu l'article 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0212/2014), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur une méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs (1), |
|
— |
vu les articles 103 et 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A8-0047/2014), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance; |
|
1. |
approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
|
2. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/152 |
P8_TA(2015)0170
Fonds monétaires ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2015, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les fonds monétaires (COM(2013)0615 — C7-0263/2013 — 2013/0306(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/38)
[Amendement no 1]
AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*)
à la proposition de la Commission
RÈGLEMENT (UE)2015/…
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
sur les fonds monétaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
les fonds monétaires (MMF, money market funds) fournissent des financements à court terme aux établissements financiers, aux entreprises et aux administrations publiques, et contribuent ainsi au financement de l'économie européenne. Pour ces acteurs, le fait d'investir dans des fonds monétaires constitue un moyen efficace de répartir leurs risques de crédit et leur exposition au lieu de recourir uniquement à des dépôts bancaires. |
|
(2) |
Pour ceux qui ont des liquidités à placer, les fonds monétaires sont des outils de gestion de la trésorerie à court terme offrant à la fois un degré élevé de liquidité, une bonne diversification et une grande stabilité de la valeur du principal investi, tout en fournissant un rendement fondé sur le marché. Ils sont ▌utilisés par un grand nombre d'acteurs, y compris les associations caritatives, les sociétés de logement, les pouvoirs locaux et les investisseurs professionnels plus importants, comme les entreprises et les fonds de pension, qui cherchent à investir leurs liquidités excédentaires pour un court laps de temps. Ils constituent donc un lien crucial entre offre et demande d'argent à court terme. |
|
(3) |
Les événements qui se sont produits pendant la crise financière ont mis en lumière plusieurs aspects des fonds monétaires qui les rendent vulnérables en cas de difficultés sur les marchés financiers et peuvent donc propager ou amplifier les risques dans l'ensemble du système financier. En cas de baisse du prix des actifs dans lesquels les fonds monétaires investissent, notamment en période de tension sur les marchés, ces fonds ne sont pas toujours en mesure de garantir un remboursement immédiat à la valeur du principal des parts ou des actions qu'ils ont émises. Cette situation , dont le Conseil de stabilité financière (CSF) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) estiment qu'elle peut être particulièrement grave pour les fonds monétaires à valeur liquidative constante ou stable, peut donner lieu à des demandes de rachat importantes et soudaines, avec le risque de conséquences macroéconomiques plus générales. |
|
(4) |
En cas de multiplication des demandes de rachat, les fonds monétaires peuvent être contraints de vendre une partie de leurs placements sur un marché en baisse, ce qui risquerait ainsi d'alimenter une crise des liquidités. Dans de telles circonstances, les émetteurs du marché monétaire peuvent faire face à d'importantes difficultés de financement si les marchés des billets de trésorerie et des autres instruments du marché monétaire s'assèchent . Il pourrait en découler une contagion au sein du marché du financement à court terme ▌et d'importantes difficultés directes de financement pour les établissements financiers, les entreprises, les administrations publiques et, partant, l'ensemble de l'économie. |
|
(5) |
Les gestionnaires d'actifs, soutenus par les sponsors, peuvent décider d'apporter un soutien discrétionnaire afin de préserver la liquidité et la stabilité de leurs fonds monétaires. Les sponsors sont souvent obligés de fournir un tel appui à leurs fonds monétaires qui perdent de la valeur, du fait du risque de réputation et de la crainte que la panique puisse toucher les autres activités des sponsors . Or, selon la taille du fonds et la pression qui s'exerce en matière de demandes de rachat, l'aide que doit apporter le sponsor peut aller au-delà de ses réserves disponibles. Par conséquent, il est important de prévoir des règles uniformes permettant de prévenir une défaillance du sponsor et la propagation du risque à d'autres entités sponsors de fonds monétaires. |
|
(6) |
Afin de préserver l'intégrité et la stabilité du marché intérieur ▌, il est nécessaire d'établir des règles relatives au fonctionnement des fonds monétaires, et notamment à la composition de leur portefeuille. L'objectif est de rendre les fonds monétaires plus résilients et de limiter les risques de contagion. Des règles uniformes applicables à l'ensemble de l'Union sont nécessaires pour que les fonds monétaires soient en mesure de répondre aux demandes de remboursement des investisseurs, notamment en situation de tension sur les marchés. Il y a lieu en outre d'établir des règles uniformes en ce qui concerne le portefeuille de ces fonds, pour garantir que ces derniers pourront faire face à des demandes de rachat substantielles et soudaines émises par un groupe important d'investisseurs. |
|
(7) |
L'établissement de règles uniformes applicables aux fonds monétaires est en outre nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du marché du financement à court terme pour les établissements financiers, les entreprises qui émettent des créances à court terme et les administrations publiques. De telles règles sont également nécessaires pour garantir le traitement égal de tous ceux qui investissent dans un fonds monétaire et pour éviter qu'en cas de suspension temporaire des rachats ou de liquidation du fonds, ceux qui ont demandé tardivement un rachat ne soient défavorisés. |
|
(8) |
Il faut harmoniser les exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires en définissant des règles claires qui imposent des obligations directes à ces fonds et à leurs gestionnaires dans l'ensemble de l'Union. Cela permettrait de renforcer la stabilité des fonds monétaires en tant que source de financement à court terme pour les administrations publiques et les entreprises dans l'ensemble de l'Union, et aussi de garantir que ces fonds restent un outil fiable de gestion des liquidités pour le secteur privé. |
|
(9) |
Le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) a adopté des lignes directrices pour les fonds monétaires afin de créer un cadre a minima pour ces fonds dans l'Union, mais un an après leur entrée en vigueur, seuls 12 États membres les avaient mises en œuvre, ce qui démontre la persistance de règles nationales divergentes. Ces différences entre approches nationales empêchent de remédier aux faiblesses des marchés monétaires de l'Union ▌ et d'atténuer les risques de contagion, mettant ainsi en péril le bon fonctionnement et la stabilité du marché intérieur , comme on a pu le constater au cours de la crise financière . Des règles communes applicables aux fonds monétaires devraient donc prévoir un niveau élevé de protection des investisseurs et prévenir et atténuer tout risque de contagion lié à des demandes de rachat massives ▌de ces fonds. |
|
(10) |
En l'absence d'un règlement fixant des règles applicables aux fonds monétaires, des mesures divergentes pourraient être adoptées au niveau national, avec le risque d'importantes distorsions de concurrence résultant de différences fondamentales entre les règles de protection des investissements. L'existence de règles divergentes sur la composition des portefeuilles, sur les actifs admissibles, leur maturité, leur liquidité et leur diversification, ainsi que sur la qualité du crédit des émetteurs d'instruments du marché monétaire créerait des différences de niveau de protection des investisseurs, liées aux différents niveaux de risque des propositions d'investissement des fonds monétaires. Il est donc essentiel d'adopter un ensemble de règles uniformes pour éviter toute contagion des marchés du financement à court terme et des sponsors de fonds monétaires, qui constituerait un risque pour la stabilité des marchés financiers de l'Union. Dans le but d'atténuer le risque systémique, les fonds monétaires à valeur liquidative constante (fonds VLC) devraient, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, être opérés dans l'Union uniquement en tant que fonds VLC liés à la dette publique de l'Union, en tant que fonds VLC pour petits investisseurs ou en tant que fonds VL à faible volatilité. Sauf mention contraire, toutes les références faites dans le présent règlement à des fonds VLC s'entendent comme désignant un fonds VLC lié à la dette publique, un fonds VLC pour petits investisseurs ou un fonds VL à faible volatilité. Les fonds VLC existants devraient également pouvoir choisir de fonctionner à la place comme des fonds monétaires à valeur liquidative variable. |
|
(11) |
Les nouvelles règles sur les fonds monétaires sont étroitement liées à la directive 2009/65/CE (3) et à la directive 2011/61/UE (4), qui constituent le cadre juridique de l'Union pour l'établissement, la gestion et la commercialisation des fonds monétaires. |
|
(12) |
Dans l'Union, les organismes de placement collectif peuvent fonctionner soit en tant qu'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérés par des gestionnaires d'OPCVM, soit en tant que sociétés d'investissement agréées au titre de la directive 2009/65/CE, soit en tant que fonds d'investissement alternatifs (FIA) gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés ou enregistrés au titre de la directive 2011/61/UE. Les nouvelles règles relatives aux fonds monétaires complètent les dispositions de ces directives. De ce fait, les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires devraient s'appliquer en sus de celles prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE. Dans le même temps, des exemptions explicites devraient être prévues en ce qui concerne les politiques d'investissement des OPCVM énoncées au chapitre VII de la directive 2009/65/CE, et des règles spécifiques sur les produits devraient figurer dans ces nouvelles dispositions uniformes applicables aux fonds monétaires. |
|
(13) |
Des règles harmonisées devraient s'appliquer aux organismes de placement collectif dont les caractéristiques correspondent à celles des fonds monétaires. Pour les OPCVM et les FIA qui investissent dans des actifs à court terme tels que des instruments du marché monétaire ou des dépôts, procèdent à des prises en pension ou concluent certains types de contrats dérivés dans l'unique but de couvrir des risques inhérents à d'autres investissements du fonds, et dont l'objectif est d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, la conformité avec les nouvelles règles relatives aux fonds monétaires devrait être obligatoire. |
|
(14) |
La spécificité des fonds monétaires découle de la combinaison des actifs dans lesquels ils investissent et des objectifs qu'ils poursuivent. L'objectif d'offrir un rendement comparable aux taux du marché monétaire et celui de préserver la valeur d'un investissement ne s'excluent pas mutuellement. Un fonds monétaire peut viser l'un ou l'autre de ces objectifs, ou les deux. |
|
(15) |
L'objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire doit s'entendre au sens large. Il n'est pas nécessaire que le rendement attendu soit parfaitement aligné sur l'EONIA, l'EURIBOR, le LIBOR ou un autre taux du marché monétaire. Un OPCVM ou un FIA dont l'objectif serait de faire très légèrement mieux que les taux du marché monétaire ne devrait pas être exclu du champ d'application des nouvelles règles uniformes. |
|
(16) |
L'objectif de la préservation de la valeur de l'investissement ne devrait pas être compris comme une garantie du capital par le fonds, mais comme un objectif que l'OPCVM ou le FIA cherche à atteindre. Une baisse de la valeur des investissements ne devrait pas être interprétée comme signifiant que l'organisme de placement collectif a changé son objectif de préservation de la valeur de l'investissement. |
|
(17) |
Il est important que les OPCVM et les FIA qui présentent les caractéristiques de fonds monétaires puissent être identifiés en tant que tels et que leur capacité à satisfaire en permanence aux nouvelles règles uniformes applicables à ces fonds puisse être explicitement vérifiée. Aussi les fonds monétaires devraient-ils être agréés par des autorités compétentes. Pour les OPCVM, l'agrément en tant que fonds monétaire devrait faire partie de l'agrément en tant qu'OPCVM conformément aux procédures harmonisées prévues dans la directive 2009/65/CE. Les FIA, quant à eux, ne sont pas soumis aux procédures d'agrément et de surveillance harmonisées de la directive 2011/61/UE. Il est donc nécessaire de prévoir pour eux des règles de base communes en matière d'agrément qui reflètent les règles harmonisées applicables aux OPCVM. Ces procédures doivent garantir que le gestionnaire d'un FIA agréé en tant que fonds monétaire est un gestionnaire de FIA agréé conformément à la directive 2011/61/UE. |
|
(18) |
Afin de garantir que tous les organismes de placement collectif présentant les caractéristiques de fonds monétaires sont soumis aux nouvelles règles communes relatives aux fonds monétaires, il est nécessaire d'interdire l'utilisation de la dénomination «fonds monétaire» ou de tout autre terme suggérant qu'un organisme de placement collectif présente les caractéristiques d'un fonds monétaire, s'il ne respecte pas les dispositions du présent règlement. Pour éviter tout contournement des règles applicables aux fonds monétaires, les autorités compétentes devraient surveiller les pratiques commerciales des organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire pour vérifier qu'ils ne font pas un usage abusif de la dénomination «fonds monétaire» et qu'ils ne laissent pas entendre qu'ils sont un fonds monétaire alors qu'ils ne respectent pas le nouveau cadre réglementaire. |
|
(19) |
Les nouvelles règles applicables aux fonds monétaires devraient s'appuyer sur le cadre réglementaire existant établi par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE ainsi que par les actes adoptés pour les mettre en œuvre. Par conséquent, les règles sur les produits relatives aux fonds monétaires devraient s'appliquer en sus des règles sur les produits définies dans la législation en vigueur de l'Union, sauf exemption explicite. En outre, les règles relatives à la gestion et à la commercialisation énoncées dans le cadre législatif existant devraient s'appliquer aux fonds monétaires en tenant compte du fait qu'ils sont, soit des OPCVM, soit des FIA. De même, les règles relatives à la prestation transfrontière de services et à la liberté d'établissement prévues par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient s'appliquer de manière correspondante aux activités transfrontières des fonds monétaires. |
|
(20) |
Étant donné que les OPCVM et les FIA peuvent prendre différentes formes juridiques, y compris des formes dépourvues de la personnalité juridique, les dispositions obligeant un fonds monétaire à prendre des mesures devraient être interprétées comme se référant au gestionnaire du fonds monétaire dès lors que ce fonds est un OPCVM ou un FIA sans personnalité juridique et n'est donc pas en mesure d'agir par lui-même. |
|
(21) |
Les règles sur le portefeuille des fonds monétaires devraient clairement identifier les catégories d'actifs dans lesquels ces fonds auraient le droit d'investir, et les conditions d'admissibilité de ces actifs. Pour assurer l'intégrité de ces fonds, il est également souhaitable de leur interdire d'effectuer certaines opérations financières susceptibles de mettre en péril leur stratégie d'investissement et leurs objectifs. |
|
(22) |
Les instruments du marché monétaire sont des instruments cessibles généralement négociés sur le marché monétaire. Il peut notamment s'agir de bons du Trésor, d'obligations émises par des collectivités territoriales, de certificats de dépôt, de billets de trésorerie, de titres adossés à des actifs de grande qualité, d'acceptations bancaires ou de titres de créance à court ou moyen terme. De tels instruments ne devraient pouvoir faire l'objet d'un investissement par un fonds monétaire que s'ils satisfont aux conditions de maturité ou, dans le cas de titres adossés à des actifs, s'ils peuvent être considérés comme des actifs de grande qualité conformément aux règles de liquidités énoncées à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), et s'ils sont considérés par le fonds comme présentant une qualité de crédit élevée. |
|
(23) |
Le papier commercial adossé à des actifs (PCAA) devrait être considéré comme faisant partie des instruments du marché monétaire admissibles pour autant qu'il respecte certaines conditions supplémentaires. Étant donné que certaines titrisations étaient particulièrement instables pendant la crise, il est nécessaire d'imposer des limites de maturité et des critères de qualité aux actifs sous-jacents et de faire en sorte que l'ensemble d'expositions soit suffisamment diversifié . Cependant, toutes les catégories d'actifs sous-jacents ne se sont pas révélées instables, notamment dans le cas des titrisations dont les actifs sous-jacents servaient à soutenir le capital d'exploitation d'entreprises manufacturières et la vente de biens et de services dans l'économie réelle. Ces titrisations ont obtenu de bonnes performances et devraient être considérées comme faisant partie des instruments du marché monétaire admissibles pour autant qu'ils puissent être considérés comme des actifs liquides de grande qualité conformément aux règles de liquidité visées à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013, précisées dans le règlement délégué no… de la Commission (6) . Ce principe devrait s'appliquer aux titres liquides et de grande qualité adossés à des actifs composés de l'une des sous-catégories d'actifs sous-jacents titrisés visées à l'article 13, paragraphe 2 (g), point iii) ou iv) du règlement délégué (UE) no… de la Commission, à savoir les prêts et contrats de crédit-bail automobiles au profit d'emprunteurs ou de preneurs établis ou résidant dans un État membre, ou les prêts commerciaux, contrats de crédit-bail et facilités de crédit au profit d'entreprises établies dans un État membre destinés à financer des dépenses d'investissement ou des opérations commerciales autres que l'acquisition ou le développement de biens immobiliers commerciaux. La référence à certaines catégories d'actifs sous-jacents titrisés énoncées dans le règlement délégué (UE) no … est importante pour assurer une définition uniforme des actifs sous-jacents titrisés aux fins des règles de liquidité applicables aux établissements de crédit comme aux fins du présent règlement, ce qui revêt également une grande importance pour la liquidité de ces instruments, le but étant d'éviter les obstacles aux titrisations dans l'économie réelle. |
|
(23 bis) |
Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne précisant les critères qui définissent une titrisation simple, transparente et normalisée. Ce faisant, la Commission doit veiller à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 135, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et prendre en considération les caractéristiques des titrisations présentant une échéance à l'émission inférieure à 397 jours. Il convient aussi de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des actes précisant les critères permettant d'identifier une dette d'une qualité de crédit élevée et des papiers commerciaux adossés à des actifs liquides. La Commission doit veiller à la cohérence des différents flux de travail de l'ABE, et soutenir ces derniers. |
|
(24) |
Un fonds monétaire ne devrait pouvoir investir dans des dépôts que dans la mesure où il a la possibilité d'en retirer son argent à tout moment. Or, cette possibilité de retrait serait compromise en pratique si les pénalités associées à un retrait anticipé étaient telles qu'elles dépassent les intérêts accumulés avant le retrait. Aussi les fonds monétaires devraient-ils veiller à ne pas effectuer de dépôts auprès d'établissements de crédit qui imposent des pénalités supérieures à la moyenne, ni de dépôts à trop long terme qui entraînent des pénalités trop élevées. |
|
(25) |
Les fonds monétaires ne devraient pouvoir investir dans des instruments financiers dérivés que dans la mesure où ceux-ci leur servent à couvrir des risques de taux d'intérêt ou de change et où leur sous-jacent est constitué de taux d'intérêt, de monnaies ou d'indices représentant ces catégories. L'utilisation de dérivés à toute autre fin, ou comportant d'autres sous-jacents, devrait être interdite. Les dérivés ne devraient être utilisés qu'en complément de la stratégie du fonds, et non comme moyen principal de réaliser ses objectifs. Dans l'hypothèse où un fonds monétaire investirait dans des actifs libellés dans une monnaie autre que celle du fonds, son gestionnaire serait censé couvrir entièrement le risque de change, y compris par le biais de produits dérivés. Les fonds monétaires devraient être autorisés à investir dans des instruments financiers dérivés si ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, tel que visé à l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou via un système de négociation organisé tel que défini dans le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. |
|
(26) |
La prise en pension devrait pouvoir être utilisée par les fonds monétaires comme moyen d'investir leurs liquidités excédentaires à très court terme, à condition que les positions soient intégralement couvertes par des garanties. Afin de protéger les intérêts des investisseurs, il est nécessaire de veiller à ce que les éléments fournis en garantie dans le cadre des opérations de prise en pension soient de grande qualité. Les fonds monétaires ne devraient recourir à aucune autre technique d'optimisation de la gestion de portefeuille, y compris le prêt et l'emprunt de titres, étant donné qu'elles sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation de leurs objectifs d'investissement. |
|
(27) |
Afin de limiter la prise de risques par les fonds monétaires, il est essentiel de réduire leur risque de contrepartie en soumettant leur portefeuille à des exigences de diversification claires. À cet effet, il est également nécessaire que les accords de prise en pension soient intégralement couverts par des garanties et que, pour limiter le risque opérationnel, aucune contrepartie d'un accord de prise en pension ne représente à elle seule plus de 20 % des actifs du fonds. Tous les dérivés de gré à gré devraient être régis par le règlement (UE) no 648/2012 (7). |
|
(28) |
Pour des raisons prudentielles et pour éviter qu'un fonds monétaire puisse exercer une influence significative sur la gestion d'un organisme émetteur, il faut éviter que ce fonds ne concentre trop d'investissements dans des actifs émis par un même organisme émetteur. |
|
(29) |
Le fonds monétaire devrait avoir la responsabilité d'investir dans des actifs admissibles de grande qualité. Par conséquent, il devrait disposer d'une procédure d'évaluation de crédit prudente ▌pour déterminer la qualité du crédit des instruments du marché monétaire dans lesquels il entend investir. Conformément à la législation de l'Union qui limite la dépendance excessive à l'égard des notations de crédit, il est important que les fonds monétaires évitent de recourir excessivement aux notations publiées par les agences de notation lorsqu'ils évaluent la qualité des actifs admissibles. ▌ |
|
(29 bis) |
Compte tenu des travaux réalisés par des organismes internationaux, comme l'OICV et le CSF, ainsi que de la législation européenne, comme le règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) et la directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil (9) , portant sur la diminution de la dépendance excessive des investisseurs à l'égard des notations de crédit, il n'est pas approprié d'empêcher explicitement tout produit, y compris les fonds monétaires, de solliciter ou de financer une notation de crédit externe. |
|
(30) |
Afin d'éviter que les gestionnaires des fonds monétaires n'utilisent des critères différents pour évaluer la qualité de crédit d'un instrument du marché monétaire, et donc attribuent des caractéristiques de risque différentes à un même instrument, il est essentiel qu'ils mettent en place une procédure interne d'évaluation s'appuyant sur des méthodes d'attribution prudentes, systématiques et continues . On peut citer comme exemples de critères d'évaluation des mesures quantitatives relatives à l'émetteur de l'instrument, telles que ses ratios financiers, l'évolution de son bilan ou ses lignes directrices en matière de rentabilité, évalués et comparés à l'aune d'entreprises et de groupes du même secteur, mais aussi des mesures qualitatives telles que l'efficacité de sa gestion ou sa stratégie d'entreprise, analysées en vue de s'assurer que la stratégie globale de l'émetteur ne menace pas sa qualité de crédit future. Les évaluations internes les plus élevées devraient correspondre au fait que la qualité de crédit de l'émetteur des instruments est maintenue en permanence au plus haut niveau possible. |
|
(31) |
Afin de développer une procédure transparente et cohérente d'évaluation du crédit , le gestionnaire devrait consigner par écrit les procédures d'évaluation du crédit , pour garantir qu'elles respectent un ensemble clair de règles vérifiables et que les méthodes employées puissent être communiquées sur demande aux parties intéressées , ainsi qu'à l'autorité nationale compétente . |
|
(32) |
Afin de réduire le risque de portefeuille des fonds monétaires, il importe de fixer des limites d'échéance, sous la forme d'une maturité moyenne pondérée (MMP) maximale et d'une durée de vie moyenne pondérée (DVMP) maximale. |
|
(33) |
La MMP est utilisée pour mesurer la sensibilité d'un fonds monétaire aux variations des taux d'intérêt du marché monétaire. Lorsqu'ils déterminent leur MMP, les gestionnaires devraient tenir compte des instruments dérivés, des dépôts et des prises en pension, et de leur effet sur le risque de taux d'intérêt du fonds monétaire. Le fait qu'un fonds monétaire conclue un contrat d'échange afin d'être exposé à un instrument à taux fixe plutôt qu'à taux variable devrait être pris en considération lors de la détermination de la MMP. |
|
(34) |
La DVMP est utilisée pour mesurer le risque de crédit, étant donné que plus le remboursement du principal est différé, plus le risque de crédit est élevé. Elle est également utilisée pour limiter le risque de liquidité. Contrairement au calcul de la MMP, le calcul de la DVMP effectué pour les titres à taux variable et les instruments financiers structurés ne peut se baser sur les dates de révision du taux d'intérêt, mais uniquement sur la date d'échéance finale de l'instrument financier. La maturité utilisée pour le calcul de la DVMP est donc l'échéance résiduelle jusqu'à la date du remboursement légal, qui est la seule date pour laquelle la société de gestion a l'assurance que l'instrument sera remboursé. Certaines caractéristiques d'un instrument, telles que la possibilité d'un remboursement à certaines dates (options put), ne sont pas prises en compte dans le calcul de la DVMP. |
|
(35) |
Afin de renforcer la capacité des fonds monétaires à faire face à des demandes de rachat et de prévenir la liquidation de leurs actifs avec une forte décote, ces fonds devraient détenir en permanence un montant minimal d'actifs liquides à échéance journalière ou hebdomadaire. La date employée pour calculer la part des actifs à échéance journalière et hebdomadaire devrait être la date légale de remboursement. La possibilité pour le gestionnaire de résilier à court terme un contrat devrait pouvoir être prise en considération. Par exemple, s'il peut être mis fin à une prise en pension moyennant un préavis d'un jour, elle devrait être considérée comme étant à échéance journalière. De même, si le gestionnaire a la possibilité de retirer de l'argent d'un compte de dépôt moyennant un préavis d'un jour, les montants déposés devraient pouvoir être considérés comme étant à échéance journalière. Les titres d'État peuvent être repris parmi les actifs à maturation journalière dans les cas où le gestionnaire du fonds monétaire estime que ces titres présentent une qualité de crédit élevée. |
|
(36) |
Étant donné que les fonds monétaires peuvent investir dans des actifs de maturité différente, les investisseurs devraient pouvoir faire la distinction entre les différentes catégories de fonds. Par conséquent, les fonds devraient être classés soit comme fonds à court terme, soit comme fonds standard. Les fonds monétaires à court terme ont pour objectif d'offrir des rendements comparables aux taux du marché monétaire tout en assurant aux investisseurs la plus grande sécurité possible. Leur MMP et leur DVMP étant courtes, ces fonds présentent un risque de duration et un risque de crédit limités. |
|
(37) |
Les fonds monétaires standard ont pour objectif d'offrir des rendements légèrement supérieurs à ceux du marché monétaire, et investissent par conséquent dans des actifs qui ont une échéance plus lointaine. En outre, pour assurer ces meilleures performances, ces fonds devraient être autorisés à employer des maxima plus élevés pour leur risque de portefeuille, notamment pour ce qui concerne leur MMP et leur DVMP. |
|
(38) |
Conformément à l'article 84 de la directive 2009/65/CE, les gestionnaires de fonds monétaires qui sont des OPCVM ont la possibilité de suspendre temporairement les remboursements dans des cas exceptionnels si les circonstances l'exigent. Conformément à l'article 16 de la directive 2011/61/UE et à l'article 47 du règlement délégué (UE) no 231/2013 (10), les gestionnaires de FIA monétaires peuvent recourir à des dispositions spéciales en cas d'illiquidité des actifs du fonds. |
|
(39) |
Pour que la gestion des risques des fonds monétaires ne soit pas biaisée par des décisions à court terme influencées par l'éventuelle notation attribuée au fonds, lorsque le gestionnaire d'un fonds monétaire sollicite une notation de crédit externe, la procédure doit être soumise et conforme au règlement (UE) no 462/2013 . ▌Pour assurer une bonne gestion de la liquidité, il est nécessaire que les gestionnaires des fonds monétaires mettent en place des politiques et des procédures solides afin de connaître leurs investisseurs. Ces politiques devraient les aider à se familiariser avec leur clientèle d'investissement et à anticiper d'éventuelles demandes de rachat importantes. Afin d'éviter que le fonds monétaire ne soit confronté à des demandes de rachat massives, une attention particulière devrait être accordée aux gros investisseurs représentant une part substantielle des actifs du fonds, par exemple à tout investisseur représentant à lui seul plus que la part d'actifs venant à échéance journalière. Dans un tel cas, le fonds monétaire devrait augmenter le volume d'actifs venant à échéance journalière à proportion de cet investisseur. Le gestionnaire devrait, chaque fois que c'est possible, déterminer l'identité des investisseurs, même s'ils sont représentés par des comptes de mandataire, des portails ou tout autre acheteur indirect. |
|
(40) |
Dans le cadre d'une gestion prudente des risques, les fonds monétaires devraient effectuer ▌des simulations de crise au moins une fois par trimestre . Les gestionnaires des fonds monétaires devraient prendre des mesures pour renforcer leur fonds dès lors que les résultats de ces simulations font apparaître des vulnérabilités. |
|
(41) |
Afin de tenir compte de la valeur effective des actifs, l'évaluation au prix du marché devrait être la méthode privilégiée de valorisation des actifs des fonds monétaires. Si la valeur de l'actif ainsi obtenue est fiable, le gestionnaire ne devrait pas être autorisé à utiliser la méthode d'évaluation par référence à un modèle, qui a tendance à être moins précise. Des actifs tels que les bons du Trésor et obligations ou titres de créance à court et moyen terme émis par les collectivités territoriales présentent généralement une valorisation au prix du marché qui est fiable. Pour valoriser des billets de trésorerie ou des certificats de dépôt, le gestionnaire devrait vérifier s'il existe un marché secondaire fournissant des prix fiables. Le prix de rachat offert par l'émetteur devrait également être considéré comme fournissant une bonne estimation de la valeur des billets de trésorerie. ▌Les gestionnaires devraient estimer la valeur, par exemple à l'aide de données du marché telles que les rendements d'émissions comparables faites par le même type d'émetteurs , ou appliquer les méthodes comptables d'amortissement des coûts reconnues sur le plan international et définies par les normes comptables internationales reconnues . |
|
(42) |
Les fonds VLC ont pour objectif de préserver le capital de l'investissement tout en assurant une liquidité élevée. La majorité des fonds de ce type affichent une valeur liquidative (VL) par part ou par action établie par exemple à 1 EUR, 1 USD ou 1 GBP lorsqu'ils distribuent des revenus aux investisseurs. Les autres accumulent leurs revenus dans la valeur liquidative du fonds tout en maintenant constante la valeur intrinsèque de l'actif. |
|
(43) |
Afin de tenir compte des spécificités des fonds VLC, ces derniers doivent être autorisés à mesurer leur valeur liquidative constante par part ou par action selon la méthode comptable de l'amortissement du coût. Cependant, pour qu'il soit possible à tout moment de suivre la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action, les fonds VLC devraient également calculer la valeur de leurs actifs sur la base d'une valorisation au prix du marché ou par rapport à un modèle. |
|
(44) |
Étant donné qu'un fonds monétaire devrait publier une valeur liquidative qui reflète toutes les variations de valeur de ses actifs, la valeur liquidative publiée devrait être arrondie au maximum au point de base le plus proche ou son équivalent. Par conséquent, lorsque la valeur liquidative est publiée dans une monnaie donnée, par exemple 1 EUR, les changements de valeur doivent être indiqués par paliers de 0,0001 EUR. Dans le cas d'une valeur liquidative de 100 EUR, ce palier devrait être de 0,01 EUR. Seuls les fonds VLC devraient être autorisés à publier un prix qui ne suit pas entièrement l'évolution de la valeur de leurs actifs. Dans ce cas, la valeur liquidative peut être arrondie au centime le plus proche pour une valeur liquidative de 1 EUR (soit un palier de 0,01 EUR). |
|
(44 bis) |
Les investisseurs devraient être clairement informés, avant d'investir dans un fonds monétaire, s'il s'agit d'un fonds à court terme ou d'un fonds standard. Pour éviter de susciter des attentes indues chez l'investisseur, toute la documentation commerciale devrait indiquer clairement que les fonds monétaires ne sont pas un véhicule d'investissement garanti. |
|
(45) |
Afin de pouvoir atténuer les demandes de rachat en situation de tension sur les marchés, tous les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VL à faible volatilité devraient disposer de frais ou de mesures de verrouillage des demandes de rachat pour éviter que des clients ne formulent des demandes massives de rachat en situation de tension sur les marchés, laissant les autres investisseurs injustement exposés aux conditions alors en vigueur sur le marché. Les frais de liquidité devraient être équivalents au coût réel de la liquidation des actifs pour répondre à la demande de rachat des clients en situation de tension sur les marchés et ne pas correspondre à une charge excessive nettement supérieure au montant qui permettrait de compenser les pertes imposées aux autres investisseurs du fait des demandes de rachat. |
|
(46) |
Les fonds VLC liés à la dette publique et les fonds VLC pour petits investisseurs devraient cesser d'être des fonds VLC s'ils ne sont pas en mesure de répondre aux exigences hebdomadaires minimales de liquidités dans les 30 jours suivant l'utilisation des frais de liquidité ou des mesures de verrouillage des demandes de rachat. Dans ce cas, le fonds VLC lié à la dette publique ou le fonds VLC pour petits investisseurs devrait automatiquement être converti en fonds VLV ou liquidé. |
|
(46 bis) |
Les fonds VL à faible volatilité ne devraient être autorisés que pour une période de cinq ans. La Commission devrait procéder à un réexamen de l'opportunité des fonds VL à faible volatilité quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Le réexamen devrait concerner l'incidence et la mise en œuvre des dispositions relatives aux fonds VL à faible volatilité, y compris la fréquence des mécanismes de sauvegarde visés dans le présent règlement. Il devrait également tenir compte du risque pour la stabilité financière du système financier de l'Union et des coûts pour l'économie, y compris pour les entreprises, le secteur des fonds monétaires et le secteur financier de manière plus générale. Le réexamen devrait aussi envisager la possibilité d'autoriser les fonds VL à faible volatilité au-delà de cinq ans ou pour une durée indéterminée, et dans ce cas, les changements à apporter à leur régime. |
|
(47) |
L'apport d'une aide extérieure à un fonds monétaire ▌, pour préserver sa liquidité ou sa stabilité, ou qui a de tels effets en pratique, augmente le risque de contagion entre le secteur des fonds monétaires et le reste du secteur financier. Les tiers qui apportent une aide de ce type ont intérêt à agir de la sorte soit parce qu'ils ont un intérêt économique dans la société de gestion qui gère le fonds monétaire, soit parce qu'ils veulent éviter toute atteinte à leur réputation dans le cas où leur nom serait associé à la défaillance d'un fonds monétaire. Étant donné que ces tiers ne s'engagent pas explicitement à apporter cette aide ou à la garantir, il existe une incertitude quant au fait qu'elle sera apportée lorsque le fonds monétaire en aura besoin. Dans ces conditions, le caractère discrétionnaire de l'aide apportée par le sponsor contribue à renforcer l'incertitude, parmi les acteurs du marché, sur le point de savoir qui supportera les pertes potentielles du fonds monétaire. Il est probable que cette incertitude rend les fonds monétaires encore plus vulnérables à des demandes de rachat massives en période d'instabilité financière, lorsque les risques financiers globaux sont les plus grands et que la santé des sponsors et leur capacité à aider les fonds monétaires affiliés suscitent des inquiétudes. Pour ces raisons, toute aide extérieure doit être interdite aux fonds monétaires ▌. |
|
(48) |
Les investisseurs devraient être clairement informés, avant d'investir dans un fonds monétaire, s'il s'agit d'un fonds à court terme ou d'un fonds standard ▌. Pour éviter de susciter des attentes indues chez l'investisseur, toute la documentation commerciale devrait indiquer clairement que les fonds monétaires ne sont pas un véhicule d'investissement garanti. ▌ |
|
(48 bis) |
Les investisseurs devraient également être informés de l'endroit où ils peuvent trouver des informations sur le portefeuille d'investissements du fonds monétaire ainsi que sur ses niveaux de liquidités. ▌ |
|
(50) |
L'autorité compétente pour un fonds monétaire donné devrait assurer un suivi permanent de la capacité de ce fonds à respecter les dispositions du présent règlement. Les autorités compétentes disposent déjà, en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE, de pouvoirs importants, qu'il y a lieu d'étendre afin qu'ils puissent être exercés aux fins des nouvelles règles communes applicables aux fonds monétaires. Les autorités compétentes pour un OPCVM ou un FIA devraient également vérifier la conformité de tous les organismes d'investissement collectif présentant les caractéristiques d'un fonds monétaire qui existent déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
|
(50 bis) |
Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission devrait analyser l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Les titres de créance émis ou garantis par les États membres représentent une catégorie d'investissements distincte qui possède des caractéristiques propres en termes de qualité de crédit et de liquidité. En outre, la dette souveraine joue un rôle capital dans le financement des États membres. La Commission devrait évaluer l'évolution du marché de la dette souveraine émise ou garantie par les États membres, ainsi que la possibilité de créer un cadre spécial pour les fonds monétaires qui axent leur politique d'investissement sur ce type de dette. |
|
(51) |
La Commission devrait adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les actes délégués relatifs à la procédure d'évaluation interne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. |
|
(52) |
La Commission devrait aussi pouvoir adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes délégués conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (11). L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution à soumettre à la Commission en ce qui concerne le modèle de rapport contenant des informations sur les fonds monétaires à communiquer aux autorités compétentes. |
|
(53) |
L'AEMF devrait pouvoir exercer toutes les compétences qui lui sont conférées par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE eu égard au présent règlement. Elle devrait également être chargée d'élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution. |
|
(54) |
▌Durant les trois années qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, il est essentiel que la Commission analyse l'expérience acquise dans l'application dudit règlement et son incidence sur les différents aspects économiques liés aux fonds monétaires. Ce réexamen devrait porter en priorité sur les conséquences des modifications requises par le présent règlement sur l'économie réelle et la stabilité financière. |
|
(55) |
Les nouvelles règles uniformes relatives aux fonds monétaires devraient respecter les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13). |
|
(56) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer l'uniformité des exigences prudentielles applicables aux fonds monétaires dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre la sécurité et la fiabilité des fonds monétaires, d'une part, et le bon fonctionnement du marché monétaire et les coûts assumés par ses différents acteurs, d'autre part, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions ou de leurs effets, être mieux réalisés au niveau de l'Union, l'Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
|
(57) |
Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires respectent les droits fondamentaux et observent les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d'entreprise et la protection des données à caractère personnel. Les nouvelles règles uniformes sur les fonds monétaires devraient être appliquées conformément à ces droits et principes, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Chapitre I
Dispositions générales
Article premier
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit des règles relatives aux instruments financiers dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir, ainsi qu'aux portefeuilles de ces fonds et à leur valorisation, et les obligations de communication qui s'appliquent aux fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union.
Le présent règlement s'applique aux organismes de placement collectif qui:
|
i. |
sont soumis à agrément en tant qu'OPCVM en vertu de la directive 2009/65/CE ou sont des FIA relevant de la directive 2011/61/UE; |
|
ii. |
investissent dans des actifs à court terme; |
|
iii. |
ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire et de préserver la valeur de l'investissement. |
2. Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.
Article 1 bis
Types de fonds VLC
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les fonds VLC fonctionnent dans l'Union uniquement en tant que:
|
a) |
fonds VLC liés à la dette publique; |
|
b) |
fonds VLC pour petits investisseurs; ou |
|
c) |
fonds VL à faible volatilité. |
Sauf mention contraire, toutes les références faites dans le présent règlement à des fonds VLC s'entendent comme désignant un fonds VLC lié à la dette publique, un fonds VLC pour petits investisseurs ou un fonds VL à faible volatilité.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
1) |
«actifs à court terme»: des actifs financiers dont l'échéance résiduelle est de deux ans au plus; |
|
2) |
«instruments du marché monétaire»: des instruments cessibles visés à l'article 2, paragraphe 1, point o), de la directive 2009/65/CE généralement négociés sur le marché monétaire, comme les bons du Trésor, les obligations émises par des collectivités territoriales, les certificats de dépôt, les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, et les titres de créance à court ou moyen terme, ainsi que des instruments visés à l'article 3 de la directive 2007/16/CE ; |
|
3) |
«valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l'article 2, paragraphe 1, point n), de la directive 2009/65/CE; |
|
4) |
«mise en pension»: tout accord par lequel une partie transfère à une contrepartie des titres ou les droits rattachés à des titres en s'engageant à les racheter à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer; |
|
5) |
«prise en pension»: tout accord par lequel une partie reçoit d'une contrepartie des titres ou les droits rattachés à des titres en s'engageant à les revendre à la contrepartie à un prix déterminé et à une date future déterminée ou à déterminer; |
|
6) |
«prêt de titres» et «emprunt de titres»: une transaction par laquelle un établissement ou sa contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; il s'agit d'un «prêt de titres» pour l'établissement qui transfère les valeurs et d'un «emprunt de titres» pour l'établissement auquel les titres sont transférés; |
|
7) |
«titrisation»: une titrisation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013; |
|
7 bis) |
«titre adossé à des actifs liquides de qualité»: titre adossé à des actifs répondant aux exigences énoncées à l'article 13 du règlement délégué (UE) no …/.. de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit sur la base de l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013, en vue d'une définition uniforme des actifs cessibles d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées admissibles conformément à l'article 416, paragraphe 1, point d) du règlement (UE) no 575/2013; |
|
8) |
«dettes d'entreprise»: les instruments de dette émis par une entreprise qui est effectivement engagée dans la production ou la commercialisation de biens ou de services non financiers; |
|
9) |
« évaluation au prix du marché»: l' évaluation de positions à des cours de liquidation aisément accessibles provenant de sources indépendantes, tels que cours boursiers, cotations électroniques ou cotations fournies par plusieurs courtiers indépendants de renom; |
|
10) |
« évaluation par référence à un modèle»: une évaluation résultant d'une mesure, d'une extrapolation ou d'un autre calcul effectué à partir d'une ou plusieurs données du marché; |
|
11) |
«méthode du coût amorti»: une méthode de valorisation qui se fonde sur le coût d'acquisition d'un actif et adapte cette valeur en fonction de l'amortissement des primes ou décotes jusqu'à l'échéance; |
|
12) |
«fonds monétaire à valeur liquidative constante» ou «fonds VLC»: un fonds monétaire qui maintient une valeur liquidative constante par part ou par action, les revenus du fonds étant comptabilisés quotidiennement ou distribués à l'investisseur, et les actifs étant généralement valorisés selon la méthode du coût amorti ou la valeur liquidative étant arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent dans une monnaie; |
|
12 bis) |
«fonds monétaire à valeur liquidative constante pour petits investisseurs» ou «fonds VLC pour petits investisseurs»: un fonds VLC auquel seules les organisations caritatives, les organisations sans but lucratif, les administrations publiques et les fondations publiques peuvent souscrire; |
|
12 ter) |
«fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité» ou «fonds VL à faible volatilité»: un fonds monétaire qui respecte les exigences fixées à l'article 27, paragraphes 1 à 4; |
|
13) |
«fonds monétaire à court terme»: un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire admissibles visés à l'article 9, paragraphe 1; |
|
14) |
«fonds monétaire standard»: un fonds monétaire qui investit dans des instruments du marché monétaire admissibles visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2; |
|
15) |
«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; |
|
16) |
«autorité compétente pour le fonds monétaire»:
|
|
17) |
«État membre d'origine du fonds monétaire»: l'État membre où le fonds monétaire est agréé; |
|
18) |
«maturité moyenne pondérée (MMP)»: la durée moyenne restant jusqu'à l'échéance légale ou, si elle est plus courte, la durée moyenne restant jusqu'à la prochaine révision de taux d'intérêt en fonction d'un taux du marché monétaire, de tous les actifs sous-jacents du fonds, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu; |
|
19) |
«durée de vie moyenne pondérée (DVMP)»: la durée moyenne restant jusqu'à l'échéance légale de tous les actifs sous-jacents du fonds, compte tenu de la part relative de chaque actif détenu; |
|
20) |
«échéance légale»: la date où le principal d'un titre doit être intégralement remboursé, sans qu'aucune option ne permette de déroger à ce remboursement; |
|
21) |
«échéance résiduelle»: la durée restante jusqu'à l'échéance légale; |
|
22) |
«vente à découvert»: la vente non couverte d'instruments du marché monétaire; |
|
22 bis) |
«fonds VLC lié à la dette publique»: un fonds VLC qui investit 99,5 % de ses actifs dans des instruments de dette publique et qui, avant 2020, investit au moins 80 % de ses actifs dans des instruments de dette publique de l'Union; les fonds VLC liés à la dette publique de l'Union devraient augmenter progressivement leurs investissements dans la dette publique; |
|
22 ter) |
«soutien extérieur»: un soutien direct ou indirect proposé par un tiers, y compris le sponsor du fonds, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action; un soutien extérieur peut notamment prendre une des formes suivantes:
|
|
22 quater) |
«instruments de dette publique de l'Union»: des instruments de dette publique constitués de liquidités ou d'actifs publics des États membres ou de prises en pension publiquement garanties par des institutions, organes ou organismes de l'Union, notamment par la Banque centrale européenne, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement et le Fonds européen pour les investissements stratégiques; |
|
22 quinquies) |
«instruments de dette publique»: liquidités, actifs publics ou prises en pension garantis par la dette publique d'un émetteur souverain admissible, déterminé par le gestionnaire du fonds monétaire. |
Article 3
Agrément des fonds monétaires
1. Aucun organisme de placement collectif n'est établi, commercialisé ou géré dans l'Union en tant que fonds monétaire s'il n'a pas été agréé conformément au présent règlement.
Cet agrément vaut pour tous les États membres.
2. Un organisme de placement collectif qui demande à être agréé en tant qu'OPCVM au titre de la directive 2009/65/CE est agréé en tant que fonds monétaire dans le cadre de la procédure d'agrément de ladite directive.
3. Un organisme de placement collectif qui est un FIA est agréé en tant que fonds monétaire conformément à la procédure d'agrément prévue à l'article 4.
4. Un organisme de placement collectif n'est pas agréé en tant que fonds monétaire si l'autorité compétente dont il relève n'a pas l'assurance qu'il est en mesure de satisfaire à toutes les exigences du présent règlement.
5. Aux fins de l'agrément, le fonds monétaire présente à l'autorité compétente dont il relève les documents suivants:
|
a) |
le règlement ou les documents constitutifs du fonds; |
|
b) |
l'identification de son gestionnaire; |
|
c) |
l'identification de son dépositaire; |
|
d) |
une description du fonds monétaire, ou toute information le concernant mise à disposition des investisseurs; |
|
e) |
une description des dispositifs et procédures permettant d'assurer le respect des exigences visées aux chapitres II à VII, ou toute information sur ces dispositifs et procédures; |
|
f) |
tout autre renseignement ou document demandé par l'autorité compétente dont il relève afin de vérifier sa conformité aux exigences du présent règlement. |
6. Chaque trimestre, les autorités compétentes informent l'AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.
7. L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque fonds monétaire agréé en vertu du présent règlement et précisant sa typologie, son gestionnaire et son autorité compétente. Le registre est publié sous forme électronique.
Article 4
Procédure d'agrément des FIA en tant que fonds monétaire
1. Un FIA n'est agréé en tant que fonds monétaire que si l'autorité compétente dont il relève a approuvé la demande faite par un gestionnaire, agréé en vertu de la directive 2011/61/UE, en vue de gérer ce FIA, et si elle a également approuvé le règlement du fonds et le choix du dépositaire.
2. Lors de l'introduction de la demande de gestion du FIA, le gestionnaire du FIA (ci-après le «gestionnaire») agréé fournit à l'autorité compétente pour le fonds monétaire:
|
a) |
l'accord écrit conclu avec le dépositaire; |
|
b) |
des informations sur les modalités de la délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour le FIA concerné; |
|
c) |
des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer. |
L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire peut demander à l'autorité compétente pour le gestionnaire des clarifications et des informations concernant les documents visés au précédent alinéa ou une attestation indiquant si les fonds monétaires sont couverts par l'agrément de gestion du gestionnaire. L'autorité compétente pour le gestionnaire répond dans un délai de 10 jours ouvrables à la demande présentée par l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire.
3. Le gestionnaire notifie immédiatement à l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire toute modification ultérieure apportée aux documents visés au paragraphe 2.
4. Les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire ne peuvent rejeter la demande du gestionnaire que si celui-ci:
|
a) |
ne respecte pas le présent règlement; |
|
b) |
ne respecte pas la directive 2011/61/UE; |
|
c) |
n'est pas agréé par son autorité compétente pour la gestion de fonds monétaires; |
|
d) |
n'a pas fourni les documents visés au paragraphe 2. |
Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes dont relève le fonds monétaire consultent l'autorité compétente pour le gestionnaire.
5. L'agrément d'un FIA en tant que fonds monétaire n'est pas subordonné à l'obligation pour le FIA d'être géré par un gestionnaire agréé dans l'État membre d'origine du FIA, ni à l'obligation pour le gestionnaire d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine du FIA.
6. Le gestionnaire est informé, deux mois au plus tard après le dépôt d'une demande complète, si le FIA est agréé ou non en tant que fonds monétaire.
7. L'autorité compétente pour le fonds monétaire n'octroie pas l'agrément si le FIA est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.
Article 5
Utilisation de la dénomination «fonds monétaire»
1. Les OPCVM et les FIA n'utilisent la dénomination «fonds monétaire» ou «OPC monétaire» pour eux-mêmes ou pour les parts ou actions qu'ils émettent que s'ils ont été agréés conformément au présent règlement.
Les OPCVM et les FIA n'utilisent des dénominations qui évoquent les fonds monétaires, ou des termes tels que «liquidités», «trésorerie», «liquide», «monétaire», «de dépôt» ou autres termes analogues, que s'ils ont été agréés conformément au présent règlement.
2. L'utilisation de la dénomination «fonds monétaire», «OPC monétaire» ou toute autre dénomination évoquant un fonds monétaire et l'utilisation des termes visés au paragraphe 1 comprennent leur utilisation dans des documents internes ou externes, rapports, déclarations, publicités, communications, lettres et tout autre document adressé ou destiné à être distribué aux investisseurs potentiels, porteurs de parts, actionnaires ou autorités compétentes sous une forme écrite, orale, électronique ou autre.
Article 6
Règles applicables
1. Les fonds monétaires se conforment à tout moment aux dispositions du présent règlement.
2. Un fonds monétaire qui est un OPCVM et son gestionnaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2009/65/CE, sauf indication contraire du présent règlement.
3. Un fonds monétaire qui est un FIA et son gestionnaire se conforment à tout moment aux exigences de la directive 2011/61/UE, sauf indication contraire du présent règlement.
4. Le gestionnaire du fonds monétaire est responsable du respect des dispositions du présent règlement. Il est responsable de toute perte ou de tout préjudice résultant de son non-respect.
5. Le présent règlement n'empêche pas les fonds monétaires d'appliquer des limites d'investissement plus strictes que celles qu'il prévoit.
Chapitre II
Obligations concernant les politiques d'investissement des fonds monétaires
Section I
Règles générales et actifs admissibles
Article 7
Principes généraux
1. Lorsqu'un fonds monétaire est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins des chapitres II à VII, comme un fonds monétaire distinct.
2. Les fonds monétaires agréés en tant qu'OPCVM ne sont pas soumis aux obligations concernant les politiques d'investissement des OPCVM énoncées aux articles 49, 50, 50 bis, 51, paragraphe 2, et 52 à 57 de la directive 2009/65/CE, sauf mention contraire expresse dans le présent règlement.
Article 8
Actifs admissibles
1. Les fonds monétaires investissent uniquement dans une ou plusieurs des catégories suivantes d'actifs financiers et seulement dans les conditions spécifiées par le présent règlement:
|
a) |
instruments du marché monétaire; |
|
a bis) |
instruments financiers émis ou garantis individuellement ou conjointement par les administrations centrales, régionales et locales des États membres ou leurs banques centrales, ou par des institutions, organes et organismes de l'Union européenne, notamment la Banque centrale européenne, ou par la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le nouveau Fonds européen pour les investissements stratégiques, mais aussi par le Mécanisme européen de stabilité, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque de développement du Conseil de l'Europe et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement; |
|
b) |
dépôts auprès d'établissements de crédit; |
|
c) |
instruments ▌dérivés admissibles utilisés exclusivement à des fins de couverture ; |
|
d) |
opérations de prise en pension ou contrats de mise en pension, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
|
2. Les fonds monétaires ne se livrent à aucune des activités suivantes:
|
a) |
l'investissement dans des actifs autres que ceux visés au paragraphe 1; |
|
b) |
la vente à découvert d'instruments du marché monétaire; |
|
c) |
l'exposition directe ou indirecte sur des fonds indiciels cotés, des actions ou des matières premières, y compris par l'intermédiaire de produits dérivés, de certificats représentatifs de ces actions ou matières premières ou d'indices basés sur celles-ci, ou de tous autres moyens ou instruments exposant à un risque en rapport avec elles; |
|
d) |
la conclusion de contrats de prêt ou d'emprunt de titres ▌ou de tout autre contrat qui grèverait les actifs du fonds monétaire; |
|
e) |
le prêt et l'emprunt de liquidités; |
|
e bis) |
l'investissement dans d'autres fonds monétaires. |
Article 9
Instruments du marché monétaire admissibles
1. Les instruments du marché monétaire dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
|
a) |
ils entrent dans l'une des catégories d'instruments du marché monétaire visées à l'article 50, paragraphe 1, point a), b), c) ou h), de la directive 2009/65/CE; |
|
b) |
ils présentent l'une des deux caractéristiques suivantes:
|
|
c) |
leur émetteur a obtenu l'une des deux notes internes les plus élevées selon les règles énoncées à l'article 18 du présent règlement; |
|
d) |
en cas d'exposition sur une titrisation, ils satisfont aux exigences supplémentaires visées à l'article 10. |
2. Les fonds monétaires standard sont autorisés à investir dans un instrument du marché monétaire dont le rendement est soumis à un ajustement régulier, tous les 397 jours au moins, pour tenir compte des conditions du marché monétaire, et dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas deux ans.
3. Le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire qui sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité ou la Banque européenne d'investissement.
Article 10
Titrisations admissibles
1. Une titrisation est ▌admissible si toutes les conditions suivantes sont remplies:
|
a) |
l'exposition sous-jacente, ou l'ensemble d'expositions sous-jacent, se compose exclusivement de titres de dette admissibles et est suffisamment diversifié ; |
|
b) |
les titres de dette admissibles sous-jacents présentent une qualité de crédit et une liquidité élevées; et; |
|
c) |
les titres de dette admissibles sous-jacents ont une échéance légale, à l'émission, de 397 jours ou moins, ou une échéance résiduelle de 397 jours ou moins. |
1 bis. Les titres liquides de qualité élevée adossés à des actifs tels que définis à l'article 2, paragraphe 7, point a), sont réputés être des titrisations admissibles..
1 ter. Les titres de qualité élevée adossés à des actifs sont réputés admissibles s'ils sont liquides conformément au règlement (UE) no 575/2013, et si les expositions sous-jacentes présentent une qualité de crédit élevée.
2. La Commission adopte conformément à l'article 44 [dans les six mois suivant la publication du présent règlement] des actes délégués précisant les critères qui définissent une titrisation simple, transparente et normalisée en ce qui concerne chacun des aspects suivants:
|
a) |
sous quelles conditions et dans quelles circonstances il est considéré que l'exposition sous-jacente, ou l'ensemble d'expositions sous-jacent, se compose exclusivement de titres de dette admissibles et s'ils sont considérés comme suffisamment diversifiés ; |
|
b) |
les conditions et les seuils numériques permettant d'établir que des titres de dette sous-jacents présentent une qualité de crédit et une liquidité élevées. |
|
b bis) |
les exigences en matière de transparence relatives à la titrisation et à ses actifs sous-jacents; Ce faisant, la Commission veille à la cohérence avec les actes délégués adoptés conformément à l'article 460 du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 135, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), et prend en considération les caractéristiques des titrisations présentant une échéance à l'émission inférieure à 397 jours. En outre, la Commission adopte [dans les six mois suivant la publication du présent règlement] des actes délégués précisant les critères permettant d'identifier une dette d'une qualité de crédit élevée et des papiers commerciaux adossés à des actifs liquides eu égard au paragraphe 1bis. Ce faisant, la Commission veille à la cohérence des différents flux de travail de l'ABE, et soutient ces derniers. |
Article 11
Conditions d'admissibilité des dépôts auprès d'établissements de crédit
Les dépôts auprès d'établissements de crédit dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
|
a) |
ils sont remboursables sur demande ou peuvent être retirés à tout moment; |
|
b) |
ils arrivent à échéance en 12 mois maximum; |
|
c) |
l'établissement de crédit a son siège statutaire dans un État membre ou, dans le cas contraire, est soumis à des règles prudentielles considérées équivalentes aux règles édictées dans le droit de l'Union conformément à la procédure visée à l'article 107, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. |
Article 12
Instruments financiers dérivés admissibles
Les instruments financiers dérivés dans lesquels les fonds monétaires peuvent investir sont négociés sur un marché réglementé au sens de l'article 50, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la directive 2009/65/CE ou bien sont soumis à l'obligation de compensation visée au règlement (UE) no 648/2012, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
|
a) |
ils ont pour sous-jacent des taux d'intérêt, taux de change, monnaies ou indices représentatifs de l'une de ces catégories; |
|
b) |
ils servent uniquement à couvrir la duration et les risques de change liés à d'autres investissements du fonds monétaire; |
|
c) |
les contreparties des ▌instruments dérivés ▌sont des établissements soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles et appartenant aux catégories approuvées par les autorités compétentes de l'État membre d'origine du fonds monétaire; |
|
d) |
les instruments dérivés ▌font l'objet d'une valorisation quotidienne fiable et vérifiable et peuvent, à l'initiative du fonds monétaire, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur. |
Article 13
Opérations de prise en pension admissibles
1. Les accords de prise en pension que peuvent conclure les fonds monétaires remplissent obligatoirement toutes les conditions suivantes:
|
(a) |
le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum; |
|
(b) |
la valeur de marché des actifs reçus dans le cadre de l'accord de prise en pension est à tout moment au moins égale à la valeur des liquidités distribuées . |
2. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont des instruments du marché monétaire tels qu'énoncés à l'article 9.
3. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension n'incluent pas de titrisations au sens de l'article 10. ▌
4. Les actifs reçus par le fonds monétaire dans le cadre d'un accord de prise en pension sont inclus aux fins du calcul des limites en matière de diversification et de concentration fixées dans le présent règlement. Ces actifs ne sont ni cédés, ni réinvestis, ni donnés en nantissement, ni transférés de quelque autre façon.
5. Par dérogation au paragraphe 2, un fonds monétaire peut, dans le cadre d'un accord de prise en pension, recevoir des valeurs mobilières liquides ou des instruments du marché monétaire liquides autres que des instruments visés à l'article 9 pour autant que ces actifs remplissent l'une des conditions suivantes:
|
a) |
ils possèdent une qualité de crédit élevée et sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un État membre, la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité ou la Banque européenne d'investissement; |
|
b) |
ils sont émis ou garantis par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, et l'émetteur concerné dudit pays a réussi l'évaluation interne selon les règles énoncées aux articles 16 à 19. |
Les investisseurs du fonds monétaire sont informés des actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa.
Les actifs reçus dans le cadre d'un accord de prise en pension conformément au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 14, paragraphe 6.
5 bis. Un fonds monétaire peut emprunter ou conclure des contrats de mise en pension, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:
|
a) |
le contrat de mise en pension n'a qu'une durée temporaire, pour un maximum de sept jours ouvrés, et n'est pas utilisé à des fins d'investissement; |
|
b) |
le montant des contrats de mise en pension ne doit pas excéder 10 % de la valeur des actifs du fonds monétaire concerné et ne peut pas être investi dans des actifs admissibles; |
|
c) |
le fonds monétaire a le droit de résilier l'accord à tout moment moyennant un préavis de deux jours ouvrables maximum; |
|
d) |
les garanties en espèces reçues sont uniquement:
|
▌
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLITIQUES D'INVESTISSEMENT
Article 14
Diversification
1. Les fonds monétaires n'investissent pas plus de 5 % de leurs actifs dans:
|
a) |
des instruments du marché monétaire émis par une même entité; |
|
b) |
des dépôts effectués auprès d'un même établissement de crédit. |
2. La somme de toutes les expositions d'un fonds monétaire à des titrisations ne dépasse pas 10 % de ses actifs.
3. Le risque total auquel un fonds monétaire s'expose sur une même contrepartie dans le cadre d'opérations sur instruments dérivés ▌ne dépasse pas 5 % de ses actifs.
4. Le montant total de liquidités qu'un fonds monétaire fournit à une même contrepartie dans le cadre d'accords de prise en pension ne dépasse pas 10 % de ses actifs.
5. Nonobstant les limites individuelles fixées aux paragraphes 1 et 3, un fonds monétaire , qu'il s'agisse d'un fonds lié à la dette publique ou d'un fonds standard, ne peut, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 8 % de ses actifs dans une seule et même entité, combiner plusieurs des éléments suivants:
|
a) |
des investissements dans des instruments du marché monétaire émis par cette entité; |
|
b) |
des dépôts auprès de cette entité; |
|
c) |
des instruments financiers dérivés ▌exposant à un risque de contrepartie sur cette entité. |
6. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les autorités compétentes peuvent autoriser un fonds monétaire à placer, conformément au principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents instruments du marché monétaire émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou la banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union, par le mécanisme européen de stabilité, par la Banque européenne d'investissement, par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.
Le premier alinéa ne s'applique que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
|
a) |
le fonds monétaire détient des instruments du marché monétaire appartenant à six émissions différentes au moins de l'émetteur concerné; |
|
b) |
le fonds monétaire limite à 30 % maximum de ses actifs l'investissement dans des instruments du marché monétaire appartenant à une même émission; |
|
c) |
le fonds monétaire mentionne expressément dans son règlement ou dans ses documents constitutifs les autorités centrales, régionales ou locales ou les banques centrales des États membres , la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissements, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, les instruments de dette publique, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux, la Banque de développement du Conseil de l'Europe, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou tout autre organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, en tant qu'émetteur ou garant d'instruments monétaires dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs. |
|
d) |
inclut, bien en évidence, dans ses prospectus ou communications publicitaires, une déclaration qui attire l'attention sur l'utilisation de cette dérogation et indique les autorités centrales, régionales ou locales ou les banques centrales des États membres , la Banque centrale européenne, l'Union, le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissements, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l'autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers, le Fonds monétaire international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque des règlements internationaux ou tout autre organisme international dont font partie un ou plusieurs États membres, en tant qu'émetteur ou garant d'instruments monétaires dans lesquels il envisage d'investir plus de 5 % de ses actifs. |
7. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 83/349/CEE (14) du Conseil ou aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule et même entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 5.
Article 15
Concentration
1. Un fonds monétaire ne détient pas plus de 5 % des instruments du marché monétaire émis par une même entité.
2. La limite fixée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments du marché monétaire émis ou garantis par une autorité centrale, régionale ou locale ou la banque centrale d'un État membre, par la Banque centrale européenne, par l'Union, par le mécanisme européen de stabilité, par la Banque européenne d'investissement, par une autorité centrale ou la banque centrale d'un pays tiers ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres.
SECTION III
QUALITÉ DE CRÉDIT DES INSTRUMENTS DU MARCHÉ MONÉTAIRE
Article 16
Procédure d'évaluation interne
1. Les gestionnaires des fonds monétaires établissent, mettent en œuvre et appliquent ▌des procédures d'évaluation interne prudentes ▌pour déterminer la qualité de crédit des instruments du marché monétaire, en tenant compte de l'émetteur et des caractéristiques de l'instrument lui-même.
1 bis. Les gestionnaires des fonds monétaires veillent à ce que les informations utilisées aux fins d'une évaluation de crédit interne soient de qualité suffisante, actualisées et de source fiable.
2. Les procédures d'évaluation interne reposent sur ▌des méthodes d'attribution prudentes ▌, systématiques et continues. Les méthodes appliquées sont soumises à la validation du gestionnaire du fonds monétaire , sur la base de données historiques et empiriques, y compris de contrôles a posteriori.
3. Les procédures d'évaluation interne respectent les principes généraux suivants :
|
a) |
elles établissent un système efficace d'obtention et de mise à jour des informations pertinentes sur les caractéristiques des émetteurs; |
|
b) |
les gestionnaires des fonds monétaires adoptent et mettent en œuvre des mesures adéquates pour veiller à ce que l'évaluation de crédit soit fondée sur une analyse approfondie de toutes les informations disponibles et pertinentes et inclue la totalité des facteurs déterminants pour la solvabilité de l'émetteur; |
|
c) |
les gestionnaires des fonds monétaires exercent un suivi constant de leur procédure d'évaluation interne et ▌réexaminent toutes les évaluations de crédit tous les six mois . Chaque fois qu'un changement important risque d'avoir un effet sur l'évaluation de crédit d'un émetteur , ils revoient leur évaluation de crédit interne . |
|
d) |
lorsque les gestionnaires de fonds procèdent à une évaluation interne, la procédure est soumise et conforme au règlement (UE) no 462/2013. |
|
e) |
les méthodes d'évaluation de crédit sont revues au moins tous les six mois par le gestionnaire du fonds afin de déterminer si elles restent adaptées au portefeuille actuel et aux conditions extérieures , et le réexamen est transmis aux autorités compétentes . |
|
f) |
en cas de modification des méthodes, des modèles ou des principales hypothèses utilisés pour la notation dans les procédures d'évaluation interne, les gestionnaires des fonds monétaires réexaminent dès que possible toutes les évaluations de crédit internes concernées ▌; |
|
g) |
les évaluations de crédit internes et leur réexamen périodique par les gestionnaires des fonds monétaires n'incombent pas aux personnes qui assurent la gestion du portefeuille du fonds monétaire ou qui sont responsables de cette gestion. |
Article 17
Procédure d'évaluation interne
1. Tout émetteur d'instruments du marché monétaire dans lesquels un fonds monétaire souhaite investir se voit délivrer une évaluation de crédit suivant la procédure d'évaluation de crédit établie conformément à la procédure d'évaluation interne.
2. La structure de la procédure d'évaluation de crédit respecte les principes généraux suivants :
|
a) |
la procédure détermine la quantification du risque de crédit de l'émetteur en tenant compte du risque relatif de défaut ; |
|
b) |
la procédure détermine le risque de crédit d'un émetteur et consigne par écrit les critères ayant servi à déterminer ce niveau du risque de crédit; |
|
c) |
la procédure tient compte du caractère à court terme des instruments du marché monétaire. |
3. L'évaluation de crédit visée au paragraphe 1 est fondée sur les critères qui remplissent toutes les conditions suivantes:
|
a) |
ils comprennent au moins des indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur l'émetteur de l'instrument ainsi que sur la situation macroéconomique et celle du marché financier; |
|
b) |
ils mentionnent les valeurs de référence numériques et qualitatives communes utilisées pour évaluer les indicateurs quantitatifs et qualitatifs; |
|
c) |
ils sont adaptés au type d'émetteur concerné. On distingue au moins les types d'émetteurs suivants: émetteurs souverains, autorités publiques régionales ou locales, sociétés financières et sociétés non financières; |
|
d) |
en cas d'exposition sur une titrisation, ils tiennent compte du risque de crédit de l'émetteur, de la structure de la titrisation et du risque de crédit des actifs sous-jacents. |
Article 18
Documentation
1. Les gestionnaires des fonds monétaires consignent par écrit leur procédure d'évaluation interne et leur système de notation interne. Ce dossier inclut:
|
a) |
le concept et les détails opérationnels de la procédure d'évaluation et du système de notation internes, afin que les autorités compétentes puissent comprendre comment se fait l'attribution des différentes notes et évaluer si une attribution donnée est ou non appropriée; |
|
b) |
la logique et l'analyse sous-tendant le choix par le gestionnaire des critères de notation et de la fréquence de leur réexamen. Cette analyse couvre les paramètres et le modèle (ainsi que ses limites) utilisés pour choisir les critères de notation; |
|
c) |
tous les changements importants apportés à la procédure d'évaluation interne, y compris les raisons de ces changements; |
|
d) |
l'organisation de la procédure d'évaluation interne, notamment le processus d'attribution de la notation et la structure de contrôle interne; |
|
e) |
un historique complet des notations internes attribuées aux émetteurs et aux garants reconnus; |
|
f) |
les dates d'attribution des notations internes; |
|
g) |
les données essentielles et la méthodologie utilisées pour obtenir la notation interne, y compris les principales hypothèses de notation; |
|
h) |
l'identité de la personne ou des personnes chargée(s) d'attribuer les notations internes. |
2. La procédure d'évaluation interne est décrite en détail dans le règlement ou dans les documents constitutifs du fonds monétaire, et tous les documents mentionnés au paragraphe 1 sont mis à disposition sur demande des autorités compétentes du fonds monétaire et des autorités compétentes du gestionnaire du fonds monétaire.
Article 19
Actes délégués
La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 44 , des actes délégués spécifiant les points suivants:
|
a) |
les conditions dans lesquelles les méthodes d'attribution sont réputées prudentes, ▌systématiques et continues ainsi que les conditions de la validation visée à l'article 16 , paragraphe 2; |
|
b) |
la définition de chaque échelon en rapport avec la quantification du risque de crédit d'un émetteur visée à l'article 17, paragraphe 2, point a), et les critères servant à quantifier le risque de crédit mentionnés à l'article 17, paragraphe 2, point b); |
|
c) |
les valeurs de référence précises pour chaque indicateur qualitatif et les valeurs de référence numériques pour chaque indicateur quantitatif. Ces valeurs de référence des indicateurs sont spécifiées pour chaque niveau de l'échelle de notation compte tenu des critères visés à l'article 17, paragraphe 3; |
|
d) |
la signification de l'expression «changement important» telle qu'elle figure à l'article 16, paragraphe 3, point c). |
Article 20
Gouvernance de l'évaluation de la qualité de crédit
1. Les procédures d'évaluation internes sont approuvées par les instances dirigeantes, l'organe directeur et, lorsqu'elle existe, la fonction de surveillance du gestionnaire du fonds monétaire.
Ces parties ont une compréhension fine des procédures d'évaluation internes, des systèmes de notation internes et des méthodes d'attribution du gestionnaire ainsi qu'une connaissance détaillée des rapports y afférents.
2. L'analyse, fondée sur les notations internes, du profil de risque de crédit du fonds monétaire est une composante essentielle des rapports qui sont adressés aux parties visées au paragraphe 1. Ces rapports contiennent au minimum les informations suivantes: profil de risque par échelon, migration des notations entre échelons, estimation des paramètres pertinents par échelon et comparaison des taux de défaut effectifs. La fréquence des rapports dépend de l'importance et du type d'informations communiquées mais est au moins annuelle.
3. Les instances dirigeantes veillent en permanence à ce que la procédure d'évaluation interne fonctionne convenablement.
Les instances dirigeantes sont tenues régulièrement informées du fonctionnement de la procédure d'évaluation interne, des domaines dans lesquels des points faibles ont été remarqués et de l'avancement des actions et des travaux engagés pour remédier aux insuffisances précédemment détectées.
Chapitre III
Obligations concernant la gestion des risques par les fonds monétaires
Article 21
Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires à court terme
Le portefeuille des fonds monétaires à court terme satisfait en permanence aux exigences suivantes:
|
a) |
sa maturité moyenne pondérée (MMP) ne dépasse pas 60 jours; |
|
b) |
sa durée de vie moyenne pondérée (DVMP) ne dépasse pas 120 jours; |
|
c) |
au moins 10 % de ses actifs sont à échéance journalière. Les fonds monétaires à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité; |
|
d) |
au moins 20 % de ses actifs sont à échéance hebdomadaire. Les fonds monétaires à court terme s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 20 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité; aux fins de ce calcul, les instruments du marché monétaire peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 5 %, dans la mesure où ils peuvent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables suivants. |
|
d bis) |
Les exigences de liquidité à un jour ou à une semaine visées aux paragraphes c) et d) sont augmentées respectivement de:
|
Article 22
Règles relatives au portefeuille des fonds monétaires standard
1. Le portefeuille des fonds monétaires standard satisfait à toutes les exigences suivantes:
|
a) |
il a en permanence une MMP ne dépassant pas 6 mois; |
|
b) |
il a en permanence une DVMP ne dépassant pas 12 mois; |
|
c) |
au moins 10 % de ses actifs sont à échéance journalière. Les fonds monétaires standard s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance journalière lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 10 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité; |
|
d) |
au moins 20 % de ses actifs sont à échéance hebdomadaire. Les fonds monétaires standard s'abstiennent d'acquérir tout actif autre qu'à échéance hebdomadaire lorsque cette acquisition ferait tomber à moins de 20 % la part de leurs investissements en actifs de cette maturité. aux fins de ce calcul, les instruments du marché monétaire peuvent être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire jusqu'à un maximum de 5 %, dans la mesure où ils peuvent être vendus et réglés dans les cinq jours ouvrables suivants. |
|
(d bis) |
Les exigences de liquidité à un jour ou à une semaine visées aux paragraphes c) et d) sont augmentées respectivement de:
|
2. Les fonds monétaires standard peuvent investir jusqu'à 10 % de leurs actifs dans des instruments du marché monétaire émis par une seule et même entité.
3. Nonobstant la limite individuelle fixée au paragraphe 2 et par dérogation , les fonds monétaires standard peuvent combiner, lorsque cela les amènerait à investir jusqu'à 15 % de leurs actifs dans une même entité, plusieurs des éléments suivants:
|
a) |
des investissements dans des instruments du marché monétaire émis par cette entité; |
|
b) |
des dépôts auprès de cette entité; |
|
c) |
des instruments financiers dérivés ▌exposant à un risque de contrepartie sur cette entité. |
4. Les investisseurs des fonds monétaires standard sont informés de tous les actifs de portefeuille dans lesquels ces fonds investissent en vertu des paragraphes 2 et 5 .
5. Les fonds monétaires standard ne prennent pas la forme de fonds VLC.
Article 23
Notations de crédit des fonds monétaires
Lorsque les fonds monétaires sollicitent une notation de crédit externe, la procédure est soumise et conforme au règlement (UE) no 462/2013.
Article 24
Obligation de «connaître son client»
1. Les gestionnaires des fonds monétaires établissent, mettent en œuvre et appliquent des procédures et exercent toute la diligence requise pour déterminer le nombre de leurs investisseurs, leurs besoins et leur comportement ainsi que le montant de leurs avoirs, afin de prévoir correctement l'effet d'un désengagement simultané de plusieurs investisseurs, en prenant à tout le moins en considération le type d'investisseurs, le nombre d'actions du fonds détenues par un même investisseur et l'évolution des entrées et des sorties . À cet effet, les gestionnaires des fonds monétaires prennent en considération au moins les éléments suivants:
|
a) |
les schémas d'évolution identifiables des besoins de liquidités des investisseurs; |
|
b) |
le type d'investisseur ; |
|
c) |
l'aversion pour le risque des différents investisseurs; |
|
d) |
le degré de corrélation ou l'étroitesse des liens entre différents investisseurs du fonds monétaire; |
|
d bis) |
l'évolution cyclique du nombre d'actions du fonds . |
1 bis. Lorsque les investisseurs d'un fonds monétaire passent par un intermédiaire, le gestionnaire du fonds monétaire recherche des données, que lui transmet l'intermédiaire, lui permettant de gérer de manière appropriée les liquidités et la concentration des investisseurs du fonds monétaire.
2. Les gestionnaires des fonds monétaires veillent à ce que:
|
a) |
la valeur des parts ou des actions détenues par un même investisseur ne dépasse à aucun moment la valeur des actifs à échéance journalière; |
|
b) |
le désengagement d'un investisseur n'affecte pas gravement le profil de liquidité du fonds monétaire. |
Article 25
Simulations de crise
1. Les fonds monétaires se dotent tous de solides processus de simulation de crise permettant de repérer les événements possibles ou futurs changements de conditions économiques susceptibles d'avoir sur eux un effet défavorable. Les gestionnaires des fonds monétaires procèdent régulièrement à des simulations de crise et élaborent des plans d'action correspondant à divers scénarios. En outre, dans le cas des fonds VL à faible volatilité, les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la VL constante par part ou par action et la VL réelle par part ou par action.
Les simulations de crise sont basées sur des critères objectifs et examinent les effets de scénarios plausibles de crise grave. Les scénarios des simulations de crise tiennent compte au moins de paramètres de référence qui comprennent les facteurs suivants:
|
a) |
des variations hypothétiques du degré de liquidité des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire; |
|
b) |
des variations hypothétiques du niveau de risque de crédit des actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire, y compris les événements de crédit et les événements de notation; |
|
c) |
des fluctuations hypothétiques des taux d'intérêt; |
|
d) |
des niveaux hypothétiques de remboursement; |
|
d bis) |
des élargissements ou des resserrements hypothétiques des écarts entre les indices auxquels les taux d'intérêt en portefeuille titres sont liés; |
|
d ter) |
des chocs macrosystémiques hypothétiques touchant l'ensemble de l'économie. |
2. En outre, dans le cas des fonds VLC liés à la dette publique et des fonds VLC pour petits investisseurs , les simulations de crise procèdent à une estimation, suivant divers scénarios, de la différence entre la VL constante par part ou par action et la VL par part ou par action ▌. Sur la base des résultats de la simulation de crise, le gestionnaire du fonds élabore des plans de redressement pour différents scénarios possibles. Ces plans de redressement sont approuvés par les autorités compétentes.
▌
4. Les simulations de crise ont lieu selon une fréquence décidée par le conseil d'administration ▌du fonds monétaire, après réflexion sur ce qui constitue un intervalle de temps adéquat et raisonnable compte tenu des conditions du marché et eu égard à toute modification envisagée du portefeuille du fonds. Cette fréquence est au minimum trimestrielle .
4 bis. Lorsqu'il ressort des simulations de crise qu'un fonds donné présente une vulnérabilité quelconque, le gestionnaire de ce fonds prend des dispositions en vue de renforcer sa solidité, notamment des mesures visant à accroître la liquidité ou la qualité de ses actifs et informe immédiatement l'autorité compétente des mesures prises.
5. Un rapport complet présentant les résultats des simulations de crise et une proposition de plan d'action est soumis à l'examen du conseil d'administration ▌du fonds monétaire. Le conseil d'administration modifie le cas échéant le plan d'action proposé et approuve le plan d'action final. Le rapport est conservé pour une période d'au moins cinq années.
▌
6. Le rapport visé au paragraphe 5 est soumis à l'autorité compétente du fonds monétaire. Les autorités compétentes transmettent le rapport à l'AEMF.
▌
Chapitre IV
Règles de valorisation et traitement comptable
Article 26
Valorisation des actifs des fonds monétaires
1. Les actifs des fonds monétaires sont valorisés au moins une fois par jour. Le résultat de cette valorisation est publié quotidiennement sur le site internet du fonds monétaire. Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 4, points a) et b), la valorisation est effectuée par un tiers indépendant qui utilise les méthodes de valorisation au prix du marché ou de valorisation par référence à un modèle. Elle n'est effectuée ni par le fonds monétaire lui-même, ni par son gestionnaire d'actifs, ni par son sponsor.
2. Sans préjudice de l'article 27, paragraphe 4, points a) et b), les actifs des fonds monétaires sont valorisés chaque fois que possible au prix du marché.
3. Lorsque la méthode de la valorisation ▌au prix du marché est utilisée , elle prend pour base le plus prudent du cours vendeur ou du cours acheteur à moins que l'institution ne puisse liquider sa position au cours moyen du marché. Lorsque la méthode de la valorisation ▌au prix du marché est utilisée , seules sont utilisées des données de marché de qualité communiquées par des fournisseurs de cours indépendants et reconnus, pour autant que cela ne porte pas indûment préjudice à un règlement valeur-jour . La qualité des données de marché est appréciée en tenant compte de tous les éléments suivants:
|
a) |
le nombre et la qualité des contreparties; |
|
b) |
le volume et le chiffre d'affaires du marché de cet actif; |
|
c) |
la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre. |
4. Lorsque l'utilisation de la méthode de la valorisation au prix du marché n'est pas possible ou que les données de marché sont de qualité insuffisante, les actifs des fonds monétaires font l'objet d'une valorisation prudente en utilisant la méthode de valorisation par référence à un modèle. Le modèle estime avec précision la valeur intrinsèque de l'actif sur la base des données clés actualisées suivantes:
|
a) |
le volume et le chiffre d'affaires du marché de cet actif; |
|
b) |
la taille de l'émission et la proportion de l'émission que le fonds monétaire projette d'acheter ou de vendre; |
|
c) |
le risque de marché, le risque de taux d'intérêt et le risque de crédit liés à l'actif. |
Lorsque la méthode de valorisation ▌par référence à un modèle est utilisée, la méthode du coût amorti ne l'est pas .
Lorsque la méthode de valorisation par référence à un modèle est utilisée, il convient d'utiliser uniquement des données relatives aux prix provenant de fournisseurs de cours indépendants et reconnus, et de soumettre la méthode de fixation des prix du modèle à l'approbation de l'autorité compétente dont relève le fonds monétaire.
5. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les actifs d'un fonds VLC lié à la dette publique et d'un fonds VLC pour petits investisseurs peuvent ▌ être valorisés selon la méthode du coût amorti pour la valorisation des actifs .
Article 27
Calcul de la valeur liquidative par part ou par action
1. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 13 ter, la VL réelle par part ou par action ▌est calculée comme étant égale à la différence entre la somme de tous les actifs d'un fonds monétaire et la somme de tous ses passifs, et elle est valorisée selon les méthodes de valorisation au prix du marché ou de valorisation par référence à un modèle, divisée par le nombre de parts ou d'actions en circulation de ce fonds.
Le premier alinéa s'applique à tous les fonds monétaires, y compris les fonds VL à faible volatilité, les VLC liés à la dette publique et les fonds VLC pour petits investisseurs.
2. La valeur liquidative réelle par part ou par action est arrondie au point de base le plus proche ou son équivalent lorsque la VL est exprimée dans une unité monétaire.
3. La valeur liquidative réelle par part ou par action d'un fonds monétaire est calculée au moins une fois par jour.
4. Outre le calcul de la valeur liquidative réelle par part ou par action conformément aux paragraphes 1 à 3, un fonds VL à faible volatilité peut aussi afficher une VL constante par part ou par action, à condition que soient remplies toutes les conditions suivantes:
|
a) |
utilisation de la méthode du coût amorti pour la valorisation des actifs dont l'échéance résiduelle est inférieure à 90 jours; les prix de tous les actifs dont l'échéance résiduelle est supérieure à 90 jours sont fixés en utilisant les prix du marché ou par référence à un modèle; |
|
b) |
aux fins de la valorisation, les actifs sont arrondis à la deuxième décimale, pour autant que la VL constante par part ou par action ne s'écarte pas de sa VL réelle de plus de 20 points de base, puis à la quatrième décimale; |
|
c) |
remboursement ou souscription à la VL constante par part ou par action, pour autant que la VL constante par part ou par action ne s'écarte pas de sa VL réelle de plus de 20 points de base; |
|
d) |
remboursement ou souscription à la VL réelle par part ou par action, arrondie à la quatrième décimale, ou moins, si la VL constante s'écarte de la VL réelle de plus de 20 points de base; |
|
e) |
les investisseurs sont clairement avertis par écrit, avant la conclusion du contrat, des circonstances dans lesquelles le fonds ne procèdera plus à un rachat ou à une souscription à une VL constante; |
|
f) |
la différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative réelle par part ou par action fait l'objet d'une surveillance continue et est publiée chaque jour sur le site internet du fonds monétaire. |
5. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à un réexamen de son incidence et de sa mise en œuvre, y compris de la fréquence des mécanismes de sauvegarde visés à l'article 27, paragraphe 4, point d), et le présente au Parlement européen et au Conseil.
Les autorisations accordées aux fonds VL à faible volatilité dans le cadre du présent règlement expirent cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission examine si les fonds VL à faible volatilité ont correctement pris garde au risque systémique ainsi qu'aux éventuelles menaces à la stabilité financière de tout ou partie du système financier de l'Union. Selon les résultats de cet examen et l'incidence sur la stabilité financière, la Commission fait des propositions législatives conformément au premier alinéa et examine notamment la possibilité de supprimer le deuxième alinéa.
▌
Article 28
Prix d'émission et prix de rachat
1. Les parts ou actions des fonds monétaires , à l'exception des fonds VL à faible volatilité qui sont soumis à l'article 27, paragraphe 4, sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative par part ou par action de ces fonds.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les parts ou actions des fonds VLC pour petits investisseurs et pour fonds VLC liés à la dette publique, sont émises ou rachetées à un prix qui est égal à la valeur liquidative constante par part ou par action de ces fonds.
▌
Chapitre V bis
Exigences spécifiques applicables aux fonds VLC liés à la dette publique, aux fonds VLC pour petits investisseurs et aux fonds VL à faible volatilité
Article 34 bis
Exigences supplémentaires pour fonds VLC liés à la dette publique et fonds VLC pour petits investisseurs
Les fonds monétaires ne valorisent pas leurs actifs au coût amorti, ne fondent pas leur publicité sur une valeur liquidative constante par part ou par action, ni n'arrondissent la valeur liquidative constante par part ou par action au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la VL est exprimée dans une unité monétaire, à moins qu'ils n'aient été expressément agréés en tant que fonds VLC liés à la dette publique ou pour petits investisseurs ou qu'il s'agisse d'un fonds VL à faible volatilité soumis à l'article 27, paragraphe 4.
Article 34 ter
Frais de liquidité et mesures de verrouillage applicables aux fonds VLC liés à la dette publique, aux fonds VLC pour petits investisseurs et aux fonds VL à faible volatilité
1. Les gestionnaires de fonds VLC liés à la dette publique ou de fonds VLC pour petits investisseurs ou de fonds VL à faible volatilité établissent, mettent en œuvre et appliquent systématiquement des procédures d'évaluation interne prudentes, rigoureuses, systématiques et continues pour déterminer les seuils hebdomadaires de liquidités applicables aux fonds monétaires. La gestion des seuils de liquidité hebdomadaire implique l'application des procédures suivantes:
|
a) |
Lorsque la proportion d'actifs présentant une maturité à une semaine est inférieure à 30 % du nombre total d'actifs du fonds monétaire, le gestionnaire et le conseil d'administration de ce fonds se conforment aux dispositions suivantes:
|
|
b) |
Lorsque la proportion d'actifs présentant une maturité à une semaine est inférieure à 10 % du nombre total d'actifs du fonds monétaire, le gestionnaire et le conseil d'administration de ce fonds se conforment aux dispositions suivantes:
|
|
c) |
Une fois que le conseil d'administration du fonds a arrêté les mesures à prendre dans les situations (a) et (b) ci-dessus, il communique rapidement les modalités de sa décision à l'autorité compétente dont relève le fonds. |
Chapitre VI
Soutien extérieur
Article 35
Soutien extérieur
1. Les fonds monétaires ne reçoivent pas de soutien extérieur ▌.
▌
3. On entend par soutien extérieur un soutien direct ou indirect proposé par un tiers , y compris le sponsor du fonds, et ayant pour objet ou pour effet de garantir la liquidité du fonds monétaire ou de stabiliser la valeur liquidative par part ou par action.
Le soutien extérieur inclut:
|
a) |
les injections de capitaux par un tiers; |
|
b) |
l'achat par un tiers d'actifs du fonds monétaire à un prix majoré; |
|
c) |
l'achat par un tiers de parts ou d'actions du fonds monétaire en vue de lui fournir des liquidités; |
|
d) |
l'octroi par un tiers de toute forme de garantie implicite ou explicite, de caution ou de lettre de soutien au profit du fonds monétaire; |
|
e) |
toute action d'un tiers ayant pour objectif direct ou indirect de maintenir le profil de liquidité et la valeur liquidative par part ou par action du fonds monétaire. |
▌
Chapitre VII
Exigences de transparence
Article 37
Transparence
1. Les investisseurs d'un fonds monétaire reçoivent au moins une fois par semaine les informations suivantes:
|
a) |
le profil de liquidité du fonds monétaire, y compris le pourcentage cumulé des investissements arrivant à échéance le lendemain et dans la semaine et la manière dont cette liquidité sera assurée; |
|
b) |
le profil de solvabilité et la composition du portefeuille; |
|
c) |
la MMP et la DVMP du fonds monétaire; |
|
d) |
la concentration cumulative des cinq principaux investisseurs du fonds monétaire. |
2. Outre le respect des exigences du paragraphe 1, les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VL à faible volatilité mettent à la disposition de leurs investisseurs les informations suivantes:
|
a) |
la valeur totale de l'actif; |
|
b) |
la MMP et la DVMP; |
|
c) |
la ventilation par échéance; |
|
d) |
la proportion des actifs dans le portefeuille venant à échéance dans un jour; |
|
e) |
la proportion des actifs dans le portefeuille venant à échéance dans une semaine; |
|
f) |
le rendement net; |
|
g) |
la valeur indicative (VNA) quotidienne au prix du marché à quatre décimales; |
|
h) |
des précisions sur les actifs détenus dans le portefeuille de la MMF, tels que le nom, le pays, la maturité et le type d'actif (y compris les détails de la contrepartie en cas de conventions de revente); |
|
i) |
la VL telle que publiée sur leur site internet. |
3. Les fonds monétaires mettent régulièrement à disposition des informations sur le pourcentage de leur portefeuille total consistant:
|
a) |
en instruments du marché monétaire émis par leur sponsor; |
|
b) |
le cas échéant, en titrisations émises par leur sponsor; |
|
c) |
si le sponsor est un établissement de crédit, en dépôts bancaires auprès du sponsor du fonds monétaire; et |
|
d) |
en exposition du sponsor du fonds monétaire en tant que contrepartie aux opérations sur des instruments dérivés de gré à gré. |
4. Lorsque le sponsor d'un fonds monétaire investit dans les actions ou parts de ce fonds, ce dernier communique à ses autres investisseurs le montant total investi par le sponsor et leur notifie par la suite toute modification du nombre total d'actions ou de parts.
▌
Article 38
Comptes rendus aux autorités compétentes
1. Pour chaque fonds monétaire qu'il gère, le gestionnaire fait rapport à l'autorité compétente dont relève le fonds, au moins sur une base trimestrielle. Sur demande, le gestionnaire fournit également ces informations à l'autorité compétente dont il relève si celle-ci diffère de celle du fonds monétaire.
2. Les informations communiquées en application du paragraphe 1 incluent les points suivants:
|
a) |
le type et les caractéristiques du fonds monétaire; |
|
b) |
les indicateurs de portefeuille tels que la valeur totale des actifs, la valeur liquidative, la maturité moyenne pondérée, la durée de vie moyenne pondérée la ventilation par échéance, la liquidité et le rendement; |
▌
|
d) |
les résultats des simulations de crise; |
|
e) |
des informations sur les actifs détenus dans le portefeuille du fonds monétaire:
|
|
f) |
des informations sur les passifs du fonds monétaire, y compris les points suivants:
|
Si nécessaire, et dans les cas dûment justifiés, les autorités compétentes peuvent solliciter des informations supplémentaires.
3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution visant à établir un modèle de rapport contenant toutes les informations énoncées au paragraphe 2.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Les autorités compétentes communiquent à l'AEMF toutes les informations reçues en application du présent article ainsi que toute autre notification ou information échangée avec le fonds monétaire ou son gestionnaire en vertu du présent règlement. Ces informations sont transmises à l'AEMF au plus tard 30 jours après la fin du trimestre faisant l'objet du rapport.
L'AEMF recueille les informations nécessaires à la création d'une base de données centrale sur tous les fonds monétaires établis, gérés ou commercialisés dans l'Union. La Banque centrale européenne dispose d'un droit d'accès à cette base de données, à des fins statistiques seulement.
Chapitre VIII
Surveillance
Article 39
Surveillance par les autorités compétentes
1. Les autorités compétentes veillent en permanence au respect des dispositions du présent règlement. L'agrément accordé à un fonds monétaire est retiré en cas de violation de l'interdiction de soutien d'un sponsor.
2. L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire est chargée de garantir le respect des règles énoncées aux chapitres II à VII.
3. L'autorité compétente dont relève le fonds monétaire est chargée de veiller au respect des exigences mentionnées dans le règlement ou les documents constitutifs du fonds ainsi qu'au respect des exigences formulées dans le prospectus, qui sont cohérentes avec le présent règlement.
4. L'autorité compétente pour le gestionnaire du fonds monétaire est chargée de veiller à l'adéquation des modalités d'organisation dudit gestionnaire, afin qu'il soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les fonds monétaires qu'il gère.
5. Les autorités compétentes contrôlent les OPCVM ou FIA établis ou commercialisés sur leur territoire pour s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination de «fonds monétaire» ni ne laissent entendre qu'ils seraient de tels fonds, à moins qu'ils ne se conforment au présent règlement.
Article 40
Pouvoirs des autorités compétentes
1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions dans le cadre du présent règlement.
2. Les pouvoirs dévolus aux autorités compétentes en vertu des directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement.
Article 41
Pouvoirs et compétences de l'AEMF
1. L'AEMF dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice des tâches que lui confère le présent règlement.
2. Les pouvoirs dévolus à l'AEMF par les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE s'appliquent également au titre du présent règlement et conformément au règlement (CE) no 45/2001.
3. Aux fins du règlement (UE) no 1095/2010, le présent règlement est un «acte juridiquement contraignant de l'Union européenne conférant des tâches à l'Autorité», au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 42
Coopération entre autorités
1. Lorsqu'elles ne sont pas les mêmes, l'autorité compétente dont relève un fonds monétaire et l'autorité compétente pour son gestionnaire coopèrent et échangent des informations en vue de s'acquitter de leurs tâches au titre du présent règlement.
2. Les autorités compétentes , y compris les autorités désignées par un État membre au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (15) sur les établissements de crédit dans l'État membre d'origine du fonds monétaire, le MSU et la BCE, et l'AEMF coopèrent en vue de s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
3. Les autorités compétentes , notamment les autorités désignées par un État membre au titre du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE sur les établissements de crédit dans l'État membre d'origine du fonds monétaire, le MSU et la BCE, et l'AEMF échangent toutes les informations et les documents nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, et en particulier afin de détecter les infractions au présent règlement et d'y remédier.
Chapitre IX
Dispositions finales
Article 43
Traitement des OPCVM et FIA existants
1. Dans les neuf mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les OPCVM ou FIA existants qui investissent dans des actifs à court terme et ont pour objectifs distincts ou cumulés d'offrir des rendements comparables à ceux du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement soumettent une demande à leur autorité compétente, accompagnée de tous les documents et justificatifs nécessaires pour prouver qu'ils respectent le présent règlement.
▌
Article 44
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 13 et 19 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée aux articles 13 et 19 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 et 19 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 45
Réexamen
Au plus tard [trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement], la Commission réexamine si le présent règlement est approprié d'un point de vue à la fois prudentiel et économique. Ce réexamen détermine en particulier si des changements devraient être apportés au régime concernant les fonds VLC liés à la dette publique, les fonds VLC pour petits investisseurs et les fonds VLFV. De surcroît, dans le cadre de ce réexamen, la Commission:
|
a) |
analyse l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, ainsi que l'impact sur les investisseurs, les fonds monétaires et les gestionnaires de fonds monétaires dans l'Union; |
|
b) |
évalue le rôle que jouent les fonds monétaires dans l'achat des titres de créance émis ou garantis par les États membres; |
|
c) |
tient compte des caractéristiques propres des titres de créance émis ou garantis par les États membres et de la place que tiennent ces instruments dans le financement des États membres; |
|
d) |
tient compte du rapport mentionné à l'article 509, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; |
|
e) |
tient compte de l'évolution du cadre réglementaire au niveau international. |
Les résultats du réexamen sont communiqués au Parlement européen et au Conseil, accompagnés le cas échéant des propositions de modification appropriées.
Article 46
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à, le
Par le Parlement européen
Le président
Par le Conseil
Le président
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0041/2015).
(*) Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.
(2) JO C 170 du 5.6.2014, p. 50.
(3) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(4) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(6) Règlement délégué no… de la Commission complétant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.
(7) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) no 1060/2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 146 du 31.5.2013, p. 1).
(9) Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive 2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit (JO L 145 du 31.5.2013, p. 1).
(10) Règlement délégué (UE) no 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance (JO L 83 du 22.3.2013, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(12) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(13) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(14) Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés ( JO L 193 du 18.7.1983, p. 1).
(15) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/186 |
P8_TA(2015)0171
Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des régimes d'importation spécifiques de l'Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2015 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte) (COM(2014)0345 — C8-0023/2014 — 2014/0177(COD))
(Procédure législative ordinaire — refonte)
(2016/C 346/39)
Le Parlement européen,
|
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2014)0345), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8–0023/2014), |
|
— |
vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 décembre 2014 (1), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2), |
|
— |
vu la lettre en date du 13 novembre 2014 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission du commerce international conformément à l'article 104, paragraphe 3, de son règlement, |
|
— |
vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 février 2015, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
|
— |
vu les articles 104 et 59 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission du commerce international (A8-0016/2015), |
|
A. |
considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance; |
|
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
|
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; |
|
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. |
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.
P8_TC1-COD(2014)0177
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 29 avril 2015 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2015/… du Parlement européen et du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union (refonte)
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2015/936.)
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/188 |
P8_TA(2015)0172
État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l'exercice 2016 — section I — Parlement
Résolution du Parlement européen du 29 avril 2015 sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l'exercice 2016 (2015/2012(BUD))
(2016/C 346/40)
Le Parlement européen,
|
— |
vu l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
|
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), et notamment son article 36, |
|
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (2), |
|
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), et notamment son article 27, |
|
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (4), |
|
— |
vu ses résolutions du 23 octobre 2013 (5) et du 22 octobre 2014 (6) relatives à la position du Conseil sur le projet de budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014 et pour l'exercice 2015, respectivement, |
|
— |
vu le rapport du Secrétaire général au Bureau en vue de l'établissement de l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour l'exercice 2016, |
|
— |
vu l'avant-projet d'état prévisionnel établi par le Bureau le 27 avril 2015, |
|
— |
vu le projet d'état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l'article 96, paragraphe 2, du règlement du Parlement, |
|
— |
vu les articles 96 et 97 de son règlement, |
|
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A8-0144/2015), |
|
A. |
considérant qu'il s'agit de la première procédure budgétaire complète menée au cours de la nouvelle législature et de la troisième procédure du cadre financier pluriannuel 2014-2020; |
|
B. |
considérant que lors de sa réunion du 9 février 2015, le Bureau a entériné les orientations pour le budget 2016 telles que proposées par le Secrétaire général; considérant que ces orientations sont axées sur le renforcement de la capacité des commissions parlementaires à contrôler l'exécutif, notamment pour ce qui est des actes délégués, sur les investissements dans la sécurité des bâtiments du Parlement et la cybersécurité et sur le soutien aux députés, notamment au niveau de l'assistance parlementaire; |
|
C. |
considérant qu'un budget de 1 850 470 600 EUR a été proposé par le Secrétaire général pour l'avant-projet d'état prévisionnel du Parlement pour 2016, ce qui représente une hausse de 3,09 % par rapport au budget 2015 et 19,51 % de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel 2014-2020; |
|
D. |
considérant que, dans le contexte de la charge élevée que représentent actuellement la dette publique et l'assainissement budgétaire pour les États membres, le Parlement doit faire preuve de responsabilité budgétaire et de modération tout en veillant à disposer de moyens suffisants pour exercer pleinement ses prérogatives et pour assurer le bon fonctionnement de l'institution; |
|
E. |
considérant qu'en dépit d'une marge de manœuvre limitée et de la nécessité de compenser les économies réalisées dans d'autres domaines, certains investissements devraient être envisagés afin de renforcer le rôle institutionnel du Parlement; |
|
F. |
considérant que le plafond de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel pour le budget 2016 est de 9 483 millions d'euros aux prix courants; |
|
G. |
considérant que des réunions de conciliation ont eu lieu le 24 mars et les 14 et 15 avril 2015 entre les délégations du Bureau et de la commission des budgets; |
Cadre général et budget global
|
1. |
salue le bon esprit de coopération qui s'est instauré entre le Bureau du Parlement européen et la commission des budgets pendant la procédure budgétaire actuelle ainsi que l'accord conclu pendant la procédure de conciliation; |
|
2. |
prend acte des objectifs prioritaires proposés par le Secrétaire général pour 2016; |
|
3. |
rappelle que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, des dépenses supplémentaires importantes se sont ajoutées au budget du Parlement en raison des évolutions suivantes: la fonction de colégislateur véritable acquise par le Parlement européen et l'extension de la politique immobilière (2010-2012), l'adhésion de la Croatie, la Maison de l'histoire européenne (2013) et la création d'un service de recherche parlementaire (2014-2015); se félicite du fait que le Parlement soit parvenu à compenser une grande partie de ces dépenses par des économies réalisées grâce à des réformes structurelles et organisationnelles, ce qui a permis de limiter les augmentations budgétaires à un niveau modéré, proche du taux d'inflation; |
|
4. |
note que, au cours de la législature écoulée, le Parlement avait fixé une série de priorités politiques qui ont donné lieu à des augmentations budgétaires modérées ou à des économies budgétaires; estime que le nouveau Parlement élu devrait examiner en profondeur la réalisation de ces projets pluriannuels et, sur cette base, fixer ses propres priorités politiques, y compris, le cas échéant, des priorités négatives; demande à cet égard au Secrétaire général de présenter, en temps utile, un rapport d'évaluation sur ces projets pluriannuels avant la lecture du Parlement à l'automne 2015; |
|
5. |
estime que la priorité de 2016 devrait être accordée au renforcement des travaux parlementaires, notamment en élargissant les travaux législatifs du Parlement et en renforçant ses moyens de contrôle de l'exécutif, ainsi qu'au renforcement de la sécurité des bâtiments du Parlement et de la cybersécurité; |
|
6. |
estime que le Parlement devrait montrer l'exemple et faire un effort particulier en ce qui concerne le volume de son budget et le taux d'augmentation des dépenses par rapport à 2015; souligne que le budget pour 2016 devrait s'appuyer sur des bases réalistes et respecter les principes de discipline budgétaire et de bonne gestion financière; |
|
7. |
estime que les réformes structurelles et organisationnelles destinées à améliorer l'efficacité, la viabilité environnementale et l'efficience devraient se poursuivre par l'examen approfondi de toutes les synergies et de toutes les économies possibles; rappelle que des économies considérables pourraient être réalisées si le Parlement disposait d'un seul lieu de travail au lieu de trois (Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg); souligne que cet examen devrait avoir lieu sans nuire à l'excellence législative du Parlement, à ses compétences budgétaires, à ses compétences de contrôle ou à la qualité des conditions de travail des députés, des assistants et du personnel; |
|
8. |
souligne qu'il convient de veiller à la mise à disposition de moyens suffisants pour permettre aux députés d'exercer leur mandat et au Parlement d'exercer l'ensemble de ses compétences; souligne que les dépenses statutaires et obligatoires nécessaires pour 2016 doivent être prises en compte; |
|
9. |
se félicite du fait que la part du budget du Parlement dans le total de la rubrique 5 du cadre financier pluriannuel ait été inférieure à 20 % au cours de la législature écoulée, à l'exception de 2011 et de 2014; estime que la part du budget du Parlement devrait aussi être maintenue sous les 20 % en 2016; |
|
10. |
est d'avis que l'augmentation totale des dépenses du budget du Parlement pour 2016 par rapport à 2015 devrait être déterminée par les deux éléments suivants:
souligne que, pour ce faire, des économies doivent être réalisées dans d'autres domaines; |
|
11. |
salue l'accord sur les économies à réaliser conclu entre les délégations de la commission des budgets et du Bureau lors des réunions de conciliation des 14 et 15 avril 2015 par rapport au montant initialement proposé par le Bureau dans l'avant-projet d'état prévisionnel; |
|
12. |
fixe le niveau de ses dépenses courantes de fonctionnement pour l'exercice 2016 à 1 823 648 600 EUR, soit une hausse de 1,6 % par rapport au budget 2015, et ajoute à son projet d'état prévisionnel la dépense extraordinaire ponctuelle de 15 millions d'euros nécessaire en 2016 pour renforcer la sécurité de ses bâtiments à Bruxelles ainsi que la cybersécurité du Parlement; |
|
13. |
saisit l'occasion offerte par cette première procédure de conciliation à part entière sur le budget du Parlement dans le cadre de la huitième législature pour demander au Secrétaire général et au Bureau de présenter une programmation budgétaire à moyen terme et à long terme, ainsi que les documents relatifs à la procédure aux fins de l'établissement du budget 2017; demande au Secrétaire général de distinguer clairement les dépenses liées aux investissements (immobilier, achats, etc.) et les dépenses relatives au fonctionnement du Parlement et à ses obligations statutaires; |
|
14. |
rappelle que le Parlement, dans le cadre de la procédure budgétaire, a la possibilité d'adapter les priorités budgétaires et adoptera une décision définitive à l'automne 2015; |
Questions spécifiques
Priorité aux travaux parlementaires
|
15. |
souligne que, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a fait du Parlement un véritable colégislateur et compte tenu du fait que l'une des principales missions du Parlement est de contrôler l'exécutif, il est désormais absolument essentiel de mettre l'accent sur l'action législative et de contrôle de la part des députés; |
|
16. |
estime que, pour consolider le rôle du Parlement, la capacité administrative des secrétariats des commissions parlementaires spécialisées devrait, si ce n'est pas déjà le cas, être renforcée en conséquence, par voie de redéploiement; |
|
17. |
estime que pour apporter le soutien nécessaire aux députés dans l'exercice de leurs activités parlementaires, un nouvel équilibre entre assistants parlementaires accrédités et assistants locaux est requis; demande au Secrétaire général de présenter au Bureau dans les meilleurs délais une proposition de décision à cet effet; estime qu'une période de transition doit être respectée en cas de révision des règles en vigueur et escompte l'entrée en vigueur de la décision définitive en juillet 2016 au plus tard; |
|
18. |
souligne la nécessité d'une transparence accrue en ce qui concerne l'indemnité de frais généraux des députés; invite le Bureau du Parlement à définir des règles plus précises en matière de responsabilité pour les dépenses autorisées au titre de cette indemnité, sans que cela engendre des coûts supplémentaires pour le Parlement; |
|
19. |
rappelle qu'en vertu de l'article 130 du règlement, la Conférence des présidents doit procéder, pour juillet 2015 au plus tard, à l'évaluation du régime des questions écrites en ce qui concerne les questions supplémentaires; souligne que l'accent mis sur les statistiques en matière de travaux parlementaires ne devrait pas compromettre le véritable travail législatif des députés; demande donc une révision de ce régime et invite l'autorité compétente:
|
|
20. |
souligne que la révision des dispositions du règlement du Parlement relatives aux questions avec demande de réponse écrite (article 130) permettrait de réaliser des économies et de réduire la charge administrative des institutions de l'Union sans nuire aux pouvoirs législatifs du Parlement européen; escompte l'entrée en vigueur des nouvelles règles dès janvier 2016; |
|
21. |
estime que le renouvellement du mobilier dans les espaces de travail des députés et du personnel ne constitue pas une priorité pour le budget 2016; |
Sécurité
|
22. |
souligne que, dans le contexte actuel, la priorité absolue devrait être accordée à la sécurité des bâtiments du Parlement; souligne que le Parlement devra prendre les nouvelles mesures indispensables au renforcement de la sécurité dans ses locaux et à l'extérieur, tout en restant un «espace ouvert» pour les citoyens européens, ainsi qu'au renforcement de la cybersécurité; |
|
23. |
demande au Secrétaire général, à cet égard, de présenter à la commission des budgets une évaluation globale des mesures de sécurité adoptées à ce jour par le Parlement ainsi que les conséquences budgétaires de ces mesures depuis la décision d'internaliser les services de sécurité du Parlement (décision du Bureau de juin 2012), et d'exposer les mesures envisagées pour renforcer la sécurité du Parlement dans ses locaux et à l'extérieur ainsi que l'incidence de ces mesures sur le budget 2016; demande des informations sur les conséquences financières de l'accord de coopération administrative interinstitutionnelle dans le domaine de la sécurité; |
Cybersécurité
|
24. |
est d'avis qu'en raison de la généralisation de l'utilisation des médias et du matériel électroniques, une attention particulière devrait être accordée à la sécurité informatique pour garantir le niveau maximum possible de sécurité de ses systèmes d'information et de communication; estime qu'en la matière, toute mesure devrait être fondée sur une évaluation précise des besoins du Parlement et adoptée dans le cadre de la procédure budgétaire; |
Politique immobilière
|
25. |
rappelle que la stratégie immobilière à moyen terme, adoptée par le Bureau en 2010, est en cours de révision; invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme dans les meilleurs délais et au plus tard en août 2015, avant la lecture du budget par le Parlement à l'automne 2015; |
|
26. |
rappelle que les investissements à long terme, tels que les projets immobiliers du Parlement, doivent être envisagés avec précaution et de manière transparente; insiste sur la rigueur dans la gestion des coûts ainsi que dans la planification et le suivi des projets; demande une nouvelle fois la transparence des décisions dans le domaine de la politique immobilière, sur la base d'une information rapide, compte tenu de l'article 203 du règlement financier; |
|
27. |
invite les vice-présidents compétents à présenter à la commission compétente la nouvelle stratégie immobilière à moyen terme ainsi qu'un rapport sur l'état d'avancement du bâtiment KAD reprenant les options de financement; décidera, sur cette base, lors de la lecture du budget, de l'inscription du financement du bâtiment KAD au budget du Parlement pour 2016 en tenant compte d'éventuelles économies sur les taux d'intérêt; |
|
28. |
rappelle que, grâce à la construction du bâtiment KAD, le montant total annuel des paiements sera, à terme, nettement inférieur aux frais de location d'un immeuble comparable; |
Communication
|
29. |
demande au Secrétaire général de présenter à la commission des budgets une évaluation de la campagne électorale parlementaire de 2014 et de l'efficacité des mesures de communication du Parlement à l'intention du public; |
|
30. |
est fermement convaincu que le mandat des députés porte avant tout sur les travaux législatifs; estime par conséquent que, dans cette optique, il faudrait donner la priorité à la communication à l'intention du public et des autres acteurs par la remise à niveau de l'équipement technique et des installations à l'intention des médias étant donné l'intérêt croissant que ceux-ci portent au Parlement, le rôle de plus en plus important des médias sociaux et les besoins supplémentaires des députés lors des séances plénières ordinaires; |
|
31. |
invite le Bureau à procéder à une évaluation indépendante de la première rencontre de la jeunesse européenne (EYE) avant d'organiser une seconde édition; |
Empreinte environnementale du Parlement
|
32. |
répète qu'il incombe au Parlement d'agir dans le sens de la durabilité; se félicite des efforts déployés pour renoncer au papier et du travail remarquable réalisé en ce moment grâce à la stratégie EMAS; estime qu'EMAS a besoin d'une aide budgétaire soutenue; |
|
33. |
demande une évaluation des résultats de l'approche volontaire en ce qui concerne les voyages en classe affaires pour les vols de courte distance; |
Maison de l'histoire européenne
|
34. |
relève que la Maison de l'histoire européenne devrait ouvrir ses portes en 2016; invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets, dans les meilleurs délais et avant la lecture du Parlement à l'automne 2015, une mise à jour de la programmation budgétaire couvrant les cinq prochaines années pour les dépenses opérationnelles et de fonctionnement prévues en ce qui concerne la Maison de l'histoire européenne dès son ouverture, contribution de la Commission comprise; rappelle qu'au sein du budget 2014, une nouvelle ligne budgétaire 16 03 04, intitulée «Maison de l'histoire européenne» et consacrée à la contribution de la Commission aux frais de fonctionnement de la Maison de l'histoire européenne, a été inscrite à la section III du budget de l'Union; |
Mesures relatives au personnel
|
35. |
souligne que la réalisation de l'objectif de réduction de 5 % du personnel, décidée dans le cadre de l'accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, devrait se poursuivre en 2016; salue la confirmation de la non-application de la réduction du personnel aux groupes politiques, comme le demandent les résolutions susmentionnées du Parlement sur le budget 2014 et le budget 2015; |
|
36. |
note qu'il est proposé de supprimer 57 postes du tableau des effectifs du Secrétariat du Parlement en 2016, ce qui devrait permettre une économie de 1,8 million d'euros, sachant que certains de ces postes sont actuellement vacants et que les titulaires du reste des postes prendront leur retraite ou seront réaffectés dans le courant de l'année; note qu'il est proposé de supprimer deux autres postes du tableau des effectifs du Parlement et de les transférer à la Commission dans le cadre de deux projets informatiques interinstitutionnels gérés par la Commission, et que deux postes supplémentaires seront donc créés au tableau des effectifs de la Commission pour 2016; |
|
37. |
approuve la proposition du Secrétaire général de créer 25 postes supplémentaires pour renforcer la DG SAFE afin d'améliorer l'efficacité des systèmes de sécurité dans les locaux du Parlement et à l'extérieur et la sécurité incendie des bâtiments ainsi que d'assurer la protection suffisante des députés, du personnel et des invités de marque dans les locaux du Parlement; demande le coût précis de ces postes; estime toutefois que la sécurité en dehors des bâtiments du Parlement devrait être assurée par les autorités belges; |
|
38. |
salue la proposition de renforcement des secrétariats des commissions parlementaires pour permettre aux députés de bénéficier du soutien nécessaire pour faire face aux tâches de contrôle, en particulier dans les commissions parlementaires où le nombre d'actes d'exécution et d'actes délégués, actuels ou à venir, est le plus élevé; souligne que tout renforcement devrait être réalisé par voie de redéploiement; |
|
39. |
note que, à cet effet, le Secrétaire général propose la création de 20 postes supplémentaires pour renforcer les secrétariats des commissions parlementaires concernées (ECON, ENVI, ITRE, TRAN et LIBE); |
|
40. |
invite le Secrétaire général à présenter à la commission des budgets une analyse complète de l'évolution des postes au Parlement et de la façon dont l'objectif de réduction de 5 % des effectifs a été abordé jusqu'ici ainsi que de la manière dont cette réduction sera menée à bien dans les délais et du nombre référence de postes de l'organigramme visé par cet objectif; |
Conclusions
|
41. |
arrête l'état prévisionnel pour l'exercice 2016; |
|
42. |
charge son Président de transmettre la présente résolution et l'état prévisionnel au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(4) JO L 287 du 29.10.2013, p. 15.
(5) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0437.
(6) Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0036.
Jeudi 30 avril 2015
|
21.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/194 |
P8_TA(2015)0177
Suspension des mesures commerciales exceptionnelles en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 30 avril 2015,à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne et suspendant l'application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine (COM(2014)0386 — C8-0039/2014 — 2014/0197(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2016/C 346/41)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Article premier — point — 1 (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Considérant 14 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
-1) Le considérant suivant est inséré: |
||
|
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Article premier — point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Article 2 — paragraphe 3
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
|
1 bis) À l'article 2, le paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: |
|
3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas les paragraphes 1 ou 2 , la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4. |
«3. Si un pays ou un territoire ne respecte pas les point a) ou b) du paragraphe 1 , la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, partiellement ou totalement, les bénéfices octroyés par le présent règlement aux pays ou territoires concernés. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.» |
Amendement 8
Proposition de règlement
Article premier — point 1 ter (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Article 7 — point c (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
1 ter) À l'article 7, le point suivant est ajouté: |
||
|
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Article premier — point 1 quater (nouveau)
Règlement (CE) no 1215/2009
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
|
Texte en vigueur |
Amendement |
|
|
1 quater) À l'article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: |
|
1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement: |
«1. Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers la Communauté au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions des points a) et b) de l'article 2, paragraphe 1, par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre en tout ou en partie les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:» |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 61, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A8-0060/2015).
(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(2) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.