ISSN 1977-0936
Journal officiel
de l'Union européenne
C 486
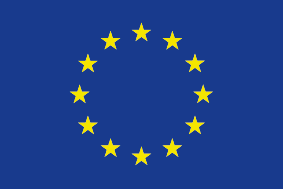
Édition de langue française
Communications et informations
65e année
21 décembre 2022
|
ISSN 1977-0936 |
||
|
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486 |
|
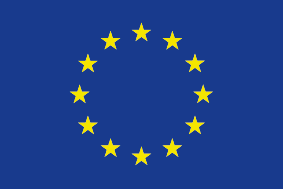
|
||
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
|
Sommaire |
page |
|
|
|
I Résolutions, recommandations et avis |
|
|
|
AVIS |
|
|
|
Comité économique et social européen |
|
|
|
572e session plénière du Comité économique et social européen, 21.9.2022-22.9.2022 |
|
|
2022/C 486/01 |
||
|
2022/C 486/02 |
||
|
2022/C 486/03 |
||
|
2022/C 486/04 |
||
|
2022/C 486/05 |
||
|
2022/C 486/06 |
||
|
2022/C 486/07 |
||
|
2022/C 486/08 |
||
|
2022/C 486/09 |
||
|
2022/C 486/10 |
||
|
2022/C 486/11 |
||
|
2022/C 486/12 |
||
|
2022/C 486/13 |
||
|
2022/C 486/14 |
||
|
2022/C 486/15 |
|
|
III Actes préparatoires |
|
|
|
Comité économique et social européen |
|
|
|
572e session plénière du Comité économique et social européen, 21.9.2022-22.9.2022 |
|
|
2022/C 486/16 |
||
|
2022/C 486/17 |
||
|
2022/C 486/18 |
||
|
2022/C 486/19 |
||
|
2022/C 486/20 |
||
|
2022/C 486/21 |
||
|
2022/C 486/22 |
||
|
2022/C 486/23 |
||
|
2022/C 486/24 |
||
|
2022/C 486/25 |
||
|
2022/C 486/26 |
||
|
2022/C 486/27 |
|
FR |
|
I Résolutions, recommandations et avis
AVIS
Comité économique et social européen
572e session plénière du Comité économique et social européen, 21.9.2022-22.9.2022
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/1 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Les PME, les entreprises de l’économie sociale, l’artisanat et les professions libérales face au paquet “Ajustement à l’objectif 55”»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/01)
|
Rapporteure: |
Milena ANGELOVA |
|
Corapporteur: |
Rudolf KOLBE |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Marché unique, production et consommation |
|
Adoption en section |
27.6.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
143/1/0 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Les micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées «MPME»), qu’il s’agisse d’entreprises traditionnelles, d’entreprises familiales, de commerçants, d’entreprises de l’économie sociale, d’artisanat ou de professions libérales, constituent une composante essentielle de la solution pour avancer vers une économie européenne compétitive, neutre pour le climat, circulaire et inclusive, pour autant que les conditions propices soient créées et qu’elles puissent prévaloir. Les MPME exercent une influence positive lorsqu’elles améliorent leurs propres performances environnementales ou fournissent une expertise et des solutions à d’autres entreprises, à la population et au secteur public. Tout en reconnaissant et en soulignant la diversité des MPME et les différences quant à leurs besoins, le CESE préconise qu’une attention particulière soit accordée aux plus petites et aux plus vulnérables d’entre elles. |
|
1.2. |
De nombreuses MPME sont insuffisamment informées des obligations législatives — qui changent en permanence — introduites pour atteindre la neutralité climatique, ainsi que de la manière de s’y conformer. Par ailleurs, elles peinent à discerner les avantages commerciaux potentiels et les possibilités qu’offre la transition écologique. Le CESE souligne dès lors qu’il est urgent d’aider les MPME à comprendre et à gérer au mieux la transition écologique. |
|
1.3. |
Le CESE plaide en faveur de mesures d’information et de sensibilisation tout à la fois de grande ampleur et ciblées, mises en œuvre d’une manière coordonnée et soucieuse des complémentarités par la Commission européenne et les États membres, ainsi que par les organisations et chambres professionnelles, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées. |
|
1.4. |
Le CESE plaide également pour un programme global de soutien aux MPME quels que soient les problèmes auxquels elles sont confrontées dans leurs activités commerciales et dans l’action qu’elles mènent en faveur de la mutation écologique et en vue de respecter la législation. En raison des différences considérables qui existent entre les MPME, des solutions très personnalisées ainsi que des politiques et mesures bien ciblées sont nécessaires. |
|
1.5. |
Un soutien à court terme, immédiat et ciblé, visant les MPME s’impose pour stimuler leur reprise économique après la pandémie, ainsi que pour les aider à gérer les conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine, telles que des prix élevés de l’énergie et des situations de pénurie dans l’approvisionnement en matériaux et en produits. Au vu des circonstances extraordinaires, le CESE estime qu’il faut prévoir jusqu’à la fin de la crise assez de flexibilité dans les calendriers du pacte vert pour l’Europe, tout en veillant à ce que les objectifs ne soient pas, pour une raison ou une autre, abandonnés. |
|
1.6. |
Pour améliorer l’utilisation efficace de leurs ressources par les MPME, le CESE propose de créer dans différentes régions des «pôles de circularité». Cette initiative devrait renforcer la coopération entre les entreprises dans tous les secteurs et faciliter le développement de nouvelles pratiques et de nouveaux processus, y compris la démonstration de nouvelles technologies. Il conviendrait que les organisations de MPME, les chambres de commerce, l’université, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées fassent partie intégrante du processus. |
|
1.7. |
Le CESE juge important d’associer les représentants des MPME à l’élaboration de feuilles de route sectorielles en matière d’action pour le climat au niveau national, ainsi qu’à la définition des trajectoires de transition au niveau de l’Union pour les différents écosystèmes d’entreprises, ce qui permettra dans le même temps de s’intéresser de plus près au partage des bonnes pratiques et d’assurer une répartition adéquate des ressources ainsi qu’une mise en œuvre efficace. |
|
1.8. |
Le CESE invite l’Union européenne et les États membres à accélérer les investissements verts des MPME en garantissant un environnement réglementaire propice, prévisible et encourageant, ce qui suppose de mettre en place des procédures d’autorisation bien huilées tout en évitant les tâches administratives trop lourdes, et aussi d’offrir un accès rapide, facile, simple et traçable au financement, adapté aux différents besoins de toutes les catégories de MPME, dans toute leur diversité. |
|
1.9. |
Le CESE plaide pour une coopération étroite entre les prestataires de services éducatifs et les MPME pour concevoir des formations permettant de répondre aux compétences et aptitudes requises dans le cadre de la transition écologique, y compris par le perfectionnement et la reconversion professionnels, aussi bien des salariés que des entrepreneurs. En outre, le CESE appelle à appuyer les activités d’innovation en faveur des MPME en encourageant et en facilitant la coopération avec d’autres entreprises, leurs organisations, les chambres de commerce, les universités et les organismes de recherche. |
|
1.10. |
Le CESE demande instamment de valoriser le commerce des solutions vertes produites par les MPME, y compris dans le cadre de marchés publics, en offrant aux MPME des conditions de concurrence équitables au sein du marché unique, et en facilitant leur accès aux marchés étrangers de produits, technologies et services écologiques. Il convient d’assurer aux entreprises de l’Union un environnement des affaires concurrentiel par rapport aux pays tiers, en déployant tous les moyens de la diplomatie, y compris dans les domaines du climat, des ressources et de la politique commerciale, tout en accordant une attention particulière aux évolutions de la Chine et d’autres marchés émergents. |
2. La transition écologique et les MPME
|
2.1. |
Les MPME contribuent à une économie durable et créatrice d’emplois. Elles permettent à nos sociétés de rester soudées, en combinant souvent des fonctions économiques et sociales, et ce faisant, confortent les bases de la démocratie, de l’unité et de l’inclusivité. Enracinées dans les territoires, en tout lieu de l’Union européenne, en particulier dans des zones rurales et reculées où elles représentent souvent le seul facteur de création d’activités économiques, elles sont essentielles à la relance économique et sociale et à la prospérité. |
|
2.2. |
Le changement climatique est le moteur de la transition énergétique durable, mais plus encore, il pousse l’ensemble de l’économie et de la société vers la neutralité climatique, la circularité et la durabilité globale. Il est à l’origine de phénomènes météorologiques extrêmes et de catastrophes naturelles, et se trouve corrélé à d’autres problèmes environnementaux majeurs telles que la perte de biodiversité, la pollution de l’environnement ou encore la dégradation des ressources naturelles. |
|
2.3. |
Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» met spécifiquement l’accent sur l’atténuation du changement climatique, et comprend de nombreux actes législatifs qui affectent de différentes manières les MPME. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative phare de l’Union, le pacte vert pour l’Europe, qui porte sur la croissance durable liée à l’industrie, au commerce, aux services et à l’énergie, aux transports, au bâtiment ou encore aux systèmes alimentaires. Les MPME jouent un rôle essentiel dans tous ces secteurs. |
|
2.4. |
Les MPME représentent une composante essentielle de la solution dans la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, pour autant que des conditions propices soient créées et qu’elles puissent prévaloir. Cet effet positif est produit, d’une part, par l’amélioration des performances des MPME dans leur grande variété et, d’autre part, par les actions desdites MPME, qui fournissent une expertise et des solutions à d’autres entreprises, aux particuliers et au secteur public. |
|
2.5. |
La transition écologique est étroitement liée à la transformation numérique, et les MPME doivent par conséquent gérer chacun des pans de cette double transition, soit deux immenses défis qui exercent une pression très forte sur les ressources. La numérisation apparaît comme un moyen de rendre les activités des entreprises plus efficaces, contribuant à leur expansion vers de nouveaux marchés et à leur internationalisation. Elle recèle un potentiel considérable de réduction des émissions, des déchets et de l’utilisation des ressources naturelles. En revanche, les services et équipements numériques ont aussi des incidences sur l’environnement qui doivent être gérées simultanément. |
|
2.6. |
Outre les efforts qu’elles déploient pour les transitions écologique et numérique, les MPME se heurtent à des difficultés pour se redresser économiquement après la pandémie ainsi que pour faire face aux conséquences de l’invasion russe de l’Ukraine. Les prix élevés de l’énergie et le manque d’approvisionnement en matériaux et produits figurent aux premiers rangs des problèmes récents ayant des répercussions massives sur les MPME et leurs activités. Leur compétitivité, au même titre que la compétitivité globale de l’économie de l’Union, sont plus encore mises en péril par les retournements soudains de la Chine et d’autres marchés émergents, qui tirent également profit de leur refus d’appliquer les sanctions visant la Russie et de leur interprétation moins stricte des exigences climatiques et environnementales. |
|
2.7. |
Les questions liées au climat et à l’environnement ne se limitent pas aux seuls aspects de durabilité environnementale, mais elles constituent aussi, dans une large mesure, un élément essentiel de la compétitivité, de la rentabilité et de la performance économique globale des entreprises. Les MPME s’appuient certes sur leurs propres valeurs et sur la conscience générale qu’elles peuvent avoir du problème, mais elles répondent aussi, par le truchement de divers mécanismes, aux exigences et aux attentes en matière de climat et d’environnement.
|
|
2.8. |
Les MPME sont nombreuses à ne pas être pleinement conscientes des incidences de certaines politiques et exigences en matière de climat et d’environnement sur leurs activités et leurs chaînes d’approvisionnement ou de valeur, ni de la façon dont elles doivent adapter ou convertir des produits et services suffisamment en amont pour éviter des pertes ultérieures, voire une exclusion du marché. Elles sont de surcroît confrontées à des ressources humaines et financières limitées pour leurs opérations quotidiennes et le développement de leurs activités, et un risque demeure que leur taille limitée présuppose ou requière une palette trop large de compétences. Une part non négligeable d’entreprises sont aux prises avec des problèmes découlant de la complexité des textes législatifs en constante évolution, de la charge administrative, des règles financières et des coûts élevés, du défaut d’expertise spécifique en matière d’environnement, des difficultés à choisir les actions appropriées (1), qui s’ajoutent à un accès malaisé à de nouvelles chaînes de valeur, au financement, au recrutement ainsi qu’à de nouveaux modèles d’entreprise. |
|
2.9. |
Si le défaut de préparation aux exigences et aux moyens d’y répondre apparaît comme un défi important à relever, il en va de même des difficultés à repérer les atouts et possibilités potentiels pour les entreprises, tels que la réduction des coûts de l’énergie et des matériaux, l’amélioration de l’accès au financement, la montée en puissance de la demande et de nouveaux marchés, ainsi que les progrès en termes d’image auprès des parties prenantes. |
|
2.10. |
Les MPME qui ont une proposition de valeur commerciale en matière d’économie circulaire, de climat, de biodiversité, d’énergies renouvelables et d’autres thèmes du pacte vert pour l’Europe sont par nature incitées à explorer, à investir et à exploiter de nouveaux débouchés commerciaux dans ces domaines. Les possibilités qui s’offrent à elles sont multiples, par exemple dans la rénovation des bâtiments, la planification et la construction d’infrastructures, la production industrielle et la maintenance des équipements, la fourniture de services juridiques et comptables ou encore le développement de solutions numériques. Le processus de transition dépend, dans une large mesure, des solutions intelligentes qu’elles apportent, conçues par les experts qu’elles emploient, ce qui souligne l’importance d’une éducation de qualité et pertinente, de l’enseignement et de la formation professionnels ou encore d’une mise à niveau constante des compétences. |
|
2.11. |
Le groupe le plus vulnérable des MPME, qui est aussi celui qui a le plus besoin d’informations, est, par ailleurs, celui qui ne voit dans le pacte vert pour l’Europe qu’un texte de loi supplémentaire venant alourdir encore l’accumulation de charges administratives, mettant leurs modèles économiques actuels sous pression et limitant la rentabilité dans un scénario de maintien du statu quo. Ce constat met bel et bien en lumière le fait que toutes les catégories de MPME, qu’elles soient vulnérables ou à la traîne, en position de «suiveur» ou de «leader», ont besoin d’un soutien différent et conçu pour s’adresser spécifiquement à elles (2). |
|
2.12. |
Qui plus est, les MPME affichent entre elles de nombreuses différences, sur le plan de leurs capacités et de leur préparation, pour ce qui est de la nature et de la portée des questions climatiques et environnementales, des exigences et des attentes dont elles sont la cible, ainsi que des possibilités qui s’offrent à elles. l’intensité en ressources naturelles de l’entreprise, la taille de cette dernière, sa position dans les chaînes d’approvisionnement et les écosystèmes commerciaux, sa localisation, les différents types de clients, les sources de facteurs de production et les marchés géographiques de l’entreprise. |
|
2.13. |
Ces divers aspects appellent des solutions très personnalisées et des politiques et mesures parfaitement ciblées, qui tiennent compte des différences entre, par exemple, les moyennes entreprises du secteur manufacturier, les sociétés actives dans les domaines de l’hôtellerie et du commerce de détail, les entreprises familiales et traditionnelles, les «start-up» innovantes, les entreprises de l’économie sociale, l’artisanat ou les professions libérales. |
|
2.14. |
Malgré les nombreuses différences observables entre les MPME, la bonne gestion de la transition écologique dans chaque entreprise passe d’abord par une prise de conscience et une connaissance adéquates des problématiques et des évolutions actuelles, ce qui permet de repérer les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques pour l’entreprise, et de définir la manière dont elle souhaite se positionner dans la transition écologique. |
|
2.15. |
Les actions les plus concrètes au niveau de l’entreprise concernent la planification, l’organisation et le suivi de l’ensemble des activités de l’entreprise, y compris la production et la commercialisation de biens et de services, les transports et la logistique ou encore l’achat d’énergie, de matières premières et d’autres facteurs de production. Les aspects climatiques et environnementaux font également partie intégrante des activités d’innovation, du développement des compétences et de la participation de l’ensemble du personnel, ainsi que de la communication et de la coopération avec les parties prenantes. |
3. Politiques et mesures de soutien aux MPME au titre de l’«Ajustement à l’objectif 55»
|
3.1. |
Pour répondre à l’«Ajustement à l’objectif 55» et réussir la transition écologique, les MPME doivent être pleinement informées et accompagnées pour pouvoir mieux comprendre les implications de propositions législatives qui sont à la fois nouvelles et complexes (3). Cette approche implique des mesures d’information et de sensibilisation tout à la fois de grande ampleur et ciblées, mises en œuvre de manière coordonnée et complémentaire par la Commission et les États membres, qui tous ont une responsabilité cruciale à cet égard. Le rôle des organisations professionnelles et des chambres de commerce est aussi cardinal pour informer et soutenir leurs membres, avec l’appui des prestataires d’enseignement et de formation, des bureaux de développement régional, des groupements d’acteurs économiques, des partenaires sociaux et des organisations de la société civile concernés. |
|
3.1.1. |
À la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, les politiques du pacte vert pour l’Europe font désormais l’objet d’une consultation ouverte pour ce qui est du calendrier en raison du caractère extraordinaire des nouvelles circonstances et de la dépendance de l’Union à l’égard de l’énergie et des denrées alimentaires en provenance de Russie et d’Ukraine. Le CESE reconnaît que les circonstances et les dépendances sont effectivement extraordinaires, et il estime que les objectifs écologiques ne devront en aucun cas être abandonnés quel que soit le motif invoqué, mais qu’une flexibilité de bon aloi devra être accordée au fil du temps, et ce, jusqu’au dénouement de la crise. |
|
3.1.2. |
Outre l’analyse d’impact appropriée de toutes les initiatives législatives, le CESE invite la Commission à produire un guide complet, clair et sans équivoque qui reprenne la totalité des exigences actuelles et à venir en matière de climat et leurs implications pour les MPME. Celui-ci devrait couvrir:
|
|
3.1.3. |
Le CESE souhaite que des orientations correspondantes soient également élaborées en ce qui concerne la législation relative à d’autres questions environnementales majeures. De façon plus générale, ce type de guide devrait s’imposer dans les pratiques courantes et accompagner toute initiative future dans le domaine du pacte vert pour l’Europe. Les MPME ont besoin d’un cadre législatif stable qui offre des perspectives et une programmation claires pour leurs investissements. Il convient donc d’éviter des changements soudains, comme la récente modification des objectifs en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique proposée dans le plan REPowerEU, sachant qu’ils tendent à dégrader plus encore un environnement qui est déjà extrêmement complexe et incertain. |
|
3.2. |
Compte tenu de l’amplitude du champ d’application du pacte vert pour l’Europe et de l’ampleur de cette initiative, une transformation industrielle totale est envisagée. Conformément au principe «Penser aux PME d’abord», et si l’on ne veut pas que les MPME se trouvent contraintes de «mettre la clé sous la porte», un programme de soutien et de développement des capacités de grande envergure s’impose. Le but consisterait à soutenir les MPME quels que soient les problèmes auxquels elles sont confrontées dans leurs activités commerciales et dans l’action qu’elles mènent en faveur de la mutation écologique et en vue de respecter la législation. |
|
3.2.1. |
Le CESE prend acte d’un vif intérêt, exprimé tant par la Commission que par le Parlement européen, pour ce qui est de développer les initiatives déjà en place afin de promouvoir la stratégie en faveur des PME et d’explorer des possibilités supplémentaires d’obtenir pour cette stratégie des progrès tangibles. Le CESE suggère que cet intérêt se traduise dans les faits par des politiques dans tous les domaines possibles, et souligne le rôle indispensable des États membres, lesquels doivent agir en coopération avec les organisations de MPME, les chambres de commerce, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes concernées. |
|
3.2.2. |
Les jeunes entrepreneurs représentent une croissance à venir des MPME et de l’emploi. L’attention qu’ils portent aux consommateurs et le pouvoir d’attraction qu’ils exercent auprès des jeunes salariés, conjugués à l’inquiétude grandissante suscitée par la transition écologique, doivent par conséquent faire l’objet d’une prise en compte plus spécifique et être dûment traités, par exemple dans les plans de relance. En outre, pour exploiter pleinement le potentiel de l’ensemble de la société et accroître la diversité dans les entreprises, il convient de supprimer tout obstacle à l’entrepreneuriat féminin. Il faut aussi encourager et mettre en valeur l’esprit d’entreprise auprès de tous les groupes vulnérables — personnes handicapées, migrants et communautés minoritaires. |
|
3.2.3. |
Pour renforcer les synergies entre la numérisation et la mue écologique des MPME, ces deux évolutions doivent être prises en considération simultanément lors de l’élaboration des politiques et des mesures. Sachant que ni la transition écologique ni la transition numérique ne relèvent de questions purement techniques ou financières, les grandes thématiques humaines et économiques doivent être prises à bras-le-corps pour que la grande majorité des MPME adoptent une trajectoire numérique durable, inscrite dans le long terme et parée pour l’avenir (4). |
|
3.2.4. |
Le CESE invite aussi la Commission et les États membres à surveiller les effets produits par la mise en œuvre des transitions écologique et numérique sur le plan des chaînes d’approvisionnement et de valeur, ainsi que les évolutions économiques et sociétales dans chaque région afin de pouvoir contrer les effets négatifs possibles sur les MPME et sur l’emploi à un stade précoce. |
|
3.3. |
Dans l’optique de soutenir les évolutions au jour le jour des activités économiques des MPME, telles que la production de biens et de services, la production et la consommation d’énergie ou encore l’organisation de la logistique, il est indispensable de disposer d’un apport adéquat de services de conseil et de plateformes de coopération. |
|
3.3.1. |
Le CESE invite l’Union européenne et ses États membres à renforcer et à encourager la mise en place de services d’assistance technologique et de gestion à la disposition des MPME, en déployant tout le potentiel de différents instruments, et en particulier dans la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience et des accords de partenariat, dans le but d’aider les entreprises à améliorer l’efficacité de leur consommation d’énergie et de ressources matérielles, et à faire baisser la production d’émissions et de déchets, de manière à réduire au minimum les coûts et les incidences sur l’environnement. Le CESE plaide semblablement pour que les services de conseil de la sphère du numérique intègrent les aspects environnementaux. |
|
3.3.2. |
Pour améliorer l’utilisation efficace de leurs ressources par les MPME, le CESE propose de créer dans différentes régions des «pôles de circularité». Cette initiative devrait renforcer la coopération entre les entreprises dans tous les secteurs et faciliter le développement de nouveaux procédés de recyclage et de réutilisation des déchets et des sous-produits, y compris la démonstration de nouvelles technologies. |
|
3.3.3. |
Le CESE demande que les MPME et leurs représentants soient associés à l’élaboration de feuilles de route sectorielles en matière d’action pour le climat au niveau national, ainsi qu’à la définition des trajectoires de transition au niveau de l’Union pour les différents écosystèmes d’entreprises, ce qui permettra également de s’intéresser de plus près au partage des bonnes pratiques et d’assurer une répartition adéquate des ressources ainsi qu’une mise en œuvre efficace. |
|
3.4. |
Pour renforcer et soutenir les investissements dans la mue écologique des MPME, de l’économie et de la société dans son ensemble, il faut garantir un environnement favorable à l’investissement ainsi que des conditions permettant aux MPME de bénéficier d’un accès adapté au financement. |
|
3.4.1. |
Le CESE invite l’Union et les États membres à accélérer les investissements des MPME en s’employant notamment à:
|
|
3.4.2. |
Le CESE invite la Commission à tenir dûment compte des incidences indirectes des critères de financement durable sur les MPME. Il en va de même pour les exigences de solvabilité des banques, et de toute autre mesure relevant des politiques économique et budgétaire qui ont une incidence indirecte sur la capacité des MPME à investir et à exercer leurs activités, ce qui se traduit par la création d’emplois et le maintien de l’emploi. |
|
3.4.3. |
Le CESE demande que des règles de concurrence saine soient respectées lors de l’allocation des fonds publics aux investissements verts. Le CESE souligne également la nécessité de surveiller les flux financiers au moyen d’indicateurs appropriés. Il est important d’accorder aux MPME un accès égal aux marchés publics et aux investissements, par exemple dans le domaine des infrastructures en général, et d’encourager les investissements dans la mutation écologique des MPME elles-mêmes, par exemple en faisant appel au financement public comme levier pour l’investissement privé. |
|
3.4.4. |
Au vu de l’évolution récente des marchés de l’énergie, la Commission a pris acte de la vulnérabilité des MPME en raison du risque croissant de précarité énergétique (5). Le CESE se félicite de la définition donnée des «microentreprises vulnérables» et demande que des actions supplémentaires soient déployées pour leur apporter le soutien approprié leur permettant de supporter le poids qui pèse sur elles. |
|
3.5. |
Le CESE invite l’Union et les États membres à augmenter le commerce des solutions vertes par les MPME en développant et en garantissant des conditions de marché adéquates qui permettent de réaliser les actions suivantes:
|
|
3.6. |
Pour conforter le rôle des MPME dans la mise au point de nouvelles solutions vertes pour les entreprises, les consommateurs et la société dans son ensemble, le CESE préconise les mesures suivantes:
|
|
3.7. |
Dans l’optique de garantir les compétences nécessaires au développement et à la gestion des entreprises conformément à la transition écologique (6), le CESE préconise les actions suivantes:
|
|
3.8. |
Le CESE demande la création d’indicateurs appropriés, et d’outils pratiques qui contribuent au suivi systématique des opérations menées et des incidences sur les entreprises dans le cadre de la transition écologique, ce qui devrait également servir à communiquer avec l’éventail très large des parties prenantes. Dans le même temps, le CESE invite les responsables politiques de l’Union à s’abstenir d’assigner aux MPME des obligations d’information contraignantes et aussi de bien évaluer les conséquences indirectes pour les MPME des obligations de déclaration ciblant les grandes entreprises. |
4. Observations spécifiques concernant les professions libérales, l’artisanat et les entreprises de l’économie sociale
|
4.1. |
Une transition écologique équitable où nul n’est laissé pour compte ne peut être garantie qu’à la condition de faire en sorte que les politiques européennes soient élaborées en tenant compte de leur impact potentiel sur le commerce et l’artisanat. Ces acteurs économiques sont en effet importants pour les économies locales, car ils fournissent des biens et des services indispensables et adaptés aux besoins des consommateurs, même dans des zones géographiques moins connectées aux centres urbains. Le dialogue avec leurs représentants, tels que les organisations professionnelles et les chambres de commerce, permet de prendre des décisions intelligentes quant aux politiques menées, qui tiennent compte de l’impact potentiel sur le terrain. |
|
4.2. |
Une expertise professionnelle indépendante est de mise pour faire émerger des solutions innovantes optimisées si l’on veut relever les défis liés au changement climatique et à l’environnement. Les professions libérales répondent à cette nécessité dans plusieurs domaines de l’économie et de la société en fournissant une expertise et des conseils techniques, juridiques, financiers et non financiers. Le CESE préconise, à l’échelle de l’Union, des mesures qui incitent les États membres à promouvoir des réglementations professionnelles qui garantissent une mise en œuvre satisfaisante de la transition écologique et numérique, par exemple au moyen d’approches techniques complexes, de manière à mettre en avant les solutions qui soient les plus axées sur le marché et les plus innovantes. |
|
4.3. |
Il est possible d’accroître la durabilité de l’aménagement du territoire local et régional en améliorant les services de conseil pour les municipalités. Il importe aussi de développer plus avant le concept d’évaluation environnementale stratégique dans le sens d’une évaluation de la durabilité — écologique, économique et sociale. Les procédures de passation de marchés publics dans l’ensemble de l’Union devraient appliquer des critères liés au climat et d’autres critères qualitatifs, ce qui permettrait de promouvoir l’innovation des MPME et de faciliter leur accès à des projets, en particulier dans le domaine des services de planification. |
|
4.4. |
Techniques, produits et procédés nouveaux apparaissent nécessaires dans le contexte de la transition vers l’économie circulaire. Par exemple, dans le secteur de la construction, ce nouveau virage requiert le recyclage des déchets de la rénovation et de la construction, la réutilisation d’éléments et l’introduction de nouveaux matériaux de construction, y compris la reconnaissance de matériaux de construction secondaires de qualité garantie, ainsi qu’une coopération étroite entre les producteurs, les artisans, les professionnels et l’industrie du recyclage. Les chaînes de valeur régionales et la création de grappes d’entreprises (clusters) doivent également être renforcées grâce à la participation de l’artisanat. |
|
4.5. |
Les enjeux environnementaux liés aux entreprises de l’économie sociale sont fondamentalement les mêmes que ceux des autres entreprises pour ce qui est des problématiques en question. Toutefois, les conditions spécifiques de ces entreprises doivent être dûment prises en considération dans le droit fil des nombreux avis du CESE abordant ces questions, et au moyen de mesures ciblées prenant appui sur le récent plan d’action de l’Union européenne consacré aux entreprises de l’économie sociale. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Données de l’Eurobaromètre Flash 498. Rapport sur les PME, les marchés verts et l’utilisation efficace des ressources, p. 46, mars 2022.
(2) Smit, S.J., SME focus — Long-term strategy for the European industrial future (Priorité aux PME — Stratégie à long terme pour l’avenir industriel de l’Europe), Parlement européen, département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, PE 648.776 — avril 2020.
(3) Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» comprend un large éventail d’initiatives législatives soumis à une décision finale faisant l’objet de négociations entre les institutions. Tant que ce processus ne sera pas mené à son terme, les MPME ne pourront suivre que des informations partielles et elles resteront confrontées à des incertitudes quant à l’avenir.
(4) Priorité aux PME, département thématique du Parlement européen, avril 2020.
(5) COM(2021) 568 final, 14.7.2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52021PC0568
(6) Conformément au JO C 56 du 16.2.2021, p. 1.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/9 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Les transmissions d’entreprises en tant que promoteurs d’une reprise et d’une croissance durables dans le secteur des PME»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/02)
|
Rapporteure: |
Mira-Maria KONTKANEN |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 32, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Marché unique, production et consommation» |
|
Adoption en section |
8.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
143/0/0 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Les transmissions d’entreprise sont un important processus stratégique qui permet d’assurer la continuité des activités des entreprises et de préserver l’emploi. Par conséquent, le Comité économique et social européen (CESE) propose que l’Union européenne et ses États membres ménagent un rôle plus important à la transmission d’entreprise dans leurs politiques de relance et de croissance. |
|
1.2. |
Les transmissions d’entreprise préservent le tissu social des zones rurales, dans lesquels les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) sont fortement représentées. Il est essentiel de développer des écosystèmes performants de transmission d’entreprise, ainsi que des services de soutien, afin de préserver les moyens de subsistance et les économies des zones rurales et mono-industrielles. Le CESE estime que cet aspect devrait être mis en valeur dans le cadre de la concrétisation de la vision de l’Union à long terme pour les zones rurales et du plan d’action rural. |
|
1.3. |
Mener à bien les transmissions d’entreprise, c’est préserver les emplois existants et en créer de nouveaux, ainsi qu’ouvrir des perspectives d’avenir aux travailleurs du point de vue de la continuité de leur emploi et de leur développement professionnel. Le CESE encourage les États membres à mettre en commun les bonnes pratiques concernant la manière de favoriser la transmission d’une société à ses travailleurs, par exemple sous la forme d’une coopérative (1) et d’autres sociétés de l’économie sociale dont les travailleurs sont les propriétaires. |
|
1.4. |
Plus tôt leurs propriétaires se préparent à leur transmission, plus grande est la chance que celle-ci réussisse. Les États membres doivent intensifier leurs activités de sensibilisation en matière de transmission d’entreprise et outiller les entreprises et d’autres organisations de soutien afin de favoriser et d’accompagner les transmissions de microentreprises et de PME. Le CESE demande également aux États membres de mettre en place et de développer plus avant des mécanismes (2) d’alerte précoce pour les microentreprises et les PME afin de conforter la résilience, la pérennité et, en définitive, la capacité de transmission de l’entreprise. |
|
1.5. |
Il convient de promouvoir activement l’acquisition d’une entreprise existante en ce qu’elle constitue pour des entrepreneurs débutants une possibilité aussi attrayante que de lancer une jeune pousse. Le savoir-faire concernant le rachat d’une société et d’une succession devrait faire partie de l’éducation à l’esprit d’entreprise dans l’enseignement secondaire et supérieur. Aussi le CESE demande-t-il de développer des incitations en faveur de la transmission de petites sociétés à des jeunes entrepreneurs. Ces incitations pourraient notamment prendre la forme d’actions de sensibilisation, de services de conseil, d’un tutorat et de l’accès au financement. Par ailleurs, il serait encore possible de renforcer la compréhension qu’ont les jeunes entrepreneurs du dialogue social pour assurer la réussite des transmissions d’entreprise aux yeux de toutes les parties intéressées. De la même manière, il convient de concevoir des incitations supplémentaires à la transmission d’entreprise auprès des femmes entrepreneures, afin d’accroître le nombre de celles-ci, qui est bien trop faible à l’heure actuelle. |
|
1.6. |
Le financement demeure un obstacle à la réussite des transmissions d’entreprise, dont la plupart requièrent en la matière une intervention extérieure. Le CESE encourage vivement chaque État membre à veiller à ce que des institutions financières soient disponibles pour soutenir les transmissions d’entreprise dans le cas des microentreprises et des PME, par exemple en les assistant grâce à des garanties de prêts bancaires. |
|
1.7. |
Le CESE recommande aux États membres de mettre en place des forums nationaux des parties intéressées en matière de transmission d’entreprise, qui représentent les acteurs aussi bien publics que privés. Les forums sur la transmission d’entreprise offrent une approche systématique et à long terme pour promouvoir cette question. Ils procurent également un espace pour un dialogue continu entre les experts nationaux et ils constituent une manière plus efficace d’utiliser les ressources. |
|
1.8. |
Le CESE estime qu’il convient de développer des plateformes en ligne pour la transmission d’entreprise dans tous les États membres, auxquelles les microentreprises et les petites entreprises pourraient également accéder. Il convient de développer les interconnexions et les synergies entre différentes plateformes en ligne au sein des États membres et la Commission européenne pourrait faciliter l’interconnexion de différentes places de marché en ligne au sein de l’Union européenne. |
|
1.9. |
Les données touchant aux transmissions d’entreprise sont souvent fragmentaires, insuffisantes, obsolètes et non comparables d’un État membre de l’Union à l’autre. Le CESE recommande à la Commission et aux États membres de continuer d’améliorer la banque de données des transmissions d’entreprise. |
|
1.10. |
Il convient de mettre en place un examen régulier de la situation en matière de transmission d’entreprise en Europe, par exemple sous la forme d’un baromètre paneuropéen de la transmission d’entreprise, qui fournirait des éléments permettant d’élaborer des politiques fondées sur des données probantes. L’on devrait user de l’assemblée annuelle européenne des PME comme d’un forum tenu à intervalles réguliers pour débattre et mettre en commun les expériences en matière de transmission des microentreprises et de PME. Enfin, il convient d’envisager diverses initiatives de sensibilisation telles que l’organisation d’une semaine nationale et/ou européenne de la transmission d’entreprise. |
2. Introduction
|
2.1. |
Accroître le nombre de transmissions d’entreprise réussies profiterait immédiatement à l’emploi, à la pérennité des entreprises et à l’économie européenne dans son ensemble. Dans le droit fil des propositions de la conférence sur l’avenir de l’Europe (3), les transmissions contribuent à accroître la résilience et la cohésion des sociétés. |
|
2.2. |
Les transmissions d’entreprise constituent une phase naturelle d’une importance croissante du développement stratégique des microentreprises et des PME, de leur renouvellement et de leur croissance. Au vu du vieillissement de la population européenne et du nombre croissant d’entrepreneurs qui envisagent de se retirer de leurs affaires, la réussite des transmissions d’entreprise revêt un caractère toujours plus crucial pour l’économie des microentreprises et des PME européennes. |
|
2.3. |
Chaque année, ce sont quelque 450 000 entreprises employant 2 millions de travailleurs dans toute l’Europe qui sont transmises. L’on estime que chaque année, la transmission de quelque 150 000 entreprises risque d’échouer, ce qui met en danger 600 000 emplois environ. Ce sont les plus petites entreprises qui sont les plus vulnérables face à ce risque d’échec (4). |
|
2.4. |
La transmission d’entreprise peut s’avérer une procédure compliquée du fait de problèmes financiers, managériaux, réglementaires, administratifs ou commerciaux, lorsqu’il s’agit par exemple de mettre en rapport, et d’accord, vendeurs et acheteurs. Dans le même temps, la plupart des transmissions d’entreprise interviennent dans le segment des microentreprises qui ne disposent que de ressources limitées. Une transmission est souvent plus difficile pour les petites entreprises et pour celles dont le propriétaire en fonction joue un rôle prédominant (5). |
|
2.5. |
Un écosystème performant des transmissions d’entreprise est essentiel pour leur réussite et contribue à créer des marchés dynamiques pour la transmission d’entreprise. Ces écosystèmes de transmission d’entreprise rassemblent diverses parties intéressées publiques et privées telles que des acheteurs, des vendeurs, des prédécesseurs, des héritiers, des conseillers d’entreprise tels que des courtiers d’entreprise, des comptables, des juristes et des consultants, des médiateurs, des institutions financières, des organisations de soutien aux entreprises, des décideurs politiques et des universitaires. Des activités de sensibilisation afin d’améliorer l’état de préparation à la transmission d’entreprise constituent également un élément important d’un tel écosystème. Aujourd’hui encore, la situation d’ensemble en matière de transmission d’entreprise varie sensiblement d’un État membre à l’autre, ainsi qu’entre régions au sein d’un même État membre, et laisse ainsi une place à l’apprentissage mutuel et à l’amélioration des écosystèmes de transmission d’entreprise partout en Europe. Toutefois, la responsabilité de la transmission d’entreprise ressortit toujours en dernier lieu à l’entrepreneur. |
|
2.6. |
Un changement réussi de propriétaires peut permettre à l’entreprise de gagner en résilience, en innovation et en compétitivité. Lorsque de nouveaux propriétaires font adopter à leurs entreprises des modèles commerciaux plus écologiques et plus numériques, les transmissions d’entreprise contribuent également à la transition écologique et numérique du secteur des microentreprises et des PME. |
|
2.7. |
La pandémie de COVID-19 a également mis en évidence la nécessité de renforcer la résilience des entreprises européennes et d’assurer une meilleure planification de leur état de préparation. Pour réussir une transmission d’entreprise, l’entreprise et son modèle commercial devraient être sains et résilients face aux chocs extérieurs. La santé financière et la résilience accroissent les chances de succès de la transmission. |
3. Contexte
|
3.1. |
Depuis le début des années 90, les transmissions d’entreprise constituent un volet de la politique de l’Union européenne en faveur des entreprises. En 1994, la Commission européenne avait publié une recommandation (6) visant à améliorer les conditions générales de la transmission d’entreprise dans les États membres. Cette recommandation proposait à l’intention de ces derniers une série de mesures afin d’améliorer la situation des entreprises qui se préparaient à une transmission. Ces mesures consistaient notamment à mener des activités de sensibilisation et de préparation, à améliorer l’environnement financier pour les transmissions d’entreprise, à ouvrir des voies légales de restructuration, à fournir les moyens juridiques d’assurer la continuité des partenariats dans l’éventualité du décès d’un partenaire ou du propriétaire, à s’assurer que le régime fiscal applicable aux successions et aux donations n’entrave pas la transmission et à faciliter la transmission à des tiers grâce à des règles fiscales appropriées. |
|
3.2. |
Depuis lors, la Commission a révisé sa recommandation en 2006 et a publié une communication (7) sur la «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne pour la croissance et l’emploi: la transmission d’entreprise — La continuité grâce à un nouveau départ». Cette révision faisait valoir que la mise en œuvre de la recommandation de 1994 appelait encore des efforts supplémentaires. En sus de demander de mettre en œuvre la recommandation de 1994, la communication de 2006 formulait des recommandations supplémentaires afin de favoriser la transmission d’entreprise, consistant notamment à accorder à celle-ci une attention politique accrue, à lui fournir un appui spécialisé et un tutorat, à organiser des marchés transparents pour les transmissions et à mettre en place une infrastructure de soutien à l’échelon national, régional et local afin d’encourager les transmissions. |
|
3.3. |
En 2013, la Commission a évalué l’état d’avancement de ses recommandations de 2006. Dans l’ensemble, elle concluait à l’insuffisance des progrès dans la mise en œuvre des mesures visant à améliorer le cadre régissant les transmissions d’entreprise depuis sa communication de 2006. Les lacunes énumérées dans cette évaluation concernaient des domaines tels que les dispositions fiscales en faveur des tiers ou des salariés ou encore la fourniture d’un appui spécifique et d’initiatives financières. Cette évaluation faisait également valoir que les transmissions d’entreprise ne bénéficiaient pas d’une attention politique suffisante à l’échelon de l’Union européenne ou de ses États membres, à l’inverse de la politique en faveur des jeunes pousses. |
|
3.4. |
En 2020, la Commission a publié une stratégie de l’Union en faveur des PME (8), dans laquelle elle réaffirme qu’elle poursuivra ses travaux visant à faciliter les transmissions d’entreprise et soutiendra les États membres dans leurs efforts pour créer un environnement favorable à leur endroit. Récemment, la Commission s’est attachée à améliorer la base de connaissances probantes sur la transmission d’entreprise et a publié un rapport sur cette question en 2021 (9). Elle propose, sur son site internet (10), une page pour pouvoir suivre ses actions et les bonnes pratiques financées par l’Union. |
|
3.5. |
Le CESE a également reconnu l’importance que revêtent les transmissions d’entreprise pour les microentreprises et les PME, et il préconise d’adopter rapidement des mesures visant à faciliter et à rationaliser cette procédure à des coûts raisonnables (11). Dans son avis sur la stratégie de l’Union axée sur les PME, le CESE demande également d’accorder une attention particulière aux transmissions de microentreprises et de PME par-delà les frontières pour s’attaquer aux coûts élevés liés à ces opérations et aux différences substantielles entre les réglementations nationales (12). Son avis de suivi sur la stratégie de l’Union en faveur des PME (13) montre les possibilités qu’offrent des transmissions d’entreprise réussies pour rendre les entreprises plus numériques et durables dans le contexte des objectifs de cette double transition de l’Union. |
4. Observations générales
|
4.1. |
La question des transmissions d’entreprise ne cesse de gagner en importance pour les microentreprises et les PME compte tenu de la situation démographique en Europe et du vieillissement des entrepreneurs. Quelque 90 % des transmissions d’entreprise interviennent dans des microentreprises (14). |
|
4.2. |
Accroître le nombre de transmissions d’entreprise réussies profite immédiatement à l’économie européenne. Si on les compare aux jeunes pousses, les entreprises qui ont connu une transmission réussie affichent de meilleures performances du point de vue de leur pérennité, de leur chiffre d’affaires, de leurs bénéfices, de leur capacité d’innovation et de l’emploi (15). Selon la Commission européenne, en moyenne, les entreprises existantes proposent cinq emplois alors qu’une nouvelle entreprise n’en génère que deux (16). Favoriser les transmissions d’entreprise constitue donc la meilleure manière possible de promouvoir la croissance entrepreneuriale. |
|
4.3. |
Les transmissions d’entreprise préservent le tissu social des zones rurales où les microentreprises et les PME sont fortement représentées; en effet, on estime qu’au moins un tiers des catégories d’entreprises en Europe s’y trouvent. Elles garantissent la cohésion économique et sociale des zones rurales grâce aux services qu’elle fournissent aux citoyens, aux consommateurs et aux activités économiques locales, ainsi que grâce aux emplois qu’elles procurent (17). Les transmissions d’entreprise contribuent à éviter de perdre des compétences artisanales locales. Souvent, le secteur local de l’artisanat et du commerce de détail favorise la diversité du choix proposé au consommateur sur le marché et constitue une alternative à l’uniformité des chaînes de distribution. Pour les consommateurs, une transmission réussie se traduit par le maintien, et souvent l’amélioration, des services et des produits. Il est essentiel de développer des écosystèmes performants de transmission d’entreprise, ainsi que des services de soutien, afin de préserver les moyens de subsistance et les économies des zones mono-industrielles et rurales, ce qui revêt une importance particulière pour le secteur de l’agriculture et de la transformation des denrées alimentaires. Réussir les transmissions ouvre également la voie à une accélération de la double transition dans les zones rurales au moyen d’une transformation enclenchée par un changement de propriétaire. Le CESE estime que développer des écosystèmes de transmission d’entreprise et des services de soutien devrait être pris en compte dans le cadre de la concrétisation de la vision à long terme pour les zones rurales de l’Union, ainsi que dans le plan d’action rural. |
|
4.4. |
Favoriser la transmission d’entreprise profite également aux travailleurs, car elle préserve les emplois et la continuité des activités. Au sein notamment des microentreprises et des PME, les travailleurs constituent l’actif le plus précieux qui est transmis au nouveau propriétaire. Aussi importe-t-il de garantir leur bien-être lorsque s’opère une transmission. Souvent, les nouveaux propriétaires prennent en main avec enthousiasme la transmission pour développer et faire croître l’entreprise. Ses objectifs sont également synonymes de meilleures perspectives d’avenir pour les travailleurs du point de vue de la continuité de leur emploi et de leur développement professionnel. Le CESE encourage les États membres à faire connaître les bonnes pratiques de transmission consistant en une reprise de l’entreprise par ses travailleurs, qui peuvent continuer à exercer leurs tâches et à en développer les activités, par exemple sous la forme d’une coopérative et d’autres types d’entreprise de l’économie sociale dont les travailleurs sont les propriétaires (18) qui ont démontré leur capacité à résister aux situations de crise. En outre, favoriser le dialogue social et la communication d’informations en amont facilite les reprises par les salariés. Cette démarche s’inscrit dans le droit fil de l’avis du CESE (dossier INT/925) (19), selon lequel la formule du rachat de l’entreprise par ses salariés représente une bonne pratique pour relancer des entreprises en crise, mais aussi pour assurer une transmission dans le cas de petites et moyennes entreprises dont les propriétaires n’ont pas de successeurs. |
|
4.5. |
Il s’impose d’accorder à la promotion de la transmission d’entreprise une place plus importante dans les politiques de l’Union et de ses États membres pour la relance et la croissance. Le CESE approuve les efforts stratégiques consentis de longue date par la Commission européenne, ainsi que par des organisations qui promeuvent la transmission d’entreprise, telles que Transeo (20), afin de créer un environnement qui y soit plus propice en Europe. Il y a toutefois encore matière à progrès. En matière de promotion de la transmission d’entreprise, le degré d’attention dont elle bénéficie, les performances d’ensemble actuelles de l’écosystème et l’ampleur des efforts entrepris varient sensiblement d’un État membre à l’autre. Dans un environnement commercial en développement rapide, les entrepreneurs doivent se saisir des chances de croissance, que ce soit au sein même de leur entreprise ou au moyen d’acquisitions. Il convient d’envisager toutes sortes de transmission de la propriété, notamment les successions familiales, le rachat ou la vente par les dirigeants, les acquisitions stratégiques et le rachat par les travailleurs. |
|
4.6. |
Il est indispensable de prendre en compte les microentreprises et les PME pour que la transition de l’Europe vers une économie numérique et écologique puisse réussir. Les transmissions d’entreprise sont une manière naturelle de transformer le modèle commercial d’une microentreprise ou d’une PME pour le rendre plus écologique et plus numérique et favoriser ainsi sa transition dans ces deux domaines. Un changement réussi de propriétaires peut permettre à l’entreprise de gagner en résilience, en innovation et en compétitivité. En outre, du point de vue des ressources, racheter une société existante disposant d’installations de production s’avère souvent plus respectueux de l’environnement que d’en acquérir de nouvelles. |
|
4.7. |
Notamment lorsque l’entreprise se transmet d’un entrepreneur âgé à un plus jeune, il est probable que ce dernier soit mieux armé pour intégrer au sein de l’entreprise qu’il a acquise de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de production et des modèles commerciaux durables. Aussi le CESE demande-t-il de développer des incitations supplémentaires, telles que des actions de sensibilisation, des services de conseil, du tutorat et l’accès au financement, en faveur de la transmission de microentreprises et de PME à des jeunes entrepreneurs. Par ailleurs, il serait encore possible de renforcer la compréhension qu’ont les jeunes entrepreneurs du dialogue social par exemple grâce à des modules sur ce thème dans le cadre de la formation à l’entrepreneuriat. Il convient de promouvoir activement le démarrage d’une carrière d’entrepreneur par l’acquisition d’une entreprise existante, en ce qu’elle constitue une possibilité qui s’avère aussi attrayante que le lancement d’une jeune pousse. De la même manière, il convient de concevoir des incitations supplémentaires à la transmission d’entreprise auprès des femmes entrepreneures, afin d’accroître le nombre de celles-ci, qui est bien trop faible à l’heure actuelle. |
|
4.8. |
Une large majorité des transmissions d’entreprise requiert un financement extérieur. Du fait de l’accroissement des exigences réglementaires à l’œuvre dans le secteur financier, deux principaux instruments financiers entrent en ligne de compte pour favoriser la transmission d’entreprise. En premier lieu, il est évident qu’il est nécessaire de disposer de garanties pour financer les opérations de transmission d’entreprise. Toutefois, une part croissante des actifs des entreprises sont immatériels, tandis que le secteur bancaire est tenu de se conformer à des règles toujours plus strictes. Chaque État membre doit disposer d’un acteur ou d’une organisation qui fournit des garanties pour des prêts bancaires. En second lieu, le développement du cadre réglementaire de l’Union européenne accroît la demande de financement par fonds propres. Plusieurs catégories d’acheteurs ont les qualifications pour mener l’entreprise concernée mais manquent de capitaux propres. Le CESE invite fermement la Commission européenne à jouer un rôle volontariste pour promouvoir le développement de ces deux instruments financiers au sein des États membres. |
|
4.9. |
À l’avenir, un nombre croissant de microentreprises et de PME familiales seront transmises à des tiers. Pour attirer des acheteurs tiers, ces entreprises doivent se trouver dans une situation viable, saine sur le plan économique et attrayante. Plus tôt leurs propriétaires se préparent à leur transmission, plus grande est la chance que celle-ci réussisse. Les États membres doivent intensifier leurs activités de sensibilisation en matière de transmission d’entreprise et outiller les entreprises et d’autres organisations de soutien afin de favoriser et d’accompagner les transmissions de microentreprises et de PME. Il peut être également important d’offrir un outil d’alerte précoce pour soutenir une entreprise en difficultés financières afin d’aider un entrepreneur à ramener cette entreprise sur la voie de la viabilité financière et de la préparer à une transmission. Par conséquent, le CESE demande aux États membres de mettre en place et de développer plus avant des mécanismes d’alerte précoce pour soutenir les microentreprises et les PME. |
Une récente étude sur la promotion de la transmission d’entreprise dans des pays européens (21) expose des pratiques d’États membres en la matière qui sont susceptibles d’être reproduites dans d’autres États. Le CESE approuve la recommandation que formule cette étude demandant aux États membres de mettre en place des forums nationaux où seraient représentées les parties intéressées en matière de transmission d’entreprise, qu’elles soient publiques ou privées. Il est nécessaire que les parties intéressées coopèrent à tous les niveaux, régional, national et international. Les forums sur la transmission d’entreprise offrent, grâce à un dialogue continu entre experts nationaux, une approche systématique et à long terme pour promouvoir cette question et ils constituent une manière plus efficace d’utiliser les ressources. À terme, l’on pourrait établir un dialogue transfrontière, favorisé par la Commission européenne, entre différents forums nationaux afin d’échanger les bonnes pratiques en matière de promotion de la transmission d’entreprise au sein des États membres de l’Union.
|
4.10. |
Le CESE recommande aux États membres d’exploiter pleinement les technologies numériques pour promouvoir les transmissions d’entreprise. Il convient de développer des plateformes en ligne pour la transmission d’entreprise dans tous les États membres, auxquelles les microentreprises et les petites entreprises pourraient également accéder, sachant que ce sont le plus souvent des parties intéressées privées qui sont propriétaires de ces plateformes et qui les gèrent. Il y a lieu d’améliorer les interconnexions et les synergies entre différentes plateformes en ligne au sein des États membres et la Commission européenne pourrait faciliter l’accès à différentes places de marché en ligne au sein des États membres. En outre, parmi les petites entreprises, le nombre de transmissions par-delà les frontières augmentent. Améliorer la coopération entre les plateformes nationales en ligne constituerait un moyen efficace, par rapport aux coûts, de permettre aux petites entreprises de découvrir d’éventuels propriétaires potentiels dans d’autres États membres. |
|
4.11. |
Pour élaborer avec succès la politique européenne en matière de transmission d’entreprise, il s’impose d’améliorer la collecte des données. Aujourd’hui encore, les données relatives aux transmissions d’entreprise sont fragmentaires et ne sont pas comparables. Le CESE recommande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures proposées afin d’améliorer la banque de données des transmissions d’entreprise. Le récent rapport «Improving the evidence base on transfer of business in Europe: final report» (22) exposait les grandes lignes de telles mesures. Le CESE préconise également de développer un baromètre paneuropéen de la transmission d’entreprise, assorti d’un rapport tous les quatre ans, afin de contribuer à une élaboration des politiques fondées sur des données probantes. En outre, il convient d’envisager diverses initiatives de sensibilisation telles que l’organisation d’une semaine nationale et/ou européenne de la transmission d’entreprise. |
|
4.12. |
Le CESE propose qu’en sus de s’atteler à améliorer la collecte des données, la Commission devrait régulièrement faire le point sur la situation des transmissions d’entreprise en Europe. L’on devrait user de l’assemblée annuelle européenne des PME comme d’un forum tenu à intervalles réguliers pour débattre et mettre en commun les expériences en matière de transmission des microentreprises et de PME. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Il existe par exemple en France un cadre pour organiser et faciliter la transmission d’une société à ses travailleurs et pour renforcer l’activité économique des territoires en rendant plus aisée la transmission des microentreprises et des PME.
(2) Le mécanisme d’alerte précoce est un service de conseil et de soutien pour les entreprises qui connaissent des difficultés financières, et qui vise à intervenir à un stade précoce afin d’éviter la faillite d’entreprises viables par ailleurs.
(3) Rapport sur les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe, mai 2022.
(4) Commission européenne, Business Dynamics: Start-ups, Business Transfers and Bankruptcy (Dynamique des entreprises: jeunes pousses, transmission et faillite), 2011.
(5) Communication de la Commission: «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne pour la croissance et l’emploi: la transmission d’entreprise — La continuité grâce à un nouveau départ», COM(2006) 117 final, 2006, p. 4.
(6) Recommandation de la Commission du 7 décembre 1994 sur la transmission des petites et moyennes entreprises (94/1069/CE).
(7) Communication de la Commission: «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne pour la croissance et l’emploi: la transmission d’entreprise — La continuité grâce à un nouveau départ», COM(2006) 117 final, 14 mars 2006.
(8) Communication de la Commission, «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique», COM(2020) 103 final, 2020.
(9) Commission européenne, Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, Improving the evidence base on transfer of business in Europe: final report (Rapport final: améliorer la base de connaissances factuelles sur le transfert d’entreprise en Europe), Office des publications, 2021.
(10) Commission européenne, page internet consacrée aux transmissions d’entreprise, ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/transfer-businesses_en (uniquement en anglais).
(11) JO C 197 du 8.6.2018, p. 1.
(12) JO C 429 du 11.12.2020, p. 210.
(13) JO C 194 du 12.5.2022, p. 7.
(14) Commission européenne, Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, Improving the evidence base on transfer of business in Europe: final report (Rapport final: améliorer la base de connaissances factuelles sur le transfert d’entreprise en Europe), Office des publications, 2021.
(15) Tall, J., Varamäki, E., et Viljamaa, A., Business Transfer Promotion in European Countries (La promotion de la transmission d’entreprise dans des pays européens), Seinäjoki, 2021, p. 8.
(16) Communication de la Commission: «Mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne pour la croissance et l’emploi: la transmission d’entreprise — La continuité grâce à un nouveau départ», Bruxelles, 2006, p. 3.
(17) SMEunited, Position on long-term vision for the EU’s rural area (Position sur une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE), avril 2022.
(18) Par exemple, les sociétés dont les travailleurs sont propriétaires («sociedades laborales») en Espagne.
(19) JO C 286 du 16.7.2021, p. 13.
(20) Transeo est une association internationale à but non lucratif qui rassemble des experts en matière de transmission et d’acquisition de petites et moyennes entreprises en Europe et au-delà.
(21) Tall, J., Varamäki, E. et Viljamaa, A., Business Transfer Promotion in European Countries (La promotion de la transmission d’entreprise dans des pays européens), Seinäjoki, 2021, p. 8.
(22) Commission européenne, Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises, Improving the evidence base on transfer of business in Europe: final report (Rapport final: améliorer la base de connaissances factuelles sur le transfert d’entreprise en Europe), Office des publications, 2021.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/15 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Taxinomie sociale: enjeux et possibilités»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/03)
|
Rapporteure: |
Judith VORBACH |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
|
Adoption en section |
9.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
22.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
123/26/12 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Par le présent avis, le Comité économique et social européen (CESE) entend mettre en lumière l’idée d’une taxinomie sociale, dans le but de susciter le débat. Il invite la Commission à publier enfin le rapport décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour étendre le champ d’application de la taxinomie à «d’autres objectifs de durabilité, tels que les objectifs sociaux», comme demandé dans le règlement sur la taxinomie (1) (ci-après le «règlement»). Le CESE plaide en faveur d’une taxinomie sociale viable d’un point de vue opérationnel et rigoureuse sur le plan conceptuel, afin de concrétiser les possibilités offertes tout en maîtrisant les défis. La taxinomie de l’Union devrait être alignée sur une approche globale couvrant la durabilité environnementale mais aussi sociale. Eu égard aux enjeux de la transition écologique, aux conséquences économiques et sociales de la pandémie ainsi qu’à la guerre en Ukraine provoquée par l’agression russe et aux tensions géopolitiques qui en résultent, le CESE réclame une nouvelle fois une politique économique équilibrée et une attention accrue pour les objectifs sociaux. |
|
1.2. |
Les garanties minimales inscrites dans le règlement sont les bienvenues et devraient être pleinement mises en œuvre. Elles ne sont cependant pas en mesure de garantir à elles seules la durabilité sociale au bénéfice des travailleurs, des consommateurs et des communautés. Une taxinomie de l’Union contribuerait à répondre aux besoins d’investissement urgents dans le domaine social en canalisant les investissements dans cette direction. Elle gagnerait même en importance si elle s’inscrivait dans une politique globale axée sur l’équité sociale et l’inclusion. Une transition juste requiert des conditions sociales durables, et une taxinomie sociale pourrait fournir les orientations attendues de longue date. Le CESE invite la Commission à estimer les fonds nécessaires à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Dans l’ensemble, les investissements publics continueront de jouer un rôle crucial en matière de services publics. Le financement de la protection sociale par les dépenses publiques et la stabilité des systèmes de sécurité sociale restent primordiaux. Néanmoins, une taxinomie sociale convenue d’un commun accord pourrait fournir des orientations pour des investissements à retombées sociales positives. |
|
1.3. |
Le CESE recommande que le rapport de la Commission adhère à l’approche diversifiée et à niveaux multiples proposée par la plateforme sur la finance durable (2) (ci-après la «plateforme»). Il serait utile d’intégrer une taxinomie sociale dans l’environnement législatif de l’Union en matière de finance et de gouvernance durables, en gardant à l’esprit que la tâche est immense. En particulier, la proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD) constituerait un complément important à une taxinomie sociale au regard de laquelle les mesures pourraient être analysées et évaluées. Une taxinomie sociale bien conçue contribuerait également à résoudre le problème que peut poser le blanchiment social. Le CESE recommande de commencer par des orientations simples et claires, de prévoir des procédures simples et transparentes et de les compléter progressivement à un stade ultérieur. L’objectif final devrait être une intégration étroite des taxinomies sociale et environnementale, mais, dans un premier temps, des garanties minimales réciproques pourraient s’avérer utiles. |
|
1.4. |
La taxinomie de l’Union devrait mettre en lumière les actions et les entreprises qui contribuent de manière substantielle à la durabilité sociale et devrait constituer une norme de référence reflétant un niveau d’ambition plus élevé que celui déjà prévu dans la législation. Le CESE accueille favorablement les objectifs proposés par la plateforme, à savoir un travail décent, un niveau de vie adéquat et l’avènement de communautés inclusives et durables. Alors que la taxinomie sociale devrait se fonder sur une série de principes internationaux et européens, le CESE recommande en particulier d’établir des liens avec le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable (ODD) pertinents, tels que l’ODD 8 relatif au travail décent. En tout état de cause, le respect des droits de l’homme et des droits des travailleurs doit être une condition de conformité à la taxinomie. Le respect des conventions collectives et des mécanismes de cogestion conformément à la législation nationale et européenne en la matière est essentiel et devrait constituer un principe DNSH (3). Les orientations ayant des incidences sociales positives, fondées sur l’accord des partenaires sociaux, devraient être considérées comme conformes à la taxinomie. Il convient de ne pas perdre de vue la forte disparité entre les États membres s’agissant du taux de couverture par des négociations collectives, qui a diminué dans 22 d’entre eux, ce problème ayant été abordé dans la directive sur les salaires minimaux. |
|
1.5. |
Le CESE demande instamment aux législateurs d’associer pleinement les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à l’élaboration de la taxinomie sociale, non seulement parce qu’ils sont directement concernés et soumis à des obligations de déclaration, mais aussi afin de maintenir un sentiment d’appropriation. Il s’interroge sur le recours excessif aux actes délégués dans le domaine de la taxinomie, car cette thématique englobe un large éventail de questions politiques. La taxinomie a pour objectif d’offrir une certaine transparence aux investisseurs, aux entreprises et aux consommateurs. À l’avenir, il conviendrait d’évaluer et d’examiner de manière approfondie son utilisation potentielle, par les institutions gouvernementales, comme référence pour les programmes d’aide et de financement. Toute utilisation plus large de la taxinomie doit faire l’objet d’un processus décisionnel approprié. Il convient d’éviter toute interférence excessive avec la législation nationale et l’autonomie des partenaires sociaux. Enfin, il y a lieu d’exclure tout risque de «blanchiment social». Des mécanismes de plainte à destination des syndicats, des comités d’entreprise, des organisations de consommateurs et autres représentants de la société civile organisée devraient être prévus et les autorités nationales compétentes devraient être davantage tenues d’assumer leurs fonctions de contrôle. |
|
1.6. |
Le CESE entend souligner d’autres avantages liés à une taxinomie sociale. Premièrement, il convient de soutenir la demande croissante d’investissements à dimension sociale en élaborant une taxinomie fiable qui constitue un concept cohérent de mesure de la durabilité sociale. Deuxièmement, les activités socialement dommageables pourraient se traduire par des risques économiques, qu’une taxinomie pourrait contribuer à réduire au minimum. Troisièmement, la transparence est un élément essentiel de l’efficacité du marché des capitaux et pourrait également contribuer à la dimension sociale du marché intérieur en vertu de l’article 3 du TFUE. Elle favoriserait l’égalité des conditions de concurrence, empêcherait la concurrence déloyale et améliorerait la visibilité des entreprises et des organisations qui contribuent à la durabilité sociale. Quatrièmement, l’Union devrait s’appuyer sur ses atouts et s’efforcer de montrer l’exemple en matière de durabilité environnementale et sociale et de jouer un rôle moteur à cet égard. Il conviendrait de relancer le débat sur une agence de notation de l’Union. Le CESE réitère également son appel en faveur d’une réglementation et d’une surveillance adéquates des fournisseurs de données financières et extrafinancières. |
|
1.7. |
Le CESE met également en avant des enjeux et solutions possibles. Premièrement, il existe des craintes d’un verrouillage du marché. Toutefois, les investissements reposent également sur d’autres critères, tels que le rendement escompté, qui pourraient l’emporter sur les objectifs de durabilité, et l’on observe de nombreux cas de synergies entre les investisseurs et les intérêts d’autres parties prenantes. En tout état de cause, les activités non conformes à la taxinomie ne doivent pas être considérées comme préjudiciables, ce qui devrait être indiqué clairement par la Commission. Il convient de souligner davantage l’incidence des investissements durables sur les activités de l’économie réelle. Deuxièmement, la définition de ce qui devrait être inclus dans la taxinomie sera controversée. C’est précisément la raison pour laquelle cette définition devrait faire l’objet d’un débat et d’une prise de décision démocratiques. Cela permettra ainsi de développer une idée commune et fiable de la durabilité, sur laquelle les différents acteurs pourraient et devraient s’appuyer. Le succès de la taxinomie est lié à sa crédibilité et les activités qui y seront incluses doivent répondre à une définition largement acceptée de la durabilité. Troisièmement, une taxinomie sociale pourrait entraîner des exigences supplémentaires en matière d’établissement de rapports. Le CESE invite la Commission à les réduire au minimum, tout en évitant les chevauchements. Il pourrait être utile qu’une agence disposant d’une autorisation légale puisse fournir des conseils et des services en lien avec la taxinomie, en particulier aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives et aux entreprises à but non lucratif. Les établissements financiers devraient par ailleurs être encouragés à évaluer les incidences sociales des investissements, comme le font actuellement dans le monde entier les banques fondées sur des valeurs éthiques. |
2. Contexte de l’avis
|
2.1. |
Le cadre de l’Union en matière de finance durable devrait contribuer à orienter les flux financiers privés vers des activités économiques durables. Le plan d’action de 2018 sur la finance durable se composait d’une taxinomie, d’un système de publication d’informations par les entreprises et d’outils d’investissement, y compris des indices de référence, des normes et des labels, tandis que la stratégie renouvelée de 2021 en matière de finance durable se concentre sur le financement de la transition de l’économie réelle vers la durabilité, ainsi que sur l’amélioration du caractère inclusif et de la résilience du secteur financier, sur sa contribution à la durabilité et sur les objectifs mondiaux. Dans ce contexte, l’Union a élaboré diverses initiatives législatives dans lesquelles la taxinomie de l’Union joue un rôle essentiel. Le CESE renvoie à ses avis en la matière (4). |
|
2.2. |
La taxinomie de l’Union devrait garantir la transparence pour les investisseurs et les entreprises et les aider à déterminer quels sont les investissements durables. Le règlement sur la taxinomie établit un système de classification qui se concentre sur six objectifs environnementaux dans les domaines de l’atténuation du changement climatique, de l’adaptation à celui-ci, de l’eau, de la biodiversité, de la prévention de la pollution et de l’économie circulaire. Un investissement durable sur le plan environnemental doit contribuer de manière significative à la réalisation d’un ou de plusieurs de ces objectifs, ne causer de préjudice important à aucun d’entre eux (principe DNSH) et respecter des seuils de performance, appelés critères d’examen technique. Il doit également respecter des garanties minimales en matière sociale et de gouvernance (article 18). Par conséquent, les entreprises doivent mettre en œuvre des procédures pour faire en sorte que leurs activités soient alignées sur les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que la charte internationale des droits de l’homme. |
|
2.3. |
L’article 26 du règlement charge la Commission de publier, pour la fin de l’année 2021, un rapport décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour étendre le champ d’application dudit règlement à «d’autres objectifs de durabilité, tels que des objectifs sociaux». Si une telle démarche révèle une intention d’élargir le champ d’application de cet acte, elle ne rend toujours pas obligatoire la mise en œuvre d’une taxinomie sociale. Conformément au règlement, le sous-groupe sur la taxinomie sociale de la plateforme sur la finance durable a été chargé d’étudier la possibilité d’élargir la taxinomie aux objectifs sociaux. Son rapport final sur la taxinomie sociale a été publié en février 2022 (5), soit plus tard qu’annoncé, et la Commission devrait élaborer son rapport sur cette base. En outre, la plateforme est invitée à conseiller la Commission sur l’application de l’article 18, c’est-à-dire à donner des orientations sur la manière dont les entreprises pourraient se conformer à des garanties minimales et sur la nécessité éventuelle de compléter les exigences de l’article. |
|
2.4. |
La plateforme propose pour la taxinomie sociale une structure qui s’inscrirait dans l’environnement législatif actuel de l’Union en matière de finance et de gouvernance durables. Si une taxinomie sociale était mise en œuvre, d’autres dispositions assureraient la mise en place d’un cadre réglementaire, parmi lesquelles la proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), qui remplacera la directive sur la publication d’informations non financières (NFRD) et introduira des normes contraignantes à l’échelle de l’Union en matière de publication d’informations sur la durabilité; le règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), et la directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (CSDD). En particulier, la CSRD telle que proposée impose aux entreprises de traiter également un ensemble d’informations sur des sujets sociaux ainsi que la publication d’informations sur les facteurs de gouvernance, et devrait améliorer la publication d’informations sur des questions sociales. Elle constituerait dès lors un complément important à une taxinomie sociale au regard de laquelle ces questions pourraient être analysées et évaluées. |
|
2.5. |
Malgré certaines différences, la plateforme suggère de suivre les aspects structurels de la taxinomie environnementale. Elle propose trois objectifs principaux assortis de sous-objectifs. L’objectif du travail décent comprend des sous-objectifs tels que le renforcement du dialogue social, la promotion de la négociation collective, ainsi que des salaires minimums vitaux qui garantissent une vie décente. L’objectif d’un niveau de vie adéquat porte notamment sur des produits sains et sûrs, des soins de santé de qualité et un logement de qualité, et l’objectif de communautés inclusives et durables vise également à promouvoir l’égalité et la croissance inclusive ainsi que des moyens de subsistance durables. Les garanties minimales proposées renvoient à des objectifs à la fois environnementaux, gouvernementaux et sociaux de manière à éviter toute incohérence, telle qu’une entreprise exerçant des activités durables qui serait impliquée dans des violations des droits de l’homme. En outre, il conviendrait de prendre en considération les parties prenantes intéressées, en particulier la main-d’œuvre et les travailleurs de la chaîne de valeur de l’entité en question, les utilisateurs finaux et les communautés concernées. Des critères DNSH dans le domaine social et l’établissement d’une liste des activités préjudiciables sont également proposés. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Le CESE plaide en faveur d’une politique économique qui soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et les ODD. L’accent doit être mis, de manière équilibrée, sur un certain nombre d’objectifs essentiels, tels que la durabilité environnementale, une croissance durable et inclusive, le plein emploi et la qualité de l’emploi, une répartition équitable, la santé et la qualité de vie, l’égalité entre les hommes et les femmes, la stabilité financière, la stabilité des prix, l’équilibre des échanges commerciaux dans le cadre d’une structure économique et industrielle équitable et compétitive, et la stabilité des finances publiques. Le CESE attire également l’attention sur le programme de durabilité compétitive, qui place ses quatre dimensions (durabilité environnementale, productivité, équité et stabilité macroéconomique) sur un pied d’égalité afin d’obtenir des effets de renforcement mutuel et de faire aboutir la transition écologique et numérique (6). Eu égard à la guerre en Ukraine provoquée par l’agression russe, le CESE réitère son appel en faveur d’une politique économique équilibrée qui contribue à en atténuer les conséquences économiques et sociales, et attire l’attention sur la déclaration de la constitution de l’OIT de 1919 selon laquelle «une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale». |
|
3.2. |
Le CESE entend mettre en lumière le concept de taxinomie sociale, dans le but de susciter le débat et de sensibiliser le public. Le CESE plaide en faveur d’une taxinomie sociale bien conçue, viable d’un point de vue opérationnel et rigoureuse sur le plan conceptuel, qui permette de vérifier les vastes possibilités qui se présentent tout en relevant les défis exposés ci-après. Tout comme la politique économique dans son ensemble, il convient d’inscrire le concept de durabilité dans le domaine de la finance, et en particulier la taxinomie de l’Union, dans une approche globale et multidimensionnelle qui placerait, autant que faire se peut, la durabilité environnementale et celle en matière sociale sur un pied d’égalité. En outre, la transition écologique peut être néfaste sur le plan social. Par conséquent, il y a lieu de protéger et d’améliorer les normes dans le domaine social, en mettant l’accent sur la nécessité de ne laisser personne de côté. Une transition juste requiert des conditions sociales durables, et une taxinomie sociale pourrait fournir des orientations à cet égard. |
|
3.3. |
Le CESE considère qu’une taxinomie sociale constitue un complément important et nécessaire à la dimension sociale de l’Union et invite la Commission à publier en temps utile le rapport demandé à l’article 26. Il convient d’adhérer à l’approche diversifiée et à niveaux multiples adoptée par le rapport de la plateforme. S’efforcer d’atteindre la perfection et d’intégrer en une fois tous les aspects de la durabilité sociale pourrait toutefois entraîner d’énormes retards de mise en œuvre de la taxinomie sociale et même soulever le risque d’un abandon du projet dans son ensemble. Le CESE recommande dès lors d’entamer le processus en établissant en temps utile des orientations simples et claires ainsi que des procédures faciles à mettre en œuvre en matière de transparence, puis de les compléter progressivement et en permanence. S’agissant de la relation entre la taxinomie environnementale et une taxinomie sociale, l’objectif devrait être de rechercher la cohérence et une intégration étroite des deux approches. Néanmoins, dans un premier temps, des garanties minimales réciproques pourraient s’avérer utiles. |
|
3.4. |
Le CESE se félicite que la plateforme ait publié un projet de rapport en lien avec l’article 18 du règlement afin de conseiller les entreprises sur la manière de mettre en œuvre les exigences de l’article et, éventuellement, de permettre sa modification. En particulier, dans le contexte de la durabilité sociale, il est essentiel d’évaluer les performances réelles d’une entreprise en matière de droits de l’homme, de relations industrielles et de travail décent. Cependant, si les garanties minimales de la taxinomie environnementale sont les bienvenues et devraient être pleinement mises en œuvre, elles ne remplaceront jamais une taxinomie sociale. Elles sont loin de pouvoir garantir à elles seules la durabilité sociale au bénéfice des travailleurs, des consommateurs et des communautés (7). Le CESE recommande par ailleurs de coopérer avec les partenaires sociaux, les organisations de la société civile et les entreprises sociales à l’échelon local, afin de surveiller et de promouvoir l’incidence positive des activités économiques sur les parties prenantes. |
|
3.5. |
La taxinomie sociale gagnera en importance si elle s’inscrit dans une politique globale axée sur la durabilité sociale et assortie de règles appropriées, par exemple concernant le devoir de diligence en matière de droits de l’homme. Toutefois, elle ne remplacera jamais une réglementation et une politique sociale solides. Le financement de la protection sociale par les dépenses publiques et la stabilité des systèmes de sécurité sociale restent primordiaux. La taxinomie ne devrait pas servir d’instrument d’éviction financière ou de privatisation. Les investissements publics continuent de jouer un rôle crucial dans le domaine des services publics et attirent souvent d’autres investissements privés. La taxinomie sociale pourrait cependant fournir à tous les investisseurs des critères de durabilité dans le domaine des infrastructures, de la santé, de l’éducation et de la formation ainsi que du logement social, afin de permettre des investissements socialement durables dans l’économie réelle et d’éviter tout phénomène de «blanchiment social». À l’avenir, la taxinomie pourrait également être utilisée par les institutions gouvernementales comme référence pour les programmes d’aide et de financement. Cette question devra faire l’objet d’une évaluation et d’un examen approfondis. |
|
3.6. |
Une taxinomie sociale permettrait de structurer de manière détaillée les incidences sociales positives et négatives des activités économiques. Parmi les points à l’examen, nombreux sont ceux qui sont étroitement liés à des questions traditionnellement débattues entre les partenaires sociaux et parmi les organisations de la société civile. Le CESE demande que la société civile organisée soit pleinement associée à l’élaboration de la taxinomie sociale, et notamment des (sous-)objectifs, des critères DNSH et des principes de garantie. Les employeurs, les travailleurs, les consommateurs et d’autres parties prenantes et communautés sont concernés par la conception des objectifs et/ou soumis à des obligations de déclaration. Le CESE attire également l’attention sur l’exemple des fonds de pension, dans le cadre desquels les salariés sont les bénéficiaires des investissements. La participation des parties prenantes est cruciale pour maintenir un sentiment d’appropriation. Le CESE espère que la mise en œuvre d’une taxinomie sociale passera par la révision du règlement, ce qui impliquerait de suivre la procédure législative ordinaire. Le recours excessif aux actes délégués dans le contexte de la finance durable et, en particulier, lors de la mise en œuvre de la taxinomie est discutable, car cette thématique englobe un large éventail de questions politiques allant bien au-delà de simples spécifications techniques. |
|
3.7. |
Le CESE fait valoir combien il importe d’accroître la qualité de l’information dans le domaine des investissements durables sur le plan social ainsi que de prévenir la désinformation touchant à la situation sociale, afin d’éviter toute incidence négative sur l’ensemble des parties prenantes. Une taxinomie sociale bien conçue contribuerait de manière significative à résoudre ces problèmes en mettant en lumière les actions et les entreprises qui participent grandement à la durabilité sociale. Elle devrait constituer une norme de référence et refléter un niveau d’ambition plus élevé que celui déjà prévu dans la législation, tout en trouvant le juste équilibre entre un champ d’application trop large et trop étroit. Si les critères environnementaux reposent avant tout sur la science, une taxinomie sociale telle que proposée par la plateforme s’appuierait davantage sur des normes et des cadres convenus au niveau international qui, sans être prescriptifs, serviraient d’orientations pour encourager les activités socialement durables. |
|
3.8. |
Le respect des droits de l’homme et des droits des travailleurs doit être une condition de conformité à la taxinomie. De même, le respect des conventions collectives et des mécanismes de cogestion conformément à la législation nationale et européenne en la matière est essentiel et devrait constituer un principe DNSH. En outre, des orientations prévoyant des procédures simples et transparentes ayant des incidences sociales positives, fondées sur l’accord des partenaires sociaux, devraient constituer une activité économique conforme à la taxinomie. À cet égard, il importe de garder à l’esprit que le taux de couverture par des conventions collectives varie considérablement d’un État membre à l’autre, n’atteignant que 7 % en Lituanie pour se monter à 98 % en Autriche. Depuis 2000, il a baissé dans 22 États membres, et l’on estime que le nombre de travailleurs qui sont protégés grâce à un accord négocié par cette voie a diminué d’au moins 3,3 millions de personnes. Pour mettre en œuvre la taxinomie sociale, la nouvelle directive relative à des salaires minimaux et l’extension de l’application des accords issus de la négociation collective joueront également un rôle important (8). Le CESE recommande par ailleurs de fournir des conseils clairs sur la mise en œuvre de garanties minimales dans l’acte juridique proposé lui-même, en s’appuyant éventuellement sur le rapport de la plateforme consacré à l’article 18 du règlement. |
|
3.9. |
La taxinomie sociale pourrait se fonder sur une série de normes et de principes internationaux et européens. En ce qui concerne les (sous-)objectifs, le CESE recommande d’établir des liens avec le socle européen des droits sociaux et le plan d’action connexe ainsi qu’avec les ODD pertinents, en particulier l’ODD 8 (travail décent et croissance économique), l’ODD 1 (pas de pauvreté), l’ODD 2 (faim «zéro»), l’ODD 3 (santé et bien-être), l’ODD 4 (éducation et formation), l’ODD 5 (égalité entre les sexes), l’ODD 10 (inégalités réduites) et l’ODD 11 (villes et communautés durables). Les cadres approuvés par les partenaires sociaux pourraient également constituer une référence de choix. Le CESE juge essentielle l’idée de la plateforme consistant à mettre en œuvre les garanties minimales sur la base des principes directeurs des Nations unies et de l’OCDE. La charte sociale européenne, la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la convention européenne des droits de l’homme et la proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité constitueraient également des points de référence précieux pour une taxinomie sociale. Enfin, il convient d’exclure les activités jugées particulièrement préjudiciables, c’est-à-dire celles qui s’opposent fondamentalement et en toutes circonstances à tout objectif de durabilité et qu’aucun moyen ne permettrait de rendre moins dommageables. Il y a lieu notamment de ranger dans cette catégorie les armes bannies par des accords internationaux, telles que les bombes à sous-munitions ou les mines antipersonnel. Le CESE recommande également d’élaborer une marche à suivre à l’égard des régimes agressifs et belliqueux. |
4. La taxinomie sociale comme source de possibilités
|
4.1. |
Le CESE recommande vivement d’exploiter le potentiel de la taxinomie pour orienter les investissements vers des activités et des entités socialement durables et créer des emplois décents. La part de citoyens de l’Union confrontés au risque de pauvreté est largement supérieure à 20 %; la pandémie a exacerbé les inégalités et la guerre en Ukraine accentuera encore les tensions économiques et sociales. À l’échelle mondiale, on estime qu’environ 3 300 à 4 500 milliards de dollars (USD) doivent être mobilisés chaque année pour atteindre les ODD. Les produits fabriqués dans des conditions de violation des droits de l’homme en matière de travail ont un lien avec le marché de l’Union vers lequel ils sont importés. Dans l’Union, il est également nécessaire d’investir de toute urgence dans le domaine social, par exemple dans la réduction de la pauvreté, l’apprentissage tout au long de la vie et la santé (9). L’écart minimal en matière d’investissements dans les infrastructures sociales a été estimé à environ 1 500 milliards d’EUR entre 2018 et 2030 (10). Le CESE invite la Commission à fournir une estimation actualisée des besoins à combler en matière d’investissement pour se conformer aux principes du socle européen des droits sociaux et atteindre les grands objectifs de l’Union pour 2030. Des fonds publics et privés substantiels sont nécessaires pour mettre en œuvre la durabilité sociale. |
|
4.2. |
Grâce à la taxinomie sociale, les investisseurs et les entreprises pourraient évaluer l’impact social de leurs investissements ou activités et considérer volontairement cette démarche comme un objectif essentiel. Le CESE attire l’attention sur la demande croissante d’investissements à dimension sociale et se félicite de l’ouverture des investisseurs à une finance qui soit durable sur le plan social. En revanche, l’on constate un manque de définitions et de normalisation, et l’analyse des notations dans le domaine environnemental, social et de la gouvernance (ESG) et des résultats connexes révèle également des différences fondamentales en fonction de l’organisme à l’origine de la notation, ce qui complique la tâche de ceux qui souhaitent investir de manière socialement durable. Une taxinomie sociale constituerait un concept cohérent pour définir et faire progresser la durabilité sociale et mesurer les progrès accomplis. Elle est susceptible de renforcer l’obligation de rendre des comptes et de fournir des orientations claires. Elle apporterait dès lors un soutien décisif aux investisseurs dans la réalisation de leurs ambitions et pourrait inciter d’autres acteurs du marché à investir dans ce domaine, tout en contribuant à la prévention du blanchiment social. |
|
4.3. |
Les activités socialement dommageables peuvent également se traduire par des risques économiques. Une entreprise associée à des violations des droits de l’homme court le risque d’être boycottée, et une société qui négligerait son devoir de diligence en la matière pourrait se voir couper l’accès aux marchés publics. Elle pourrait également se retrouver empêtrée dans de coûteuses procédures judiciaires pour violation des droits de l’homme, ou voir ses chaînes d’approvisionnement perturbées par des grèves. Les risques économiques et politiques liés au creusement des inégalités entre les riches et les pauvres pourraient également affecter les investissements. Ces différents risques pourraient être réduits si les décisions d’investissement s’appuyaient notamment sur une taxinomie sociale. Le CESE attire également l’attention sur les travaux de la Banque centrale européenne (BCE) visant à renforcer le suivi et la gestion des risques systémiques imputables à la négligence des facteurs de durabilité. Il souligne que les risques environnementaux s’accompagnent souvent de risques sociaux, par exemple lorsque des personnes perdent leur logement en raison d’une inondation. Dans l’ensemble, les risques en matière de durabilité sociale devraient être abordés de manière explicite et être couverts par l’action de la BCE sur les risques liés à la durabilité. |
|
4.4. |
Le CESE souligne en outre que la transparence est un élément essentiel de l’efficacité du marché. Cela ne vaut pas uniquement pour les marchés des capitaux. Une taxinomie sociale pourrait également servir d’outil pour favoriser un équilibre entre les libertés économiques et les droits sociaux et du travail (11). En renforçant la transparence, elle pourrait contribuer à la dimension sociale du marché intérieur en vertu de l’article 3 du TFUE et promouvoir une concurrence équitable. En outre, elle favoriserait l’égalité des conditions de concurrence et améliorerait la visibilité des entreprises qui respectent les droits de l’homme et des travailleurs et participent de manière substantielle à la durabilité sociale, les aidant ainsi à attirer les investisseurs. Le potentiel de transformation qu’offre la taxinomie serait renforcé si on la faisait connaître davantage. Dans ce contexte, le CESE rappelle à nouveau le rôle positif que peuvent jouer les instruments financiers dans le développement des entreprises à impact social (12). |
|
4.5. |
Enfin, l’Union s’est imposée sur la scène internationale comme chef de file dans le domaine de la finance durable d’un point de vue environnemental et contribue activement à cet effort mondial. S’il se félicite de ces démarches, le CESE rappelle à la Commission qu’il est indispensable de progresser également dans le domaine de la durabilité sociale et de promouvoir les ODD. L’UNION devrait s’efforcer de montrer également l’exemple en matière de durabilité sociale et jouer un rôle moteur à cet égard en abordant la question dans les enceintes internationales. En cette période de guerre et de tensions internationales, une architecture internationale de la finance durable se doit, plus que jamais, de prendre également en considération la durabilité sociale. |
5. Défis et solutions possibles
|
5.1. |
La volonté des investisseurs financiers de réaliser des investissements durables sur les plans social et environnemental est tout à fait bienvenue et doit être soutenue. Cela étant, les acteurs des marchés financiers prennent en général leurs décisions d’investissement sur la base d’attentes en matière de rendement, de risque, de liquidité et de maturité. Ces motivations pourraient aller à l’encontre des intérêts d’autres parties prenantes et nuire aux objectifs environnementaux et sociaux, voire l’emporter sur ces derniers. Toutefois, le CESE attire également l’attention sur les nombreuses synergies possibles entre les intérêts des investisseurs et ceux d’autres parties prenantes, par exemple lorsqu’une participation accrue des travailleurs va de pair avec l’amélioration de la productivité des entreprises ou qu’une activité économique contribue au bien-être de la population. En tout état de cause, les activités ou entités économiques potentiellement non conformes à la taxinomie ne doivent pas automatiquement être considérées comme préjudiciables. Des craintes d’un verrouillage du marché voient le jour dans ce contexte, et le CESE demande à la Commission des éclaircissements ainsi qu’une approche équilibrée. Il convient de souligner davantage l’incidence des investissements durables sur les activités de l’économie réelle. |
|
5.2. |
Des incompatibilités pourraient survenir parce que les questions sociales sont réglementées au niveau des États membres et dans le cadre d’échanges entre les partenaires sociaux, tandis que la société civile organisée dans son ensemble s’efforce d’être associée aux politiques, entre autres sociales et environnementales. Cependant, le CESE se félicite du rapport de la plateforme en ce qui concerne les risques d’infractions à d’autres règlements et part du principe que la proposition de la Commission veillera à éviter les chevauchements et les interférences contradictoires avec les systèmes sociaux, les relations industrielles et les réglementations nationales. En outre, une taxinomie sociale reposerait sur des déclarations et des principes communs au niveau international et européen — comme le socle européen des droits sociaux — et viendrait appuyer une prise de décision volontaire, sans imposer aucune politique sociale particulière. Cela étant, toute utilisation plus large de la taxinomie, telle que visée ci-dessus, doit faire l’objet d’un processus décisionnel approprié. Il convient d’éviter toute interférence excessive avec la législation nationale et l’autonomie des partenaires sociaux et de reconnaître la diversité des modèles de marché du travail et des systèmes de négociation collective en vigueur à l’échelon national. |
|
5.3. |
L’élaboration d’une taxinomie sociale et, partant, d’une vue d’ensemble structurée des activités et secteurs socialement durables touche également aux valeurs politiques. Il sera difficile de définir quelle activité économique et/ou quel secteur est jugé conforme à la taxinomie. C’est néanmoins la raison pour laquelle l’élaboration d’une taxinomie devrait faire l’objet d’un débat et d’une prise de décision démocratiques (13). Ce n’est que dans ces conditions qu’il sera possible de développer une idée commune de la durabilité sociale, qui pourrait et devrait servir de base et de référence pour les différents acteurs. Le CESE souligne que, dans le domaine social également, le succès de la taxinomie dépend de son acceptation générale. Les activités et les secteurs concernés doivent répondre à une définition largement acceptée de la durabilité, fondée sur des valeurs généralement reconnues telles que la dignité humaine, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’équité, l’inclusion, la non-discrimination, la solidarité, le caractère abordable, le bien-être et la diversité. Il est essentiel de préserver la crédibilité de la taxinomie pour éviter de compromettre le projet dans son ensemble. |
|
5.4. |
D’autres préoccupations portent sur le fait qu’une taxinomie sociale pourrait faire peser une charge excessive sur les entreprises en leur imposant des obligations supplémentaires en matière de déclaration et en les contraignant à fournir des informations complexes et difficiles, assorties de procédures d’audit onéreuses. Le CESE invite la Commission à réduire ces charges au minimum et à élaborer des critères simples et facilement observables, tout en s’appuyant sur les chevauchements avec d’autres obligations de déclaration. Le CESE se félicite de l’approche adoptée par la plateforme, qui consiste à conférer aux objectifs de la taxinomie sociale une structure comparable à celle proposée dans le cadre de la CSRD. De manière générale, il plaide en faveur d’un ensemble de règles ordonné et cohérent, dont la complexité ne soit pas excessive et qui évite toute redondance inutile, de façon à pouvoir fonctionner dans la pratique tout en garantissant la transparence nécessaire. Il pourrait également être utile qu’une agence spécialisée disposant d’une autorisation légale puisse fournir aux entreprises et aux autres organisations désireuses de se conformer à la taxinomie des conseils et des services en lien avec cette thématique. Cela garantirait par ailleurs que les entreprises pouvant consacrer moins de ressources aux procédures de déclaration aient accès à la taxinomie. Les établissements financiers restent toutefois en mesure d’évaluer les incidences sociales des investissements, comme le font actuellement dans le monde entier les banques fondées sur des valeurs éthiques. |
|
5.5. |
Si la taxinomie vise à fournir un cadre fiable pour des investissements socialement durables, le risque d’un «blanchiment» écologique ou social ne peut être exclu. Le CESE partage l’avis de la plateforme selon lequel le simple contrôle des engagements et des politiques ne garantit pas une mise en œuvre effective et la protection des droits de l’homme ni ne favorise le développement d’activités socialement durables. Il est extrêmement difficile de surveiller et de faire respecter les objectifs de durabilité sociale proclamés par une entreprise et d’évaluer ses performances tout au long des chaînes d’approvisionnement, qui sont souvent très complexes à l’heure actuelle. D’un autre côté, la plateforme met en lumière des évolutions prometteuses dans le domaine des données sociales quantifiables, notamment dans le contexte du tableau de bord social révisé et des ODD. De manière générale, la taxinomie sociale doit être transparente, fiable et actualisée en permanence. Le CESE propose à cet égard d’intégrer également, par exemple, les comités d’entreprise et les organisations de la société civile. |
|
5.6. |
Le CESE suggère de relancer le débat sur une agence de notation de l’Union, qui pourrait désormais se concentrer sur la durabilité, et de consolider ainsi le rôle pionnier de l’Union dans ce domaine. Il réitère également son appel en faveur d’une réglementation et d’une surveillance adéquates des fournisseurs de données financières et extrafinancières. Des mécanismes de plainte à destination des syndicats, des comités d’entreprise, des organisations de consommateurs et autres représentants de la société civile organisée devraient être prévus en cas de fausses allégations de conformité avec la taxinomie. Le CESE reconnaît que le règlement laisse aux États membres le soin de définir les mesures et sanctions applicables en cas d’infraction. En tout état de cause, les autorités nationales compétentes (14) devraient être davantage tenues d’assumer leurs fonctions de contrôle, ainsi que de faire rapport à leurs parlements et à la société civile. |
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.
(2) Plateforme sur la finance durable | Commission européenne (europa.eu).
(3) DNSH = «do no significant harm» ou «ne pas causer de préjudice important».
(4) JO C 517 du 22.12.2021, p. 72.
(5) «Final Report on Social Taxonomy» (Rapport final sur la taxinomie sociale) (europa.eu).
(6) JO C 275 du 18.7.2022, p. 50.
(7) JO C 152 du 6.4.2022, p. 97.
(8) Directive relative à des salaires minimaux adéquats dans l’UE, article 4, paragraphe 2, de l’accord provisoire. Le seuil de 80 % qui y est fixé en matière de couverture par des négociations collectives, destiné à contraindre les États membres à prendre des mesures pour accroître ce taux, devrait être soutenu dans une taxinomie sociale.
(9) «Final Report on Social Taxonomy» (Rapport final sur la taxinomie sociale) (europa.eu).
(10) Commission européenne, Boosting Investment in Social Infrastructure in Europe (Stimuler l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe), Discussion Paper 074, janvier 2018.
(11) JO C 275 du 18.7.2022, p. 50.
(12) JO C 194 du 12.5.2022, p. 39.
(13) Voir supra, point 3.
(14) Règlement sur la taxinomie, article 21.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/23 |
Avis du Comité économique et social européen sur le financement d’un fonds d’ajustement climatique à l’aide du Fonds de cohésion et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
(avis d’initiative)
(2022/C 486/04)
|
Rapporteur: |
Ioannis VARDAKASTANIS |
|
Corapporteure: |
Judith VORBACH |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
|
Adoption en section |
9.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
139/3/3 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
L’Union européenne prend actuellement des mesures importantes pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Les politiques de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie sont conçues dans une perspective à long terme afin de contribuer à prévenir les conséquences les plus graves de l’urgence climatique à laquelle le monde est confronté. Toutefois, cela pourrait s’avérer encore insuffisant. |
|
1.2. |
Si l’engagement de l’Union est important, les conséquences du changement climatique et de la raréfaction des ressources se font malheureusement déjà ressentir. L’Union doit donc s’adapter à une réalité qu’elle n’a pas connue auparavant. Si elle est déterminée à juste titre à éviter une aggravation de la situation, elle n’est toutefois pas préparée à faire face aux urgences climatiques imprévues, aux crises énergétiques et aux catastrophes naturelles. |
|
1.3. |
Depuis 2021, nous avons connu deux situations d’urgence très notables face auxquelles les mécanismes de financement de l’Union se sont révélés mal équipés pour apporter une réponse. La première est l’ensemble de destructions causées par les inondations et les incendies de forêt dans toute l’Europe au cours de l’été 2021. La seconde est la crise énergétique actuelle, avec la nécessité pour l’Union d’accéder à l’autonomie énergétique à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022. |
|
1.4. |
Le mécanisme dont l’Union dispose actuellement pour faire face aux catastrophes naturelles est le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE). Toutefois, son budget est dérisoire au regard des coûts des dommages causés par les catastrophes naturelles récentes et devrait être considérablement augmenté. Le financement consacré par l’Union à la transition vers une énergie verte est plus important, mais ne tient pas compte de l’urgence des besoins actuels de l’Union en matière d’autonomie en énergie et de l’immense risque que représente la précarité énergétique, comme le CESE l’a souligné dans son avis intitulé «Lutte contre la précarité énergétique et résilience de l’Union: enjeux économiques et sociaux» (1). |
|
1.5. |
Le CESE estime que l’Union a besoin d’un nouveau mécanisme de financement capable d’apporter une aide immédiate et ambitieuse aux États membres dans de telles situations d’urgence. Il propose dès lors la création d’un nouveau Fonds d’adaptation au changement climatique. Ce dernier devrait être alimenté par une réaffectation de ressources de l’Union existantes, provenant notamment du Fonds de cohésion et de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), mais ces ressources seraient gérées de manière rationalisée et cohérente par l’intermédiaire de ce nouveau fonds. |
|
1.6. |
Dans le cadre de la modernisation de l’environnement de financement, l’on pourrait également prévoir d’élargir le champ d’application des programmes existants et de les renforcer, et envisager de considérer l’instrument de l’Union européenne pour la relance (NextGenerationEU) comme modèle pour un nouvel instrument de financement. |
|
1.7. |
Compte tenu des besoins importants en investissements, le CESE recommande également à la Commission d’envisager de renforcer le Fonds d’adaptation au changement climatique en encourageant les investissements et les contributions privés. En ce qui concerne plus particulièrement les catastrophes naturelles, la Commission et les États membres devraient également s’efforcer d’accroître et de faciliter la couverture d’assurance et d’utiliser le système d’assurance comme un moyen d’orienter directement les financements vers l’amélioration de la résilience face au changement climatique, en particulier dans les zones à risque, afin de réduire la dépendance à l’égard du soutien financier de l’Union. |
|
1.8. |
Le Fonds d’adaptation au changement climatique doit être adaptable, flexible et prêt à réagir aux crises nouvelles et émergentes dans les années et les décennies à venir. |
|
1.9. |
Il est essentiel que le fonctionnement du Fonds d’adaptation au changement climatique, davantage axé sur des réponses rapides et urgentes, soit cohérent avec les politiques globales de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie, qui, à long terme, réduiront la dépendance à l’égard des réponses d’urgence et protégeront l’humanité ainsi que le monde naturel. |
2. Observations générales
|
2.1. |
Le CESE reconnaît que la lutte contre la crise climatique s’inscrit dans les engagements pris par l’Union dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, en vue de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable (ODD). Si la lutte contre les causes du changement climatique devrait être à l’avant-garde de la politique climatique de l’Union, le CESE souligne la nécessité de disposer, parallèlement aux plans de réduction des émissions de GES, de mécanismes de financement solides et rationalisés pour faire face aux urgences climatiques et énergétiques auxquelles les citoyens de l’Union sont déjà confrontés. |
|
2.2. |
La vision du CESE est que l’on devrait créer un nouveau Fonds d’adaptation au changement climatique, une proposition soutenue par plusieurs membres du Parlement européen (2). Ce mécanisme devrait être alimenté par des ressources existantes provenant des fonds de cohésion et de la FRR et concentrées dans un fonds unique qui en améliorera l’efficacité et la réactivité et facilitera un suivi centralisé des secteurs où les besoins de financement sont les plus pressants. Il devrait renforcer la capacité de l’Union à aider les États membres à réagir rapidement aux urgences climatiques, environnementales et énergétiques. Dans le contexte actuel, il servirait à faire face à deux des situations d’urgence les plus flagrantes que nous connaissons: la nécessité de se redresser après des catastrophes naturelles, lesquelles sont de plus en plus fréquentes, et celle d’opérer d’urgence une transition vers une énergie verte et un mouvement vers l’autonomie énergétique européenne, avec toutefois une certaine flexibilité pour faire face aux crises futures. |
|
2.3. |
L’Union européenne consacre déjà des financements à la transition énergétique et à la reprise après une catastrophe, mais divers problèmes nuisent à leur efficacité. L’actuel Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), mis en place pour aider les communautés locales à se redresser après des catastrophes naturelles, est tout simplement de dimension trop restreinte pour répondre à l’ampleur des catastrophes climatiques modernes. Le financement consacré à la transition énergétique est plus ambitieux, mais encore loin d’être suffisant. Il est par ailleurs géré par l’intermédiaire de plusieurs fonds distincts, avec un risque d’incohérence ou de chevauchement, et d’une manière qui combine des objectifs d’urgence absolue et des objectifs à plus long terme en matière de lutte contre le changement climatique. La nécessité de renforcer l’autonomie énergétique de l’Union du fait de l’invasion de l’Ukraine par la Russie a mis en évidence la mesure dans laquelle notre dépendance énergétique vis-à-vis de pays hostiles affaiblit notre capacité à réagir de manière décisive face aux événements internationaux. |
|
2.4. |
Le CESE plaide dès lors en faveur de la création d’un Fonds d’adaptation au changement climatique, dont l’objectif spécifique est de répondre aux urgences imminentes en matière d’environnement, de climat et d’énergie et d’aider l’Union à s’adapter à une nouvelle réalité dans laquelle de telles crises deviennent malheureusement de plus en plus fréquentes. Le Fonds d’adaptation au changement climatique devrait servir de réserve de financement, prête à passer immédiatement à l’action en cas de besoin pressant d’investissement. |
|
2.5. |
Le fonds devra offrir la souplesse et la solidité nécessaires à des investissements rapides et ambitieux pour répondre aux besoins immédiats de l’Union, tout en restant cohérent avec les politiques à long terme en matière de climat et d’énergie. Il devrait regrouper une partie des fonds de cohésion actuellement destinés aux questions climatiques, le FSUE existant et une partie des ressources de la FRR destinées aux réformes environnementales. Le fait de concentrer ces ressources dans un fonds unique mettant clairement l’accent sur les mesures d’urgence permettra d’améliorer l’efficacité de la réaction et de faciliter le suivi des besoins d’investissement les plus pressants. Cette approche devrait améliorer la capacité à aiguiller sans délai les ressources là où se situent les besoins. |
|
2.6. |
Dans le cadre de la modernisation de l’environnement de financement, l’on pourrait également prévoir d’élargir le champ d’application des programmes existants et de les renforcer. Compte tenu de l’intérêt commun et de l’urgence de lutter contre le changement climatique et ses conséquences catastrophiques, le CESE souligne également la nécessité d’une meilleure méthode de financement à l’avenir. Même si une règle d’or pour les investissements verts devait (à juste titre) être mise en œuvre, il se pourrait que certains États membres n’aient toujours pas la capacité de lever les montants massifs d’investissements nécessaires sans compromettre leur viabilité budgétaire. Par conséquent, le CESE recommande également de considérer NextGenerationEU comme un modèle pour le financement du Fonds d’adaptation au changement climatique. Les subventions et/ou prêts au titre de ce fonds devraient être débloqués à condition que l’État membre ou la région qui les reçoit investisse les moyens nécessaires pour lutter contre le changement climatique ou ses conséquences, par exemple en réalisant des investissements ultérieurs dans les énergies renouvelables et décarbonées. Toute intervention de ce type doit être conditionnée à la participation obligatoire des partenaires sociaux et des organisations de la société civile, et le principe de partenariat inscrit dans la politique de cohésion doit être respecté. |
|
2.7. |
Le CESE fait observer que le Fonds d’adaptation au changement climatique ne suffira pas, à lui seul, pour faire face aux conséquences des catastrophes naturelles et couvrir les coûts de l’adaptation au changement climatique destinée à accroître la résilience. Dans ce contexte, le CESE attire l’attention sur le «déficit de protection contre les aléas climatiques», à savoir la part des pertes économiques non assurées induites par les catastrophes climatiques. La couverture d’assurance contre les catastrophes naturelles reste faible en Europe: entre 1980 et 2017, seules 35 % environ des pertes dues aux catastrophes naturelles ont été couvertes par les assurances (3). Il est donc important d’analyser et de favoriser l’assurance contre les catastrophes dans les États membres et de promouvoir des systèmes d’assurance nationaux qui incitent les utilisateurs à investir dans l’adaptation, de manière à moins solliciter les fonds de l’Union et à encourager des investissements proactifs. Le dialogue entre les parties prenantes et l’innovation en matière de produits d’assurance peuvent faire émerger de nouvelles solutions de transfert des risques dans le cadre du système d’assurance et de réassurance, tout en donnant la priorité à la stabilité des marchés financiers et à la protection des consommateurs (4). La capacité du Fonds d’adaptation au changement climatique à pouvoir relever les défis qui l’attendent s’en trouverait améliorée. |
|
2.8. |
Les fonds de l’Union ont également un rôle important à jouer comme capital d’amorçage pour attirer les investissements privés, notamment vers les mesures d’adaptation visant à améliorer la résilience face au changement climatique. |
3. Le Fonds d’adaptation au changement climatique en tant qu’outil de préparation et de reprise en cas de catastrophe naturelle
|
3.1. |
Une étude interinstitutionnelle de l’Union met en évidence l’urgence de lutter contre la catastrophe climatique: «Une augmentation de 1,5 oC est le maximum que la planète puisse tolérer; si les températures continuent d’augmenter au-delà de 2030, nous serons confrontés non seulement à toujours plus de sécheresses, d’inondations, d’épisodes de chaleur extrême et à l’extension de la pauvreté à des centaines de millions de personnes, mais également à la disparition probable des populations les plus vulnérables» (5). |
|
3.2. |
Il commence à devenir manifeste que nous sommes extrêmement mal préparés aux défis du changement climatique. En 2021, les États membres de l’Union ont connu des destructions sans précédent provoquées par des catastrophes naturelles, depuis les inondations meurtrières en Allemagne et au Benelux jusqu’aux incendies de forêt catastrophiques qui ont touché la Grèce et l’Espagne. À observer la crise climatique et les autres sources de dégradation de l’environnement avec lesquelles elle se combine, il est probable que les destructions et les catastrophes naturelles deviendront la norme plutôt que l’exception. Plus l’on reporte, édulcore ou évite la prise de mesures efficaces pour faire face à la crise climatique et à la dégradation de l’environnement, plus les risques deviennent importants. |
|
3.3. |
Au moins 240 personnes ont perdu la vie lors des inondations qui ont frappé l’Europe occidentale au cours de l’été 2021 (6), sans parler des innombrables personnes déplacées ou ayant perdu leur foyer. En Grèce, ce ne sont pas moins de 500 feux de forêt qu’il a fallu combattre lors de la canicule qui a frappé le pays (7). |
|
3.4. |
L’ampleur des destructions et des pertes en vies humaines dues aux catastrophes environnementales de 2021 a été sans précédent, de même que le coût financier pour les localités touchées. En Europe occidentale, les inondations ont causé, selon les estimations, 38 milliards d’EUR de dommages (8). En Grèce, le Premier ministre a été obligé d’approuver un programme d’aide de 500 millions d’EUR en faveur de l’île d’Eubée, la région la plus touchée par les incendies (9). |
|
3.5. |
Aucune région sur la planète n’est à l’abri du danger croissant de catastrophes naturelles. De même, aucun État membre de l’Union n’est suffisamment bien équipé pour relever des défis aussi importants — que ce soit en termes de ressources et de matériel pour faire face aux sécheresses, aux incendies de forêt et aux inondations, que sur le plan des financements nécessaires pour aider les zones touchées à se redresser. |
|
3.6. |
Les investissements du Fonds d’adaptation au changement climatique destinés à faire face aux catastrophes naturelles devraient s’efforcer de compléter les dépenses en cours au titre des Fonds structurels et d’investissement de l’Union en faveur de la préparation et de la prévention des catastrophes. Des investissements considérables sont nécessaires pour créer une résilience face aux effets du changement climatique, par exemple dans la construction de digues, de bâtiments résistant aux inondations, de protections contre l’érosion côtière, d’équipements pour surveiller et contenir les incendies de forêt, et dans des technologies permettant d’économiser et de stocker de l’eau douce, dans les zones touchées par les sécheresses, entre autres. Les Fonds structurels et d’investissement devraient intervenir en amont afin de réduire les dommages potentiels, tandis que le Fonds d’adaptation au changement climatique devrait servir à réagir rapidement là où de telles mesures préventives n’ont pas permis d’empêcher certains sinistres. |
|
3.7. |
Le CESE souligne que les répercussions prévisibles de la crise climatique nécessitent un mécanisme de soutien beaucoup plus solide que celui actuellement en place. Le budget total du Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE) est plafonné à 500 millions d’EUR par an (10). Depuis sa mise en place en 2002, le FSUE a soutenu 28 pays européens différents pour un montant d’ensemble de plus de 7 milliards d’EUR (11). Pour impressionnant que soit ce chiffre, il ne suffirait en aucune manière à couvrir les coûts des dommages causés par les catastrophes naturelles pour la seule année 2021. |
|
3.8. |
En cas de catastrophes naturelles, nous constatons un risque accru de pertes de vies humaines chez certains groupes qui ne peuvent pas facilement évacuer les zones touchées. C’est notamment le cas des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants. Les investissements doivent être ciblés pour faire en sorte que les services d’urgence dans les zones touchées disposent du matériel et du personnel de secours supplémentaire pour venir en aide à toutes les personnes nécessitant une attention particulière. De même, les personnes disposant de moins de ressources sont moins à même d’évacuer, en raison du coût de la recherche d’un autre logement et de leur accès limité aux moyens de mobilité individuelle. Le Fonds d’adaptation au changement climatique devrait chercher à traiter ce problème. |
4. Le Fonds d’adaptation au changement climatique en tant que voie d’accès à la transition vers une énergie verte
|
4.1. |
Le CESE est d’avis que l’adaptation au changement climatique consiste également à s’adapter à une nouvelle réalité s’agissant de la production d’énergie durable. En raison des évolutions récentes de la situation, l’Union est confrontée à des défis colossaux et urgents en ce qui concerne son indépendance énergétique, qui n’ont pas été anticipés lors de l’élaboration du cadre financier pluriannuel (CFP), de NextGenerationEU et du cadre de gouvernance économique. Se référant au plan «REPowerEU» de la Commission (12) et aux conclusions du Conseil européen, le CESE convient pleinement qu’à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les arguments en faveur de l’indépendance énergétique n’ont jamais été aussi forts, y compris grâce au développement des énergies renouvelables. |
|
4.2. |
Le CESE souligne la nécessité de se concentrer sur le rôle que les technologies énergétiques vertes et décarbonées, qui améliorent l’efficacité énergétique et réduisent la demande en énergie, peuvent jouer pour fournir davantage d’énergie dans l’Union et la rendre plus abordable financièrement. Une telle démarche contribuera à protéger l’Union contre les hausses de prix, qui entravent la croissance économique, aggravent les inégalités, entraînent la précarité énergétique, augmentent les coûts de production et nuisent à sa compétitivité. En particulier, le CESE se félicite de l’accélération du déploiement de solutions innovantes fondées sur l’hydrogène et d’une électricité renouvelable compétitive au regard des coûts dans les secteurs industriels. |
|
4.3. |
La nécessité d’investir de toute urgence et de manière ambitieuse dans la transition vers la production de formes d’énergie plus vertes au sein de l’Union est plus importante que jamais. Si la production d’énergie verte et l’autonomie énergétique devraient toujours être un objectif à long terme pour l’Union, dans le contexte immédiat, celle-ci a un besoin urgent de fournir de l’énergie à un prix abordable à partir de sources alternatives, sans compromettre ses objectifs énergétiques. Le Fonds d’adaptation au changement climatique pourrait apporter une réponse plus efficace et efficiente que les mécanismes existants aux besoins d’investissement urgents en vue de fournir aux citoyens de l’énergie abordable à partir de sources alternatives. |
|
4.4. |
Le CESE observe qu’il est de plus en plus clair que la dépendance énergétique est un facteur de causalité qui affaiblit les réactions de l’Union face des pays tels que la Russie, comme le montre clairement la manière dont l’Union répond à l’invasion de l’Ukraine. La dépendance excessive actuelle à l’égard du gaz russe compromet gravement la capacité de l’Union et de ses États membres à prendre rapidement des mesures sans exposer leurs propres citoyens à un risque de pénurie de carburant et de précarité énergétique. Hélas, les projets visant à acheter du gaz naturel aux États-Unis ne constituent pas une solution durable ou responsable sur le plan environnemental (13). |
|
4.5. |
Le Fonds d’adaptation au changement climatique devrait servir de moyen de financement du besoin urgent pour l’Union de produire de l’énergie verte et décarbonée sur son territoire, par le recours à des marchés publics ambitieux pour les technologies existantes et à des investissements dans le développement de nouvelles technologies afin de parvenir à une économie à émissions nulles. Le CESE insiste sur le fait que la guerre en Ukraine ne doit pas conduire à négliger la mission de l’Union consistant à atteindre les objectifs environnementaux et sociaux, qui sont à la base du renforcement de sa puissance économique sur le long terme. |
|
4.6. |
Pour ce qui est de la réduction de la consommation d’énergie, les progrès enregistrés sont très contrastés suivant les États membres. En 2018, seuls 11 des 27 États membres avaient baissé leur demande nationale totale en énergie en dessous de leur objectif pour 2020. Dans l’ensemble, l’Union est loin d’atteindre ses objectifs pour 2030, ce qui signifie que des efforts supplémentaires sont nécessaires. Heureusement, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie dans l’Union ne cesse d’augmenter. Le paquet «Ajustement à l’objectif 55» a proposé d’atteindre une proportion de 40 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici à 2030. Si la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie varie également considérablement d’un État membre à l’autre, il en va de même pour la capacité de production d’énergie renouvelable, en raison des restrictions budgétaires et de la géographie. Dans certains pays, la capacité photovoltaïque installée par habitant est assez faible malgré un potentiel élevé dans ce domaine. D’autres pays parviennent à produire une proportion élevée d’énergies renouvelables en raison des possibilités géographiques favorables dont ils disposent pour les centrales hydroélectriques. |
|
4.7. |
L’intensification des efforts en faveur de la transition vers une énergie verte s’accompagne de nouveaux besoins de financement et devra être menée de toute urgence, compte tenu de la crise énergétique et du besoin croissant d’autonomie énergétique de l’Union. Renforcer les propositions «Ajustement à l’objectif 55» en les assortissant d’objectifs plus ambitieux et de délais plus courts pour l’utilisation des énergies renouvelables, par exemple via le déploiement de l’énergie solaire et éolienne et l’amélioration de l’efficacité énergétique, nécessitera une réponse financière solide. La Commission a annoncé son intention d’évaluer ces besoins de financement dans le cadre des propositions du plan REPowerEU (14) sur la base d’une cartographie des besoins dans les États membres, ainsi que des exigences en matière d’investissements transfrontières. Le CESE s’en félicite, mais attire également l’attention sur le fait que les instruments de financement actuels au niveau de l’Union et au niveau national ne seront pas suffisants et qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour faire des énergies renouvelables une solution dès à présent. Les dépenses du Fonds d’adaptation au changement climatique en faveur des énergies renouvelables devraient également être renforcées en attirant des investissements privés, le Fonds devant servir à apporter le capital d’amorçage. |
|
4.8. |
Il convient d’accroître les investissements afin d’améliorer l’autonomie énergétique de l’Union, en mettant l’accent sur la transition vers les énergies vertes et renouvelables. Pour réussir, l’Union aura besoin, en sus d’investissements plus immédiats au moyen du Fonds d’adaptation au changement climatique, d’investissements importants à long terme dans la recherche et l’innovation et de nouveaux modes de production et de consommation, afin d’améliorer notre capacité à offrir une énergie propre et abordable à toute la population. Le programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne témoigne déjà d’un engagement considérable en faveur de cet objectif, ouvrant la possibilité de réaliser des progrès notables. Toutefois, cet accent mis sur la recherche doit s’accompagner d’un engagement, de la part des États membres, d’adopter des formes de production d’énergie plus vertes et de leur capacité à abandonner progressivement des moyens de production d’énergie plus traditionnels, en particulier dans les États membres qui sont encore fortement tributaires du charbon. |
|
4.9. |
Si le CESE accueille favorablement les financements existants consacrés à la politique climatique dans le cadre du CFP et de NextGenerationEU, il souligne également que les menaces environnementales les plus immédiates qui pèsent sur les citoyens de l’Union ont changé depuis leur élaboration et que de nouvelles approches sont nécessaires. Outre la création de ce nouveau fonds, le CESE demande à la Commission de revoir l’environnement de financement afin de recenser les déficits de financement et les besoins financiers supplémentaires concernant différents aspects de la politique climatique. |
5. Garantir la solidité des politiques existantes de l’Union en matière de climat et d’énergie, et leur complémentarité avec le Fonds d’adaptation au changement climatique
|
5.1. |
Le Fonds d’adaptation au changement climatique répondrait à un besoin très concret non satisfait en termes de financement de la part de l’Union, à savoir qu’il permettrait de disposer de fonds suffisants pour réagir rapidement aux situations d’urgence climatique, environnementale et énergétique. Toutefois, ce fonds doit être cohérent et s’articuler avec les politiques générales de l’Union dans ces domaines. |
|
5.2. |
La crise climatique est un problème systémique qui ignore les frontières, ce qui signifie qu’il est nécessaire d’apporter un changement systémique au fonctionnement de notre économie et de faire en sorte que les gouvernements s’engagent à trouver des solutions systémiques au lieu de se contenter de s’attaquer aux symptômes du problème. |
|
5.3. |
Il existe d’énormes disparités dans la manière dont les personnes ou les groupes s’engagent contre la crise climatique ou sont touchés par elle, ce qui aggrave encore le problème du changement climatique. Ces disparités ont trait à l’empreinte carbone, les émissions de CO2 par habitant variant assez significativement d’un État membre et d’une région à l’autre. On observe aussi des disparités quant aux effets du changement climatique, à la capacité de s’adapter aux défis et de les gérer et, enfin, aux incidences des mesures de politique climatique et aux changements structurels importants, lesquels sont imminents. |
|
5.4. |
Sur le territoire de l’Union, les incidences climatiques varient considérablement d’un État membre à l’autre ainsi qu’au sein d’un même État membre, en fonction de leur géographie, mais aussi de l’état et de la structure de leur économie. Par exemple, alors que 7 % de la population de l’Union vit dans des zones exposées aux crues, plus de 9 % de ses habitants résident dans des régions comptant plus de 120 jours sans pluie par an. |
|
5.5. |
Œuvrer pour une transition juste nécessite également la mise en place de conditions sociales durables, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) et au socle européen des droits sociaux. En outre, le CESE plaide en faveur d’une approche globale de la durabilité environnementale et attire l’attention sur le règlement relatif à la taxinomie, qui fixe six objectifs environnementaux: l’atténuation du changement climatique; l’adaptation au changement climatique; l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines; la transition vers une économie circulaire; la prévention et le contrôle de la pollution; et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. |
|
5.6. |
Avec un budget de plus de 330 milliards d’EUR validé pour la période de programmation actuelle, la politique de cohésion est l’outil d’investissement conjoint le mieux doté et le plus important en Europe, et a, par conséquent, un rôle crucial à jouer dans la lutte contre le changement climatique. Les disparités entre États membres, et en leur sein, auxquelles la politique de cohésion vise à remédier sont également très susceptibles d’être accentuées par le changement climatique et ses conséquences. Pour sa part, le plan pour la reprise et la résilience met lui aussi fortement l’accent sur le climat. Si l’on constate un engagement manifeste en matière d’investissements, il est nécessaire d’avoir une vision claire et structurée du fléchage des fonds de l’Union pour lutter contre le changement climatique et des modalités de leur gestion. |
|
5.7. |
Le CESE insiste également sur la nécessité pour les collectivités locales et régionales de prendre un engagement politique clair en faveur de la réalisation des objectifs climatiques. Il est urgent d’intensifier le dialogue à plusieurs niveaux entre les autorités nationales, régionales et locales sur la planification et la mise en œuvre des mesures nationales en matière de changement climatique au niveau régional et local, sur l’accès direct aux financements pour les collectivités locales et sur le suivi de l’avancement des mesures adoptées. Les partenaires sociaux et la société civile organisée doivent être associés à ce processus afin de préserver une approche équilibrée, dans le respect des intérêts de tous les groupes. |
|
5.8. |
Le CESE souligne le rôle central joué par les partenaires locaux et régionaux et les partenaires sociaux dans la lutte contre les conséquences du changement climatique. Malheureusement, le soutien que beaucoup de ces acteurs reçoivent pour financer leurs activités est encore loin d’être suffisant pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Pour améliorer cet appui, il conviendrait notamment de renforcer le Fonds pour une transition juste. |
|
5.9. |
Le CESE insiste sur le fait que la transition vers la durabilité environnementale doit être inclusive et conforme aux ODD et au socle européen des droits sociaux. Dans ce contexte, les critères clés doivent inclure la sauvegarde et la création d’emplois «verts» de qualité, prévoir des actions de formation et des mesures sociales inclusives, tout en développant des secteurs économiques alternatifs et neutres pour le climat au bénéfice de la population des régions concernées. Il s’agit de contrebalancer les effets régressifs potentiels des mesures de politique climatique et des changements structurels. Par exemple, il conviendrait que les marchés publics et les mesures d’aide d’État en faveur des entreprises soient conditionnés à la création d’emplois de qualité et au respect des droits des travailleurs, des normes environnementales et des obligations fiscales. En outre, les personnes vulnérables doivent être protégées contre les effets du changement climatique, et il convient d’empêcher en tout état de cause la précarité énergétique. Enfin, le CESE attire l’attention sur le principe de la taxinomie de l’Union consistant à «ne pas causer de préjudice important», qui dispose qu’aucun objectif environnemental ne saurait être compromis par la mise en œuvre de telle ou telle politique. |
|
5.10. |
L’éducation formelle et non formelle apportant des mécanismes importants pour lutter contre la crise climatique, il est essentiel d’investir dans une éducation accessible relative au changement climatique et à la citoyenneté active. L’éducation à la durabilité est un outil puissant pour donner aux jeunes les moyens de participer aux conversations sur la direction qu’une politique climatique concrète devrait prendre. Le rôle de l’éducation et de la formation dans la lutte contre le changement climatique est de plus en plus reconnu. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/lutte-contre-la-precarite-energetique-et-resilience-de-lunion-enjeux-economiques-et-sociaux (voir page 88 du présent Journal officiel).
(2) Regional development MEPs suggest to set-up a Climate Change Adaptation Fund | News | European Parliament (article d’information du Parlement européen: «Développement régional: des députés européens suggèrent de mettre en place un Fonds d’adaptation au changement climatique»).
(3) Economic losses from climate-related extremes in Europe — European Environment Agency.
(4) Bâtir une Europe résiliente — la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique, COM(2021) 82 final, section 2.2.3; Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable, COM(2021) 390 final, sections II et III, action no 2, point c), tableau de bord relatif aux lacunes de la protection assurantielle et document de réflexion de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).
(5) ESPAS_Report.pdf, p. 8.
(6) https://www.brusselstimes.com/belgium-all-news/199487/europes-summer-floods-amount-to-worlds-second-most-costly-natural-disaster-of-2021
(7) https://www.reuters.com/world/europe/greece-starts-count-cost-after-week-devastating-fires-2021-08-09/
(8) Europe’s summer floods amount to world’s second-most costly natural disaster of 2021 (brusselstimes.com)
(9) https://www.reuters.com/world/europe/greece-starts-count-cost-after-week-devastating-fires-2021-08-09/
(10) Fonds de solidarité de l’UE.
(11) https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/solidarity-fund/
(12) Plan REPowerEU, COM(2022) 230 final.
(13) U.S., EU strike LNG deal as Europe seeks to cut Russian gas | Reuters.
(14) COM(2022) 230 final.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/30 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Les crypto-actifs: enjeux et possibilités»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/05)
|
Rapporteur: |
Philip VON BROCKDORFF |
|
Corapporteure: |
Louise GRABO |
|
Décision de l’assemblée plénière |
24.3.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
|
Adoption en section |
9.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
22.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
148/0/3 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Prenant acte de l’augmentation de la capitalisation de marché des crypto-actifs, le CESE approuve fermement la proposition de la Commission européenne d’un règlement sur les marchés de crypto-actifs, qui vise à réglementer ces derniers au sein de l’Union européenne et qui a donné lieu le 30 juin 2022 à un accord politique provisoire des colégislateurs (1). |
|
1.2. |
Le CESE plaide également en faveur d’un cadre réglementaire et opérationnel solide pour améliorer le suivi financier des transactions et le respect des obligations fiscales pour les crypto-actifs. |
|
1.3. |
Le CESE recommande vivement aux autorités de s’en tenir au principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles». Aussi convient-il de s’appuyer sur les cadres réglementaires existants en ce qui concerne les entreprises qui effectuent des opérations sur des crypto-actifs qui requièrent de couvrir des risques semblables à ceux qui se présentent pour des opérations traditionnelles. Le CESE estime qu’il s’agit là d’une nécessité afin d’éviter que ne se produisent des asymétries entre des services et actifs analogues mais susceptibles de ressortir à des cadres différents pour des vétilles d’ordre technique. |
|
1.4. |
Tout cadre réglementaire des crypto-actifs doit être cohérent entre les juridictions et pas seulement au sein de l’UE. Des normes fondées sur des conditions de concurrence équitables devraient être établies à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE afin de protéger les clients. Le CESE approuve le règlement sur les transferts de fonds (2), bien qu’à certains égards, celui-ci aille plus loin que pour les opérations financières traditionnelles. Toutefois, dans le même temps, le Comité soutient l’innovation au sein de l’Union européenne et il importe que des produits ordinaires qui se fondent sur la technologie de la chaîne de blocs et qui ne sont pas de nature financière soient traités comme leurs homologues matériels et non comme des instruments financiers, conformément au principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles». |
|
1.5. |
Le CESE s’inquiète des conséquences environnementales des crypto-actifs et des activités de minage en rapport au regard des engagements en matière de climat pris par l’Union européenne dans le cadre du pacte vert. Il est également d’avis que bien qu’il semble que les technologies des registres distribués émergentes, telles que la chaîne de blocs, soient en mesure de réaliser des infrastructures durables pour un avenir sobre en carbone, aucun élément ne permet de conclure de manière probante que ce soit bien le cas. |
|
1.6. |
Le CESE est d’avis que la chaîne de blocs, en tant que principale technologie sous-jacente dans le domaine des crypto-actifs, pourrait contribuer à répondre aux risques qui prévalent actuellement sur le marché. Les avantages potentiels de la chaîne de blocs vont des transactions en temps réel permettant de réduire les risques et d’améliorer la gestion du capital, au renforcement de l’efficacité réglementaire, par exemple en utilisant cette technologie à des fins de connaissance clientèle ou de vérifications dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. |
|
1.7. |
Le CESE relève également que de nouveaux progrès technologiques peuvent contribuer à remédier aux lacunes existantes en matière de respect des obligations fiscales et, partant, améliorer la transparence et la qualité des données transmises aux autorités fiscales à des fins de contrôle, et permettre de lutter contre la fraude fiscale et les transactions illicites. |
|
1.8. |
De nouvelles évolutions technologiques dans le domaine de la chaîne de blocs pourraient également inciter les banques à coopérer au sein de son écosystème, ce qui leur permettrait de partager des informations et des expériences avec la communauté des chaînes de blocs au sens large, par l’intermédiaire d’une plateforme de financement du commerce fondée sur cette technologie. |
|
1.9. |
En dernier lieu, le CESE approuve sans réserve le rôle que joue la Banque centrale européenne (BCE) pour suivre les évolutions dans le domaine des crypto-actifs et leurs possibles retombées sur la politique monétaire et les risques que ceux-ci peuvent faire peser sur le bon fonctionnement des infrastructures des marchés et des paiements, ainsi que sur la stabilité du système financier. |
2. Contexte
|
2.1. |
Bien que la capitalisation boursière des crypto-actifs ait plus que triplé en 2021, pour atteindre 2 600 milliards d’USD, ceux-ci continuent de ne représenter qu’une petite partie de l’ensemble des actifs du système financier mondial (3). Pour ce qui est de leur nombre, les crypto-actifs sont comparables à certaines catégories d’actifs établies, même si leur importance est encore très éloignée de celle des obligations d’État, des marchés boursiers et des produits dérivés. La croissance rapide des crypto-actifs a attiré plusieurs nouveaux acteurs dans l’écosystème et entraîné une offre croissante de crypto-actifs, dont certains sont appelés «monnaies virtuelles», ou «pièces» ou «jetons» numériques. Parmi les principaux crypto-actifs à ce jour figurent notamment Bitcoin et Ether, qui représentent ensemble environ 60 % de la capitalisation boursière totale des crypto-actifs. |
|
2.2. |
Au cours de l’année écoulée, la demande de crypto-actifs appelés «cryptomonnaies stables» (4) a connu une croissance sans précédent soutenue par les évolutions technologiques, notamment la chaîne de blocs. Les volumes des transactions des cryptomonnaies stables, en particulier, ont dépassé ceux de presque tous les autres crypto-actifs, principalement parce qu’elles sont largement utilisées pour régler les transactions au comptant et sur produits dérivés sur les marchés boursiers. La relative stabilité des prix des cryptomonnaies stables contribue également à protéger les détenteurs de crypto-actifs contre la volatilité associée aux crypto-actifs monétaires non stables. |
|
2.3. |
La finance décentralisée (DeFi) (5) basée sur la technologie de la chaîne de blocs et fournissant des services financiers au moyen de cryptomonnaies stables et d’autres crypto-actifs est l’une des principales raisons de l’augmentation de la demande de crypto-actifs, puisqu’elle a permis aux utilisateurs de négocier des crypto-actifs sans intermédiaire. Il n’est, en outre, pas nécessaire de procéder à une évaluation du risque de crédit du client au cours d’une transaction. Il est intéressant de noter que de telles transactions concernent principalement des acteurs institutionnels d’économies développées où les cryptomonnaies stables sont couramment échangées (6). |
|
2.4. |
La technologie de la chaîne de blocs ou des registres distribués (DLT) peut être décrite comme un grand fichier public partagé et stocké dans un vaste réseau d’ordinateurs, et qui contient toutes les transactions portant sur des crypto-actifs. Étant donné qu’il est partagé publiquement et que son contenu est validé, il n’est pas possible de revenir sur une transaction ou de la modifier. Aussi le fichier public produit du fait du recours à la technologie des registres distribués prévient-il les transactions frauduleuses. |
|
2.5. |
Au plus fort de la crise de la COVID-19, une période de tensions sur les marchés, la valeur du bitcoin est retombée à 4 994,70 USD à la mi-mars 2020, après avoir culminé à 10 367,53 USD à la mi-février de la même année. Toutefois, la forte augmentation et la forte baisse de la valeur du bitcoin n’a pas grand-chose à voir avec la pandémie et ses effets sur le marché des titres (7). Le comportement apparemment erratique de la valeur du bitcoin est le résultat d’un phénomène que les mineurs et les experts appellent le «halving» (division par deux). Le halving du bitcoin se produit tous les quatre ans, ou chaque fois que 210 000 blocs ont été extraits. Le premier halving s’est produit en 2012 et des fluctuations prévisibles similaires des prix du bitcoin ont alors pu être observées. Cette configuration n’a guère changé depuis 2012. |
|
2.6. |
En l’état actuel des choses, les crypto-actifs ne semblent pas présenter de risque important pour la stabilité financière, comme l’a confirmé le Conseil de stabilité financière (CSF) dans son rapport de 2018. Cela étant, le CSF a lui-même fait part de ses préoccupations quant aux risques que pourrait entraîner une augmentation de la capitalisation boursière, notamment ceux qui concernent la confiance des investisseurs, les risques découlant de l’exposition directe et indirecte des établissements financiers et ceux liés à l’utilisation de crypto-actifs à des fins de paiements et d’échanges. |
|
2.7. |
Des préoccupations similaires ont été exprimées par les autorités européennes de surveillance (l’ABE, l’AEMF et l’AEAPP), qui ont averti les consommateurs que de nombreux crypto-actifs comportent un risque élevé, sont hautement spéculatifs et ne sont pas adaptés à la plupart des investisseurs de détail, ni comme moyen de paiement ou d’échange. Les autorités européennes de surveillance estiment qu’il est fort possible que les consommateurs ayant acheté des crypto-actifs à haut risque perdent tout l’argent investi. Elles mettent également les consommateurs en garde contre les risques de publicités trompeuses, notamment sur les médias sociaux et par l’intermédiaire d’influenceurs. Les consommateurs devraient être particulièrement méfiants à l’égard des promesses de rendements rapides ou élevés. |
|
2.8. |
Les liens directs entre les crypto-actifs d’une part, et les établissements financiers d’importance systémique et les principaux marchés financiers d’autre part, bien qu’en croissance rapide, demeurent limités à l’heure actuelle. Néanmoins, la participation de ces institutions aux marchés des crypto-actifs, à la fois en tant qu’investisseurs et en qualité de prestataires de services, s’est accrue au cours de l’année écoulée, bien qu’elle soit encore peu développée. Si la trajectoire actuelle de croissance d’échelle et sur le plan de l’interconnexion des crypto-actifs avec ces établissements devait se poursuivre, cela pourrait avoir des répercussions sur le système financier mondial. |
|
2.9. |
Cette croissance d’échelle et sur le plan de l’interconnexion des crypto-actifs renforce la nécessité et l’importance de s’assurer que ceux-ci font l’objet d’audits cohérents, comparables et objectifs, de manière à pouvoir disposer de rapports évaluant l’exactitude et l’exhaustivité des informations financières communiquées au public. Dans ce contexte, la Commission européenne a présenté, en septembre 2020, une proposition législative visant à harmoniser et à légitimer la réglementation des cryptomonnaies dans le domaine des crypto-actifs (8). Celle-ci fournit un cadre global pour la réglementation et la surveillance des émetteurs et des initiateurs de crypto-actifs et des prestataires de services sur crypto-actifs en vue de protéger les consommateurs ainsi que l’intégrité et la stabilité du système financier. Le 30 juin 2022, les colégislateurs sont parvenus à un accord politique provisoire. L’on escompte que le texte législatif définitif sera publié et entrera en vigueur dans les prochains mois. La position du CESE à ce sujet est développée dans son avis sur les crypto-actifs et la technologie des registres distribués (9). |
3. Risques posés par les crypto-actifs
|
3.1. |
La croissance rapide des crypto-actifs s’est généralement caractérisée par une structure opérationnelle médiocre, une mauvaise gestion des risques informatiques et des cadres de gouvernance indigents. La combinaison de ces trois éléments accroît les risques pour les clients, la cybersécurité étant un problème dans le domaine des crypto-actifs. Les crypto-actifs volés se retrouvent généralement sur des marchés illégaux et sont utilisés pour financer d’autres activités criminelles. Dans le même ordre d’idées et dans le contexte des attaques menées au moyen de rançongiciels, les criminels demandent souvent aux victimes de payer la rançon en cryptomonnaies telles que le bitcoin (10). Le règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, sur lequel les colégislateurs se sont récemment accordés et qui est en cours de finalisation en vue de sa publication, pose des exigences uniformes relatives à la sécurité des réseaux et des systèmes d’information sous-tendant les processus opérationnels des entités financières, nécessaires pour atteindre un niveau commun élevé de résilience opérationnelle numérique. |
|
3.2. |
L’écosystème des crypto-actifs est également exposé à un certain niveau de risque de concentration, les transactions étant dominées par un nombre relativement restreint d’entités (11). Une étude a révélé que moins de 10 000 personnes dans le monde possèdent collectivement 4,8 millions de bitcoins (12), soit près d’un tiers des 18,5 millions de bitcoins extraits à ce jour. Ces derniers représentent une valeur de marché de près de 600 milliards d’USD. La situation n’a guère changé. L’écosystème du bitcoin se concentre autour de quelques grands acteurs qui continuent de le dominer, qu’il s’agisse de mineurs (13), de détenteurs de bitcoin ou de changeurs. Cette concentration expose le bitcoin au risque systémique et implique également que la majorité des gains tirés des nouvelles adoptions sont susceptibles de revenir de manière disproportionnée à un nombre restreint de participants (14). |
|
3.3. |
Dans son dernier rapport (15), le CSF indique que les systèmes de marché tels que le secteur bancaire ont été largement protégés de la volatilité des crypto-actifs. Toutefois, il met en garde contre l’importance croissante des actifs numériques dans les opérations des établissements financiers. Si une cryptomonnaie stable de premier plan (largement utilisée pour les paiements) devait connaître une défaillance, cela pourrait avoir une incidence supplémentaire sur la stabilité financière, dans un contexte d’incertitude croissante due à la guerre en Ukraine et marqué par la persistance de prix élevés des produits de base. Une telle défaillance pourrait également entraîner des pénuries de liquidités au sein de l’écosystème plus large des crypto-actifs, limitant ainsi les volumes de négociation. |
|
3.4. |
Comme indiqué dans un précédent avis (16), le CESE soutient pleinement les efforts déployés dans l’UE pour renforcer la surveillance des crypto-actifs. Toutefois, en raison de l’impression d’anonymat qu’ils offrent, le risque que les crypto-actifs soient utilisés à des fins criminelles existe toujours, malgré des améliorations dans leur traçage. De même, les crypto-actifs ont récemment été les plus plébiscités en tant que monnaie privilégiée des cyber-assaillants, qui utilisent des rançongiciels pour s’introduire dans les systèmes et exigent ensuite de l’entreprise concernée des paiements en bitcoin, en échange desquels ils ne détruisent ni ne divulguent des données précieuses pour celle-ci. En outre, on observe une augmentation du nombre de rapports concernant des systèmes de Ponzi crypto. La BCE affirme également que les cryptomonnaies sont utilisées pour éluder les sanctions imposées aux oligarques russes depuis le début de la guerre en Ukraine (17). Le risque d’utilisation abusive de crypto-actifs pour contourner les sanctions à l’encontre de la Russie rappelle utilement que ces marchés doivent être tenus de respecter les normes établies, y compris en ce qui concerne les informations sur les investisseurs, la lutte contre le blanchiment de capitaux et les obligations d’information. |
|
3.5. |
Les informations trompeuses et le manque de transparence constituent un autre problème extrêmement préoccupant. Certains crypto-actifs font l’objet d’une publicité agressive auprès du public, qui s’appuie sur du matériel promotionnel et d’autres informations parfois peu clairs, incomplets, inexacts ou délibérément trompeurs, et surestime les gains potentiels tout en négligeant de communiquer sur les risques encourus. Leur commercialisation est souvent confiée à des influenceurs sur les réseaux sociaux qui ne déclarent pas publiquement qu’ils ont un intérêt économique à commercialiser certains crypto-actifs. C’est notamment le cas avec la récente montée en puissance des jetons non fongibles artistiques (NFT art) dont la valeur symbolique est associée à diverses célébrités et personnalités du monde du sport. |
|
3.6. |
Les autorités de surveillance de l’UE estiment que les fluctuations extrêmes des prix des crypto-actifs représentent un risque important pour les investisseurs, même si des risques similaires pourraient également survenir en cas de fluctuations sur les marchés boursiers mondiaux. En fait, de nombreux crypto-actifs font l’objet de fluctuations de prix soudaines et extrêmes, ce qui les rend hautement spéculatifs, les prix dépendant principalement de la demande des investisseurs. Ces fluctuations extrêmes des prix ont suscité de nouveaux doutes quant à l’avenir des cryptomonnaies en tant que catégorie d’actifs. |
|
3.7. |
Fait inquiétant dans le cas des crypto-actifs, les investisseurs estiment souvent qu’il est presque impossible d’exiger des dommages et intérêts ou de faire valoir leurs droits dans le cadre d’autres actions en justice, concernant par exemple des informations trompeuses, notamment parce que, à ce jour, ces actifs ne relèvent pas de la protection qu’offre actuellement la réglementation européenne en vigueur en matière de services financiers. Les investisseurs ne sont pas non plus protégés par les systèmes de garantie des dépôts des banques, étant donné que ceux-ci ne couvrent que les devises et non les crypto-actifs, les actions ou les obligations. |
|
3.8. |
À l’échelle de l’UE, la prochaine entrée en vigueur du règlement sur les marchés de crypto-actifs devrait résoudre le manque d’harmonisation qui prévaut à l’heure actuelle entre les États membres. En ce qui concerne la fiscalité, les approches adoptées diffèrent d’un État membre à l’autre et plusieurs d’entre eux prélèvent un impôt sur les plus-values pour les bénéfices dérivés des crypto-actifs à des taux de 0 à 50 %. En 2020, avec l’adoption du train de mesures sur la finance numérique visant à réglementer la technologie financière, l’UE a reconnu le potentiel que la finance numérique peut offrir sur le plan de l’innovation et de la compétitivité, tout en limitant les risques qui en découlent. |
|
3.9. |
Le CESE plaide en faveur d’un cadre réglementaire et opérationnel efficace pour améliorer le suivi des opérations et le respect des obligations fiscales pour les crypto-actifs. Tout en étant conscient des problèmes qu’entraîne l’absence de contrôle centralisé des crypto-actifs, leur pseudo-anonymat, les difficultés d’évaluation et les caractéristiques hybrides qu’ils présentent, ainsi que l’évolution rapide de la technologie sous-jacente, le CESE est d’avis qu’il est possible d’assurer le respect des obligations fiscales en s’appuyant sur une approche symétrique. Une étude récente (18) indiquait que les recettes fiscales potentielles au titre des plus-values générées par le bitcoin au sein de l’Union européenne s’élevaient au total à 850 millions d’euros en 2020, ce qui met en relief l’importance du produit éventuel de l’impôt qu’il serait possible de tirer de ce secteur. Bien entendu, cela suppose que les revenus provenant des crypto-actifs devraient être soumis à l’impôt, à l’instar des instruments financiers traditionnels. Là encore, cela exige que les obligations fiscales soient correctement appliquées sur la base d’une déclaration adéquate et que les administrations fiscales aient accès aux informations. L’amélioration du suivi en temps réel des ventes commerciales procurerait l’avantage supplémentaire de renforcer la procédure de perception de la TVA. |
|
3.10. |
Il convient de souligner que certains crypto-actifs peuvent être considérés comme des instruments financiers relevant du champ d’application de la directive révisée concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), comme de la monnaie électronique au sens de la directive sur la monnaie électronique (DME) ou comme des fonds au titre de la deuxième directive sur les services de paiement (DSP 2). Le problème est que certains États membres ont mis en place des règles sur mesure au niveau national pour les crypto-actifs ne relevant pas de la réglementation actuelle de l’UE, ce qui a entraîné une fragmentation réglementaire. Cette situation fausse la concurrence au sein du marché unique, ce qui rend plus difficile pour les prestataires de services sur crypto-actifs d’étendre leurs activités au-delà des frontières et ouvre la voie à un arbitrage réglementaire. |
|
3.11. |
Si le CESE approuve la préférence donnée à une approche globale visant à cibler tant les crypto-actifs susceptibles de s’apparenter à des instruments financiers existants que les crypto-actifs qui ne relèvent pas à l’heure actuelle du champ d’application de la réglementation, il recommande vivement aux autorités de respecter le principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles». Aussi convient-il de s’appuyer sur les cadres réglementaires existants en ce qui concerne les entreprises qui effectuent des opérations sur des crypto-actifs qui requièrent de couvrir des risques semblables à ceux qui se présentent pour des opérations traditionnelles. Le CESE estime qu’il s’agit là d’une nécessité afin d’éviter que ne se produisent des asymétries entre des services et actifs analogues mais susceptibles de ressortir à des cadres différents pour des vétilles d’ordre technique. En outre, pour atténuer les risques, il s’impose que toute innovation dans le domaine des crypto-actifs donne lieu à une réponse réglementaire efficace. |
|
3.12. |
Enfin, les conséquences environnementales des crypto-actifs et des activités de minage y afférentes revêtent une importance capitale, étant donné les engagements climatiques de l’Union dans le cadre du pacte vert. Une étude récente (2021) de la Banque centrale des Pays-Bas met en évidence une augmentation de l’empreinte carbone du réseau Bitcoin, qui consomme au total autant d’électricité que les Pays-Bas, avec un coût environnemental de 4,2 milliards d’euros (19). Cela étant, il peut être pertinent d’établir une comparaison avec la consommation d’électricité du secteur bancaire mondial. À cet égard, le CESE relève que les technologies des registres distribués émergentes, telles que la chaîne de blocs, semblent être utilisées pour permettre la réalisation d’infrastructures durables pour un avenir sobre en carbone. Toutefois, aucun élément tangible ne permet jusqu’à présent de prouver que ce soit bien le cas. Un aspect positif réside dans les tentatives des développeurs au sein de l’ensemble du secteur de l’énergie de tirer parti de la technologie des registres distribués pour contribuer à décentraliser la distribution d’énergie, contrôler les réseaux d’énergie au moyen de contrats intelligents et fournir des services de réponse à la demande liés aux prévisions de consommation et d’offre d’électricité. |
4. Possibilités offertes par les crypto-actifs
|
4.1. |
Compte tenu des risques susmentionnés, il est difficile de déterminer si les cryptomonnaies deviendront un jour un moyen d’échange courant. Toutefois, il n’est pas déraisonnable de penser que des progrès techniques à venir pourraient remédier aux lacunes qui les caractérisent, qu’il s’agisse de leur capacité de traitement ou de la consommation énergétique très élevée de leur processus de minage. Il en va de même pour les risques connexes d’activités criminelles et de blanchiment de capitaux: la part illicite du volume des transactions de cryptomonnaies est passée de 0,62 % en 2020 à 0,15 % en 2021 (20) et les services répressifs font des progrès en matière de repérage et de confiscation des cryptomonnaies illicites. À la lumière de ce qui précède, le CESE note que, depuis la publication en mars 2018 du plan d’action pour les technologies financières de la Commission, celle-ci a examiné à la fois les possibilités offertes par les crypto-actifs et les défis qu’ils posent. |
|
4.2. |
S’il est nécessaire de doter les crypto-actifs d’un cadre législatif solide, comme le prévoit la proposition de la Commission (21), le CESE est d’avis que la chaîne de blocs, en tant que principale technologie sous-jacente dans ce domaine, pourrait contribuer dans une large mesure à répondre aux risques existants. Les avantages potentiels de la chaîne de blocs vont des transactions en temps réel permettant de réduire les risques et d’améliorer la gestion du capital, au renforcement de l’efficacité réglementaire, par exemple en utilisant cette technologie à des fins de connaissance clientèle ou de vérifications dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux. En outre, la chaîne de blocs renforce également la cybersécurité, étant donné que le piratage d’un écosystème fondé sur cette technologie nécessiterait des ressources colossales en matière de puissance de réseau et de calcul. Il existe également un énorme potentiel d’intégration avec d’autres technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle et l’internet des objets, pour soutenir la technologie des crypto-actifs. |
|
4.3. |
Comme indiqué précédemment, le manque de transparence et d’information qui entoure les crypto-actifs et qui entraîne à la fois un pseudo-anonymat et une carence de données fiscales constitue un problème sérieux. De nouveaux progrès technologiques peuvent contribuer à remédier aux lacunes existantes et, partant, améliorer la transparence et la qualité des données transmises aux autorités fiscales à des fins de respect des obligations dans ce domaine, et permettre de lutter contre la fraude fiscale et les transactions illicites. En outre, les synergies entre la chaîne de blocs et l’intelligence artificielle pourraient également constituer une solution, étant donné que la technologie de la chaîne de blocs fournit des données de haute qualité pour les applications de l’IA ainsi que des modèles transparents pour les études comparatives, et garantit l’intégrité d’une évaluation fiscale automatisée. |
|
4.4. |
De nouvelles évolutions technologiques dans le domaine de la chaîne de blocs pourraient également inciter les banques à coopérer au sein de son écosystème, ce qui leur permettrait de partager des informations et des expériences avec la communauté des chaînes de blocs au sens large, par l’intermédiaire d’une plateforme de négociation. Une telle infrastructure pourrait offrir un service pleinement intégré de négociation, de règlement et de garde «de bout en bout» pour les actifs numériques basés sur la chaîne de blocs. Elle pourrait également garantir un environnement sûr pour l’émission et l’échange d’actifs numériques et permettre la tokénisation des titres et des actifs non bancables existants pour rendre négociables des actifs qui ne l’étaient pas précédemment. |
|
4.5. |
Pour y parvenir, il est bien entendu nécessaire de disposer d’un cadre réglementaire solide. Cela dit, ce cadre doit être cohérent entre les juridictions et pas seulement au sein de l’UE. Des normes fondées sur des principes de conditions de concurrence équitables devraient être établies à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE afin de protéger les consommateurs. Dans ce contexte, le CESE approuve le règlement sur les transferts de fonds, bien qu’à certains égards, celui-ci aille plus loin que pour les opérations financières traditionnelles. Toutefois, dans le même temps, le Comité soutient l’innovation au sein de l’Union européenne et il importe que des produits ordinaires qui se fondent sur la technologie de la chaîne de blocs et qui ne sont pas de nature financière soient traités comme leurs homologues matériels et non comme des instruments financiers, conformément au principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles». |
|
4.6. |
Pour clore ces considérations, il convient d’évoquer l’éventuelle introduction d’un euro numérique. Il y a lieu de préciser qu’un euro numérique n’est pas un crypto-actif mais une autre forme de l’euro (22). Un euro numérique permettrait aux citoyens de l’Union d’effectuer des paiements numériques dans l’ensemble de la zone euro, tout comme ils peuvent utiliser des espèces pour effectuer des paiements physiques. Bien entendu, il existe des arguments pour et contre l’introduction d’un euro numérique mais il semble qu’il s’agisse d’une démarche logique sachant que les paiements ne cessent de se numériser. Elle est vitale pour deux raisons principales: un euro numérique pourrait contribuer à contrer quelque peu la position dominante des États-Unis sur le marché des cryptomonnaies stables et il importe que la BCE continue de suivre les évolutions dans le domaine des crypto-actifs et leurs possibles retombées sur la politique monétaire et les risques que ceux-ci peuvent faire peser sur le bon fonctionnement des infrastructures des marchés et des paiements, ainsi que sur la stabilité du système financier. |
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) L’on escompte que ce texte prendra sa forme définitive une fois que le COREPER l’aura approuvé à la fin du mois de septembre 2022; par conséquent, il est fort peu probable qu’il soit disponible avant que le CESE n’adopte le présent avis.
(2) Le règlement sur les transferts de fonds résulte pour l’essentiel de la recommandation du Groupe d’action financière (GAFI) de poser l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds d’informations sur le payeur et le bénéficiaire. Ce même règlement couvrira les nouvelles technologies telles que celles utilisées dans le cadre des transferts de crypto-actifs.
(3) «Assessment of risks to financial stability from crypto-assets» (Évaluation des risques que présentent les crypto-actifs pour la stabilité financière).
(4) Liao et Caramichael, «Stablecoins: Growth potential and impact on banking» (Cryptomonnaies stables: potentiel de croissance et incidence sur les activités bancaires), International Finance Discussion Papers no 1334, Washington: Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve (2022).
(5) La finance décentralisée désigne pour l’essentiel la prestation de services financiers de manière décentralisée, c’est-à-dire en l’absence de recours à un intermédiaire pour faciliter la prestation d’un service financier donné. Une fois conçues par des particuliers, les applications de finance décentralisée sont déployées sur la chaîne de blocs et prennent progressivement leur indépendance sachant que leur gouvernance est concédée à la communauté des utilisateurs. La forme ultime d’une telle application est une organisation autonome décentralisée. Cette forme diffère de celle du système financier traditionnel qui s’appuie sur des intermédiaires centralisés qui contrôlent l’accès aux services financiers. En soi, l’emploi de la technologie de la chaîne de blocs n’est pas l’élément déterminant de la finance décentralisée, mais c’est bien plutôt l’absence d’intermédiaires, que permet notamment la chaîne de blocs, qui produit la finance décentralisée.
(6) Chainalysis (2021).
(7) Voir Sajeev, K. C., Afjal, M., «Contagion effect of cryptocurrency on the securities market: a study of Bitcoin volatility using diagonal BEKK and DCC GARCH models» (Effet de contagion des cryptomonnaies sur le marché de valeurs mobilières: une étude de la volatilité du bitcoin à l’aide des modèles diagonaux BEKK et DCC GARCH), SN Bus Econ 2, 57 (2022).
(8) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2020) 593 final, 24 septembre 2020.
(9) JO C 155 du 30.4.2021, p. 31.
(10) «Crypto-assets: Key developments, regulatory concerns and responses» (Crypto-actifs: principales évolutions, préoccupations réglementaires et réponses).
(11) Il importe de faire valoir que le niveau de risque de concentration s’exprime en termes relatifs et se limite à l’écosystème des crypto-actifs. Il n’a pas d’incidence sur la concentration de la richesse, telle que la décrit par exemple la liste des milliardaires du monde publiée par le magazine états-unien Forbes.
(12) Makarov, I., Schoar, A., «Blockchain Analysis of the Bitcoin Market» (Analyse de la chaîne de blocs du marché du bitcoin), 18 avril 2022.
(13) Le minage de cryptomonnaie désigne le processus de création de blocs individuels ajoutés à la chaîne de blocs en résolvant des problèmes mathématiques complexes. L’objectif du minage consiste à vérifier les opérations en cryptomonnaie et d’apporter la preuve du travail accompli en ajoutant cette information dans un bloc sur la chaîne, qui fait office de grand livre des transactions de minage.
(14) Makarov, I., Schoar, A., «Blockchain Analysis of the Bitcoin Market» (Analyse de la chaîne de blocs du marché du bitcoin), 18 avril 2022.
(15) «Assessment of risks to financial stability from crypto-assets» (Évaluation des risques que présentent les crypto-actifs pour la stabilité financière).
(16) Avis du CESE sur les crypto-actifs et la technologie des registres distribués (JO C 155 du 30.4.2021, p. 31).
(17) Lagarde Says Cryptos Being Used to Evade Russian Sanctions («[La présidente de la BCE, Christine] Lagarde déclare que les cryptomonnaies et les crypto-actifs sont utilisés pour contourner les sanctions contre la Russie).
(18) Thiemann, A., Cryptocurrencies: An empirical View from a Tax Perspective (Un examen empirique des crytomonnaies du point de vue fiscal), document de travail du Centre commun de recherche sur la fiscalité et les réformes structurelles no 12/2021, Commission européenne, Centre commun de recherche, Séville, 2021, JRC126109.
(19) Trespalacios, J. P., et Dijk, J., «The carbon footprint of bitcoin» (L’empreinte carbone du bitcoin), De Nederlandsche Bank, série d’analyse DNB, 2021.
(20) Rapport 2022 de Chainalysis sur la cryptocriminalité.
(21) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937, COM(2020) 593 final.
(22) Voir l’avis d’initiative en cours d’élaboration sur un euro numérique.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/37 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Stratégie relative au personnel et aux soins de santé pour l’avenir de l’Europe»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/06)
|
Rapporteur: |
Danko RELIĆ |
|
Rapporteure: |
Zoe TZOTZE-LANARA |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» |
|
Adoption en section |
6.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
194/4/3 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE adhère fermement au principe que la solidité et la résilience des systèmes de santé ne pourront reposer que sur des personnels de santé formés, compétents et motivés, qui jouent un rôle essentiel, pour assurer la bonne marche des politiques de santé et, donc, sont indispensables, s’agissant de réaliser une couverture sanitaire universelle, centrée sur l’humain, et de concrétiser le droit à la santé, comme la conférence sur l’avenir de l’Europe l’a recommandé, de manière à garantir à tous les Européens un accès égalitaire et durable à des soins de santé abordables et de qualité, à visée tant préventive que curative. |
|
1.2. |
Le CESE salue l’initiative de lancer au niveau de l’Union une action qui, visant à renforcer les prestations de soins et d’accompagnement de longue durée, ainsi que d’éducation et d’accueil des jeunes enfants, contribuera à garantir que les services de soins soient de haute qualité, accessibles, égalitaires et abordables et aidera à renforcer l’égalité entre les hommes et les femmes et l’équité sociale. |
|
1.3. |
Le CESE réclame l’adoption d’une approche porteuse de transformation, qui soit centrée sur les personnes, leurs droits et leurs besoins, et prévoie notamment leur participation à toutes les procédures consultatives et décisions en la matière. Il presse la Commission de faire montre d’ambition dans la définition d’une stratégie de soins de santé et de soins et accompagnement de longue durée qui ait la capacité de contribuer à une convergence vers le haut et à assurer une cohésion de la société, tant entre les différents États membres qu’à l’intérieur de chacun d’entre eux. |
|
1.4. |
Une garantie européenne en matière de soins offrirait à toute personne vivant dans l’Union l’assurance de pouvoir accéder à des services de santé et de soins abordables et de qualité tout au long de sa vie et serait susceptible de répondre aux pénuries dans le secteur et d’y promouvoir des conditions de travail décentes, en offrant des possibilités de formation. Pour une utilisation efficace des ressources, des paramètres essentiels consistent à soutenir les aidants informels et mieux reconnaître leur rôle, ainsi qu’à mener des politiques qui prennent à bras-le-corps les problèmes qui se posent dans le domaine des soins informels, qu’ils soient rémunérés ou non. |
|
1.5. |
Étant donné que des services publics efficaces, responsables et bien financés restent essentiels pour garantir une égalité d’accès à des soins de qualité, le CESE appelle l’Union européenne à assurer une complémentarité entre tous les fournisseurs de soins de santé, sur une base de solidarité, à encourager les investissements dans les services publics et dans l’économie sociale et à en soutenir les intervenants dans le secteur des soins. |
|
1.6. |
La planification des effectifs doit tenir compte du progrès des technologies numériques, car les innovations en la matière ouvrent des possibilités pour créer de nouveaux cadres de travail et environnements de prestations de soins et elles nécessitent des compétences neuves. Pour lutter contre la fracture et la précarité numériques, il est indispensable de soutenir la numérisation des services de soins et d’accompagnement de longue durée. |
|
1.7. |
Le CESE propose de procéder à une mise à jour du plan d’action en faveur du personnel de santé de l’Union (1). Pour améliorer l’accès aux services de santé, ainsi que leur qualité, il est primordial de développer de manière intégrée une planification et une approche prévisionnelle concernant les personnels de santé, ainsi que d’adapter les compétences de ces professionnels et de ceux qui assurent les soins et l’accompagnement de longue durée. En mettant à jour le plan susmentionné, il deviendrait possible d’améliorer la collecte de données dans l’ensemble de l’Union européenne, de tirer parti des perspectives ouvertes par la numérisation et d’élaborer des méthodes pour mieux prévoir les besoins en personnels et en compétences. |
|
1.8. |
Le CESE souligne que le droit à la mobilité doit être respecté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. La mobilité transfrontière ouvre des perspectives supplémentaires pour la planification des effectifs, et la mise en place d’un service européen de suivi du personnel de santé constituerait un élément organisationnel qui serait utile sur le long terme pour aider les États membres à élaborer et à pérenniser des structures de planification et à en coordonner les aspects transfrontières. |
|
1.9. |
Un dialogue social dont les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs, avec leurs organisations représentatives seront parties prenantes constitue un paramètre essentiel pour mener une stratégie de soins transformatrice et assurer la résilience des systèmes de santé et de soins dans l’Union européenne; les personnes qui dispensent des soins et celles qui en bénéficient doivent être associées à l’élaboration d’un écosystème concernant lesdits soins et la santé qui soit plus inclusif, résilient et respectueux de l’égalité entre les hommes et les femmes. |
2. Observations générales concernant les soins et l’accompagnement
|
2.1. |
Composante cruciale de la protection sociale et du bien-être des citoyens de l’Union, la notion de soins et accompagnement de longue durée englobe toute une série de services et de dispositifs d’assistance destinés aux personnes qui présentent une fragilité ou un handicap, d’ordre mental ou physique, pendant une période prolongée, qui dépendent d’une aide pour leurs activités quotidiennes ou qui ont besoin de soins infirmiers permanents, dispensés par des prestataires professionnels ou non professionnels, rémunérés ou non rémunérés, à domicile ou dans des maisons médicalisées et autres établissements de soins avec hébergement (2). |
|
2.2. |
La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve la résilience et l’adéquation des systèmes de soins dans l’ensemble de l’Union européenne, révélant des problèmes structurels, tels que le sous-financement et le manque de personnel, qui touchent de nombreux pays et risquent d’empirer du fait des tensions économiques et politiques, de l’inflation, des incertitudes et de la crise énergétique que nous traversons. |
|
2.3. |
Le socle européen des droits sociaux consacre le droit aux soins et celui de toute personne d’avoir accès à des services de soins formels de qualité en fonction de ses besoins. Annoncée par la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, dans son discours sur l’état de l’Union 2021, la nouvelle stratégie européenne en matière d’accueil et de soins repose sur deux recommandations du Conseil, l’une consacrée à l’accueil des enfants, consistant à réviser les objectifs de Barcelone, et l’autre aux soins de longue durée. Le Parlement européen a recommandé d’améliorer l’offre de prise en charge tout au long de la vie, en tenant compte des besoins des bénéficiaires comme des prestataires, et a demandé instamment à la Commission d’aider les États membres à développer des services de soins de qualité (3). |
|
2.4. |
Le CESE a adopté plusieurs avis consacrés à la fourniture de soins dans l’Union (4) et souligné ainsi la nécessité d’investir dans une prise en charge de qualité, durable et accessible à tous et de remédier aux lacunes en matière de garde d’enfants et de soins et d’accompagnement de longue durée. Concernant la fourniture de soins pour tout un chacun, il a relevé des déficiences, concernant «la diversification et le morcellement de l’offre en matière de services, leur mauvaise réglementation, les problèmes posés par la coordination des niveaux de gestion, les difficultés liées à l’articulation entre les services sociaux et les services de santé, la marchandisation croissante des services, ou encore la nécessité d’engager des politiques et mesures de prévention»; dénonçant les stéréotypes et autres formes de discrimination dont pâtissent les personnes âgées, il a plaidé en faveur d’une prise en charge centrée sur les personnes, qui tire parti de la transformation numérique. Dans ce contexte, le CESE recommande de déployer pleinement la numérisation afin de réduire les formalités administratives inutiles pour les travailleurs du secteur des soins et de mettre en œuvre les avancées les plus bénéfiques de la réglementation intelligente. |
3. Une approche transformatrice en matière de prise en charge
|
3.1. |
Pour porter ses fruits, la stratégie européenne en matière d’accueil et de soins doit s’attacher à adopter une approche ambitieuse et porteuse de transformation, qui accorde une place centrale aux personnes, à leurs droits fondamentaux et à leurs besoins, en garantissant leur participation aux procédures de consultation et de décision, et soit à même de contribuer à la cohésion et à une convergence vers le haut, tant entre les États membres qu’au sein de chacun d’entre eux. |
|
3.2. |
Incarnant cette transformation, une garantie européenne en matière de soins assurerait à toute personne vivant dans l’Union de pouvoir accéder à des services de soins abordables et de qualité tout au long de sa vie, fournirait un cadre cohérent pour que les États membres puissent proposer des services de qualité et des stratégies de soins et d’accompagnement tout au long de la vie et donnerait la possibilité d’améliorer les conditions de travail et la formation des personnels soignants et de soutenir les aidants informels. |
|
3.3. |
Il s’impose de réaliser des investissements à grande échelle dans le secteur économique des soins et les infrastructures connexes, pour parvenir à une approche porteuse de transformation, susceptible de résorber les écarts qui persistent en matière de soins de santé et de créer quelque 300 millions d’emplois à l’horizon 2035, tout en renforçant l’égalité entre les hommes et les femmes et l’accès des femmes aux marchés du travail (5). |
|
3.4. |
Si les États membres présentent des modèles différents, il n’en reste pas moins que la clé pour garantir une égalité d’accès à des soins de qualité et soutenir les prestataires de soins non rémunérés, notamment les femmes, réside dans des services publics efficaces, responsables et bien financés. Le CESE souligne qu’il y a lieu de maximiser la complémentarité et les synergies entre tous les prestataires de services de soins et de santé, dans le secteur privé comme public, à but lucratif ou non, afin de parvenir à assurer une couverture pour toute la population (6), en tenant compte des bonnes pratiques et des exemples positifs dans les États membres tout en respectant leurs spécificités et leurs différences. |
|
3.5. |
Les mouvements tendant à la privatisation et les pratiques axées sur le marché, telles que la sélection des risques et la maximisation des profits s’exerçant au détriment des soins et de la santé, risquent d’exacerber les inégalités et de pénaliser avant tout les plus vulnérables, leurs besoins de prise en charge n’étant pas satisfaits. Fondés sur la solidarité, le respect des compétences nationales et la subsidiarité, la prise en charge de longue durée et l’accueil et les soins en faveur de l’enfance doivent pouvoir s’appuyer, au niveau de l’Union européenne et des États membres, sur une solide structure de systèmes de protection sociale et de services publics, d’investissements dans le social et d’acteurs de l’économie sociale, comme les mutuelles, afin de proposer une offre optimale, assurée par des soignants dûment formés, en matière de soins fournis dans un cadre de proximité et à domicile (7). |
|
3.6. |
Les Fonds structurels et d’investissement européens se prêtent à être utilisés pour soutenir les investissements dans les soins. Dans le domaine des soins de santé et de la prise en charge de longue durée, la Commission devrait mieux cibler les recommandations par pays qu’elle émet dans le cadre du Semestre européen et, lorsqu’il y a lieu, aider les États membres à donner la priorité à leur financement adéquat, en tant qu’il constitue un investissement productif plutôt qu’un fardeau financier. |
4. Conditions de travail, enjeux et potentiel d’emploi
|
4.1. |
Au sein de l’Union, quelque 6,3 millions de personnes travaillent dans le secteur de la prise en charge de longue durée, tandis que 44 millions d’Européens fournissent fréquemment des soins informels de longue durée à des parents ou à des amis, dans l’un des secteurs qui connaît la plus forte croissance à travers le monde (8). D’ici à 2030, jusqu’à 7 millions de postes devraient être créés pour des professionnels de santé intermédiaires et des prestataires de soins (9). |
|
4.2. |
Parmi les obstacles majeurs auxquels est confronté le secteur des soins figurent ses pénuries de personnel, ses conditions de travail exigeantes et peu attrayantes, le vieillissement de ses effectifs, ainsi que son sous-financement, lié aux coupes budgétaires opérées dans le domaine sanitaire et social pendant la crise économique de 2008, à des degrés qui varient d’un État membre à l’autre (10). Dans la quasi-totalité des pays de l’Union, la croissance de l’emploi ne parvient pas à suivre l’augmentation de la demande, en raison de conditions de travail éprouvantes, d’un point de vue psychologique et physique tout à la fois, poussant le personnel soignant à quitter le secteur, selon une tendance que la pandémie n’a fait qu’exacerber et qui produit des effets dommageables sur la santé et la sécurité des prestataires de soins comme des bénéficiaires. |
|
4.3. |
Une approche transformatrice devrait favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes, sachant que les premières représentent plus de 80 % du personnel soignant, qu’elles sont les principales bénéficiaires et dispensatrices de soins dans des contextes formels et informels (11) et qu’elles affichent une moyenne d’âge supérieure à celle de la main-d’œuvre européenne dans son ensemble. Dès lors qu’elles assument la grande majorité des responsabilités familiales, l’existence de services accessibles et abordables en matière d’éducation, d’accueil des jeunes enfants (EAJE) et de prise en charge de longue durée leur donnerait la possibilité d’intégrer en plus grand nombre le marché du travail. Le droit à pouvoir bénéficier d’au moins cinq jours ouvrables de congé d’aidant par an, qui est introduit par la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, apportera un soutien aux aidants informels qui tentent de concilier un travail et des responsabilités familiales. Toutefois, l’absence de congé payé adéquat empêche de jouir pleinement de ce droit prévu par la directive et peut exacerber les inégalités entre les hommes et les femmes. |
|
4.4. |
Dans de nombreux pays de l’Union, les salaires du secteur sont inférieurs à la moyenne, malgré des conditions de travail pénibles, des exigences spécifiques en matière d’aptitudes, de compétences et de qualifications et des risques élevés pour la santé et la sécurité au travail (12). Plusieurs États membres affichent de faibles niveaux de syndicalisation, de couverture par les négociations collectives et de satisfaction professionnelle, ainsi que des effectifs insuffisants par rapport au nombre d’utilisateurs, et, entre autres problèmes, la pandémie a révélé des lacunes concernant la fourniture d’équipements de protection individuelle. |
|
4.5. |
Les soins informels non rémunérés, ou prodigués par des proches, forment la pierre angulaire de la prestation de prise en charge de longue durée en Europe, mais, dans beaucoup de pays, les soins à domicile et dans un contexte de proximité restent sous-développés et difficilement accessibles (13). Sachant combien la fourniture de soins informels influe sur les principaux paramètres de qualité de vie, le CESE préconise vivement des politiques qui encouragent la «formalisation» des soins informels, soutiennent les aidants qui les prodiguent et contribuent à une utilisation efficace des ressources. |
|
4.6. |
Le CESE estime qu’il est préoccupant que les emplois précaires soient largement répandus parmi les prestataires non déclarés de soins à domicile, lesquels sont surtout des femmes qui résident chez les bénéficiaires et sont pour la plupart issues de populations migrantes ou de catégories de citoyens mobiles. Aggravée par le manque d’accès aux soins formels et par les contraintes économiques, la situation qui prévaut dans cette zone grise appelle une approche politique cohérente, accordant toute l’attention requise aux procédures de certification des compétences, de régularisation ou d’octroi de permis de séjour. |
|
4.7. |
Du fait de l’augmentation de la demande de soins et d’accompagnement de longue durée, le secteur pourra bénéficier de salaires plus élevés et plus stimulants, d’une représentation collective et de négociations collectives qui soient opérantes, ainsi que de possibilités accrues de formation. Les financements publics dégagés pour améliorer les conditions de travail, par exemple en imposant certaines exigences dans les marchés publics, peuvent aider à remédier aux pénuries de personnel et à garantir l’accès à des prestations de soins et un accompagnement de longue durée qui soient de haute qualité. Pour renouveler le secteur, il est essentiel de le professionnaliser, de le doter d’une définition de la qualité de ses prestations, d’élaborer des normes pour l’évaluer et la mesurer et d’assurer leur harmonisation entre les États membres (14). |
5. Autres observations concernant les soins et l’accompagnement
|
5.1. |
La pandémie a mis en évidence, dans de nombreux États membres, le morcellement et la dispersion qui caractérisent notamment les responsabilités en matière de fourniture et de financement de la prise en charge, soulignant ainsi la nécessité de mieux coordonner les services de santé et les systèmes nationaux de soins et d’accompagnement (15), qui sont les mieux placés pour en garantir l’accès à tous et l’efficacité. |
|
5.2. |
L’un des principaux enjeux qui se dessinent et nécessitent des mesures concertées dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière d’accueil et de soins consiste à prévenir et combattre les problèmes de santé mentale, résultant de la conjonction des effets de la pandémie de COVID-19, d’une part, et de l’incidence accrue de troubles mentaux, comme la démence, qui sont corrélés au vieillissement de la population, d’autre part. |
|
5.3. |
Comme en témoigne l’expérience récemment acquise en matière de prévention et de contrôle de la COVID-19 dans les établissements de soins et d’accompagnement de longue durée (16), il est essentiel de disposer d’évaluations fiables, ainsi que de contrôles externes et d’inspections efficaces et rationalisés dans les institutions de soins, tant publiques que privées, afin de prévenir les abus et de garantir la sécurité et la qualité des soins, tout particulièrement dans le cas de ceux dispensés aux catégories de population vulnérables, aux personnes âgées et aux enfants, en tirant parti des bonnes pratiques en place dans les États membres. |
|
5.4. |
Au niveau des États membres, deux éléments clés pour assurer le succès de la stratégie en matière d’accueil et de soins consistent à développer une collecte de données normalisée à l’échelle de l’Union et à définir des indicateurs relatifs aux soins et à l’accompagnement de longue durée, notamment au moyen d’obligations de déclaration et d’évaluations périodiques, à réaliser selon des procédures efficaces et rationalisées. Plus spécifiquement, une offre adéquate d’accueil et de soins en faveur de l’enfance suppose de fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs en la matière, de manière à mesurer les progrès accomplis et à atteindre les objectifs de Barcelone, voire à les dépasser. |
|
5.5. |
Pour résorber la fracture numérique, il est indispensable de soutenir la numérisation des services de soins et d’accompagnement de longue durée. Il convient d’accorder une attention particulière à l’accessibilité, aux systèmes d’assistance, à l’amélioration de la culture numérique et à la numérisation, dans la perspective d’assurer la qualité de l’emploi, la mise à niveau des compétences et l’introduction de nouvelles méthodes de diagnostic, de suivi et de traitement. |
|
5.6. |
Le CESE condamne les crimes de guerre que la Fédération de Russie a commis en Ukraine en prenant pour cibles les soignants et les professionnels de santé, les patients, les enfants, les hôpitaux et autres établissements: en plus de tuer et de blesser, ces agressions endommagent gravement le système ukrainien de santé et de soins, qui nécessite dès lors une aide ciblée et des mesures de soutien, étant entendu qu’il faut garder à l’esprit que la crise dans le pays se propage dans toutes les directions et affecte à bien des égards l’environnement socio-économique. |
|
5.7. |
Un dialogue social dont les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs, avec leurs organisations représentatives seront parties prenantes constitue un paramètre essentiel pour mener une stratégie de soins transformatrice et assurer la résilience des systèmes de santé dans l’Union européenne; il s’impose d’associer les personnes qui reçoivent des soins et celles qui les dispensent à l’élaboration d’un écosystème concernant lesdits soins et la santé qui soit plus inclusif, résilient et respectueux de l’égalité entre les hommes et les femmes, en mobilisant la société civile et d’autres parties prenantes, comme les églises et les organisations caritatives. |
6. Observations générales sur le personnel de santé
|
6.1. |
Des soins de santé de qualité constituent un des piliers d’une société stable, sûre et prospère, et leur organisation est du ressort des pouvoirs publics. Une pratique courante, dans beaucoup de pays, consiste à tabler sur la possibilité de recruter rapidement et à bon compte des professionnels de santé dans d’autres États européens. Ce procédé passe pour être un phénomène des plus anodins et, tout effarant qu’il soit, n’est aucunement pris en considération. |
|
6.2. |
Le CESE adhère fermement au principe voulant que la solidité et la résilience des systèmes de santé ne pourront reposer que sur des personnels de santé formés, compétents et motivés, qui jouent un rôle essentiel, pour assurer la bonne marche des politiques de santé et, donc, sont indispensables, s’agissant de réaliser la couverture sanitaire pour tous et de concrétiser le droit à la santé. Dans ses recommandations mêmes, la conférence sur l’avenir de l’Europe entend instaurer un «droit à la santé», qui garantisse à tous les Européens un accès égalitaire pour tous à des soins de santé abordables et de qualité, à visée tant préventive que curative. |
|
6.3. |
L’union européenne de la santé devrait améliorer à l’échelle de l’Union le niveau de la protection, de la prévention, ainsi que de la préparation et de la réaction aux risques concernant la santé humaine. Dès lors, la présence d’un personnel de santé qui soit de haute qualité constituera un facteur des plus décisif pour le succès de toutes les initiatives clés relevant de l’union européenne de la santé. |
|
6.4. |
Plusieurs avis du CESE (17) ont déjà abordé la question du personnel de santé, dans toute une série de contextes et un large éventail d’activités. Depuis le début de la pandémie, tout particulièrement, les professionnels de santé se trouvent en première ligne et font preuve, dans les moments les plus difficiles, d’un degré exceptionnel de solidarité. |
|
6.5. |
Le CESE soutient les efforts qu’il s’impose de déployer pour attirer plus de jeunes vers les métiers de la santé. Ces mesures constituent l’une des grandes conditions préalables à remplir pour que les systèmes de santé disposent de ressources humaines suffisantes afin de répondre aux besoins, s’agissant de dispenser ces soins, de promouvoir la santé et de prévenir la maladie. |
|
6.6. |
Les données sur les effectifs, les migrations, les compétences et autres paramètres concernant le personnel de santé devraient être normalisées et partagées en permanence entre les États membres. De nombreux événements, comme la pandémie de COVID-19, les tremblements de terre, les inondations ou l’invasion russe de l’Ukraine, pour n’en citer que quelques-uns, montrent qu’il importe de réagir rapidement, en particulier dans les situations de crise. |
|
6.7. |
Entre 2000 et 2017, l’emploi dans la santé et les services sociaux a progressé de 48 % au sein des pays de l’OCDE (18). À mesure que la population vieillit, la demande de services de santé est elle aussi appelée à croître et à évoluer: on estime que d’ici 2030, elle devrait pratiquement doubler en ce qui concerne les personnels de santé (19). |
|
6.8. |
Avant même que n’éclate la pandémie de COVID-19, la capacité à fournir les services essentiels de santé était limitée dans de nombreux pays par des pénuries chroniques de personnel dans ce secteur, et l’on anticipait, à l’échelle mondiale, un déficit de quelque 18 millions de professionnels de santé à l’horizon 2030 (20). |
|
6.9. |
Il importe de définir clairement les principes qui sous-tendent les possibilités de délégation des tâches («task shifting») ou d’acquisition d’un éventail de qualifications («skill mix»). Une bonne coordination s’impose entre les institutions qui forment le personnel de santé, afin de répondre de manière appropriée aux besoins des systèmes nationaux de santé, en procédant en temps utile aux ajustements dans les quotas d’inscription et les programmes d’études. |
|
6.10. |
L’évolution des ressources humaines dans le domaine de la santé et de l’aide sociale doit se faire selon des principes de coordination, de coopération intersectorielle et d’intégration des soins, l’objectif commun étant de donner au citoyen la garantie qu’ils soient dispensés en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. |
|
6.11. |
Il y a lieu de veiller tout particulièrement à assurer un accès aux soins dans les communautés locales, notamment dans les régions faiblement peuplées, les zones rurales reculées ou isolées et les îles, dans lesquelles il y a lieu de recourir plus activement aux solutions modernes de transport et de télémédecine. |
7. Planification relative au personnel de santé
|
7.1. |
Le CESE estime que la planification relative au personnel de santé doit viser à créer les conditions d’une pratique professionnelle qui améliore la qualité des soins et la sécurité des patients. Dans le même temps, il convient de garantir à tous les niveaux une capacité à fournir des formations de qualité. |
|
7.2. |
Il s’impose de traiter la gestion du personnel de santé comme une activité d’importance stratégique, qui concerne tous les échelons de l’administration publique et s’effectue grâce au rôle clé qu’assument les gouvernements des États membres, étant entendu que sa mise en œuvre doit revêtir un caractère multisectoriel et tenir compte des différentes perspectives et priorités. |
|
7.3. |
La gestion du personnel de santé englobera nécessairement toutes les phases du parcours professionnel, depuis le recrutement de nouveaux étudiants jusqu’à l’embauche de retraités. Le processus de sélection des candidats à une formation, un emploi ou une promotion doit être transparent et équitable, sans aucune forme de discrimination. |
|
7.4. |
Lorsque l’on effectue une planification concernant le personnel de santé, il importe de prendre en considération les besoins des citoyens et des professionnels de santé et de les exposer clairement. Les processus de planification et de gestion doivent établir les méthodes qui permettront de cerner tous les besoins des professionnels, depuis les conditions de travail, les droits matériels, les perspectives de carrière ou le dégagement du temps et des ressources nécessaires pour l’apprentissage et la recherche jusqu’à l’établissement d’un équilibre durable entre vie personnelle et professionnelle. |
|
7.5. |
La planification concernant le personnel de santé doit s’articuler avec celle des structures, mais aussi avec les mesures et procédures nécessaires pour atteindre les objectifs fixés, s’agissant de définir les résultats à atteindre et la manière d’y parvenir. |
|
7.6. |
Le CESE propose de procéder à une mise à jour du plan d’action en faveur du personnel de santé de l’Union (21). Pour améliorer l’accès aux services de santé, ainsi que leur qualité, il est primordial de développer de manière intégrée une planification et une approche prévisionnelle concernant les personnels de santé, ainsi que d’adapter les compétences de ces professionnels et de ceux qui assurent les soins et l’accompagnement de longue durée. |
|
7.7. |
Les partenaires sociaux et toutes les organisations de la société civile qui sont concernées doivent jouer un rôle actif dans le processus de planification relatif au personnel de santé. Il y a lieu de définir les relations entre les différents groupes professionnels, les besoins précis de la population et le système applicable à certaines compétences. |
|
7.8. |
Pour préserver les droits des professionnels de santé et leur proposer des incitations adéquates, il est nécessaire de recenser les zones géographiques ou secteurs d’activité qui sont peu attrayants et souffrent d’une pénurie de personnel. Le CESE propose qu’en ce qui concerne la couverture sanitaire universelle de base et les urgences, la Commission européenne émette des recommandations sur les ratios minimaux de ressources par nombre d’habitants, en tenant compte de la répartition géographique de la population et de la pyramide des âges (22). |
|
7.9. |
Il convient, pour donner une base à ces recommandations, d’améliorer les procédures internationales de collecte de données, en harmonisant autant que possible leurs catégories, de manière à déceler les disparités et à éviter toute erreur d’interprétation des chiffres. Afin de pouvoir replacer ces informations dans leur contexte, il importe de prendre en considération les divergences nationales par rapport aux catégories harmonisées au niveau européen (23). |
|
7.10. |
La question des ressources financières sera traitée d’une manière différenciée en fonction de la situation économique de chaque État membre. Les données disponibles suggèrent que les États membres doivent veiller à ce que la planification du système de santé dans son ensemble et celle portant plus particulièrement sur ses personnels tiennent compte tout à la fois de l’environnement plus large et de la capacité plus ou moins étendue des pouvoirs publics à l’infléchir (24). |
|
7.11. |
La planification des effectifs doit tenir compte du progrès des technologies numériques, car les innovations en la matière ouvrent des possibilités pour créer de nouveaux cadres de travail et environnements de prestations de soins et elles nécessitent des compétences neuves. |
8. Conditions de travail
|
8.1. |
Dans la décision des professionnels d’embrasser une carrière médicale, de la poursuivre ou d’y mettre fin, les conditions de travail pèsent d’un poids qui montre toute la nécessité de disposer de politiques cohérentes dans des domaines tels que l’éducation, l’emploi, la vie de famille, les salaires et les migrations. Bien qu’une large part des débats sur la planification relative au personnel de santé se concentre sur la rémunération, en tant que facteur clé pour recruter ces professionnels et les retenir, l’accès à l’éducation et à la formation, y compris le perfectionnement professionnel et la possibilité de pérenniser les compétences, ainsi que les conditions concrètes, telles que la disponibilité des soins, les horaires de travail officiel, la stabilité de l’emploi, les perspectives d’évolution dans la profession et l’équilibre entre vie professionnelle et privée sont autant de facteurs qui contribuent à un environnement de travail sain, dans le cadre duquel la médecine représentera un choix de carrière attrayant et durable (25). |
|
8.2. |
Les organisations médicales européennes et internationales constatent que dans leur pratique quotidienne et en l’absence de tout conflit, les médecins, qu’ils exercent en milieu hospitalier, dans des services de médecine générale ou en cabinets privés, sont de plus en plus confrontés à des situations de violence, qui prennent parfois un tour extrême (26). Le CESE invite la Commission européenne et toutes les parties prenantes à une mobilisation politique en la matière et les appelle à prendre conscience qu’il est urgent de protéger les personnels de santé dans l’exercice de leur profession. |
|
8.3. |
Les agents de santé courent le risque de contracter des maladies infectieuses à la suite d’expositions professionnelles, cette contamination pouvant déboucher sur un absentéisme ou une morbidité et aboutir, pour certains d’entre eux, à la mort. En dernière analyse, elle provoque une diminution de leurs effectifs et, par conséquent, affecte la qualité des soins et la sécurité des patients. |
|
8.4. |
Les agents de santé peuvent également souffrir de tensions psychologiques, ou même de troubles mentaux, qui obèrent leur travail comme leur vie personnelle. Depuis quelques années, on constate de plus en plus que des personnels de santé réduisent leur pratique professionnelle ou partent en retraite anticipée en raison d’un épuisement dû à leur métier, d’une dépression ou d’autres problèmes de santé mentale (27). Le CESE demande que des investissements soient réalisés dans les services publics de santé mentale pour garantir que tous les professionnels de la santé puissent y accéder gratuitement et sans réserve. |
9. Mobilité
|
9.1. |
Le CESE souligne que le droit à la mobilité doit être respecté, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. Dans l’intérêt de chaque travailleur et de la profession dans son ensemble, il convient de faciliter la mobilité transfrontière, parce qu’elle offre des possibilités de transfert des connaissances et d’apprentissage mutuel et qu’ainsi, elle améliore les soins des patients et profite, au bout du compte, à l’ensemble du système de santé. Dans les cas où la migration a pour cause des impératifs financiers ou des conditions de travail défavorables, il est essentiel de cerner et de traiter les causes profondes de ces tendances, ainsi que de s’efforcer d’améliorer la situation du personnel de santé (28). |
|
9.2. |
La mobilité transfrontière ouvre des perspectives supplémentaires pour la planification des effectifs, et la mise en place d’un service européen de suivi du personnel de santé constituerait un élément organisationnel qui serait utile sur le long terme pour aider les États membres à élaborer et à pérenniser des structures de planification et à en coordonner les aspects transfrontières. Ce service devrait s’articuler avec les mécanismes de l’Union, en particulier le Semestre européen et le plan contre les pandémies qui est envisagé dans le cadre d’un futur règlement européen concernant les menaces transfrontières graves pour la santé (29). |
|
9.3. |
Les États membres doivent appliquer des politiques de recrutement éthiques et conformes au code de pratique mondial de l’Organisation mondiale de la santé pour le recrutement international des personnels de santé (30). On ne peut admettre qu’un pays considère que pour pallier la pénurie de personnels de santé nationaux, il lui suffit d’en recruter à l’étranger. Lorsque les flux de mobilité sont asymétriques, il faut s’efforcer de créer des mécanismes d’équilibrage, à même de favoriser des échanges profitables à l’une et l’autre partie. |
10. Autres observations
|
10.1. |
Un encadrement efficace joue un rôle déterminant dans la gestion des professionnels de santé à tous les niveaux: pour la formation aux soins de santé, il s’agit là d’un paramètre aussi complexe que hautement appréciable, dont la fonction primordiale est de plus en plus reconnue, s’agissant d’atteindre des normes élevées en matière d’éducation, de recherche et de pratique clinique. |
|
10.2. |
Pour toutes ces professions, les programmes d’étude devraient par conséquent prévoir suffisamment de cours de qualité destinés à former des responsables et à développer leurs compétences dirigeantes (31). |
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) C’est en 2012 que la Commission européenne a publié son plan d’action en faveur du personnel de santé dans l’UE.
(2) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (2014), Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society: report jointly prepared by the Social Protection Committee and the European Commission [Une protection sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société vieillissante: rapport conjoint du comité de la protection sociale et de la Commission européenne; en anglais], Office des publications de l’Union européenne, https://data.europa.eu/doi/10.2767/32352, p. 14.
(3) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2018 sur les services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des genres, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0464_FR.html
(4) JO C 129 du 11.4.2018, p. 44, JO C 487 du 28.12.2016, p. 7, JO C 204 du 9.8.2008, p. 103, brochure et avis du CESE sur la «Mutation économique, technologique et sociale des services avancés de santé à la personne âgée» (JO C 240 du 16.7.2019, p. 10); avis du CESE sur le thème «Vers un nouveau modèle de soins et d’accompagnement pour les personnes âgées: tirer les enseignements de la pandémie de COVID-19» (JO C 194 du 12.5.2022, p. 19).
(5) Addati, L., Cattaneo, U., et Pozzan, E. (2022), Soin à autrui au travail: Investir dans les congés et services de soin à autrui pour plus d’égalité de genre dans le monde du travail, Organisation internationale du travail, Genève. Rapport complet en anglais disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/global/topics/care-economy/WCMS_838653/lang--en/index.htm.
(6) https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2018.53
(7) Voir l’avis du CESE sur «L’impact de l’investissement social sur l’emploi et les budgets publics» (JO C 226 du 16.7.2014, p. 21).
(8) Eurofound (2020), Long-term care workforce: employment and working conditions [Main-d’œuvre du secteur des soins de longue durée: conditions d’emploi et de travail; en anglais], Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/nb/publications/customised-report/2020/long-term-care-workforce-employment-and-working-conditions
(9) Barslund, Mikkel e.a. (2021), Policies for long-term Carers [Politiques relatives aux prestataires de soins de longue durée; en anglais], Bruxelles, Parlement européen, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695476/IPOL_STU(2021)695476_EN.pdf
(10) https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/186932/12-Summary-Economic-crisis,-health-systems-and-health-in-Europe.pdf
(11) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (2021), Long-term care report: trends, challenges and opportunities in an ageing society [Rapport sur les soins de longue durée: tendances, enjeux et perspectives dans une société vieillissante; en anglais], Volume I, Chapter 3, Office des publications de l’Union européenne, p. 12, 28, https://data.europa.eu/doi/10.2767/677726
(12) Voir note de bas de page 11, p. 68-70.
(13) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, Zigante, V. (2018), Informal care in Europe: exploring formalisation, availability and quality [Les soins informels en Europe: analyse de la formalisation, de la disponibilité et de la qualité; en anglais], Office des publications, https://data.europa.eu/doi/10.2767/78836
Spasova, S., e.a. (2018), Challenges in long-term care in Europe. A study of national policies [Les défis en matière de soins de longue durée en Europe. Étude des politiques nationales; en anglais], Réseau européen de politique sociale (ESPN), Bruxelles, Commission européenne, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8128&furtherPubs=yes
(14) Voir note de bas de page 11, chapitre 3.
(15) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (2014), Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society: report jointly prepared by the Social Protection Committee and the European Commission [Une protection sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société vieillissante: rapport conjoint du comité de la protection sociale et de la Commission européenne; en anglais], Office des publications de l’Union européenne, https://data.europa.eu/doi/10.2767/32352, p. 36; et Commission paneuropéenne de la santé et du développement durable (2021), À la lumière de la pandémie — Une nouvelle stratégie en faveur de la santé et du développement durable, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/512059/Pan-European-Commission-health-sustainable-development-fre.pdf
(16) Danis, K., Fonteneau, L., e.a. (2020), «High impact of COVID-19 in long-term care facilities: suggestion for monitoring in the EU/EEA» [Forte incidence de la COVID-19 dans les établissements de soins et d’accompagnement de longue durée: suggestion concernant le suivi dans l’Union européenne et l’Espace économique européen; en anglais], Euro Surveillance: European Communicable Disease Bulletin [Bulletin européen sur les maladies transmissibles], 25 (22), https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.22.2000956
(17) JO C 286 du 16.7.2021, p. 109; JO C 429 du 11.12.2020, p. 251; JO C 242 du 23.7.2015, p. 48; JO C 143 du 22.5.2012; JO C 18 du 19.1.2011, p. 74; JO C 77 du 31.3.2009, p. 96.
(18) https://one.oecd.org/document/ECO/WKP(2021)43/en/pdf
(19) Liu, J. X., Goryakin, Y., Maeda, A., Bruckner, T., et Scheffler, R. (2017), «Global health workforce labor market projections for 2030» [Projections pour le marché du travail de la santé dans le monde à l’horizon 2030; en anglais], Human Resources for Health, 15:11 (https://human-resources-health.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12960-017-0187-2).
(20) https://www.who.int/fr/health-topics/health-workforce#tab=tab_1
(21) C’est en 2012 que la Commission européenne a publié son plan d’action en faveur du personnel de santé de l’Union.
(22) Comité permanent des médecins européens (CPME) (2021), CPME Policy on Health Workforce [Politique du CPME relative au personnel de santé; en anglais], https://www.cpme.eu/policies-and-projects/professional-practice-and-patients-rights/health-systems-and-health-workforce
(23) Voir note de bas de page 2.
(24) Russo, G., Pavignani, E., Guerreiro, C. S., Neves, C. (2017), «Can we halt health workforce deterioration in failed states? Insights from Guinea Bissau on the nature, persistence and evolution of its HRH crisis» [Peut-on enrayer la régression des effectifs de santé dans les États défaillants? Le cas de la Guinée-Bissau: nature, persistance et évolution de la crise des personnels de santé; en anglais], Human Resources for Health, 15(1):12.
(25) Voir note de bas de page 2.
(26) https://www.cpme.eu/api/documents/adopted/2020/3/EMOs.Joint_.Statement.on_.Violence.FINAL_.12.03.2020.pdf
(27) Dyrbye, L. N., Shanafelt, T. D., Sinsky, C. A., Cipriano, P. F., Bhatt, J., Ommaya, A., West, C. P., et Meyers, D. (2017), «Burnout among health care professionals: A call to explore and address this underrecognised threat to safe, high-quality care» [L’épuisement professionnel chez les professionnels de santé: appel à étudier et à combattre cette menace sous-estimée pour la sécurité et la qualité des soins; en anglais], NAM Perspectives, Discussion Paper, National Academy of Medicine, Washington, DC.
(28) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (2014), Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society: report jointly prepared by the Social Protection Committee and the European Commission [Une protection sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société vieillissante: rapport conjoint du comité de la protection sociale et de la Commission européenne; en anglais], Office des publications de l’Union européenne, https://data.europa.eu/doi/10.2767/32352, p. 14.
(29) Commission européenne, direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (2014), Adequate social protection for long-term care needs in an ageing society: report jointly prepared by the Social Protection Committee and the European Commission [Une protection sociale capable de répondre aux besoins en soins de longue durée dans une société vieillissante: rapport conjoint du comité de la protection sociale et de la Commission européenne; en anglais], Office des publications de l’Union européenne, https://data.europa.eu/doi/10.2767/32352, p. 14.
(30) https://www.who.int/fr/publications/m/item/nri-2021
(31) Van Diggele, C., Burgess, A., Roberts, C., et Mellis, C. (2020), «Leadership in healthcare education» [L’exercice de l’autorité dans la formation aux soins de santé; en anglais], BMC Medical Education, 20 (Suppl. 2), 456, https://doi.org/10.1186/s12909-020-02288-x
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/46 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/07)
|
Rapporteure: |
Katrīna LEITĀNE |
|
Décision de l’assemblée plénière |
24.2.2022 |
|
Base juridique |
Article 32, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» |
|
Adoption en section |
6.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
158/0/5 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
La participation politique est le fondement de toute démocratie qui fonctionne. Pour les jeunes Européens, le principal atout de l’Union est le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit (1). Il est essentiel de veiller à ce que le point de vue des jeunes soit pris en compte dans les décisions ayant une incidence sur leur avenir, car même un effet indirect peut affecter fortement les jeunes et les générations à venir. Les politiques qui ne ciblent pas directement les jeunes ou qui ne sont pas considérées comme relevant du domaine habituel de la politique de la jeunesse peuvent avoir pourtant de lourdes conséquences sur la vie des jeunes. Il est important de proposer des mécanismes efficaces, s’inscrivant en complémentarité avec les mécanismes participatifs existants, qui soient conformes aux principes démocratiques et adaptés aux besoins des jeunes. Une telle approche peut contribuer à améliorer et à rendre plus efficace l’élaboration des politiques. |
|
1.2. |
Le CESE a la conviction que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de s’adresser aux jeunes et de les informer de toutes les formes possibles de participation et des valeurs que représente le projet européen. Les programmes en vigueur au soutien de l’éducation formelle et non formelle, comme Erasmus+ et le corps européen de solidarité, ont permis d’améliorer les opinions des jeunes en ce qui concerne la participation démocratique et les valeurs et principes de l’Union européenne. |
|
1.3. |
Le CESE attire l’attention sur la nécessité d’inclure explicitement les jeunes dans l’élaboration des politiques grâce à leur participation significative, selon une méthode qui sera la mieux adaptée possible à la jeunesse, et qui sera suivie d’un contrôle, d’une évaluation et d’une analyse d’impact pour s’assurer que les points de vue des jeunes sont bien pris en compte lors de la prise de décision politique. La participation tout au long du processus d’élaboration des politiques crée une confiance au sein des jeunes générations et au-delà, ce qui leur permet d’être considérées comme légitimes et importantes au cours de ce processus. Celui-ci devrait comprendre une communication visible et transparente des résultats de leur participation — un élément déterminant pour instaurer la confiance entre les jeunes et l’élaboration des politiques (2). L’inclusion sociale et le dialogue avec des groupes aux besoins divers sont également essentiels. |
|
1.4. |
Le CESE convient que les organisations de la société civile peuvent jouer un rôle essentiel dans la participation des jeunes face aux enjeux de société et, partant, dans leur participation à l’élaboration des politiques et au processus démocratique. Ces organisations peuvent servir à la fois de passerelles et de réseaux de soutien pour aider les jeunes à dialoguer avec des organismes publics officiels et leur permettre de devenir des citoyens actifs. Le Comité soutient ces organisations et les jeunes citoyens dans les actions qu’ils mènent, et demande que des mesures soient prises pour faire en sorte que celles-ci puissent se déployer. |
|
1.5. |
Le CESE encourage les institutions européennes et les États membres à mettre en œuvre des mesures et des mécanismes qui garantissent que la perspective des jeunes soit prise en compte dans chaque domaine d’action, tout en leur offrant un espace qui leur permette de fournir une contribution cohérente et spécialisée sur les défis auxquels ils sont confrontés. Ces structures devraient également comprendre des mécanismes de suivi et de contrôle transparents et visibles, et compléter les instruments existants en faveur de la participation des jeunes sans entraîner de diminution du financement. Il convient de mettre à disposition des ressources appropriées pour une participation significative des jeunes à l’élaboration des politiques. |
|
1.6. |
La participation des jeunes aux processus politiques et décisionnels peut soutenir l’amélioration de la réglementation et des politiques en s’attachant à recenser et à comprendre les évolutions actuelles et à venir qui ont une incidence sur la vie des jeunes et des générations futures. Une telle approche peut aussi faciliter la tâche de l’auteur d’une proposition, dans la mesure où celui-ci peut bénéficier d’une contribution de qualité pour compléter des données secondaires. |
|
1.7. |
Le CESE souhaite faire observer que, si l’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes se fonde sur les objectifs principaux de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse (3) et de l’Année européenne de la jeunesse, ces deux instruments soulignent l’importance de l’intégration de la dimension de la jeunesse dans l’élaboration des politiques, ce qui nécessite une approche intersectorielle. Il s’agit également de l’une des mesures exposées dans le rapport sur les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe (4), qui a été approuvé par toutes les parties votantes de l’assemblée plénière de la conférence ainsi que par les citoyens participants. Pour obtenir des effets durables et léguer un héritage au-delà de l’Année européenne de la jeunesse, il faut donner aux jeunes les moyens d’ouvrir la voie au changement et de construire un avenir meilleur. |
|
1.8. |
Le CESE prend acte de la référence à l’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes dans la communication de la Commission sur les résultats de la conférence sur l’avenir de l’Europe (5). Il souligne toutefois que la proposition de la Commission n’est pas conforme aux objectifs et moyens de la proposition initiale, qu’il lui manque un dialogue significatif avec les organisations de jeunesse et les experts, ainsi qu’une intégration de la jeunesse dans toutes les politiques, et enfin qu’elle ne tient pas compte des effets à long terme des politiques sur les générations futures. Le CESE estime qu’une évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes devrait faire partie de la boîte à outils pour une meilleure réglementation, en tant qu’instrument distinct, sachant que les générations futures et les jeunes méritent une attention toute particulière. |
|
1.9. |
Le CESE préconise une coopération accrue entre les différentes institutions en vue de mettre en cohérence les initiatives existantes qui ont porté leurs fruits, telles que le dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, «Votre Europe, votre avis!» ou la Rencontre des jeunes européens (EYE), et de tisser des liens avec de futures initiatives telles que l’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes, dans le droit fil de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse. Par ailleurs, le Comité présente une liste de propositions relatives à la participation des jeunes en son sein, et il se donne pour but d’introduire dans ses travaux le concept d’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes. |
2. Observations générales
2.1. Le rôle des jeunes dans la construction du projet européen
|
2.1.1. |
Les jeunes représentent la locomotive du projet européen et leur créativité, leur énergie et leur enthousiasme sont le moteur de sa pérennité. Cette année 2022 a été proclamée Année européenne de la jeunesse, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré: «[…] l’Europe a besoin de toute sa jeunesse» et «Notre Union doit avoir une âme et une vision qui leur parlent» (6). |
|
2.1.2. |
Le projet de l’Union européenne ne peut être réalisé de manière efficace et adéquate dans l’environnement démocratique actuel sans prendre en compte le discours sur la participation politique des jeunes (7) dans les traditions démocratiques et les contextes géopolitiques. Margaritis Schinas, vice-président chargé de la promotion de notre mode de vie européen, s’est exprimé en ces termes: «L’Année européenne de la jeunesse devrait entraîner un changement de paradigme dans notre manière d’associer les jeunes au processus d’élaboration des politiques et de prise de décision.» La justification sous-jacente est d’ouvrir aux jeunes l’accès à une participation significative et de leur en donner les moyens (8). |
|
2.1.3. |
Selon les études Eurobaromètre (9), moins de la moitié (47 %) des Européens ont confiance dans l’UE et seuls 44 % ont d’elle une image positive. L’avenir du projet européen dépend en grande partie de la forte adhésion des jeunes aux valeurs de l’Europe et de leur disposition à embrasser une identité européenne. L’engagement actif des jeunes dans le processus politique et les procédures de prise de décision est essentiel, puisque leur avenir sera déterminé par les décisions adoptées aujourd’hui. Il y a dès lors lieu de mettre en place des instruments participatifs pour s’assurer que la voix des jeunes soit prise en compte. Il faut renforcer la participation à la vie civile et démocratique à tous les niveaux afin de garantir la prospérité future de l’Europe, tout en reconnaissant que la maturité démocratique influence (10) les schémas de participation politique des jeunes dans l’UE. |
|
2.1.4. |
L’initiative de l’UE de convoquer une conférence sur l’avenir de l’Europe a servi d’incitation à promouvoir le dialogue participatif avec les citoyens dans l’ensemble de l’Union. La voie à suivre consiste à améliorer l’efficacité des mécanismes de participation des jeunes existants et à en élaborer de nouveaux. Comme le suggèrent les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe, il pourrait s’agir d’une «évaluation du point de vue des jeunes» (11) de la législation, assortie d’une analyse d’impact et d’un mécanisme de consultation associant des représentants de la jeunesse (12). |
|
2.1.5. |
L’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes fonctionne comme une méthode de prospective stratégique pour l’élaboration des politiques. La prospective stratégique est un concept précieux que la Commission européenne entend utiliser dans le cadre du processus d’élaboration des politiques. Comme elle repose sur des principes tels que l’analyse prospective, l’analyse des grandes tendances, la planification et la vision par scénarios, elle ne saurait faire l’impasse sur le point de vue des jeunes et des générations futures. Tout en reposant sur la conscience que l’avenir n’est pas prédéterminé, le processus de prospective recueille des informations sur les scénarios possibles et se donne pour objectif de se préparer aux défis émergents. Le dialogue intergénérationnel peut comprendre quelques outils précieux qui garantissent que les politiques élaborées tiennent compte de ces évolutions et scénarios futurs. La réalisation d’analyses prenant en considération la perspective des jeunes et des générations futures peut et doit contribuer à des politiques plus efficaces et mieux adaptées, capables de relever les défis des générations à venir. |
|
2.1.6. |
Pour mettre en place des politiques qui seront mieux adaptées aux défis futurs, il faut que ces dernières reconnaissent et préservent les droits des jeunes et des générations futures, en veillant à ce qu’elles ne produisent pas d’effets négatifs sur certains groupes générationnels et sociaux spécifiques. À l’heure actuelle, ces groupes sont souvent ignorés ou considérés comme faisant partie d’autres groupes, ce qui ne reflète pas la réalité. En conséquence, les politiques ne répondent pas correctement aux défis et contribuent au déclin de la confiance et au désengagement à l’égard des institutions officielles. |
2.2. La nécessité d’une participation significative des jeunes
|
2.2.1. |
Toute participation significative pose la question du partage du pouvoir et de la capacité à prendre des décisions, avec l’intervention d’autres parties prenantes, dans des conditions transparentes connues de tous les acteurs concernés. Des dispositifs de responsabilisation bien conçus établissent la confiance de toutes les parties prenantes dans les processus participatifs politiques, et les responsabilités explicites des différents acteurs devraient être communiquées à toutes les parties prenantes. |
|
2.2.2. |
La confiance des jeunes dans les institutions publiques est au point mort depuis la crise financière mondiale à la fin des années 2000 (13) et la perception de leur influence politique et de leur représentativité dans la prise de décision reste inchangée. La participation des jeunes à la vie démocratique peut prendre diverses formes. Toutefois, le vote aux élections locales, nationales ou européennes est considéré comme le moyen le plus efficace de faire valoir son opinion auprès des responsables politiques (39 %) (14), et ce alors même que la proportion de jeunes accordant leur confiance à ce type de participation démocratique reste très faible. Dans le même temps, les personnes susceptibles de rester à l’écart de la politique le sont en raison du manque d’engagement sérieux et de confiance et du sentiment que participer est vain si leur contribution n’est pas prise en compte. L’un des principaux obstacles à la participation des jeunes est la conviction que les décideurs «n’écoutent pas les gens comme moi» (15). La promotion de la confiance et le renforcement du dialogue entre les jeunes et les institutions publiques sont donc essentiels pour garantir la préparation et la résilience des sociétés face aux chocs futurs (16). |
|
2.2.3. |
Une majorité (70 %) (17) des jeunes estiment qu’ils n’ont pas leur mot à dire ou très peu sur les décisions, les lois et les politiques importantes qui touchent l’UE dans son ensemble. 24,8 % (18) d’entre eux considèrent qu’ils n’ont aucune influence sur les sujets qui font l’objet de débats publics ou politiques et 40,8 % déclarent qu’ils n’ont pas beaucoup d’influence. Par ailleurs, 2/3 des répondants estiment qu’une plus grande sensibilisation des responsables politiques aux préoccupations des jeunes aiderait ces derniers à influencer davantage les politiques publiques, tandis que plus de 50 % d’entre eux pensent qu’un rôle plus important des organisations de jeunesse en politique servirait également cet objectif. |
|
2.2.4. |
Les jeunes ont changé leurs modes de participation, préférant désormais des formes d’engagement politique non institutionnalisées, et en particulier sans visées électorales (19). Les recherches montrent de plus en plus que cette évolution est liée à la chute de la confiance dans les organismes publics et au mécontentement à l’égard du fonctionnement de la démocratie représentative. La participation politique non conventionnelle des jeunes est devenue de plus en plus fluide, individualisée et personnalisée, avec une préférence pour des engagements sur des questions et des sujets isolés, ainsi que pour un activisme et une protestation directs en ce qu’ils représentent un «choix de mode de vie individuel» (20). Dans l’ensemble, les jeunes sont très motivés sur le plan politique. Au moment d’étudier le sujet de la participation des jeunes, les experts en matière d’engagement politique se sont prioritairement attachés à la question de savoir non plus si les jeunes souhaitaient s’engager, mais où et de quelle manière ils entendaient exprimer leur point de vue politique (21). Compte tenu de l’éventail très large des modes d’intervention qui sont aujourd’hui à la disposition des jeunes pour influencer le jeu politique, il apparaît clairement nécessaire de tenir compte de la participation politique de nature non conventionnelle, de la prise de décision participative, ainsi que du renforcement des mécanismes de communication et de transparence au sein d’un cadre institutionnel démocratique. L’élaboration des politiques au sein des organes publics devrait être adaptée et conçue en conséquence pour garantir la sensibilisation et le dialogue avec tous les groupes de jeunes lors de la prise de décision politique. Les mécanismes participatifs devraient être réellement inclusifs et communiqués de manière à toucher un public diversifié comprenant également les personnes difficiles à atteindre. |
|
2.2.5. |
Les organisations dirigées par des jeunes ont acquis de l’expérience et des connaissances dans un large éventail de sujets liés aux problèmes rencontrés par les jeunes. Leur inclusion dans le processus d’élaboration des politiques se traduira par des règles et des réglementations plus cohérentes et mieux adaptées. Le nombre sans cesse croissant de jeunes qui rejoignent ces organisations (22) contribue également à soutenir cet aspect. |
|
2.2.6. |
Une collaboration sérieuse avec les jeunes est essentielle. Il faut améliorer leur participation et s’attaquer en particulier au manque de représentation démocratique des jeunes et à la non-prise en compte de leur point de vue en dehors du domaine traditionnel de la politique de la jeunesse. Les jeunes souhaitent être associés à l’élaboration des politiques qui ont une incidence sur leur vie. La justice intergénérationnelle (23) consiste à remédier aux inégalités entre les générations dans les sociétés vieillissantes. |
|
2.2.7. |
Les outils existants pour l’analyse de l’impact sur les jeunes, comme l’outil numéro 31 de la boîte à outils pour une meilleure réglementation, ne prévoient pas l’intégration des jeunes ni l’inclusion d’organisations de jeunesse et de jeunes disposant d’une expertise pertinente, qui sont en mesure de procéder à un examen systématique des questions du point de vue de la jeunesse. Qui plus est, d’après les publications disponibles, ces outils sont mis en œuvre moins fréquemment que ne l’exigeraient la pertinence et l’importance des propositions. |
3. Observations particulières
3.1. Évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes
|
3.1.1. |
La proposition repose sur trois piliers: la consultation, l’analyse d’impact et les mesures d’atténuation (24). Elle fournit un cadre permettant d’améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques, sur la base d’une participation accrue des jeunes et de leur intégration dans l’élaboration des politiques, tout en tenant compte également des catégories de jeunes vulnérables, tels que les jeunes handicapés, les NEET (ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de formation) (25), les jeunes vivant dans des zones reculées, etc. Grâce aux différentes composantes de l’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes, la proposition offre une structure cohérente pour élaborer des politiques de grande qualité et plus pertinentes qui abordent les problèmes auxquels les générations futures peuvent être confrontées. |
|
3.1.2. |
La première étape de l’évaluation d’impact de l’Union du point de vue des jeunes consiste à déterminer la pertinence et l’impact de tout projet de proposition politique à venir pour les jeunes et les générations futures. On pourra ainsi décider s’il convient de réaliser sur telle ou telle politique à venir une évaluation d’impact complète du point de vue des jeunes. Au moyen d’une liste de contrôle, les évaluateurs peuvent savoir si le projet de proposition est effectivement pertinent pour la jeunesse et si l’incidence directe et indirecte de la proposition sera réelle pour les jeunes et les générations futures. Passée cette première étape, l’évaluation d’impact se poursuit pour franchir l’ensemble des échelons, allant de la consultation aux mesures d’atténuation en passant par l’analyse d’impact. Les indicateurs de la liste de contrôle devraient être élaborés sur la base des besoins et des idées des jeunes pour garantir qu’ils tiennent compte des propositions qui les intéressent selon la perspective qui est la leur. |
|
3.1.3. |
À l’étape suivante, les évaluateurs concernés doivent lancer une consultation substantielle avec les parties prenantes liées à la jeunesse pour veiller à ce qu’une expertise systématique soit disponible en vue d’une analyse approfondie. Sur la base de cet engagement, les évaluateurs s’efforceront de dresser l’inventaire des préoccupations des jeunes quant aux incidences potentielles du projet de politique à l’examen. Ce volet participatif doit être transparent et permettre à un large éventail de représentants de la jeunesse, d’organisations dirigées par des jeunes et de jeunes disposant de l’expertise nécessaire d’apporter leur contribution. On peut ainsi garantir une approche systématique des questions abordées dans les projets de propositions politiques. Le fait d’inclure des organisations de jeunesse, des représentants de la jeunesse et des jeunes disposant d’une expertise pertinente peut apporter à l’analyse d’impact une information contextuelle diversifiée et unique. Grâce à un dialogue constructif, les évaluateurs peuvent obtenir une vue d’ensemble complète fondée sur les connaissances et l’expertise générales acquises par ces jeunes. En s’appuyant sur cette contribution, l’analyse d’impact peut être suffisamment détaillée pour recenser les difficultés et les aspects que les politiques sont susceptibles de perturber. |
|
3.1.4. |
Sur la base des données disponibles devant être collectées au fil du processus et des résultats des consultations, les évaluateurs sont en mesure de rédiger l’évaluation d’impact en suivant les thèmes mentionnés dans la liste de contrôle et de fournir également une analyse prospective pour les générations futures. |
|
3.1.5. |
Si une incidence négative est constatée, l’évaluateur se doit de proposer des mesures d’atténuation axées au premier chef sur les groupes vulnérables et les jeunes défavorisés. Il serait souhaitable qu’au cours de la consultation, les évaluateurs puissent inclure des questions sur d’éventuelles mesures d’atténuation qui pourraient être intégrées à l’analyse. Dans les années à venir, il est recommandé de procéder à une évaluation afin de suivre les effets des politiques et la manière dont les mesures d’atténuation ont remédié aux effets négatifs. |
|
3.1.6. |
L’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes ne devrait pas se substituer à un dialogue constructif avec les jeunes en général et devrait compléter les mécanismes participatifs existants. |
|
3.1.7. |
La proposition est le fruit d’une série d’échanges avec les plus grands réseaux de jeunesse européens, tout en ayant été spécifiquement mentionnée dans plusieurs recommandations du dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse depuis sa création, et après l’avoir été par le «dialogue structuré» qui l’a précédé. Les jeunes ont exprimé leur ferme souhait d’une procédure d’élaboration des politiques transparente qui leur permettrait d’y contribuer et d’en suivre les résultats. |
|
3.1.8. |
La proposition s’inspire également du «test PME», qui apparaît comme un exemple d’outil approprié d’analyse d’impact au niveau européen, reposant sur les trois piliers que sont la consultation, l’analyse d’impact et les mesures d’atténuation (26). En outre, à l’instar du test PME, l’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes est également destinée à intégrer la boîte à outils pour une meilleure réglementation en tant qu’instrument distinct permettant de mettre en relief le rôle des jeunes dans l’avenir de l’Europe, conformément à la communication de la présidente de la Commission. |
|
3.1.9. |
La proposition se fonde sur les exemples d’outils d’évaluation de l’impact sur les jeunes qui existent déjà dans plusieurs États membres, tels que l’Autriche, l’Allemagne, la France, la Belgique (Flandre), ainsi qu’en dehors de l’Union, comme en Nouvelle-Zélande et au Canada. |
|
3.1.10. |
L’analyse d’impact proposée fournit une solution pour veiller à ce que les effets des politiques prennent en compte les besoins et les attentes des jeunes et offre une portée au-delà du domaine traditionnel de la politique de la jeunesse. Seule une petite partie des propositions de la Commission européenne fait l’objet d’une analyse du point de vue des jeunes. Or une part importante de ces propositions touche directement et indirectement leur qualité de vie. |
|
3.1.11. |
Il est suggéré d’inclure l’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes dans les analyses d’impact de l’action «Mieux légiférer» qui sont accessibles au public et de la publier sur le portail européen de la jeunesse. Il convient néanmoins d’examiner plus avant la voie la plus efficace. Cependant, la direction générale de la communication est encouragée à promouvoir activement cet instrument afin d’en assurer la visibilité, et le secrétariat général devrait soutenir son adoption dans les différentes DG. L’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes pourrait également être publiée par les institutions qui décident de la mettre en œuvre, y compris sur le site internet du CESE. La publication de l’évaluation et de la version finale de la proposition donnera aux acteurs de la jeunesse participant à la consultation la possibilité de voir comment leur contribution a été prise en compte. |
|
3.1.12. |
L’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes est proposée comme une structure susceptible d’être mise en œuvre aux niveaux local, régional et national, en collaboration avec les institutions de l’Union européenne. |
|
3.1.13. |
L’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes peut potentiellement améliorer les politiques, mais elle doit aussi s’appuyer sur des mécanismes participatifs significatifs, car l’exploitation des connaissances au plus près du terrain est un moyen de garantir l’efficacité et d’apporter des améliorations. |
3.2. La participation des jeunes au sein du CESE
|
3.2.1. |
Le CESE reconnaît l’importance de la participation des jeunes pour façonner l’avenir de l’Europe (27) et, partant, mène plusieurs initiatives couronnées de succès, telles que «Votre Europe, votre avis!», les tables rondes des jeunes pour le climat et le développement durable et le Sommet européen de la jeunesse sur le climat qu’il organise conjointement avec le Parlement européen. Dans le cadre du suivi de son avis NAT/788 (28), le CESE a inclus pour la première fois en 2021, à l’occasion de la COP 26, un délégué de la jeunesse dans sa délégation officielle à la conférence des parties de la CCNUCC. Par ailleurs, dans le cadre de l’Année européenne de la jeunesse, le prix de la société civile 2022 du CESE récompensera des initiatives efficaces, innovantes et créatives propres à créer un avenir meilleur pour les jeunes Européens et avec eux. |
|
3.2.2. |
Le CESE s’efforcera d’amplifier la voix des jeunes et des organisations de jeunesse au moyen de mécanismes participatifs plus structurés, constructifs et ciblés, afin de renforcer leur participation interne à ses travaux. En conséquence, le Comité devrait prendre les mesures suivantes:
|
|
3.2.3. |
Le CESE continuera d’explorer et d’étudier les possibilités d’appliquer le concept d’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes dans le cadre de ses travaux, avec pour visée d’élaborer une approche cohérente de la participation des jeunes en son sein. |
|
3.2.4. |
Le CESE invite la Commission européenne à répondre à cet avis d’initiative et à la proposition relative à l’évaluation d’impact de l’UE du point de vue des jeunes, ainsi qu’à réfléchir ensemble à la mise en œuvre. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Recherche documentaire, «European Youth in 2021» (La jeunesse européenne en 2021).
(2) «Influencing and understanding political participation patterns of young people» (Comprendre et influencer les schémas de participation politique des jeunes), Parlement européen, 2021 (uniquement en anglais).
(3) Résolution du Conseil de l’Union européenne sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027.
(4) Conférence sur l’avenir de l’Europe, Rapport sur les résultats finaux, mai 2022.
(5) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52022DC0404&qid=1660827033223
(6) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/SPEECH_21_4701
(7) Deželan, T., Moxon, D., «Influencing and understanding political participation patterns of young people: the European perspective» (Comprendre et influencer les schémas de participation politique des jeunes: la perspective européenne), étude, 2021 (uniquement en anglais).
(8) Barta, O., Boldt, G., Lavizzari, A., «Meaningful youth political participation in Europe: concepts, patterns and policy implications» (Une participation politique significative des jeunes en Europe: concepts, schémas et implications politiques), étude, 2021 (uniquement en anglais).
(9) Eurobaromètre 96 — hiver 2021-2022.
(10) Kitanova, M., «Youth political participation in the EU: evidence from a cross-national analysis» (Participation politique des jeunes dans l’UE: données issues d’une analyse transnationale), Journal of Youth Studies, vol. 23, no 7, 2020 (document reçu en 2018).
(11) https://www.youthforum.org/files/YFJ_EU_Youth_Test.pdf
(12) Rapport sur les résultats finaux de la conférence sur l’avenir de l’Europe.
(13) La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle — Des politiques adaptées à toutes les générations? Synthèse.
(14) Flash Eurobaromètre — Jeunesse et démocratie dans le cadre de l’Année européenne de la jeunesse, réalisé entre le 22 février et le 4 mars 2022.
(15) Parlement européen, rapport sur l’enquête auprès des jeunes («European Parliament youth survey: report»), septembre 2021 (en anglais uniquement).
(16) La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle — Des politiques adaptées à toutes les générations? Synthèse.
(17) Parlement européen, rapport sur l’enquête auprès des jeunes («European Parliament youth survey: report»), septembre 2021 (en anglais uniquement).
(18) Rapport sur l’enquête auprès des jeunes («Youth Survey Report»)(sous le trio de présidences Allemagne-Portugal-Slovénie, janvier 2022).
(19) Rapport sur l’enquête auprès des jeunes («Youth Survey Report») (sous le trio de présidences Allemagne-Portugal-Slovénie, janvier 2022).
(20) Rapport sur l’enquête auprès des jeunes («Youth Survey Report») (sous le trio de présidences Allemagne-Portugal-Slovénie, janvier 2022).
(21) Deželan, T., Moxon, D., «Influencing and understanding political participation patterns of young people: the European perspective» (Comprendre et influencer les schémas de participation politique des jeunes: la perspective européenne), étude, 2021 (uniquement en anglais).
(22) Eurobaromètre sur l’Année européenne de la jeunesse: «Young Europeans are increasingly engaged» (Les jeunes Européens sont de plus en plus engagés), Commission européenne, 2022 (uniquement en anglais).
(23) La gouvernance au service des jeunes, de la confiance et de la justice intergénérationnelle — Des politiques adaptées à toutes les générations? Synthèse.
(24) https://www.youthforum.org/files/Concept-Note_final.pdf et https://www.youthforum.org/files/YFJ_EU_Youth_Test.pdf
(25) JO C 152 du 6.4.2022, p. 27.
(26) «Better Regulation Toolbox — SME Test» (Boîte à outils pour une meilleure réglementation — test PME).
(27) Voir l’avis SOC/706 sur l’«Année européenne de la jeunesse» (JO C 152 du 6.4.2022, p. 122) et l’avis SOC/589 sur «Une nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse» (JO C 62 du 15.2.2019, p. 142).
(28) JO C 429 du 11.12.2020, p. 44.
(29) Une étude du CESE sur la participation structurée des jeunes est en cours: il s’agit de recenser les bonnes pratiques aux niveaux international, européen, national et local afin de mettre en place les mécanismes nécessaires et appropriés pour garantir que la voix des jeunes sera entendue.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/53 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Le rôle des technologies d’élimination du carbone pour la décarbonation de l’industrie européenne»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/08)
|
Rapporteur: |
Andrés BARCELÓ DELGADO |
|
Corapporteure: |
Monika SITÁROVÁ |
|
Décision de l’assemblée plénière |
18.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Commission consultative des mutations industrielles (CCMI) |
|
Adoption en section |
24.6.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
229/0/7 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE réaffirme qu’il soutient pleinement les engagements pris dans le cadre du pacte vert ainsi que le renforcement de la primauté industrielle de l’UE et de son autonomie stratégique en matière de fourniture d’énergie. |
|
1.2. |
Les effets de la guerre qui sévit actuellement en Ukraine sur la disponibilité de l’énergie et des matières premières ne peuvent être négligés, et le Semestre européen doit suivre l’évolution de la situation. |
|
1.3. |
Le succès de la transition écologique dans l’industrie manufacturière repose sur un bouquet suffisant et approprié d’énergies renouvelables pour permettre l’électrification et la production d’hydrogène vert. Les technologies d’élimination du dioxyde de carbone (EDC), de captage et stockage du CO2 (CSC) et de captage et utilisation du CO2 (CUC) aideront l’industrie à atteindre la neutralité climatique. Pour atteindre les objectifs du pacte vert, il faut que les énergies renouvelables soient déployées dans toute l’Europe. |
|
1.4. |
La décarbonation nécessitera de transformer en profondeur les activités industrielles (au cours des 30 prochaines années). S’il existe déjà de nombreuses technologies à faible intensité de carbone, elles présentent un faible niveau de maturité technologique (NMT) (1). Des feuilles de route technologiques ambitieuses devront être élaborées pour développer et déployer à grande échelle ces technologies de pointe, et l’UE se doit de promouvoir l’innovation par l’intermédiaire des fonds pour le climat et pour l’innovation. |
|
1.5. |
Le développement des technologies ainsi que l’éducation et la reconversion professionnelle des travailleurs sont dès lors essentiels à la transition écologique dans l’industrie manufacturière. Le dialogue social, tant au niveau européen qu’au niveau des États membres et des régions, devrait contribuer à faire en sorte que la nécessité d’une transition écologique et juste dans le secteur soit reconnue, acceptée et soutenue. Le renforcement des capacités et les projets visant à définir les compétences clés seront primordiaux pour assurer une transition industrielle efficace qui ne laisse personne de côté. |
|
1.6. |
Un recours accru aux matières premières de substitution, et en particulier à la biomasse durable, est susceptible de contribuer à une élimination durable du carbone présent dans l’atmosphère en favorisant la gestion durable des terres productives (terres agricoles et forestières) et l’utilisation de la biomasse dans des produits à longue durée de vie qui prolongent encore l’effet bénéfique de l’élimination. Il contribuerait en outre à réduire la dépendance de l’UE à l’égard des matières premières et des ressources importées. |
|
1.7. |
Le CESE demande que soit préservée la compétitivité de l’industrie européenne: l’UE est une pionnière en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2, mais il faut que d’autres acteurs se rallient à ses ambitions en matière de climat. Puisque la crise climatique affecte le monde entier, la diplomatie de l’Union européenne doit redoubler d’efforts pour convaincre efficacement les pays tiers de s’engager plus activement dans la lutte contre ce phénomène. Indépendamment des objectifs stratégiques ambitieux qu’affiche l’UE, son rôle pionnier en matière de décarbonation des industries ira en s’intensifiant, grâce au soutien politique qu’elle apporte à ce processus et aux connaissances pratiques dont disposent les entreprises et leurs travailleurs en ce qui concerne les capacités industrielles, les technologies nécessaires et la manière d’anticiper les changements, ce qui permettra d’adopter des mesures concrètes en conséquence. |
|
1.8. |
Le maintien d’une base industrielle solide au sein de l’UE assurera la prospérité, des emplois de qualité et la mobilisation de la société européenne dans la lutte contre le changement climatique. L’industrie européenne doit investir en Europe, que ce soit dans la recherche, le développement et l’innovation (RDI) ou dans les installations et les équipements, de manière à préserver sa position concurrentielle, et doit disposer pour ce faire d’un cadre réglementaire approprié. |
2. Observations générales
|
2.1. |
La loi européenne sur le climat a défini un objectif ambitieux de réduction des émissions à l’horizon 2030 tout en confirmant l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050. Cela exige d’analyser toutes les activités émettrices de gaz à effet de serre et de définir des trajectoires permettant de réduire à zéro les émissions nettes aux alentours de 2050. |
|
2.2. |
Les industries manufacturières sont responsables de 20 % (2) des émissions européennes. Sur notre continent, celles qui émettent le plus de CO2 sont les industries du fer et de l’acier, du ciment, de la chimie et de la pétrochimie, de la pâte à papier et du papier, des engrais, du verre, de la céramique, du raffinage du pétrole et des métaux non ferreux (principalement l’aluminium). Les émissions de gaz à effet de serre du secteur industriel comprennent le dioxyde de carbone (CO2) résultant de la consommation d’énergie, des utilisations non énergétiques des combustibles fossiles et de sources autres que les combustibles fossiles, ainsi que des gaz autres que le CO2. |
|
2.3. |
La transition écologique de l’industrie manufacturière est essentielle pour se conformer à la loi européenne sur le climat. La transition interviendra d’abord dans les technologies et sera suivie de modifications des méthodes de travail, des qualifications et des compétences au niveau des industries. Toutefois, il sera également nécessaire de prendre des mesures axées sur la demande afin de promouvoir l’adoption des produits à faible intensité de carbone et de nouveaux modèles industriels (symbiose industrielle, circularité, modulation de la consommation). |
3. L’industrie manufacturière sur la voie de la neutralité climatique
|
3.1. |
Le présent avis d’initiative se concentre sur les secteurs industriels relevant du système d’échange de quotas d’émission. Il ne couvre donc pas les entreprises publiques du secteur de l’énergie, les transports et les bâtiments. |
|
3.2. |
Outre le défi de la décarbonation, il est impératif pour chaque secteur industriel d’améliorer son efficacité énergétique. Si elle ne suffira pas à décarboner l’industrie européenne, l’efficacité énergétique peut réduire sensiblement les émissions dues à la consommation d’énergie. L’on assistera à une transition des combustibles fossiles vers des technologies non émettrices de gaz à effet de serre, à savoir principalement les énergies renouvelables. Les services publics et les pouvoirs publics sont responsables de la transition énergétique des combustibles fossiles vers des technologies non émettrices. |
|
3.3. |
En ce qui concerne le défi de la décarbonation, les industries peuvent être classées comme suit:
|
|
3.4. |
La cogénération industrielle à haut rendement (CHP (3)) contribuera certainement à accroître l’efficacité énergétique, mais elle ne permettra pas de décarboner l’industrie. L’utilisation de la chaleur à basse enthalpie issue de l’industrie pour le chauffage urbain constituerait un autre moyen d’accroître l’efficacité énergétique globale et constitue une piste à envisager dans le cadre de la transition vers une décarbonation complète. |
|
3.5. |
Les technologies EDC éliminent le CO2 déjà émis dans l’atmosphère, générant ainsi des émissions «négatives». Les technologies CSC, telles que la bioénergie avec captage et stockage du carbone («bioenergy with carbon capture and storage» ou BECCS) et le captage direct dans l’air et stockage («direct air capture and storage» ou DACCS), constituent une part importante de la palette de technologies à émissions négatives. Toutefois, malgré leur potentiel d’atténuation du changement climatique, ces technologies n’en sont actuellement qu’au stade de la démonstration. Les autres technologies EDC, parmi lesquelles les activités qui renforcent les puits naturels de CO2, telles que le boisement et le reboisement, ne relèvent pas du champ d’application du présent avis. |
Le défi de l’avenir de l’EDC dans l’industrie manufacturière est de trouver un équilibre dans le cadre duquel le captage et stockage du carbone constituerait une possibilité d’atténuation aux côtés d’autres technologies de réduction et d’élimination du carbone. Les réductions et l’élimination des gaz à effet de serre doivent être conformes à l’accord de Paris et à la loi européenne sur le climat. Si le CSC peut permettre à l’UE de progresser au rythme nécessaire en matière d’élimination des gaz à effet de serre, l’objectif à long terme doit être d’éviter le stockage du carbone.
|
3.6. |
L’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables (hydrogène vert) semble être la réponse transsectorielle aux processus de décarbonation. Il existe ainsi, en Suède, un projet visant à éliminer les émissions de gaz à effet de serre imputables à la production d’acier en recourant à l’hydrogène renouvelable. En Finlande, un projet montrera comment produire de l’hydrogène bleu, puis vert, et capter le CO2 pour le stocker ensuite de manière permanente dans la mer Baltique. |
4. L’industrie manufacturière sur la voie de la décarbonation
|
4.1. |
Parmi toutes les industries européennes, nous nous concentrerons sur les secteurs qui présentent un fort potentiel d’amélioration et sont les plus susceptibles de contribuer à la réduction des émissions de CO2 en Europe. Dans l’industrie manufacturière, l’accent est mis sur les secteurs qui ont davantage de difficultés à surmonter pour se décarboner. Le présent avis se concentre sur les secteurs de l’acier, du ciment, de la chimie et pétrochimie, du raffinage du pétrole, de la pâte à papier et du papier, des engrais, du verre et de la céramique. |
|
4.2. |
Avant de décrire les technologies susceptibles d’avoir une incidence sur la réduction et l’élimination des émissions de dioxyde de carbone, nous devons envisager de passer des sources d’énergie dérivées des combustibles fossiles à d’autres sources d’énergie ne générant pas d’émissions et d’autres sources renouvelables. Ces sources pourraient être l’éolien, l’énergie photovoltaïque et thermosolaire, l’énergie hydroélectrique, l’énergie géothermique, la biomasse et les biocarburants. |
|
4.3. |
Certaines industries devraient intégrer dans leurs processus des technologies existantes ou nouvelles pour ramener à zéro leurs émissions de gaz à effet de serre, de façon à permettre l’avènement d’une société neutre pour le climat. Selon les secteurs et leurs émissions actuelles de gaz à effet de serre, le changement devra intervenir en une seule ou en plusieurs étapes. |
|
4.4. |
Ce premier pas pourrait sembler être une «simple» adaptation du volet production ou approvisionnement du processus. Dans de nombreuses autres situations, il peut être nécessaire de pousser plus loin la recherche et le développement, par exemple en vue d’adapter les brûleurs au gaz naturel actuels à l’hydrogène ou d’utiliser des pompes à chaleur. Les considérations relatives à l’interaction entre l’hydrogène et les différents matériaux ou produits devraient elles aussi être prises en considération. |
|
4.5. |
Sidérurgie
Le défi qui se pose à l’industrie sidérurgique traditionnelle (filière intégrée, qui nécessite une réduction du minerai de fer) s’est déjà traduit par l’introduction de plusieurs nouvelles approches technologiques, qui se concentrent à présent sur le remplacement des hauts fourneaux par des fours électriques à arc alimentés par du fer préréduit produit à partir d’hydrogène vert. D’autres solutions déjà étudiées reposent sur les technologies CSC, mais elles ne permettent pas d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’électrolyse du minerai de fer pourrait émettre jusqu’à 87 % de CO2 en moins que la filière intégrée actuelle (pour peu que l’alimentation électrique soit entièrement décarbonée). La réduction par plasma d’hydrogène devait permettre de réduire à zéro les émissions de CO2. En réalité, la production d’acier à l’aide de l’hydrogène pourrait émettre jusqu’à 95 % de CO2 en moins que la filière intégrée actuelle (pour peu qu’elle s’appuie sur une électricité entièrement décarbonée), mais la perte d’énergie encourue au moment de produire l’hydrogène augmenterait la consommation d’énergie du secteur. La production d’acier dans des fours électriques à arc ne produit que 14 % des émissions de gaz à effet de serre de la filière intégrée; le principal défi consiste à remplacer le gaz naturel dans les fours de laminage par de l’hydrogène vert ou de l’électricité d’induction. Le CUC (qui utilise les gaz résiduaires des hauts fourneaux) peut entraîner une baisse des émissions pouvant atteindre 65 % s’il est intégralement déployé (la réduction des émissions de CO2 dépend également du cycle de vie complet des produits chimiques qui en résultent). Plusieurs projets en sont à un stade de développement avancé: l’usine de démonstration de Steelanol (actuellement en construction — NMT 9) utilise des gaz résiduaires pour produire du bioéthanol, et le projet Carbon2Chem (NMT 7-8) vise à utiliser les gaz résiduaires comme matière première pour la fabrication de produits chimiques. |
|
4.6. |
Industrie du ciment
Seules 37 % des émissions de l’industrie du ciment proviennent des combustibles, les 63 % restants étant le résultat d’une réaction chimique de la matière première (qui génère ce qu’on appelle les «émissions de procédé»). Le recours à des combustibles issus de sources renouvelables (biomasse ou hydrogène) ne réduira donc l’émissivité que de 35 % au maximum. Des technologies actuellement à l’essai pourraient permettre à l’avenir de capter et de gérer ou stocker le CO2 (méthode fondée sur les amines et boucle calcium). Un autre moyen de réduire les émissions est de développer ce que l’on appelle les ciments pauvres en clinker, qui affichent actuellement un NMT compris entre 5 et 7. L’émissivité de ces ciments est jusqu’à 30 % inférieure à celle des ciments Portland purs. |
|
4.7. |
Industrie chimique
Dans l’industrie chimique, l’électrification des processus de production, notamment par le recours au vapocraquage, vise à réduire de 90 % les émissions de CO2 par four de craquage. Le secteur de la chimie joue un rôle important dans le rétablissement de cycles du carbone durables. Les produits chimiques constituent un réservoir massif de carbone capable de fixer le carbone pendant 10 à 40 ans. Aujourd’hui, le volume de carbone incorporé dans les produits chimiques est comparable aux émissions totales générées par l’industrie pour la fabrication de ces produits. Même si la majeure partie de ce carbone finit dans l’atmosphère lorsque les produits sont incinérés après utilisation, il est indispensable de déployer une stratégie ambitieuse au service de l’économie circulaire pour parvenir à des cycles du carbone qui soient durables et à l’épreuve du changement climatique en maintenant le carbone «dans le circuit». Le secteur de la chimie peut contribuer à la réduction des émissions dans d’autres secteurs en «absorbant» le carbone et en le stockant dans des produits. |
|
4.8. |
Industrie de la pâte à papier et du papier
Dans l’industrie de la pâte à papier et du papier, une combinaison d’améliorations des processus, y compris la transition vers l’industrie 4.0, et d’investissements dans des technologies de production de pointe devrait permettre de réduire de 7 millions de tonnes les émissions de CO2 à l’horizon 2050. En s’appuyant sur ses installations de cogénération sur site, l’industrie est en mesure de s’engager sur le marché de l’énergie en utilisant les excédents issus des énergies renouvelables intermittentes. Les avantages qui en résulteraient en matière de décarbonation pourraient atteindre jusqu’à 2 millions de tonnes. Poursuivre la conversion énergétique des installations industrielles au profit de sources à émissions de carbone faibles ou nulles doit permettre de réduire de 8 millions de tonnes les émissions de CO2. À certains des concepts révolutionnaires recensés dans le cadre du projet «Two Team» (4), tels que la technologie «Deep Eutectic Solvents» en cours de développement, s’ajoutent d’autres solutions innovantes et disruptives qui pourraient compléter l’effort de réduction des émissions de CO2 en réduisant celles-ci de quelque 5 millions de tonnes supplémentaires. |
|
4.9. |
Raffineries de pétrole
Les raffineries de pétrole sont susceptibles de contribuer à la transition énergétique et climatique de l’économie européenne de deux façons: i) en réduisant sensiblement l’empreinte carbone de leur processus de production, et ii) en remplaçant progressivement les combustibles et autres produits d’origine fossile par des combustibles et autres produits à base de carbone d’origine biologique ou recyclé. Associé aux technologies CUC et CSC, le remplacement graduel de l’énergie fossile par la bioénergie se traduira même par des émissions de gaz à effet de serre négatives. Les émissions nettes de gaz à effet de serre générées lors de l’utilisation des combustibles et autres produits du raffinage peuvent être considérablement réduites en remplaçant pas à pas le pétrole brut utilisé comme matière première par la biomasse durable et le CO2 recyclé. Les émissions nettes de CO2 dans l’atmosphère induites par l’utilisation de ces combustibles seront nulles ou extrêmement faibles, contribuant ainsi à la décarbonation des modes de transport, et notamment de ceux pour lesquels le passage à l’électrique est plus difficile à mener. Des investissements et de nouveaux projets sont en cours dans ces domaines. Trois des quelque 80 grandes raffineries que compte l’UE ont ainsi été converties en bioraffineries, remplaçant complètement le pétrole brut par de la biomasse durable (5). Cette stratégie de transition climatique nécessite moins de ressources financières que d’autres, étant donné que les raffineries elles-mêmes et le système logistique de distribution des produits peuvent, dans une large mesure, être adaptés et réutilisés. |
|
4.10. |
Engrais
L’industrie des engrais étudie actuellement les possibilités de remplacer le gaz naturel en tant que matière première par de l’hydrogène vert. Plusieurs projets pilotes (6) sont en préparation dans l’ensemble de l’UE et, une fois que l’hydrogène vert sera disponible et que la question de son coût sera réglée, l’industrie s’engagera sur la voie d’une décarbonation totale. |
|
4.11. |
En conclusion, l’industrie manufacturière affiche un potentiel de décarbonation fondé sur l’efficacité énergétique, l’optimisation des processus et la conversion aux énergies renouvelables. Des investissements dans les activités de recherche, développement et innovation seront nécessaires pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Les technologies CSC et CUC sont également importantes pour les industries manufacturières telles que l’industrie du ciment et celles qui utilisent la biomasse comme source d’énergie. |
5. Aptitudes et compétences dans l’industrie manufacturière de demain
|
5.1. |
Les nouveaux processus industriels nécessiteront sans aucun doute de nouvelles méthodes de travail. Les industries et les travailleurs devront adapter leur mode de fonctionnement, en mettant l’accent sur la réduction des émissions de CO2 dès les premières étapes des processus de fabrication. |
|
5.2. |
La transition écologique de l’industrie manufacturière modifiera la production à bien des égards, que ce soit par le déploiement généralisé de nouvelles technologies de production ou le recours à la numérisation. De nouvelles aptitudes, ainsi qu’une reconversion et un perfectionnement professionnels, seront nécessaires pour parvenir à une transition juste dans laquelle personne n’est laissé de côté. Il convient de veiller tout particulièrement à inviter les citoyens, travailleurs, PME, entreprises sociales et experts régionaux de l’UE à jouer localement un rôle proactif dans les changements inévitables qui s’annoncent. |
|
5.3. |
L’UE doit faire en sorte que les connaissances relatives aux nouvelles technologies et à la manière de les mettre en œuvre dans les industries actuelles parviennent aux travailleurs de ces secteurs. Les pouvoirs publics et les entreprises doivent également s’atteler à mobiliser les compétences existantes, dans le respect du dialogue social, en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation. |
|
5.4. |
La généralisation du recours à l’hydrogène vert dans l’industrie sera capitale pour de nombreux secteurs d’activité. La mise en œuvre des technologies d’élimination du dioxyde de carbone aura, toutefois, également une incidence sur les aptitudes et les compétences dans l’industrie manufacturière et, dans une large mesure, au niveau de la chaîne d’approvisionnement. |
6. Action de l’UE et conditions-cadres
|
6.1. |
Le cadre juridique de l’Union européenne et les réglementations nationales doivent contribuer à la décarbonation de l’industrie. Ils devraient tenir compte du fait que les possibilités qu’offre la transition et/ou les ressources à investir dans cette dernière varieront considérablement d’un État membre et d’une région à l’autre en Europe. |
|
6.2. |
Le Fonds pour une transition juste, qui vise à soutenir les régions très dépendantes des industries à forte intensité de carbone, constitue un premier pas dans la bonne direction. Son champ d’application, limité aux régions largement dépendantes du charbon, du lignite, de la tourbe, du schiste bitumineux et des industries à forte intensité de carbone, est cependant trop restreint. Le CESE propose, à l’instar du Parlement européen, d’augmenter considérablement le budget du Fonds pour une transition juste afin de soutenir les autres secteurs touchés par la décarbonation de l’industrie. Des ressources budgétaires supplémentaires devraient être affectées aux initiatives visant à assurer la transition d’un emploi à l’autre, la création d’emplois de substitution de bonne qualité dans les mêmes régions que les précédents, ainsi qu’une formation, une reconversion et un perfectionnement professionnels adéquats des travailleurs. |
|
6.3. |
La transition écologique de l’industrie nécessitera de pouvoir accéder à une énergie et à des matières premières neutres en carbone en quantités suffisantes et à un prix abordable, stable et compétitif. Des investissements importants, y compris dans les infrastructures énergétiques, devront être réalisés en Europe pour faire face aux grandes quantités d’énergies renouvelables dont l’industrie aura besoin. |
|
6.4. |
Le cadre réglementaire de l’UE doit mener l’économie de l’Union à l’objectif de neutralité climatique nette d’ici à 2050 en créant les conditions requises pour libérer les ressources considérables, qu’elles soient financières, technologiques ou intellectuelles, nécessaires pour investir rapidement dans les technologies à faible intensité de carbone, y compris les technologies d’élimination du carbone. |
|
6.5. |
Des incitations régulières sont nécessaires pour favoriser le déploiement du captage du carbone dans les industries manufacturières, que ce soit au niveau européen — par l’intermédiaire du Fonds pour l’innovation — ou de chaque État membre, sans toutefois démanteler le marché unique, qui constitue l’une des pierres angulaires de l’UE. L’Union devra entreprendre des initiatives supplémentaires pour attirer et mobiliser les investissements privés. |
|
6.6. |
Des alliances stratégiques doivent être nouées au niveau européen afin d’accélérer le développement de cette industrie, pour permettre à l’UE de jouer un rôle moteur dans ce domaine. Les règles actuelles en matière d’aides d’État pourraient être adaptées à cette fin. |
|
6.7. |
Il convient d’accorder une attention particulière aux activités de recherche et développement, en menant un dialogue à ce sujet au niveau européen. Le Fonds pour l’innovation doit être le véhicule privilégié pour canaliser ces activités. |
|
6.8. |
Les politiques en matière de marchés publics devraient être utilisées pour stimuler les marchés des produits verts, dont les producteurs réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport aux produits dits «bruns». |
|
6.9. |
Le retard constaté dans la lutte contre le changement climatique et les contraintes de temps signifient que les rapports du Semestre européen et les recommandations adressées à chaque État membre doivent inclure certains indicateurs clés de performance pour contribuer à la nécessaire décarbonation de l’industrie. |
|
6.10. |
Le rapport de prospective stratégique devrait examiner périodiquement les progrès accomplis, les scénarios et options les plus prometteurs ainsi que les points faibles des efforts déployés pour atteindre les objectifs climatiques. Cette démarche est d’autant plus importante qu’elle peut fournir des orientations pour les investissements urgents et à haut risque, mais aussi pour une mise en commun raisonnable des ressources, tant verticalement qu’horizontalement. |
|
6.11. |
Différents signaux mènent au constat préoccupant que les conditions de concurrence ne sont pas équitables et qu’il existe un risque de «fuite de carbone» vers les pays tiers, entravant la transition vers des industries à émissions de carbone nulles. Cela souligne une fois de plus l’importance d’introduire le contrôle de la compétitivité en tant qu’outil de filtrage des risques et d’orientation. |
|
6.12. |
Il existe des divergences clairement documentées entre les concentrations d’émissions selon les États membres, les émissions par habitant, les secteurs économiques et les régions. Compte tenu des contraintes de temps, il convient de se concentrer en priorité sur l’obtention des résultats les plus rapides et les plus importants sur la voie de la décarbonation. La métallurgie, les matières minérales, les produits chimiques et l’industrie des combustibles renouvelables doivent donc être au cœur de toutes les attentions.
La capacité d’innover et la volonté d’utiliser et de commercialiser les innovations les plus récentes diffèrent en fonction de la taille des entreprises, les très grands groupes bénéficiant d’un avantage lorsqu’il s’agit de développer de nouveaux produits tandis que les PME affichent la volonté la plus forte de les utiliser. Il convient donc d’encourager et de faciliter le transfert de connaissances, qu’il soit intersectoriel ou vertical, en créant un environnement favorable aux entreprises. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Les niveaux de maturité technologique (NMT) correspondent aux différents degrés d’une échelle utilisée pour mesurer les progrès ou le niveau de maturité d’une technologie.
(2) Agence européenne pour l’environnement.
(3) «Combined heat and power» ou production combinée de chaleur et d’électricité.
(4) https://www.cepi.org/two-team-project-report/.
(5) Gela, la bioraffinerie de Venise (eni.com) et La Mède (TotalEnergies.com).
(6) Fertiberia a lancé une usine d’engrais «impact zéro» à Puertollano, en Espagne.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/59 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «La transition énergétique et numérique dans les zones rurales»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/09)
|
Rapporteur: |
John COMER |
|
Corapporteur: |
Luís MIRA |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Agriculture, développement rural et environnement» |
|
Adoption en section |
30.6.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
173/1/2 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE estime qu’une stratégie combinée de transition énergétique et numérique dans les zones rurales n’a pas bénéficié du niveau d’attention et de soutien escompté. Il appelle à la mise en œuvre rapide de la vision à long terme de la Commission pour les zones rurales de l’Union européenne et à la mobilisation des parties prenantes dans le cadre du pacte rural de l’Union européenne. Les zones rurales les plus vulnérables doivent faire l’objet d’une attention particulière afin que personne ne soit laissé pour compte. Il est essentiel de mettre l’accent sur la précarité énergétique et les zones rurales. |
|
1.2. |
Le CESE est convaincu que le succès futur de l’Europe dépendra largement de la manière dont elle traite les zones rurales, de façon équilibrée par rapport aux zones urbaines. Les populations rurales ne doivent pas être désavantagées en ce qui concerne la numérisation et les options disponibles en matière de consommation d’énergie, eu égard par exemple à la nécessité de recourir à la voiture particulière en raison du manque de transports publics. |
|
1.3. |
Il s’impose de s’appuyer sur le rôle des communautés locales pour parvenir à une transition énergétique juste combinée au développement local en créant et en renforçant les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes, ce qui implique notamment que se réunissent sur une base volontaire les citoyens, les autorités locales et les PME afin de promouvoir les avantages sociaux et économiques. |
|
1.4. |
Le CESE demande le renforcement des politiques et instruments suivants:
|
|
1.5. |
Le CESE invite la Commission à proposer une législation sur le numérique rural (Digital Rural Act) en qualité de troisième composante de la stratégie numérique de l’Union européenne, en sus des législations sur les marchés numériques et les services numériques. La numérisation ouvrira de nouvelles perspectives (en particulier pour les jeunes), ce qui pourrait modifier les tendances démographiques en permettant aux personnes de travailler depuis leur domicile et depuis des «antennes» de leur entreprise situées en milieu rural. |
|
1.6. |
Le CESE souligne qu’il est impératif de garantir l’accès à une connexion internet à haut débit sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones à faible densité de population, pour que les plans nationaux ou européens pour la reprise et la résilience puissent bénéficier pleinement de la contribution des zones rurales. Il demande instamment aux gouvernements soit de créer les conditions permettant aux opérateurs privés de fournir ce service, soit de faire appel à une entreprise publique pour fournir ce service. |
|
1.7. |
Le CESE estime que les pouvoirs publics et les prestataires de services devraient développer des applications conviviales adaptées aux réalités des modes de vie et des activités en milieu rural. Le recours à ces technologies réduira par exemple l’empreinte carbone de l’agriculture (agriculture de précision) et contribuera à améliorer l’accessibilité des zones reculées (drones). Le secteur public doit intervenir si le secteur privé ne fournit pas ces solutions. |
|
1.8. |
Le CESE souligne que les utilisateurs ruraux, quel que soit leur âge, doivent pouvoir bénéficier d’une formation et d’une mise à niveau appropriées pour utiliser cette nouvelle technologie numérique. Personne ne doit être laissé pour compte dans les zones défavorisées et chacun doit également avoir accès aux dispositifs nécessaires, grâce à un usage partagé ou à des possibilités d’achat subventionné par l’État. |
|
1.9. |
En conclusion, le CESE estime que le déploiement des technologies numériques dans les zones rurales est nécessaire pour soutenir la transition énergétique. Le système énergétique en milieu rural doit être décentralisé, ce qui implique un besoin énorme d’interconnexions plus nombreuses et de meilleure qualité, d’où la nécessité de déployer des technologies numériques afin de faire coïncider l’offre et la demande et de garantir des flux énergétiques efficaces. L’application numérique en milieu rural devra être très efficace sur le plan énergétique en raison d’un moindre taux d’utilisation et d’une densité de population plus faible. La connectivité informatique à faible consommation d’énergie est une nécessité pour les zones rurales. |
|
1.10. |
Le CESE souligne qu’étant donné que 30 % de la population de l’Union européenne vit dans des zones rurales, une transition énergétique rurale juste est un élément essentiel de la transition juste vers une Union européenne neutre pour le climat, durable et prospère, conformément à l’agenda territorial 2030. |
|
1.11. |
La Commission a proposé que 20 % des fonds de NextGenerationEU soient investis dans le numérique. Le CESE recommande que tous les États membres consacrent au moins 10 % de ces fonds à la numérisation des zones rurales sans imposer de charge administrative indue. |
2. La transition énergétique dans les zones rurales
Introduction
|
2.1. |
Les scientifiques s’accordent généralement à considérer que la manière la plus probable dont l’humanité influence le changement climatique mondial est le rejet de dioxyde de carbone par la combustion de combustibles fossiles. |
|
2.2. |
Dans son ouvrage intitulé «The New Climate War», le climatologue Michael Mann affirme que le réchauffement de notre planète a désormais atteint un seuil dangereux et que nous ne prenons pas encore les mesures nécessaires pour éviter la plus grande crise mondiale jamais connue. |
|
2.3. |
Les effets néfastes du changement climatique se font déjà sentir à certains endroits en raison de la montée des mers. Venise et Miami doivent faire face à d’importants défis à cet égard. L’Amazonie a fait l’objet d’une déforestation massive et a subi une sécheresse provoquée par le changement climatique. La fonte de la calotte glaciaire arctique, plus rapide que prévue, est extrêmement préoccupante. |
|
2.4. |
Toutes les parties prenantes doivent agir à l’échelle mondiale pour combattre sans tarder le changement climatique, notamment par des mesures d’atténuation et d’adaptation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La réduction rapide de l’utilisation des combustibles fossiles doit être une priorité immédiate. |
Zones rurales
|
2.5. |
130 millions de personnes, soit 30 % de la population de l’Union européenne, vivent dans des zones rurales. Les zones rurales sont variées et leurs caractéristiques sont fortement influencées par leur situation géographique. Dans de nombreuses régions, en particulier dans le sud de l’Europe, l’eau se raréfiera progressivement, les inondations s’aggraveront et les feux de forêts deviendront plus intenses et plus fréquents en raison du changement climatique. Dans le nord de l’Europe, l’augmentation des précipitations et des tempêtes peut occasionner et occasionnera des dommages importants et coûteux aux infrastructures. La hausse des températures intensifiera le cycle de l’eau et augmentera la fréquence des fortes tempêtes. Ces circonstances démontrent la nécessité d’une transition énergétique et numérique qui soit la plus rapide possible dans les zones rurales. |
|
2.6. |
L’idée d’une transition énergétique dans les zones rurales n’a pas bénéficié de l’attention qu’elle aurait méritée, ce qui est surprenant, car les ressources nécessaires à la production d’énergie renouvelable sont étroitement liées aux zones rurales. La majorité des infrastructures d’énergie renouvelable, telles que les éoliennes, les centrales solaires et les installations de biogaz, sont situées dans des zones rurales. Les réseaux de transmission sont également une caractéristique du paysage rural. De nombreux habitants des zones rurales estiment que ces structures leur sont imposées et profitent davantage aux zones urbaines. |
|
2.7. |
Les zones rurales ont des besoins variés et distincts en fonction de leur situation géographique. Elles peuvent être classées selon les catégories suivantes:
|
|
2.8. |
Ces différentes zones rurales étant confrontées à des défis multiples et variés s’agissant de la mise en œuvre de la transition énergétique, une transition juste est essentielle pour atteindre l’objectif souhaité. |
|
2.9. |
De nombreuses zones rurales sont isolées physiquement, et se caractérisent par une activité économique peu diversifiée et une faible densité de population. Dans de nombreux cas, les communautés rurales sont plus vulnérables en raison des faibles revenus et du vieillissement de la population. Les personnes vivant seules dans des zones rurales isolées et ayant peu de relations sociales représentent un problème majeur lors de la mise en œuvre d’une transition énergétique. La précarité énergétique est un problème important dans ces régions. |
|
2.10. |
Bien que le déploiement de compteurs intelligents soit un élément essentiel de la transition énergétique dans les zones rurales, il semblerait qu’il ait été relativement lent à ce jour. Il convient également de veiller à ce que les ménages à faibles revenus et les personnes ayant des compétences informatiques limitées puissent utiliser au mieux les compteurs intelligents dans le cadre d’une transition énergétique juste qui ne laisse personne de côté. 25 milliards d’EUR ont été alloués au titre de la facilité pour la reprise et la résilience pour soutenir les compétences et l’éducation numériques. Les États membres doivent consacrer une part adéquate de ce fonds à la formation aux compétences numériques et à l’alphabétisation des populations rurales. Le fait que certaines parties de l’Europe ne disposent pas de l’internet est une situation intolérable à laquelle il convient de remédier au plus vite. |
|
2.11. |
Dans son avis sur le thème «Vers une stratégie globale en matière de développement rural et urbain durable» (1), le CESE a souligné que les politiques en matière d’agriculture, d’alimentation et de ruralité doivent être cohérentes avec celles qui concernent le climat et la biodiversité. Les aspects multifonctionnels de l’agriculture sont tout aussi importants que la promotion des activités non agricoles telles que l’implantation en zone rurale d’entreprises du secteur des services en matière d’énergies propres en vue de créer des emplois. Il convient d’explorer le potentiel du commerce électronique. |
|
2.12. |
La communication relative à «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE» (2) comprend un pacte rural visant entre autres à favoriser la cohésion territoriale et à créer de nouvelles perspectives afin d’attirer des entreprises innovantes. La mise en œuvre de cette vision faciliterait grandement une transition énergétique juste dans les zones rurales. Le CESE s’est félicité de cette approche dans son avis sur «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE» (3). |
Transports
|
2.13. |
L’offre de transports est un problème majeur dans les zones rurales en raison du faible développement des transports publics, de la dispersion de la population et de l’éloignement des commerces et des services. En outre, les habitants des zones rurales qui travaillent dans les centres urbains parcourent souvent de longues distances entre leur domicile et leur lieu de travail. |
|
2.14. |
Une planification locale et nationale est nécessaire pour mettre en place un système de transport multimodal permettant la transition vers une énergie renouvelable. Un tel système doit offrir diverses possibilités et solutions de substitution pour le transport de personnes et de marchandises. |
|
2.15. |
Il convient d’accorder au transport de marchandises dans les zones rurales une attention particulière au regard de la transition énergétique. Par exemple, les livraisons de fournitures agricoles et la collecte des produits agricoles doivent constituer un volet important dans le cadre de la planification de la transition énergétique. L’objectif à atteindre doit être la généralisation des poids lourds électriques et des camions à hydrogène. À court terme, les biocarburants durables et les véhicules hybrides pourraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. |
|
2.16. |
En raison de l’explosion des achats en ligne, en particulier dans les zones rurales, il est crucial de réduire les émissions de gaz à effet de serre des camionnettes de livraison. L’utilisation de camionnettes électriques permettrait de réaliser cet objectif, dès que des infrastructures de recharge adéquates seront disponibles. Les entreprises de messagerie doivent également financer l’achat de camionnettes électriques. La priorité immédiate est de commencer à réduire les émissions de toutes les manières possibles. |
|
2.17. |
Il convient de viser avant tout à améliorer l’offre de transports publics dans les zones rurales, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer l’inclusion sociale et de garantir des possibilités de développement rural. Les transports publics ruraux doivent être considérés comme un bien public dans le contexte de la transition énergétique, et des fonds publics sont dès lors nécessaires pour promouvoir et faciliter des transports publics durables. |
|
2.18. |
Les voitures particulières sont considérées comme un moyen indispensable de transport rural, car il serait inenvisageable, sans elles, de vivre en milieu rural. La priorité doit être d’aider et d’encourager les habitants des zones rurales à réduire, dans la mesure du possible, l’utilisation des voitures particulières et à passer le plus rapidement possible aux véhicules à faibles émissions. L’octroi d’une aide financière destinée à promouvoir l’achat de véhicules électriques doit être un objectif clé de la transition énergétique dans les zones rurales. |
|
2.19. |
Le stockage sur batteries est un moyen efficace d’aplatir la courbe de demande nette d’électricité renouvelable. L’utilisation généralisée de véhicules électriques pourrait apporter une contribution à cet égard. Lorsque les véhicules électriques sont en mesure de restituer de l’électricité au réseau, le parc électrique peut servir de moyen de stockage en complément d’autres formes de stockage sur batteries. Il doit être financièrement intéressant pour les consommateurs de restituer de l’électricité au réseau à partir d’un véhicule électrique, comme l’a fait observer le CESE dans son avis sur le «Règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution» (4). |
Tourisme
|
2.20. |
Les zones rurales dépendent souvent du tourisme, qui est une source de revenus importante. Par conséquent, les zones rurales doivent disposer d’une infrastructure adéquate pour les carburants alternatifs afin de soutenir le secteur du tourisme tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les sociétés de location de voitures doivent être encouragées à opter pour des véhicules à faibles émissions et, de préférence, des véhicules électriques. La transition énergétique dans les zones rurales requiert des mesures visant à accroître les revenus provenant du tourisme. |
Électricité renouvelable
|
2.21. |
L’électricité renouvelable, telle que l’énergie éolienne, l’énergie solaire et le biogaz, est une composante majeure du paysage rural. L’harmonisation de la législation entre les États membres doit promouvoir et protéger les intérêts des prosommateurs et encourager les investissements dans les infrastructures d’énergie renouvelable. La capacité à vendre l’énergie produite dans le réseau national doit être rendue possible dans tous les États membres. Des systèmes de compensation adéquats doivent être mis en place entre l’énergie renouvelable produite par les prosommateurs et l’énergie consommée afin de garantir l’indépendance énergétique des zones rurales. |
|
2.22. |
Récemment, les enchères pour l’acquisition centralisée d’électricité renouvelable ont pris de l’ampleur et ont permis, dans de nombreux cas, de réduire les coûts de construction des installations éoliennes et solaires. De manière générale, le développement de l’électricité renouvelable est principalement lié à la décarbonation du secteur de l’énergie, et il n’existe aucune synergie avec les objectifs de développement rural. Les habitants des zones rurales s’opposent fréquemment à ces évolutions car ils ne voient que peu d’avantages pour la population locale. |
|
2.23. |
Les coopératives et les autres organisations locales doivent être associées au choix des sites pour les installations d’électricité renouvelable, tant terrestres que côtières. Les communautés locales doivent détenir une participation dans ces installations et en retirer un bénéfice local. |
|
2.24. |
Dans ces grands projets, le développement des énergies renouvelables est principalement lié à la décarbonation du secteur de l’énergie; le développement rural suscite peu d’attention. Les petits parcs éoliens, ainsi que les petits digesteurs solaires et anaérobies exploités par des coopératives et les populations locales peuvent être davantage axés sur le développement rural, ainsi que sur l’inclusion sociale et économique des communautés rurales. Il est nécessaire de parvenir à un équilibre entre ces deux systèmes. Les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes constituent un moyen de parvenir à une transition énergétique juste combinée au développement local. |
|
2.25. |
Une étude de cas menée en Suède rurale (Ejdemo et Söderholm, 2015) a montré qu’en l’absence de mécanismes de partage des bénéfices avec les communautés locales, les possibilités d’emploi dans le contexte du développement rural étaient très modestes. |
|
2.26. |
Une communauté énergétique citoyenne est une entité juridique au sein de laquelle des citoyens, des PME et des collectivités locales se réunissent en tant qu’utilisateurs finaux pour coopérer en vue de la production d’énergie renouvelable. C’est le cas, par exemple, de la municipalité de Feldheim (un petit village situé au sud-ouest de Berlin), qui est devenue autosuffisante en énergie. Elle a installé des éoliennes sur son territoire et mis en place un réseau indépendant. Les habitants achètent l’électricité à des prix très bas. La construction d’une centrale de production de biogaz a permis au village de créer un réseau de chauffage urbain. Il s’agit d’un excellent exemple de communauté d’énergie renouvelable en activité. Celui-ci démontre également qu’une approche ascendante est essentielle pour l’avenir des zones rurales (5). |
|
2.27. |
La modulation de la demande permet de déplacer la consommation électrique vers des périodes où le système est en mesure de faire face à la demande. Il y a lieu d’aplatir la courbe de demande nette d’électricité pendant les périodes de pointe afin d’éviter les coupures de courant lorsque la part d’électricité verte dans la production augmente. Le recours au stockage sur batteries, au stockage hydraulique et à l’électrification intelligente offrira une certaine souplesse pour aplatir la courbe de demande nette. |
|
2.28. |
S’adressant à Dublin à des parlementaires irlandais, Kadri Simson, commissaire chargée de l’énergie, a déclaré que la guerre en Ukraine avait contraint Bruxelles à aller plus loin et à progresser plus rapidement afin de mettre un terme aux importations de carburant russe. Elle a déclaré que dans le cadre des propositions qui restent à approuver, l’Union européenne s’efforcera de porter à 45 % la part de sa consommation d’énergie provenant d’énergies renouvelables d’ici à 2030. Cela représentera une augmentation par rapport à l’objectif actuel de 32 % et plus du double de l’objectif de 22 % en 2020. Le CESE approuve ce nouvel objectif mais précise qu’il ne pourra être atteint que si des investissements nouveaux et plus importants sont consentis rapidement dans la transition énergétique rurale. |
|
2.29. |
Le vent ne souffle pas en permanence, de sorte qu’un système de secours sera nécessaire. L’hydrogène vert peut constituer une solution d’appoint pour répondre aux variations de la demande d’électricité et peut être stocké jusqu’au moment où il sera nécessaire. |
Agriculture
|
2.30. |
L’activité agricole est au cœur du développement et de la prospérité de la plupart des zones rurales. Ce secteur de l’économie rurale doit faire face à d’énormes difficultés pour réaliser la transition énergétique. |
|
2.31. |
Aucun effort important n’a été accompli pour réduire l’empreinte carbone des machines agricoles. |
|
2.32. |
Dans un avenir proche, il semblerait que la meilleure façon de réduire les émissions serait de recourir aux de biocarburants durables, étant donné que les machines existantes pourraient être utilisées après avoir été modifiées à cet effet. |
|
2.33. |
La fabrication des biocarburants durables est onéreuse et leur prix peut atteindre plus du double de celui du diesel. Les prix pourraient diminuer légèrement avec le temps. |
|
2.34. |
À l’avenir, lorsque les machines agricoles électriques deviendront plus largement disponibles, il sera possible de réduire sensiblement les émissions. |
|
2.35. |
L’agriculture étant principalement une entreprise peu lucrative, les coûts d’investissement liés au passage à des machines électriques seraient extrêmement difficiles à financer. L’un des problèmes majeurs qu’il conviendra de résoudre dans le cadre de la transition énergétique des zones rurales est celui du financement des machines électriques ou à hydrogène. |
|
2.36. |
Le placement de panneaux solaires sur les bâtiments agricoles permettrait aux agriculteurs d’utiliser de l’électricité verte, ce qui représenterait un gain significatif dans le cadre de la transition énergétique, étant donné que l’agriculture est une grande consommatrice d’électricité. Tout excédent pourrait être revendu au réseau. |
|
2.37. |
L’agriculture de précision est une approche de la gestion agricole fondée sur les données qui peut améliorer la production et les rendements et réduire l’empreinte carbone de l’agriculture. Elle est rendue possible grâce aux progrès de la technologie numérique en ce qui concerne la télédétection, le GPS et les systèmes de guidage par satellite pour les tracteurs. Elle aura son importance dans le cadre de la transition énergétique du secteur agricole, tout comme la nécessité d’investissement, de formation et de perfectionnement professionnel. |
|
2.38. |
Les agriculteurs peuvent avoir la possibilité de vendre de l’électricité excédentaire au réseau, étant donné que les producteurs laitiers et bovins disposent de surfaces de toiture importantes sur leur exploitation. Certains agriculteurs pourraient être en mesure de devenir des partenaires pour la mise en place de centrales à biomasse et la vente de gaz au réseau gazier. L’utilisation de résidus forestiers dans les centrales à biomasse est importante pour faciliter la gestion des forêts dans les zones concernées. |
|
2.39. |
Eu égard aux conséquences de la guerre en Ukraine, nous devons reconsidérer la sécurité alimentaire dans l’UE. Les terres doivent être utilisées en priorité à la production de denrées alimentaires. Celle-ci ne devrait pas faire concurrence à l’installation de panneaux solaires à l’échelle industrielle et à la production de biomasse comme source d’énergie renouvelable; il devrait plutôt s’agir d’opérations complémentaires. |
Biométhane
|
2.40. |
Le biométhane est un biogaz dont on a éliminé le dioxyde de carbone, le sulfure d’hydrogène et l’eau; il peut ensuite être injecté directement dans le réseau gazier ou utilisé dans un véhicule fonctionnant au gaz. |
|
2.41. |
Des digesteurs anaérobies doivent être installés à proximité d’un approvisionnement suffisant en lisier. L’ensilage d’herbe excédentaire et de maïs peut également être utilisé, pour autant que cela ne nuise pas à la production alimentaire et fourragère. |
|
2.42. |
Il est nécessaire de poursuivre les recherches afin d’améliorer l’efficacité des digesteurs anaérobies et de réduire les coûts associés à ce processus. |
|
2.43. |
Il convient d’encourager et de financer l’utilisation de digesteurs anaérobies dans le cadre de la transition énergétique dans les zones rurales. |
|
2.44. |
L’énergie issue de la biomasse peut être utilisée pour produire de la chaleur ou de l’électricité. La biomasse jouera un rôle essentiel dans la production d’électricité renouvelable. |
Habitat rural
|
2.45. |
De nombreux ménages ruraux peuvent installer des technologies de microgénération, telles que des panneaux solaires et de petites éoliennes, avec la possibilité de réinjecter tout excédent de production dans le réseau. |
|
2.46. |
Les ménages à faibles revenus ont besoin d’une aide financière pour pouvoir mettre en place des installations de microgénération. Il en résulterait une transition énergétique importante pour les ménages ruraux. |
|
2.47. |
Les maisons rurales sont généralement moins bien isolées et moins économes en énergie que les maisons urbaines. Bon nombre d’entre elles sont des maisons «quatre façades» exposées aux intempéries. |
|
2.48. |
Un grand programme d’investissement pour moderniser les logements ruraux afin d’en améliorer l’isolation et l’efficacité énergétique est nécessaire dans le cadre de la transition énergétique. Un tel investissement constituera une avancée majeure sur la voie de la réduction de la consommation d’énergie et de la décarbonation du chauffage domestique rural. Il conviendra de prévoir un régime d’aides sous forme de subventions étant donné que les coûts d’un grand programme de mise à niveau sont très élevés. Les ménages à faibles revenus et les ménages en situation de précarité énergétique devront bénéficier d’une aide spéciale pour mener à bien cette transition. |
3. La transition numérique dans les zones rurales
|
3.1. |
En 2021, la Commission européenne a présenté sa vision de la transformation numérique de l’Europe d’ici à 2030. D’entrée de jeu, elle a souligné la nécessité des propositions législatives sur les marchés numériques et les services numériques pour garantir un espace numérique plus sûr, dans lequel les droits fondamentaux des utilisateurs sont protégés, et afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les entreprises européennes dans le monde numérique. |
|
3.2. |
Afin de nourrir une population mondiale croissante tout en ayant une incidence minimale sur l’environnement et en promouvant la neutralité carbone, il convient de mettre en place des infrastructures numériques et technologiques dans les zones rurales pour permettre une utilisation efficace et précise des ressources dans l’agriculture. Cependant, bien que 30 % de la population européenne vive dans les zones rurales, qui représentent 80 % du territoire des 27 États membres, la numérisation rencontre, dans le monde rural, davantage de difficultés qui, si elles ne sont pas prises en compte, compromettront l’ambition numérique de l’Europe. Un cadre législatif européen sur le numérique rural permettrait de faire face à ces difficultés par les moyens suivants:
|
|
3.3. |
La législation sur le numérique rural, en tant que mécanisme législatif de la Commission européenne, constituera, à l’instar de la législation sur les marchés numériques et sur les services numériques, un ensemble de règles, d’obligations et de responsabilités visant à faire en sorte que les zones rurales européennes puissent bénéficier de toute une série d’initiatives, d’outils et de moyens d’accès qui, en raison de la faible densité de population, ne sont pas intéressants, d’un point de vue économique, pour les investissements privés. La législation sur le numérique rural garantira ainsi la mise en œuvre de la numérisation dans les zones rurales, où les besoins sont inversement proportionnels aux rendements financiers obtenus. |
|
3.4. |
Enfin, une telle législation sera un préalable essentiel à la réalisation du pacte vert pour l’Europe ainsi que des stratégies «De la ferme à la table» et en faveur d’une Europe neutre pour le climat d’ici à 2050, étant donné que la transition vers un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement ne sera possible que si la technologie et la numérisation sont disponibles et accessibles pour le monde agricole et rural. |
|
3.5. |
Comme le souligne le CESE dans son avis intitulé «Améliorer les niveaux d’inclusivité, de sécurité et de fiabilité de la numérisation pour tous» (6), l’importance de la numérisation ne saurait être sous-estimée, car elle peut être «en mesure de favoriser davantage de mobilité sur le marché du travail, d’accroître la productivité et la flexibilité sur le lieu de travail et d’aboutir à un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée lorsque les travailleurs travaillent à distance de chez eux». Pour ce faire, les travailleurs ont absolument besoin de disposer d’un ensemble complet de compétences numériques, qu’ils vivent dans des zones urbaines ou rurales. Toutefois, des obstacles supplémentaires d’aspects multiples existent dans les endroits isolés, aussi le CESE demande-t-il que la stratégie spécifique en matière de compétences numériques soutienne les citoyens européens vivant dans les zones rurales. Cette approche, qui doit figurer au centre de la législation sur le numérique rural, devrait contribuer simultanément à réduire la fracture numérique et à tirer parti des avantages de la transformation numérique de la société. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Avis sur le thème «Vers une stratégie globale en matière de développement rural et urbain durable» (JO C 105 du 4.3.2022, p. 49).
(2) COM(2021) 345 final.
(3) Avis du CESE «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE» (JO C 290 du 29.07.2022, p. 137).
(4) Avis sur le «Règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants de substitution» (JO C 152 du 6.4.2022, p. 138).
(5) Rapport d’atelier du Parlement rural européen, Atelier 21.
(6) Avis sur le thème «Améliorer les niveaux d’inclusivité, de sécurité et de fiabilité de la numérisation pour tous» (JO C 374 du 16.9.2021, p. 11).
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/67 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Les investissements publics dans les infrastructures énergétiques comme élément de solution face aux problèmes climatiques»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/10)
|
Rapporteur: |
Thomas KATTNIG |
|
Corapporteur: |
Lutz RIBBE |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
|
Adoption en section |
7.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
22.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
162/7/8 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
La crise climatique produit dès à présent d’énormes répercussions en Europe et dans le monde entier. Bien que l’éventail de possibilités dont nous disposons pour nous adapter efficacement au changement climatique se soit enrichi ces dernières années, les experts relèvent que les ressources financières dégagées sont insuffisantes, que l’engagement des citoyens et du secteur privé est trop faible et que le politique échoue à prendre la tête du mouvement. |
|
1.2. |
Pour couvrir les besoins croissants en électricité et respecter les objectifs fixés en matière climatique, il est nécessaire de doubler les investissements dans le réseau électrique, pour les porter à 55 milliards d’euros par an, et d’accroître les fonds consacrés au déploiement de capacités de production d’électricité propre, pour qu’ils atteignent un montant annuel de 75 milliards d’euros (1). Le contexte que l’on vient d’esquisser confère une grande importance aux investissements que les pouvoirs publics effectuent dans des systèmes énergétiques intelligents et renouvelables et les infrastructures de stockage, en ayant le souci d’assurer une sécurité d’approvisionnement, de lutter contre la précarité énergétique, de garantir des tarifs abordables et de créer des emplois. |
|
1.3. |
Le CESE soutient les propositions de la Commission visant à accélérer et simplifier les procédures d’autorisation des projets ressortissant aux énergies renouvelables ainsi qu’à définir des «zones propices» à de tels chantiers. Ces initiatives peuvent fortement contribuer à accélérer la transition énergétique, de sorte qu’il n’en devient que plus important de déterminer le plus concrètement possible quelles sont les simplifications applicables à ces «zones propices». |
|
1.4. |
Le droit européen de l’énergie ne considère pas que la préservation du climat prenne place parmi les objectifs de la régulation des réseaux. En conséquence, les autorités nationales de régulation éprouvent également des difficultés à arrêter, en faveur de la transformation, du développement et de la modernisation des réseaux de distribution électrique, des mesures incitatives qui feraient droit aux impératifs de la neutralité climatique. |
|
1.5. |
En ce qui concerne la structuration qu’il conviendra de donner aux systèmes et infrastructures énergétiques de demain, le CESE a souligné à maintes reprises qu’il s’impose que tous les consommateurs, qu’il s’agisse de ménages, d’entreprises ou de communautés énergétiques, soient associés activement au développement de systèmes énergétiques intelligents et que des dispositifs incitatifs soient mis en place afin que la société civile puisse prendre part à la transition en matière d’énergie mais, aussi, apporter son écot à son financement. |
|
1.6. |
De toutes les grandes économies, c’est l’Union européenne qui affiche le taux le plus faible d’investissements publics dans les technologies énergétiques propres qui sont requises par la décarbonation, de sorte que sa compétitivité s’en trouve menacée. Depuis les débuts de la libéralisation, les investissements des entreprises du secteur de l’électricité ont suivi une courbe descendante. Cette régression des moyens investis a créé des goulets d’étranglement dans l’approvisionnement et ralentit le déploiement des énergies renouvelables. En conséquence, le CESE soutient la Commission lorsqu’elle propose, pour mettre en œuvre le plan REPowerEU, d’utiliser les plans de relance et la facilité pour la reprise et la résilience, en mobilisant en complément des moyens financiers en provenance du Fonds de cohésion pour le développement régional et de l’enveloppe de la politique agricole de l’Union. |
|
1.7. |
Il est nécessaire que l’architecture du marché et sa réglementation soient remaniées pour se plier aux nouvelles réalités découlant de la position prédominante que les énergies renouvelables vont prendre dans le futur, notamment en rapport avec une production plus décentralisée et une consommation qui s’effectuera davantage sur place, qu’elles créent les conditions voulues pour chaque intervenant et qu’elles assurent une protection adéquate des consommateurs. Le CESE se félicite que la Commission exprime l’intention d’examiner les pistes envisageables pour optimiser la configuration du marché de l’électricité, et il se prononce résolument pour la réalisation d’évaluations qui analysent la structuration du marché de l’énergie ainsi que le comportement de tous les acteurs susceptibles d’intervenir sur celui-ci. En tout état de cause, il souligne qu’il est primordial, avant de prendre quelque initiative que ce soit, de la soumettre à une analyse d’impact complète. |
|
1.8. |
Le CESE recommande une fois de plus d’appliquer la «règle d’or» aux investissements publics afin de préserver la productivité et le socle social et écologique nécessaires au bien-être des générations futures. |
|
1.9. |
Les dispositifs de financement mixtes, incluant des investisseurs privés, ne peuvent constituer une option qu’à la condition de donner la garantie que les décisions concernant leur octroi s’effectuent dans la transparence et que par rapport à ceux de type public, ils n’imposent pas de coûts supplémentaires injustifiés aux pouvoirs publics. Une transparence totale doit s’appliquer aux coûts supplémentaires justifiés. Il n’en est donc que plus important, dans ces schémas de financement mixte, de définir clairement les droits et les obligations de chacun, de démêler les questions touchant aux responsabilités et de prévoir un mécanisme efficace et rapide de résolution des conflits, afin de ne pas avoir à supporter des coûts supplémentaires à longue échéance et d’éviter de se retrouver en position défavorable en ce qui concerne lesdites responsabilités. |
|
1.10. |
Le CESE souligne que le caractère «équitable» de la transition ne se réduit pas à une question de financement mais qu’il couvre aussi l’objectif d’instaurer un travail décent, de créer des emplois de haute valeur et de garantir la sécurité sociale, ainsi que de préserver la compétitivité des entreprises européennes, et qu’il exige de prendre des mesures spécifiques à tous les niveaux, dont, en particulier, celui des régions. |
|
1.11. |
Le CESE a la conviction qu’il convient de veiller tout particulièrement à ranger le développement des réseaux parmi les questions d’intérêt public majeur, de faire de la lutte contre le changement climatique un des objectifs de la régulation et, d’une manière générale, d’assurer une meilleure synchronisation entre la planification des énergies renouvelables et le réseau électrique. Il est absolument nécessaire de disposer en la matière de dispositions concrètes relevant du droit européen. |
|
1.12. |
Les développements qui se sont produits ces dix dernières années, les impératifs du développement des réseaux, la montée vertigineuse des prix de l’énergie, la menace posée par les cyberattaques et, avec non moins de force, la guerre en Ukraine, montrent clairement où se situe l’enjeu primordial, à savoir déterminer qui, à l’avenir, aura la haute main sur des infrastructures aussi essentielles que le réseau énergétique. Il s’agit d’un enjeu qui ressortit fondamentalement à l’intérêt public et, en toute logique, il induit que la puissance publique doit également détenir la propriété de l’infrastructure concernée, devant assurer le bien-être collectif et éliminer les inégalités existantes. |
|
1.13. |
Lors de l’évaluation que la Commission prévoit d’effectuer concernant les différentes voies possibles pour doter le marché de l’énergie d’une architecture optimale, il conviendrait indubitablement de se demander, en se plaçant dans la perspective de son bon fonctionnement, quels sont les avantages et les inconvénients d’une situation où les infrastructures énergétiques sont détenues par le public et le privé et/ou financées par le privé. Les résultats de cette analyse peuvent constituer un précieux outil de prise de décision pour les États membres, qui sont chargés de décider qui, du public ou du privé, détient la propriété des infrastructures énergétiques. De l’avis du CESE, l’électricité est non seulement une matière première stratégique essentielle pour l’ensemble de l’économie de l’UE, mais elle revêt également un caractère de bien public. Aussi le Comité invite-t-il la Commission européenne à analyser avec soin les effets et les conséquences de l’ensemble du processus de privatisation et de libéralisation de l’énergie européenne sur la stabilité, la fiabilité de l’approvisionnement et le bon fonctionnement du marché de l’électricité, et à traduire les résultats dans une nouvelle organisation de l’ensemble du secteur de l’énergie, en prévoyant la possibilité de renforcer le rôle des secteurs étatique et public. |
2. Contexte
|
2.1. |
Les effets de la crise climatique affectent d’ores et déjà des milliards de personnes à travers toute la planète mais aussi des écosystèmes, comme l’ont souligné les derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), et ce, alors que la hausse des températures n’a pas encore atteint le plafond de 1,5 oC fixé par l’accord de Paris. Un élément particulièrement inquiétant est que les systèmes et les groupes qui souffriront le plus de la chaleur, de la sécheresse, des inondations, des épidémies, du manque d’eau et des pénuries alimentaires sont aussi, bien souvent, ceux qui possèdent le moins de ressources pour y faire face. |
|
2.2. |
Bien que l’éventail des possibilités dont nous disposons pour nous adapter efficacement au changement climatique se soit enrichi ces dernières années, les mesures réalisées ou prévues s’avèrent insatisfaisantes dans bien des endroits en Europe. Les experts relèvent que les ressources financières dégagées sont insuffisantes, que l’engagement des citoyens et du secteur privé est trop faible et que le politique échoue à prendre la tête du mouvement. |
|
2.3. |
Dès lors qu’en raison de la guerre en Ukraine, l’Europe affecte en toute hâte un important volant de ressources à des fins militaires, on peut redouter que ses moyens financiers ne se trouvent contraints et qu’en conséquence, des retards ne risquent de se produire dans la lutte contre le changement climatique. En conséquence, le CESE salue les mesures et dispositifs que la Commission annonce dans son plan REPowerEU (2), grâce auxquels elle entend réduire la dépendance de l’Union européenne vis-à-vis des combustibles fossiles, en particulier lorsqu’ils proviennent de Russie, en entreprenant de lancer des actions d’économie d’énergie, d’accélérer le basculement vers les énergies renouvelables, de favoriser une diversification des fournisseurs et de fédérer toutes les forces pour parvenir à un système énergétique plus résilient et à une véritable union de l’énergie. |
|
2.4. |
Si nous voulons atteindre les objectifs fixés en matière climatique, nous devons plus que doubler nos capacités en énergies renouvelables. Aujourd’hui déjà, c’est en plusieurs centaines de millions d’euros par an que se chiffrent, dans de grands pays comme l’Allemagne, les coûts induits par l’électricité verte quand il faut interrompre sa production parce qu’elle ne peut être utilisée ou transportée. Ces pertes économiques se multiplieront si nous ne développons pas rapidement nos réseaux électriques et nos capacités de stockage, tout en réalisant des progrès concernant les possibilités d’employer cette électricité directement et sur place. Au stade de leur planification et de leur réglementation, il est important d’orienter les réseaux énergétiques vers l’objectif de la neutralité climatique. Ceux qui assurent la distribution jouent un rôle déterminant à cet égard, car c’est sur eux que sont raccordées la majeure partie des installations d’énergie renouvelable. |
|
2.5. |
Pour répondre à ces impératifs, il est nécessaire de multiplier par deux les investissements dans le réseau électrique, pour les porter à 55 milliards d’euros par an, et d’accroître les fonds consacrés au déploiement de capacités de production d’électricité propre, afin qu’ils atteignent un montant annuel de 75 milliards d’euros (3). Sur ce point, le CESE met l’accent sur la valeur ajoutée dont sont porteuses les propositions de la Commission visant à instaurer des procédures d’autorisation rapides pour les projets ressortissant aux énergies renouvelables, ainsi qu’à définir des «zones propices» à de tels chantiers. Le Comité estime lui aussi que lesdites procédures doivent être accélérées et simplifiées. Dans ce domaine, il convient d’accorder une attention particulière aux réseaux de distribution, car ce sont eux qu’alimentent généralement les énergies renouvelables. |
|
2.6. |
Le contexte que l’on vient d’esquisser confère une grande importance aux investissements que les pouvoirs publics effectuent dans des systèmes énergétiques intelligents et renouvelables, en ayant le souci d’assurer une sécurité d’approvisionnement, de lutter contre la précarité énergétique, de garantir des tarifs abordables et de créer des emplois. Il est indubitable que la transformation écologique effectuée dans le sens du pacte vert pour l’Europe aura d’énormes répercussions sur la situation de l’emploi dans les secteurs énergétiques à fortes émissions de CO2. En parallèle, développer judicieusement les investissements publics dans des systèmes énergétiques neutres du point de vue climatique ouvre bien des possibilités pour la création de postes de travail. À cette fin, il importe de dégager les marges budgétaires appropriées en remaniant le cadre de la politique budgétaire, comme le CESE l’a préconisé dans son avis d’initiative d’octobre 2021 sur le thème «Repenser le cadre budgétaire de l’Union européenne pour une reprise durable et une transition juste». |
|
2.7. |
Jusqu’à présent, le droit européen de l’énergie ne considère pas que la préservation du climat prenne place parmi les objectifs de la régulation des réseaux. En conséquence, les autorités nationales de régulation éprouvent également des difficultés à arrêter, en faveur de la transformation, du développement et de la modernisation des réseaux de distribution électrique, des mesures incitatives qui feraient droit aux impératifs de la neutralité climatique. |
|
2.8. |
En ce qui concerne la structuration qu’il conviendra de donner aux systèmes et infrastructures énergétiques de demain, le CESE a souligné à maintes reprises qu’il s’impose que tous les consommateurs, qu’il s’agisse de ménages, d’entreprises ou de communautés énergétiques, soient associés activement au développement de systèmes énergétiques intelligents. Malheureusement, seules des promesses ont été formulées en ce sens, sans que l’on parvienne à discerner aucune initiative correspondante. Le Comité réclame que soient enfin prises des mesures qui encouragent une mobilisation des prosommateurs, des communautés d’énergie renouvelable ou des groupements énergétiques citoyens, afin que la société civile puisse prendre part à la transition énergétique et que les consommateurs aient la possibilité d’intégrer activement le marché. Une telle démarche aurait également pour effet de donner un tour moins aigu au problème de l’augmentation ininterrompue des coûts que la gestion des énergies renouvelables nécessite, du fait des goulets d’étranglement du réseau. |
|
2.9. |
Le CESE prône que les règles européennes relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) soient mieux adaptées aux objectifs du pacte vert, lequel prévoit notamment de décarboner le système énergétique, d’effectuer la transition vers la neutralité climatique, de développer les sources d’énergie renouvelables, d’assurer l’efficacité énergétique et de prévenir le risque de précarité en la matière. Les réseaux énergétiques assurant un rôle essentiel pour l’équilibrage, la résilience et le développement du système énergétique, le CESE demande que le règlement s’inscrive avec plus de netteté dans une dynamique d’intégration dudit système, afin de promouvoir tous les types d’énergie décarbonée et de rendre impossible qu’il subisse une quelconque forme de désintégration. Dans ce contexte, il y a lieu de se féliciter que le Conseil et le Parlement européen aient pris l’initiative de poser qu’au même titre que les énergies renouvelables, les réseaux de distribution présentent eux aussi un «intérêt public majeur». |
|
2.10. |
Les actuelles augmentations de prix représentent un fardeau pour les citoyens européens comme pour les entreprises. Le CESE déplore que par le passé, les responsables politiques n’aient pas décliné en actions politiques l’appel qu’il avait lancé pour que l’Europe réduise sa dépendance stratégique à l’égard de tiers peu fiables (4), laquelle n’a fait au contraire que se renforcer. La Russie constitue le premier exportateur de pétrole, de gaz naturel et de charbon à destination de l’Union européenne, dont bon nombre de centrales nucléaires sont par ailleurs tributaires de barres de combustibles et de technologies russes. Si l’Union européenne avait déjà pu diminuer ses importations de combustibles fossiles, comme elle s’y était engagée, la crise actuelle des tarifs de l’énergie ne frapperait pas aussi durement ses citoyens et ses entreprises. En conséquence, le CESE approuve les actions que le plan REPowerEU expose pour réduire rapidement sa dépendance en la matière, en particulier vis-à-vis de la Russie. Il exprime son soutien aux efforts que les institutions de l’Union et les États membres déploient afin d’aborder efficacement le problème des prix énergétiques, dans la ligne de la panoplie d’outils que fournissent la communication d’octobre 2021, la communication COM(2022) 236 final relative au marché de l’électricité, ainsi que le cadre défini à titre temporaire en matière d’aides d’État. |
|
2.11. |
Dans le contexte actuel, le CESE fait observer à nouveau que l’enjeu primordial ne doit pas consister à diversifier les dépendances mais à atteindre au plus vite une «indépendance et autonomie stratégiques en matière énergétique». Les énergies renouvelables et l’hydrogène joueront un rôle moteur pour le processus de décarbonation, et il convient que leur production s’effectue, aussi largement qu’il est possible, sur le territoire de l’Union européenne. |
|
2.12. |
Dans certaines régions, le gaz naturel liquéfié (GNL) fait actuellement figure de solution de substitution aux importations gazières de Russie, en conjonction avec des économies d’énergie de grande envergure. À longue échéance, l’hydrogène vert se présente comme une voie compatible avec les objectifs climatiques, à la condition d’être disponible en quantités suffisantes et à un prix raisonnable. Il s’impose de tirer les leçons adéquates du cataclysme russe dans la mesure où l’Europe n’est pas à même de produire la totalité des volumes de gaz dont elle a besoin, cette incapacité apparaissant clairement dans le cas du gaz naturel liquéfié alors que, pour l’hydrogène, il est encore envisageable qu’elle puisse s’affranchir des importations. Le CESE tient à souligner que s’agissant des ressources destinées à remplacer le gaz de Russie, l’Europe doit faire preuve de la plus grande prudence, eu égard à leurs retombées environnementales et aux nouvelles dépendances qu’elles peuvent induire vis-à-vis de pays tiers qui ne partagent pas ses valeurs, comme l’attachement à la démocratie, ou le respect des droits de l’homme et de l’état de droit. |
|
2.13. |
Il convient de noter que de toutes les grandes économies, c’est l’Union européenne qui affiche le taux le plus faible d’investissements publics dans les technologies énergétiques propres qui sont requises par la décarbonation, de sorte qu’à l’échelle mondiale, sa compétitivité s’en trouve menacée. En outre, la Cour des comptes européenne a tenu à souligner que le plan REPowerEU risque de ne pas réussir à mobiliser suffisamment de moyens financiers. En conséquence, le CESE soutient la Commission lorsqu’elle propose, pour mettre en œuvre le plan REPowerEU, d’utiliser les plans de relance et la facilité pour la reprise et la résilience, en mobilisant en complément des moyens financiers en provenance du Fonds de cohésion pour le développement régional et de l’enveloppe de la politique agricole de l’Union. |
|
2.14. |
Dans certains États membres comme au niveau de l’Union européenne tout entière, l’on considère que les conséquences découlant de la guerre en Ukraine donneront l’impulsion décisive pour induire le basculement vers une plus grande indépendance énergétique et la neutralité climatique, et le CESE s’en félicite. Le tableau qui se dégage est néanmoins contrasté, puisqu’il est envisagé d’augmenter le recours au gaz de pétrole liquéfié et d’en revenir à l’utilisation du charbon, c’est-à-dire à des démarches pouvant marquer une régression dans la transition énergétique. Le Comité considère ces approches d’un œil critique, tout en ayant conscience que sur le court terme, multiplier les pistes de production d’énergie représente une mesure d’urgence qui contribue à sécuriser l’approvisionnement énergétique. En plus de l’énergie éolienne et solaire, il conviendrait donc de recourir à tout l’éventail disponible de sources d’énergie à faibles émissions de carbone pouvant s’intégrer dans le système énergétique, du point de vue de l’économie comme de l’environnement. En parallèle, le Comité appelle à redoubler d’efforts pour réaliser la transformation écologique dudit système. |
|
2.15. |
La Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) a publié un rapport (5) qui confirme que la libéralisation du système énergétique n’a apporté que de maigres réponses à la crise climatique en cours. C’est pour une bonne part à l’aide de fortes subventions publiques, et non par la libre concurrence sur le marché, qu’ont pu se diffuser largement des solutions de substitution viables aux sources d’énergie émettrices de carbone. Le document montre que si elle ne modifie pas le schéma qui régit actuellement sa structure énergétique, l’Europe sera dans l’impossibilité d’honorer les engagements qu’elle a souscrits au titre de l’accord de Paris. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Vu le cours rapide que prend le changement climatique et dans le contexte de la crise énergétique actuelle, il s’impose désormais de réaliser à brève échéance des investissements dans les infrastructures afin d’atteindre l’objectif de la neutralité climatique à l’horizon 2050 et de garantir les approvisionnements de l’Union européenne dans ce domaine. Parallèlement, la flambée des prix de l’énergie a mis en évidence les vulnérabilités de ce marché. Il y a lieu de se poser des questions fondamentales concernant notre avenir énergétique, afin d’assurer en la matière un approvisionnement qui soit respectueux de l’environnement, d’un prix abordable et d’une fiabilité éprouvée, ainsi que de garantir le droit à l’énergie. Le CESE fait valoir avec insistance que les pouvoirs publics se doivent de réaliser d’urgence des investissements afin d’atteindre l’objectif d’une indépendance énergétique par rapport aux importations de gaz russe, et il soutient les mesures que la Commission propose à cet égard dans le plan REPowerEU. |
|
3.2. |
Dans cette démarche, il y a lieu de tenir également compte de la configuration du marché et de sa régulation, tout comme des conditions qu’il est indispensable de mettre en place pour les différents intervenants, ainsi que de la nécessité de renforcer la protection du consommateur pour la porter à un niveau approprié. Le CESE se félicite que la Commission exprime l’intention d’examiner les pistes envisageables pour optimiser la configuration du marché de l’électricité et prend acte de l’analyse qu’elle effectue de ce marché et de celui du gaz, ainsi que des mesures qu’elle propose pour maîtriser les prix élevés de l’énergie et des propositions qu’elle avance pour améliorer les réseaux énergétiques et les capacités de stockage, tout comme de ses promesses réitérées de réaliser des progrès concernant l’accès au marché pour les petits acteurs (prosommateurs) et d’assurer la sécurité d’approvisionnement. |
|
3.3. |
Il est nécessaire que l’architecture du marché et sa réglementation soient remaniées pour se plier aux nouvelles réalités découlant de la position prédominante que les énergies renouvelables vont prendre dans le futur, le mot d’ordre devant être que la production devienne plus décentralisée et que la consommation s’effectue davantage sur place. Pour y parvenir, encore faut-il cependant mettre en place l’environnement requis pour chaque intervenant et garantir une protection appropriée pour le consommateur. Il est nécessaire de procéder à des évaluations des marchés qui analyseront la structuration du marché de l’énergie ainsi que le comportement de tous les acteurs susceptibles d’intervenir sur celui-ci. En tout état de cause, le CESE souligne qu’il est primordial, avant de prendre quelque initiative que ce soit, de la soumettre à une analyse d’impact complète. Il fait observer qu’il convient de mener d’urgence une lutte contre les prix élevés de l’électricité, y compris pour ce qui est de leur couplage avec ceux du gaz, qui produit des effets dommageables pour l’économie des États membres. |
|
3.4. |
Longtemps, nous nous sommes abstenus de nous demander jusqu’à quel point il serait possible d’assurer notre sécurité d’approvisionnement en recourant uniquement à des instruments ressortissant au marché, tout comme de réfléchir à la manière de configurer ce dernier pour parvenir à un tel résultat. En principe, un système énergétique qui repose sur des énergies renouvelables, lesquelles sont produites pour une large part dans nos propres contrées, garantit un approvisionnement d’un haut degré de sécurité, mais cette assertion ne se vérifiera pas automatiquement: encore faut-il que l’environnement réglementaire soit approprié. Il importe tout particulièrement à cet égard de pouvoir compter sur des réseaux intelligents, lesquels envoient des signaux clairs aux producteurs et aux consommateurs, qui se comptent par millions, afin qu’ils puissent adopter un comportement bénéfique pour le système et contribuer ainsi à sécuriser l’approvisionnement. |
|
3.5. |
S’agissant de financer les projets d’infrastructures, le plus grave obstacle auquel la puissance publique s’est heurtée par le passé a toujours résidé dans la rigidité des règles budgétaires. En conséquence, le but qu’il convient de viser doit consister en ce que les projets gravitant autour du pacte vert, de l’indépendance énergétique et du secteur numérique soient soustraits à toute réglementation qui entrave de tels investissements publics. C’est la raison pour laquelle le CESE recommande, dans la ligne de son avis sur le thème «Repenser le cadre budgétaire de l’Union européenne» (6), d’appliquer la «règle d’or» aux investissements publics, afin de sauvegarder la productivité et de préserver le socle social et environnemental qui est indispensable au bien-être des générations de demain. |
|
3.6. |
Les dispositifs de financement mixtes, incluant des investisseurs privés, ne peuvent constituer une option qu’à la condition de donner la garantie que les décisions concernant leur octroi s’effectuent dans la transparence et que par rapport à ceux de type public, ils n’imposent pas de coûts supplémentaires injustifiés aux pouvoirs publics. Une transparence totale doit s’appliquer aux coûts supplémentaires justifiés. Pour ne prendre que cet exemple, un rapport de la Banque européenne d’investissement a relevé qu’en comparaison avec des projets similaires financés de manière classique, les contrats de partenariat public-privé portant sur les transports routiers en Europe affichaient en moyenne un surcoût de 24 % (7). Il n’en est donc que plus important, dans ces schémas de financement mixte, de définir clairement les droits et les obligations de chacun, de démêler les questions touchant aux responsabilités et de prévoir un mécanisme efficace et rapide de résolution des conflits, afin de ne pas avoir à supporter des coûts supplémentaires à longue échéance et d’éviter de se retrouver en position défavorable en ce qui concerne lesdites responsabilités. |
|
3.7. |
La Commission souligne à juste titre que les investissements publics peuvent et doivent mobiliser des fonds privés. Le plan REPowerEU ne couvre toutefois pas le refinancement des fonds publics concernés. L’une des pistes possibles pour l’organiser consisterait à supprimer les subventions octroyées aux ressources fossiles, tout comme il serait également envisageable de taxer les bénéfices exceptionnels qui ont été dégagés par la grande crise du pétrole et du gaz et se traduisent par d’énormes gains inattendus, bénéficiant en particulier aux grandes compagnies pétrolières. Le CESE redoute que ces rentrées extrêmement élevées des sociétés énergétiques, d’une part, et la montée de la précarité énergétique, résultant de l’augmentation en flèche des prix de l’énergie, d’autre part, ne forment un cocktail détonant, porteur du risque d’une dangereuse explosion sociale. Le Comité propose d’éponger par la voie fiscale les sommes qui ont été gagnées de la sorte et de les transférer à titre de compensation financière à des consommateurs d’énergie comme les ménages dont les finances sont plus fragiles ou les entreprises à forte intensité énergétique, par exemple, et de les utiliser pour assurer l’expansion de la production d’énergies renouvelables et le développement des infrastructures de réseau nécessaires, d’autant qu’il s’agit d’une démarche qui en est déjà au stade de la discussion, voire de la mise en œuvre, dans certains États membres. Le CESE est d’avis que, pour ne pas dissuader les entreprises du secteur de l’énergie d’investir dans des solutions à faible intensité de carbone, de telles taxes devraient être définies de manière très fine. Il invite la Commission à proposer sans tarder davantage des mesures en la matière. |
|
3.8. |
Une infrastructure a essentiellement pour but et finalité d’être fonctionnelle, et non de viser en soi à acheminer de l’électricité d’un point A à un point B et, ainsi, à générer des rentrées permanentes. Les développements qui se sont produits ces dix dernières années, les impératifs du développement des réseaux, la montée vertigineuse des prix de l’énergie, la menace posée par les cyberattaques et, avec non moins de force, la guerre en Ukraine, montrent clairement où se situe l’enjeu primordial, à savoir déterminer qui, à l’avenir, aura la haute main sur des infrastructures aussi essentielles que le réseau énergétique. Il s’agit d’un enjeu qui ressortit fondamentalement à l’intérêt public et, en toute logique, il induit que la puissance publique doit également détenir la propriété de l’infrastructure concernée, devant assurer le bien-être collectif et éliminer les inégalités existantes. |
|
3.9. |
Le CESE souligne que le caractère «équitable» de la transition ne se réduit pas à une question de financement mais qu’il couvre aussi l’objectif d’instaurer un travail décent, de créer des emplois de haute valeur et de garantir la sécurité sociale, ainsi que de préserver la compétitivité des entreprises européennes, et qu’il exige de prendre des mesures spécifiques à tous les niveaux, dont, en particulier, celui des régions. Parmi les autres paramètres essentiels d’une «transition équitable» figurent aussi la mission d’ordre organisationnel que le secteur public doit assumer activement, ainsi que la nécessité de garantir une participation démocratique des partenaires sociaux à tous les niveaux. |
|
3.10. |
Le réseau énergétique fait partie des infrastructures critiques, dont les pannes ou les perturbations peuvent provoquer des pénuries d’approvisionnement aux effets dévastateurs et menacer la sécurité publique. Sous l’effet du mouvement de libéralisation et de privatisation qui s’est exercé durant ces dernières décennies en Europe, ces infrastructures, telles que les moyens de transport et de déplacement, les services de santé, le système financier ou les réseaux de sécurité, pour n’en citer que quelques-unes, sont de plus en plus passées dans les mains d’acteurs privés. Un tel état de fait pose problème dans la mesure où tous ces secteurs constituant des infrastructures critiques se trouvent imbriqués et que la vulnérabilité de l’un d’entre eux restreindra ou compliquera le bon fonctionnement des autres, par des répercussions en cascade. Bien que leurs dépendances croisées soient difficiles à jauger, assurer que leurs prestations soient efficaces représente une question relevant du bien-être collectif. C’est lorsque le marché connaît des perturbations ou en cas de catastrophe que le recours à des instances coordonnatrices ressortissant à la puissance publique et disposant du pouvoir de décision fait sentir toute son importance pour qu’il soit possible d’assurer une résilience qui soit structurée d’un point de vue territorial. Ces risques sont particulièrement élevés dans le cas de l’électricité, sans laquelle il est pratiquement inconcevable que la civilisation avancée du XXIe siècle puisse fonctionner; des pannes majeures du réseau électrique («blackout») entraîneraient un bouleversement de l’ensemble de la société. |
|
3.11. |
Sachant qu’en Europe, le bâti intervient pour environ 40 % de l’énergie consommée, il est particulièrement déterminant, du point de vue de la transition énergétique et de l’augmentation de l’efficacité en la matière, de parvenir à combiner judicieusement, dans le secteur du logement, les nouvelles technologies, des rénovations menées avec efficacité et la promotion des nouveaux modèles de participation citoyenne au processus. La directive sur le marché intérieur de l’électricité encourage les consommateurs à s’investir pour produire de l’électricité à partir de sources renouvelables et constitue un tremplin essentiel pour susciter l’adhésion à une production électrique décentralisée. À cet égard, il importe de procéder à une harmonisation à l’échelle de tout le territoire européen, afin qu’un maximum de ménages puissent prendre part à la transition énergétique. Des idées telles que le partage énergétique ou, plus généralement, l’énergie citoyenne ouvrent des perspectives prometteuses lorsqu’il s’agit d’utiliser les réseaux en la matière afin d’approvisionner de petites portions de territoire d’une manière qui, tout à la fois, réponde à leurs besoins et soulage cette infrastructure. |
|
3.12. |
Le CESE réitère ici sa position affirmant que l’objectif devrait être de parvenir à ce que les émissions de gaz à effet de serre soient réduites autant que faire se peut pour un coût socio-économique aussi faible que possible. Afin de favoriser un environnement énergétique plus efficace, il préconise d’articuler entre eux des instruments compatibles avec un marché bien réglementé, ainsi que, si besoin est, des mesures réglementaires, dont des dispositifs de financement adossés au cadre financier pluriannuel et au programme de relance NextGenerationEU. Dans le même temps, il doit cependant être clair que si, à l’issue d’une analyse soignée, un solide faisceau d’indices amène à conclure que le marché est défaillant ou risque de l’être, la puissance publique se doit de parer à cette éventualité, par exemple en y réalisant des investissements ou des interventions. |
4. Observations particulières
|
4.1. |
S’agissant des investissements dans les infrastructures énergétiques, l’enjeu consiste à réaliser des avancées dans la sécurité d’approvisionnement et le déploiement des énergies renouvelables d’une manière qui soit rapide, opérante et efficace par rapport aux coûts engagés, dans l’intérêt du consommateur comme de l’économie. Dans ce contexte, une question d’une importance tout à fait décisive se pose, à savoir déterminer qui aura à l’avenir la haute main sur des infrastructures aussi essentielles que le réseau énergétique et les installations de stockage. Depuis les débuts de la libéralisation, les investissements des entreprises du secteur de l’électricité ont suivi une courbe descendante. Cette régression des moyens investis, dans le réseau comme dans la production, a créé des goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement et freine les énergies renouvelables dans la poursuite de leur déploiement. |
|
4.2. |
Économiquement parlant, on peut se demander pourquoi les pouvoirs publics ne pourraient pas se montrer intéressés eux aussi par un réseau énergétique qui, pour les investisseurs, constitue un placement attrayant, parce que de grande fiabilité. S’ils étaient versés dans les caisses de l’État, les dividendes distribués chaque année par les entreprises privées pourraient être réinvestis au profit de l’intérêt général et conforter les budgets publics: dans le cas de certaines privatisations partielles réalisées par le passé, il a d’ailleurs déjà été démontré que même pour des raisons purement financières, la solution la plus judicieuse aurait été que les actifs concernés restent sous propriété publique. Divers États membres ont d’ores et déjà recours à des structures publiques ou semi-publiques et, parallèlement, l’on constate également une tendance à la remunicipalisation de ces services. Il est indubitablement important de se demander, en se plaçant dans la perspective d’un marché de l’énergie fonctionnel, quels sont les avantages et les inconvénients d’une situation où les infrastructures énergétiques sont détenues ou financées par le privé, et il conviendrait que cette question soit examinée lors de l’évaluation que la Commission prévoit d’effectuer concernant les différentes voies possibles pour doter ce marché de l’architecture optimale. Les résultats de cette analyse peuvent constituer un précieux outil de prise de décision pour les États membres, qui sont chargés de décider qui, du public ou du privé, détient la propriété des infrastructures énergétiques. |
|
4.3. |
Sur cet arrière-plan, la fourniture d’énergie à l’échelon local et régional et la remunicipalisation des entreprises d’approvisionnement énergétique constituent des questions dont l’importance va croissant, en particulier dans le contexte des stratégies de décentralisation. Les investissements publics jouent ici un rôle déterminant pour assurer une production énergétique décentralisée au niveau des communes. Il serait opportun d’explorer d’autres pistes de soutien, comme l’octroi direct de moyens financiers par le truchement de fonds. Les toitures des bâtiments publics se prêtent particulièrement bien à alimenter des quartiers entiers en énergie solaire à un tarif avantageux. |
|
4.4. |
Certains États membres prévoient des incitations financières pour accélérer le déploiement du photovoltaïque. Dans une lettre adressée à la Commission, l’Autriche, la Belgique, la Lituanie, le Luxembourg et l’Espagne réclament que, moyennant certaines conditions, il devienne obligatoire que les immeubles administratifs, les supermarchés, les toitures plates et les bâtiments industriels soient équipés d’installations photovoltaïques, lesquelles devraient également être la norme pour les habitations neuves ou rénovées. Ces États membres lui demandent également que le budget de l’Union européenne affecte davantage de moyens à ce développement. Le CESE accueille favorablement cette idée et presse l’institution de procéder à une analyse qui définisse quels sont les investissements, les réglementations et les mesures d’accompagnement, par exemple en matière de recherche et développement, qui sont nécessaires pour stimuler le développement de l’énergie photovoltaïque, ainsi que la fabrication des équipements afférents dans l’Union européenne. |
|
4.5. |
L’énergie est un bien collectif: sur ce point, le CESE souligne la nécessité de mettre en œuvre les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt économique général au sens de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), telles qu’elles sont énoncées dans le protocole no 26 annexé audit traité et à celui sur l’Union européenne. Cette démarche pourrait être profitable du point de vue de l’efficacité et de l’accessibilité en la matière et éviter les défaillances du marché. |
|
4.6. |
La crise énergétique actuelle met en évidence toute l’importance que revêt l’énergie en tant que bien présentant une dimension sociale. Dans ce domaine, indépendamment de la préservation de postes de travail de haute qualité et de la défense de l’emploi, la corrélation entre enjeux sociaux et environnementaux apparaît très clairement. La détention de ces ressources par la puissance publique peut garantir qu’un contrôle démocratique s’exerce sur elles, qu’elles bénéficient d’investissements publics, que la sécurité d’approvisionnement soit assurée et que les coûts du basculement du secteur énergétique en faveur des sources renouvelables soient répartis de manière équitable. |
|
4.7. |
Afin d’éviter des investissements stériles et mal avisés, il convient d’éliminer les ambiguïtés et les incohérences qui entourent actuellement les structures fondamentales du nouveau système énergétique et l’architecture du marché, ses fonctions et ses règles et, surtout, de remédier sans délai aux conséquences d’ordre social qui en résultent pour les travailleurs et les consommateurs. Une répartition équitable des coûts d’investissement joue un rôle essentiel à cet égard, et il en va de même du juste partage des gains éventuels. Une des grandes questions qu’il convient d’aborder pour garantir que le marché de l’énergie présente un fonctionnement optimal, et ce, à long terme, consistera à définir la manière d’assurer la couverture de ses besoins d’investissement et sa rentabilité. Dans ce domaine, le CESE prend acte des conclusions auxquelles ont abouti l’étude de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) et la communication sur le marché du gaz et de l’électricité, et il se réjouit que la Commission affiche l’intention de procéder à une évaluation du marché de l’électricité. |
|
4.8. |
Lors de la transition énergétique, un aspect important consistera à coordonner et structurer les rapports entre les importateurs, les gestionnaires de réseaux régionaux, les entreprises énergétiques citoyennes, les autoconsommateurs et communautés énergétiques, consommant sur place l’électricité qu’ils produisent, ainsi que les entreprises de stockage et les fournisseurs. |
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) C’est à cette conclusion qu’est parvenue Eurelectric, la fédération du secteur de l’électricité.
(2) Plan REPowerEU, COM(2022) 230 final.
(3) C’est à cette conclusion qu’est parvenue Eurelectric, la fédération du secteur de l’électricité.
(4) Avis du CESE sur les prix de l’énergie (JO C 275 du 18.7.2022, p. 80).
(5) A Decarbonised, Affordable and Democratic Energy System for Europe («Un système énergétique décarboné, abordable et démocratique pour l’Europe»),
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Going%20Public_EPSU-PSIRU%20Report%202019%20-%20EN.pdf
(6) Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Repenser le cadre budgétaire de l’Union européenne pour une reprise durable et une transition juste» (JO C 105 du 04.03.2022, p. 11).
(7) Banque européenne d’investissement, 2006, Ex ante construction costs in the European road sector: a comparison of public-private partnerships and traditional public procurement («Coûts de construction ex ante dans le secteur routier européen: comparaison des partenariats public-privé et des marchés publics traditionnels»), Wirtschafts- und Finanzbericht 2006/01, Blanc-Brude F., Goldsmith H. et Välilä T. https://www.eib.org/attachments/efs/efr_2006_v01_en.pdf.
ANNEXE
L’amendement suivant, qui a recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, a été rejeté au cours des débats:
Paragraphe 2.9
Modifier comme suit:
|
Avis de section |
Amendement |
|
Le CESE prône que les règles européennes relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) soient mieux adaptées aux objectifs du pacte vert, lequel prévoit notamment de décarboner le système énergétique, d’effectuer la transition vers la neutralité climatique, de développer les sources d’énergie renouvelables, d’assurer l’efficacité énergétique et de prévenir le risque de précarité en la matière. Les réseaux énergétiques assurant un rôle essentiel pour l’équilibrage, la résilience et le développement du système énergétique, le CESE demande que le règlement s’inscrive avec plus de netteté dans une dynamique d’intégration dudit système, afin de promouvoir tous les types d’énergie décarbonée et de rendre impossible qu’il subisse une quelconque forme de désintégration. Dans ce contexte, il y a lieu de se féliciter que le Conseil et le Parlement européen aient pris l’initiative de poser qu’au même titre que les énergies renouvelables, les réseaux de distribution présentent eux aussi un «intérêt public majeur». |
Le CESE prône que les règles européennes relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) soient mieux adaptées aux objectifs du pacte vert, lequel prévoit notamment de décarboner le système énergétique, d’effectuer la transition vers la neutralité climatique, de développer les sources d’énergie renouvelables, d’assurer l’efficacité énergétique et de prévenir le risque de précarité en la matière. Les réseaux énergétiques assurant un rôle essentiel pour l’équilibrage, la résilience et le développement du système énergétique, le CESE demande que le règlement s’inscrive avec plus de netteté dans une dynamique d’intégration dudit système, afin de promouvoir tous les types d’énergie décarbonée , y compris le nucléaire, et de rendre impossible qu’il subisse une quelconque forme de désintégration. Dans ce contexte, il y a lieu de se féliciter que le Conseil et le Parlement européen aient pris l’initiative de poser qu’au même titre que les énergies renouvelables, les réseaux de distribution présentent eux aussi un «intérêt public majeur». |
Exposé des motifs
La production d’électricité à partir de sources nucléaires joue et continuera de jouer un rôle important dans le large éventail de technologies à faibles émissions, comme l’a notamment souligné Mme von der Leyen, présidente de la Commission européenne, lors de récentes interventions.
Résultat du vote sur l’amendement:
|
Voix pour: |
44 |
|
Voix contre: |
109 |
|
Abstentions: |
14 |
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/76 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «La cocréation de services d’intérêt général comme contribution à une démocratie plus participative au sein de l’UE»
(avis d’initiative)
(2022/C 486/11)
|
Rapporteur: |
Krzysztof BALON |
|
Corapporteur: |
Thomas KATTNIG |
|
Décision de l’assemblée plénière |
20.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Avis d’initiative |
|
Compétence |
Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
|
Adoption en section |
7.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
226/0/2 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
La cocréation de services d’intérêt général (SIG) par des organisations de la société civile ou, directement, par les citoyennes et les citoyens, apparaît comme l’un des instruments les plus efficaces pour stimuler la démocratie participative et renforcer ce faisant l’intégration européenne. C’est pourquoi le Comité économique et social européen (CESE) propose, dans le cadre du présent avis, des mesures concrètes propres à améliorer les conditions d’ensemble qui prévalent dans l’Union européenne en la matière, afin de renforcer encore la protection des droits et des avantages dont jouissent les citoyens. |
|
1.2. |
En particulier, les situations de crise, telles que récemment l’agression russe contre l’Ukraine et l’exode de millions de personnes — principalement des femmes et des enfants — qui en a résulté, mettent en évidence le rôle crucial joué par la société civile avec ses capacités d’action immédiate, ses modèles et ses processus de cocréation, en particulier de SIG sociaux et éducatifs, dans des domaines où ont été déjà engrangées des expériences d’une véritable cocréation, y compris pour ce qui est de les relier ou de les mettre en œuvre, de façon spontanée, mais avec succès. |
|
1.3. |
L’histoire nous montre que les acteurs de la société civile sont toujours des pourvoyeurs de services sociaux d’intérêt général et d’autres services d’intérêt général, notamment lorsque les pouvoirs publics n’ont pas encore pris la mesure de certains besoins, ou encore quand les entreprises commerciales considèrent qu’il n’est pas assez rentable pour elles de les satisfaire. La plupart du temps, l’État entre en jeu dans un second temps, soit comme prestataire soit comme client, voire comme régulateur ou comme garant de la qualité des prestations. Dans ce contexte, il convient également en ce qui concerne les SIG d’appliquer le principe de subsidiarité entre les États membres et l’Union européenne, tel qu’il est prescrit à l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (TUE). En outre, toujours en ce qui concerne les SIG, le concept de subsidiarité devrait également servir de principe directeur dans les relations entre tous les niveaux de l’administration publique des États membres, ainsi qu’entre les autorités publiques et les organisations de la société civile. |
|
1.4. |
Si la responsabilité juridique et politique de la prestation des SIG revient toujours aux élus siégeant dans les instances de représentation compétentes et que celle-ci est régulièrement soumise, lors des élections, à une évaluation de la part des citoyens, les pouvoirs publics exercent pour leur part un contrôle de l’adéquation de la fourniture des dits services. Le CESE soutient une mise en œuvre ciblée de l’approche de cocréation: les SIG devront être développés conjointement avec les utilisateurs, les collectivités et les organisations de la société civile pour s’assurer, d’une part, qu’ils répondent aux besoins réels des citoyens et, d’autre part, qu’ils permettent une participation démocratique. Cela est particulièrement vrai lorsque du personnel salarié coopère avec des bénévoles ou des structures d’entraide. |
|
1.5. |
Par conséquent, les États membres sont invités à concevoir ou à améliorer des instruments garantissant la participation des citoyens et des organisations de la société civile tout au long du processus de fourniture de services d’intérêt général. Il s’agit notamment de l’instauration d’un cadre approprié pour les activités à but non lucratif de l’économie sociale, telles que définies dans l’avis du CESE sur «Le renforcement des entreprises sociales à but non lucratif, pilier essentiel d’une Europe sociale» (1) du 18 septembre 2020, ainsi que de la mise en œuvre de l’article 77 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics (2), d’une manière qui réserve des marchés à des organisations à but non lucratif pour certains services sanitaires, sociaux, culturels ainsi qu’éducatifs tels qu’énumérés audit article. |
|
1.6. |
Le CESE attire l’attention sur le fait que, dans l’intérêt des citoyens et de l’économie, la fourniture de SIG de qualité dépend de l’attribution de ressources adéquates en termes financiers et de personnel. |
|
1.7. |
Même si les États membres, les régions et les communes sont les premiers responsables du cadre qui préside à la fourniture et, partant, à la cocréation des SIG, il est aussi urgent d’encourager les États membres à développer des approches participatives en mettant en place une «boîte à outils» facilitant l’utilisation des modèles de cocréation. De telles initiatives doivent se donner pour objectif d’encourager chacun des acteurs concernés dans les États membres à promouvoir la cocréation et la fourniture de SIG par des organisations de la société civile. |
|
1.8. |
Le CESE propose que la Commission publie un document de travail en la matière, qui servira de base à d’autres travaux, en vue de la création d’une «boîte à outils», qui devrait encourager et orienter les autorités nationales, régionales et locales vers un recours accru à des modèles de cocréation. Un tel document devrait intégrer, entre autres, les arbitrages en matière de cocréation par rapport à l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et au protocole no 26 annexé au TUE et au TFUE, et tenir compte du socle européen des droits sociaux, du rôle particulier de l’économie sociale à but non lucratif dans la cocréation, et enfin des conditions-cadres requises à cet effet. Le document reprendra aussi des propositions de soutien européen et national en faveur de projets de cocréation innovants, en tenant compte des éléments de recherche et d’un recueil de bonnes pratiques. Sur la base de la boîte à outils décrite ci-dessus, après une consultation plus large au niveau de l’Union, un livre vert, puis un livre blanc, pourraient être mis en chantier. |
|
1.9. |
De son côté, le CESE va créer un forum d’échange d’idées et de bonnes pratiques dans ce domaine, avec la participation d’organisations de la société civile, des partenaires sociaux, d’établissements d’enseignement supérieur et de projets de recherche, afin de maintenir et de développer le processus de discussion au niveau européen. |
2. Contexte
|
2.1. |
L’approfondissement de la démocratie participative au sein de l’Union européenne est l’un des défis essentiels à relever si l’on veut renforcer l’intégration européenne face au populisme et au nationalisme. La cocréation de SIG par l’intermédiaire des organisations de la société civile voire directement par les citoyennes et les citoyens eux-mêmes apparaît comme l’un des instruments les plus efficaces pour stimuler la démocratie participative. |
|
2.2. |
Depuis plusieurs années, le CESE s’engage en faveur de la modernisation et du développement des SIG, en collaboration avec différents acteurs de la société civile, de l’université et de la recherche. Au sein du Comité, cette activité relève au premier chef de la responsabilité du groupe permanent sur les SIG. |
|
2.3. |
En 2019, une coopération a été lancée avec le consortium constitué pour le projet «Co-creation of Service Innovation in Europe» (cocréation d’innovation de services en Europe — CoSIE) (3), qui rassemble des universités, des municipalités et des organisations de la société civile de 9 États membres de l’Union européenne (Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suède) et du Royaume-Uni. Lors de deux séminaires, le groupe permanent sur les SIG a assuré le suivi des expériences innovantes et des conclusions du projet CoSIE. «La cocréation de services d’intérêt général: le rôle des citoyens et de leurs organisations», tenu à Bruxelles le 15 avril 2021, et «Des citoyens au service des citoyens: la cocréation et la fourniture de services d’intérêt général par les organisations de la société civile», tenu à Lublin (Pologne) les 1er et 2 décembre 2021, en coopération avec la ville de Lublin et avec la participation de partenaires ukrainiens. |
|
2.4. |
La cocréation est intrinsèquement liée à des débats plus larges portant sur la réforme du service public. Le paradigme de la «nouvelle gestion publique» («new public management» ou NPM) reposait sur l’amélioration de l’efficacité, l’application de modèles managériaux issus du secteur privé et sur l’introduction de relations de type prestataire/consommateur dans les services publics où les besoins, les demandes et les choix des utilisateurs de services passaient au premier plan. Ce fut un modèle dominant dans les années 1990 et 2000, mais qui a fini par être critiqué puisqu’il est apparu que son efficacité et son efficience étaient moindres que prévu et que son potentiel d’innovation était limité (4). La priorité est désormais donnée aux tendances dites «post-NPM» ou «paradigmettes» (5) de l’innovation dans le service public, qui présupposent un citoyen actif, qui coproduit le service, plutôt qu’un consommateur individuel passif, motivé par son seul intérêt atomisé, et qui se concentrent aussi sur le renforcement de l’intégration et de la coordination entre les réseaux de groupes d’utilisateurs et de parties prenantes plutôt que sur la désintégration. Dans les modèles «post-NPM», la cocréation est considérée comme un concept clé (6). |
|
2.5. |
Les travaux menés par le CESE qui ont abouti à ce jour dans ce domaine montrent que la cocréation et la fourniture de services d’intérêt général par les citoyens et leurs organisations contribuent au renforcement de la démocratie participative ainsi qu’au développement de l’économie sociale dans l’Union européenne, entre autres rôles essentiels que jouent les SIG en tant que catalyseur indispensable de toutes les autres activités de la société. |
3. Services d’intérêt général
|
3.1. |
Alors que l’intégration européenne va son train, avec cette tension qui la caractérise entre «unité» et «diversité», un concept nouveau applicable aux services régis par des règlements et des normes spécifiques a été développé. L’objectif est de s’assurer que l’ensemble des citoyens et des acteurs ont accès aux services essentiels qui sont à ce jour — et qui seront à l’avenir — au fondement même d’une vie décente, et apparaissent indispensables à la participation à la vie sociale, à savoir les services d’intérêt général (SIG). Ces derniers peuvent être fournis dans différents contextes, que ce soit sur des marchés concurrentiels, en tant que services économiques d’intérêt général ou en tant que services non économiques d’intérêt général exclus de ces marchés. La Commission distingue (7) en l’espèce les «services d’intérêt économique général», les «services non économiques» et les «services sociaux d’intérêt général» (économiques ou non économiques). L’article 106 du TFUE s’applique aux services d’intérêt économique général (SIEG) (8). |
|
3.2. |
Progressivement, le concept a été étayé et précisé: |
|
3.2.1. |
les SIG sont des composantes des valeurs communes de l’Union et ils jouent un rôle dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union (9). Le CESE rappelle à cet égard les valeurs communes de l’Union en matière de services d’intérêt économique général au sens de l’article 14 du TFUE, telles qu’elles sont énoncées dans le protocole n 26 sur les services d’intérêt général annexé au TUE. Un développement plus poussé des principes énoncés ici peut conduire à davantage d’efficacité ainsi qu’à la suppression des dérives. |
|
3.2.2. |
Ces valeurs communes comportent trois dimensions: le pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour répondre aux besoins des utilisateurs; le respect de la diversité et des disparités au niveau des besoins, des préférences des utilisateurs et de leurs choix démocratiques, de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes; un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs (10). |
|
3.2.3. |
Ces services font partie intégrante des systèmes économiques et sociaux des États membres de l’Union et, dans leur ensemble, ils forment une composante fondamentale du modèle social européen. Les citoyens et les entreprises européens attendent de bon droit qu’un large éventail de services d’intérêt (économique) général fiables, stables, efficaces et de qualité leur soient accessibles à des prix abordables. Ces services s’assurent que les besoins et les intérêts collectifs — missions d’intérêt général — puissent être satisfaits. Le CESE insiste explicitement sur le fait que la fourniture de ces services de qualité, essentiels aux citoyens et à l’économie, dépend de l’attribution de ressources adéquates en termes financiers et de personnel. |
|
3.2.4. |
L’accès aux services d’intérêt économique général (SIEG) fait partie des droits fondamentaux (11) et du socle des droits sociaux (12). Alors que le principe no 20 du socle européen des droits sociaux mentionne explicitement les SIG «essentiels», d’autres principes décrivent des domaines importants des SIG, tels que l’éducation, le logement et l’aide aux sans-abri, les soins de longue durée, l’inclusion des personnes handicapées, la prévention en matière de santé, pour n’en citer que quelques-uns. |
|
3.2.5. |
Pour les services non économiques d’intérêt général, les règles du marché intérieur et de la concurrence ne s’appliquent pas, ils ne relèvent que des seuls principes généraux de l’Union (transparence, non-discrimination, égalité de traitement, proportionnalité) (13). |
|
3.2.6. |
L’Union et ses États membres veillent à ce que ces services fonctionnent «sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d’accomplir leurs missions» (14). |
|
3.2.7. |
Les SIEG sont soumis aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie (15). |
|
3.3. |
La finalité des services d’intérêt général (SIG) est de répondre aux besoins de chaque habitant et de chaque collectivité et à leurs évolutions dans le temps et l’espace, et ils sont par nature dynamiques. Ils peuvent concerner, par exemple, des domaines tels que la sécurité, la santé, les services sociaux, y compris l’inclusion des personnes handicapées, les soins de longue durée, le logement social (16), — l’éducation, ainsi que d’autres visant des services essentiels explicitement mentionnés dans le principe no 20 du socle européen des droits sociaux (17). |
|
3.4. |
En ce qui concerne les SIG, il convient d’appliquer le principe de subsidiarité entre les États membres et l’Union européenne, tel qu’il est prescrit à l’article 5, paragraphe 3, du traité UE. L’Union européenne définit un cadre général de principes visant à répondre aux besoins de l’ensemble de la population et des acteurs économiques et sociaux, tandis que les États membres et les autorités régionales et locales établissent et mettent en œuvre des SIG. En outre, toujours en ce qui concerne les SIG, le concept de subsidiarité devrait également servir de principe directeur dans les relations entre tous les niveaux de l’administration publique des États membres, ainsi qu’entre les autorités publiques et les organisations de la société civile. |
|
3.5. |
Les SIG se trouvent en tension entre le respect des droits fondamentaux, les objectifs locaux de cohésion économique, sociale et territoriale, les objectifs de développement durable, les objectifs environnementaux et climatiques et la mise en œuvre de l’économie sociale de marché, du marché intérieur et des règles de concurrence. C’est au cas par cas, de manière pragmatique que des équilibres évolutifs doivent être trouvés avec la participation de toutes les parties prenantes, pour répondre aux besoins de chaque personne et de chaque collectivité. |
4. La cocréation de services d’intérêt général
|
4.1. |
Les acteurs de la société civile sont depuis toujours des pourvoyeurs de services sociaux d’intérêt général et d’autres services d’intérêt général, notamment lorsque les pouvoirs publics n’ont pas encore pris la mesure de certains besoins, ou encore quand les entreprises commerciales considèrent qu’il n’est pas assez rentable pour elles de les satisfaire. La plupart du temps, l’État entre en jeu dans un second temps, soit comme prestataire soit comme régulateur ou comme garant de la qualité des prestations. |
|
4.2. |
Les services d’intérêt général sont fournis ou commandés par les collectivités territoriales elles-mêmes. Si la responsabilité politique revient aux élus siégeant dans ces collectivités et que celle-ci est régulièrement soumise, lors des élections, à une évaluation de la part des citoyens, les pouvoirs publics exercent pour leur part un contrôle de l’adéquation de la fourniture des dits services. Deux approches différentes peuvent en l’espèce être adoptées, à savoir du «haut vers le bas», c’est-à-dire à partir d’initiatives des autorités nationales, régionales ou locales, ou encore de «bas en haut», c’est-à-dire par la cocréation associant les citoyens et les organisations de la société civile. Le présent avis porte sur cette dernière approche. Le CESE soutient une mise en œuvre étendue de l’approche de cocréation: les SIG devront être développés en coopération avec les utilisateurs, les collectivités et les organisations de la société civile afin de garantir à la fois la satisfaction des besoins des citoyens et la participation démocratique. |
|
4.3. |
Toutefois, les domaines ainsi que le niveau de mise en œuvre de la cocréation dépendent du contexte. Les services, les collectivités et les prestataires de services — en particulier dans les secteurs critiques de l’infrastructure, tels que l’approvisionnement en énergie et en eau — ne sont pas tous prêts à embrasser une manière radicalement nouvelle d’aborder la question des services et du partage des responsabilités, mais chaque pas qui va dans le sens d’un renforcement du pouvoir de codécision et de la promotion de solutions concrètes nées de manière collaborative se révèle tout à fait gratifiant. Pour maximiser la participation des utilisateurs, l’«échelle de la cocréation» (18) pourrait être préconisée, avec une gradation des niveaux d’engagement systématique des acteurs publics et privés concernés, allant d’un seuil d’engagement inférieur (lorsque les agences publiques visent à donner aux citoyens les moyens d’agir pour renforcer leur capacité à maîtriser leur propre vie et les encourager à cocréer les services proposés par le secteur public) jusqu’à l’échelon le plus élevé (lorsque sont facilitées l’innovation collaborative fondée sur l’établissement en commun des priorités et la définition des problèmes, la conception conjointe et l’expérimentation de solutions nouvelles et non éprouvées, ainsi que la mise en œuvre coordonnée s’appuyant sur des solutions publiques et privées). |
|
4.4. |
La cocréation suppose l’adoption de méthodes de travail adossées à des atouts ou à des actifs. Une approche fondée sur des actifs mobilise les ressources (matérielles et immatérielles), les capacités et les aspirations des utilisateurs de services au lieu de se contenter d’enregistrer et de satisfaire leurs besoins. Cette approche part de l’hypothèse que chaque citoyen dispose d’actifs précieux et souvent méconnus — culture, temps, expérience vécue et expérience acquise, savoir-faire pratique, réseaux, compétences, idées —, et qu’il pourrait grâce à eux contribuer au développement et à la fourniture de services. La boîte à outils méthodologique de la cocréation englobe une batterie de méthodes, allant de l’enquête de satisfaction, comme celles en usage dans le domaine du commerce électronique, aux sondages, en passant par différentes manières d’exprimer des opinions à l’aide d’outils numériques, de groupes de réflexion («focus group») et de panels, ou encore par des méthodes participatives (comme par exemple, les hackathons sociaux, la méthodologie forum ouvert, les Living Labs, les world cafés, les service blueprints, le design thinking, les user journeys et divers outils participatifs en ligne). |
|
4.5. |
Toutefois, la cocréation n’est pas une solution technique et elle ne peut nullement être obtenue au moyen d’un seul et unique exercice. Il s’agit d’une approche qui irrigue à différents stades les processus de conception et de prestation des services. Dans ses formes plus radicales, la boîte à outils couvre des formes de cogouvernance qui favorisent le transfert de pouvoir et parfois le transfert de propriété des services aux citoyens et aux collectivités. Cela suppose la participation formelle de citoyens ayant acquis une expérience vécue dans le cadre d’accords de gouvernance, d’accords de représentation réciproque, de coopératives ou d’organisations communautaires. |
|
4.6. |
La condition préalable à la réussite d’un processus de cocréation est d’inviter tous les groupes d’utilisateurs potentiels pour qu’ils puissent représenter leurs intérêts. Une participation partiale favorisant des citoyens qui ont plus de ressources que les autres et qui sont davantage disposés à participer pourrait conduire à des processus non démocratiques. |
|
4.7. |
Une autre condition sine qua non de la cocréation réside dans la confiance entre les participants au processus, laquelle ne peut s’établir entre les prestataires de services et les parties prenantes que s’il existe une transparence sur ce que le service devrait réaliser grâce à ses processus de cocréation, et jusqu’à quel point il partage ouvertement la portée et la cible du service avec les cocréateurs (19). |
|
4.8. |
La cocréation doit toujours s’inscrire dans le contexte de la planification des besoins nationaux, régionaux et locaux. Il convient de systématiquement tenir compte des contradictions entre les différentes situations de besoins. Une fois ces informations collectées, des propositions pour les hiérarchiser pourront être examinées lors de débats publics et fournir des bases de décision aux instances de médiation et de prise de décision compétentes pour garantir un niveau suffisamment élevé de qualité, de sécurité de la prestation et d’accessibilité, sans négliger l’égalité de traitement et le respect des droits des utilisateurs. L’objectif ultime des SIG doit en effet bien garder en ligne de mire les avantages pour la société dans son ensemble. Le processus de cocréation ne doit en aucun cas entraîner incidemment une baisse de la qualité des services, des hausses de prix injustifiées ou une restriction de l’accès aux services. |
|
4.9. |
La cocréation est le fruit d’une interaction dynamique entre les prestataires de services, les utilisateurs de services et les autres parties prenantes, ce qui implique différentes étapes potentielles: |
|
4.9.1. |
la coïnitiation: le fait de déterminer en commun les objectifs et le contenu des différents services dès les toutes premières phases du processus; |
|
4.9.2. |
la participation de nouveaux acteurs (utilisateurs, clients, prestataires de services) et le maintien de leur engagement tout au long du processus; |
|
4.9.3. |
la coconception: la conception conjointe des services; |
|
4.9.4. |
la comise en œuvre: la coproduction des services; |
|
4.9.5. |
la cogestion: l’organisation et la gestion communes de services; |
|
4.9.6. |
la cogouvernance: la formulation en commun des politiques; |
|
4.9.7. |
la coévaluation: l’évaluation commune multicritères de l’efficacité ou de l’efficience du service et des choix opérés. |
|
4.10. |
Dès lors, il convient de noter que, dans la pratique, il existe déjà des modèles innovants dans le cadre desquels la fourniture d’un service public n’est absolument pas possible sans la participation active des utilisateurs (20). |
|
4.11. |
Il est essentiel que les SIG soient développés dans le cadre d’un effort de collaboration avec les utilisateurs, les collectivités et la société civile et les organisations de la société civile, afin de veiller à ce qu’ils créent et enrichissent la valeur des offres de SIG, c’est-à-dire qu’ils soient porteurs d’un bien-être accru ou d’une compréhension partagée du bien commun qui puisse servir de base à l’élaboration de politiques, de stratégies ou de services. Dans le cadre d’un processus de développement de services cocréatifs, celles et ceux qui utilisent des services travaillent avec des professionnels pour concevoir, créer et fournir des services (21). Par conséquent, dans ce processus, les rôles de l’innovateur, du prestataire de services et de l’utilisateur de services convergent. |
|
4.12. |
La valeur ajoutée de la cocréation réside toujours dans une coopération active entre les pouvoirs publics, qui assument la responsabilité juridique ou politique de la fourniture des SIG, les prestataires de services et les usagers, lesquels devraient être associés au processus de cocréation démocratique. La cocréation améliore ainsi la légitimité démocratique des décisions politiques. |
|
4.13. |
Cette valeur ajoutée contribue tout spécialement à renforcer la participation démocratique lorsque les prestataires de services proviennent d’organisations de la société civile ou de l’économie sociale à but non lucratif, où des professionnels salariés coopèrent avec des bénévoles ou avec des structures d’entraide, ou lorsque de telles organisations qui représentent les intérêts des utilisateurs peuvent exercer une influence réelle sur les prestataires de services qu’ils soient publics ou privés. En outre, la cocréation revêt aussi une dimension morale; elle renforce les collectivités, la cohésion et la confiance entre les acteurs (22). |
|
4.14. |
Cela est également perceptible dans les situations de crise. La fourniture par les organisations de la société civile d’un certain nombre de services, en particulier dans les domaines social et éducatif, à l’intention des réfugiés de guerre ukrainiens — et avec leur participation — nous en offre un exemple récent. La capacité immédiate de la société civile à mettre en œuvre spontanément, mais aussi avec succès, des modèles et des procédures de cocréation, s’est révélée cruciale, et celle-ci a été possible dans les territoires qui avaient déjà connu précédemment des processus de cocréation fructueux. |
5. Initiatives politiques au niveau européen
|
5.1. |
Bien que les États membres, les régions et les communes soient responsables en premier lieu du cadre de la fourniture et, partant, de la cocréation des SIG, il est nécessaire d’encourager les instances nationales, régionales et locales à toutes apporter un soutien adéquat pour faire en sorte que la fourniture desdits services soit de qualité. À cette fin, il est urgent d’encourager les États membres à développer des approches participatives en mettant en place une boîte à outils facilitant l’utilisation de modèles de cocréation. Ces initiatives devraient encourager toutes les parties prenantes concernées dans les États membres à promouvoir la cocréation et la fourniture de SIG par les organisations de la société civile, ceci est d’autant plus vrai que l’approche de la cocréation contribue de manière nullement négligeable à l’adaptation à l’évolution des besoins, ainsi qu’à la modernisation et à l’orientation vers l’avenir. |
|
5.2. |
À cet effet, le CESE demande à la Commission d’engager une démarche transversale qui englobe ses différents champs de compétence et toutes les parties prenantes, dans le but d’élaborer une boîte à outils recensant les différentes formes possibles de cocréation, les expérimentations qui sont menées et les leçons qu’il convient d’en tirer. |
|
5.3. |
Plus spécifiquement, le CESE propose dès lors à la Commission de publier un document de travail en la matière, qui servira de base à d’autres travaux, en vue de la création d’une «boîte à outils», qui devrait encourager et orienter les autorités nationales, régionales et locales vers un recours accru à des modèles de cocréation. Ce document devrait inclure, entre autres, les considérations à prendre en compte en matière de cocréation au regard de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et du protocole no 26 annexé au TUE et au TFUE, en prenant en considération le socle européen des droits sociaux, le rôle particulier de l’économie sociale à but non lucratif dans la cocréation et le cadre général nécessaire à cet effet, tel que défini dans l’avis du CESE sur «Le renforcement des entreprises sociales à but non lucratif, pilier essentiel d’une Europe sociale» du 18 septembre 2020 (23). En outre, le document devrait faire référence à la mise en œuvre de l’article 77 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics (24) d’une manière qui réserve des marchés à des organisations à but non lucratif pour certains services sanitaires, sociaux, culturels ainsi qu’éducatifs tels qu’énumérés audit article. De plus, le document reprendra aussi des propositions de soutien européen et national en faveur de projets de cocréation innovants, en tenant compte des éléments de recherche et d’un recueil de bonnes pratiques. Sur la base de la boîte à outils décrite ci-dessus, après une consultation plus large au niveau de l’Union, un livre vert, puis un livre blanc, pourraient être mis en chantier. |
|
5.4. |
De son côté, le CESE se propose de créer un forum d’échange d’idées et de bonnes pratiques dans ce domaine, avec la participation d’organisations de la société civile, d’établissements d’enseignement supérieur et de projets de recherche, afin de maintenir et de développer le processus de discussion au niveau européen. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) JO C 429 du 11.12.2020, p. 131.
(2) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=FR
(3) https://cosie.turkuamk.fi
(4) Drechsler, W., «Towards a Neo-Weberian European Union? Lisbon agenda and public administration» (Vers une Union européenne néo-weberienne? Stratégie de Lisbonne et administration publique), Halduskultuur (Journal estonien de la culture administrative et de la gouvernance numérique), volume 10, Université des technologies de Tallinn, Tallinn, 2009, p. 6-21.
(5) Çolak, Ç. D., «Why the new public management is obsolete: an analysis in the context of the post-new public management trends» (Pourquoi le nouveau mangement public est obsolète: une analyse dans le contexte des tendances «post-NPM»), Hrvatska i komparativna javna uprava (Administration publique croate et comparée), volume 19, no 4, Institut d’administration publique, Zagreb, 2019, p. 517-536, https://doi.org/10.31297/hkju.19.4.1
(6) Torfing, J., Sørensen, E., Røiseland, A., «Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits and ways forward» (Transformer le secteur public en aire de cocréation: obstacles, moteurs, bénéfices et voies à suivre), Administration & Society 2019, volume 51, no 5, SAGE, 2019, p. 795-825, https://doi.org/10.1177/0095399716680057
(7) https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_fr
(8) L’actuel article 106 du TFUE figurait déjà dans le traité de Rome.
(9) TFUE — Dispositions d’application générale, article 14.
(10) Protocole no 26 annexé au TUE et au TFUE.
(11) Article 36 de la Charte des droits fondamentaux.
(12) Principe no 20 du socle.
(13) Protocole no 26 annexé au TUE et au TFUE.
(14) Article 14 du TFUE.
(15) Article 106 du TFUE.
(16) Alors que dans de nombreux États membres, la crise immobilière s’aggrave, le logement abordable s’impose de plus en plus comme un service essentiel.
(17) «L’eau, les services d’assainissement, l’énergie, les transports, les services financiers et les communications numériques».
(18) Torfing, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019) Transforming the public sector into an arena for co-creation:Barriers, drivers, benefits and ways forward. Administration & Society 2019, 51(5), 795-825, https://doi.org/10.1177/0095399716680057
(19) https://cosie.turkuamk.fi/arkisto/index.html
(20) Voir par exemple ce que l’on appelle en France les «services publics partagés»: https://service-public-partage.fr/
(21) Social Care Institute of Excellence, «Co-production in social care: what it is and how to do it?» (Coproduction dans le domaine de l’aide sociale: de quoi s’agit-il et comment y procéder?), SCIE Guide 51, 2021.
(22) Becker, C. et al., «A New Agenda for Co-Creating Public Services» (un nouvel agenda pour la cocréation de services publics), Université des sciences appliquées de Turku, 2021, https://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522167842.pdf
(23) JO C 429 du 11.12.2020, p. 131.
(24) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=FR
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/83 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Partenariats thématiques dans le cadre de l’accord de Ljubljana»
(avis exploratoire)
(2022/C 486/12)
|
Rapporteur: |
David SVENTEK |
|
Corapporteur: |
Florian MARIN |
|
Consultation |
Conseil — Présidence tchèque, 26.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
|
Adoption en section |
9.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
190/1/4 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE soutient fermement les déclarations présentées dans l’accord de Ljubljana concernant le programme urbain pour l’UE (PUUE) et se félicite tout particulièrement que l’accent soit mis avec force sur le partenariat ainsi que sur les approches multipartites et à plusieurs niveaux en matière de développement urbain durable. |
|
1.2. |
Les partenariats thématiques devraient aboutir à des actions et des résultats concrets et durables qui soient plus pérennes que les partenariats eux-mêmes. Il faudrait en permanence examiner la possibilité de transmettre les réalisations à d’autres États membres, régions, villes ou secteurs. La répartition territoriale et l’équilibre géographique de ces possibilités devraient faire l’objet d’un suivi de sorte qu’elles puissent profiter aux régions et aux villes vulnérables. |
|
1.3. |
Le lien entre le PUUE et la politique de cohésion pourrait être renforcé. Bien qu’il s’agisse de deux politiques et initiatives distinctes ayant des objectifs différents et intégrées dans des cadres différents, il devrait exister des synergies. Il est nécessaire de bénéficier d’outils et d’instruments interconnectés pour assurer un soutien plus cohérent aux villes dans le cadre de la politique de cohésion, ainsi que d’une coopération et d’une intégration intersectorielles et interinstitutionnelles aux niveaux stratégique et opérationnel. Il convient de conférer aux partenariats thématiques une plus grande légitimité à l’avenir. |
|
1.4. |
Des mécanismes de mise en œuvre prévisibles et bénéficiant d’un soutien financier qui traduisent les objectifs stratégiques européens en actions concrètes, ainsi qu’un financement adéquat au niveau local, sont des éléments essentiels pour les petites et moyennes collectivités urbaines et pour leur participation continue aux dispositifs du PUUE. |
|
1.5. |
Le CESE estime que les critères utilisés pour sélectionner les partenaires en vue de partenariats thématiques doivent être plus spécifiques, plus ouverts et plus inclusifs. Il ne faut pas négliger la possibilité pour les partenaires sociaux et les organisations de la société civile de participer au processus de sélection aux côtés des collectivités urbaines. Il importe de tenir compte de l’évaluation ex ante réalisée pour l’écologisation des villes et le tourisme durable. |
|
1.6. |
Les conditions de travail, la prévisibilité des carrières et l’accès à des emplois de qualité, à des opportunités égales et à des salaires adéquats sont des thèmes qui devraient être abordés de manière transversale. Il convient de tenir compte de la nécessité de garantir tous les types de dialogues et de consultations avec les parties prenantes, comme le dialogue social, le dialogue civique et les consultations avec les citoyens. |
|
1.7. |
Le CESE suggère de tenir compte de l’approche ascendante, des pôles thématiques, des réseaux thématiques et des réseaux pour le développement de solutions sur mesure et territorialisées, ainsi que de la capacité d’utiliser les réseaux thématiques et de villes existants, en particulier pour les villes petites et moyennes. |
|
1.8. |
Le rôle du CESE dans la gouvernance du PUUE et de l’accord de Ljubljana pourrait être renforcé. Le CESE devrait également faire partie du groupe de développement urbain et du groupe préparatoire technique du programme urbain, et participer à la réunion des directeurs généraux sur les questions urbaines. |
|
1.9. |
La démocratie participative, l’économie du bien-être dans les villes et les connexions entre zones urbaines et zones rurales pourraient figurer parmi les thèmes abordés par les partenariats thématiques, avec une attention particulière portée à la jeunesse. |
|
1.10. |
Le CESE réitère sa suggestion de créer un secrétariat spécifique pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité des partenariats thématiques, dans le but de garantir un lien avec les politiques urbaines au niveau local, d’assurer une assistance technique et de faciliter la création de communautés thématiques et l’échange de bonnes pratiques thématiques. Cela devrait se faire en étroite coopération avec le Comité européen des régions. |
2. Contexte
|
2.1. |
Le 26 novembre 2021, les ministres de l’Union européenne chargés du développement urbain ont adopté l’accord de Ljubljana et son programme de travail pluriannuel, qui ouvre une nouvelle phase du programme urbain pour l’UE. Ce texte prévoit des mesures concrètes afin de renouveler le programme urbain, l’objectif commun étant de le rendre plus efficace et opérant. Le programme de travail pluriannuel complète la déclaration politique et définit les paramètres opérationnels, la méthode de travail et les étapes de mise en œuvre de la prochaine phase de cette initiative multipartite soumise à une gouvernance à plusieurs niveaux. |
|
2.2. |
Les 14 thèmes prioritaires du PUUE (1) restent valables: l’inclusion des migrants et des réfugiés; la qualité de l’air; la pauvreté urbaine; le logement; l’économie circulaire; les emplois et les compétences dans l’économie locale; l’adaptation au climat (y compris les solutions d’infrastructure verte); la transition énergétique; l’utilisation durable des terres et les solutions fondées sur la nature; la mobilité urbaine; la transition numérique; des marchés publics innovants et responsables; la culture et le patrimoine culturel; et la sécurité dans les espaces publics. |
|
2.3. |
L’accord de Ljubljana ajoute les quatre thèmes suivants à cette liste des priorités: l’égalité dans les villes, l’alimentation, l’écologisation des villes et le tourisme durable. Ils ont été ajoutés grâce à des processus cocréatifs et liés à la nouvelle charte de Leipzig, aux politiques de l’UE, à d’autres tendances émergentes en matière de développement urbain et aux besoins des villes. |
|
2.4. |
La future présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne a demandé au CESE d’examiner l’incidence éventuelle des changements émanant du nouvel accord de Ljubljana sur la création de nouveaux partenariats thématiques. Deux des quatre thèmes approuvés à Ljubljana seront plus particulièrement étudiés lors de la présidence tchèque de l’UE: l’écologisation des villes et le tourisme durable. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Le CESE soutient fermement les déclarations présentées dans l’accord de Ljubljana concernant le programme urbain pour l’UE et se félicite tout particulièrement que l’accent soit mis avec force sur le partenariat ainsi que sur les approches multipartites et à plusieurs niveaux en matière de développement urbain. |
|
3.2. |
Le CESE soutient simultanément la poursuite et le développement du programme urbain pour l’UE, dans le plein respect du principe de proportionnalité. De même, le principe d’additionnalité devrait être soigneusement géré au niveau local. |
|
3.3. |
Le CESE se félicite que l’accord de Ljubljana reconnaisse son importance et son rôle dans le soutien au programme urbain pour l’UE. Comme indiqué dans le programme de travail pluriannuel dudit programme, le CESE a la capacité et la volonté d’apporter sa contribution et son soutien en ce qui concerne la territorialité du développement, les partenariats, les aspects économiques et sociaux du développement urbain, ainsi que la diffusion des politiques urbaines de l’UE. |
|
3.4. |
Les difficultés relatives à la diversité, la complexité et la durabilité auxquelles sont confrontées les politiques de développement urbain nécessitent des approches multipartites et à plusieurs niveaux qui donnent la priorité aux partenariats. L’accord de Ljubljana reconnaît l’importance du partenariat pour améliorer les connaissances. Les partenariats thématiques devraient aboutir à des actions et des résultats concrets et durables qui soient plus pérennes que les partenariats eux-mêmes. Il faudrait en permanence examiner la possibilité de transmettre les réalisations à d’autres régions, villes ou secteurs. La répartition territoriale de ces possibilités devrait faire l’objet d’un suivi. Il y a lieu de motiver et d’encourager les villes à exploiter les possibilités de développement européen et à être actives au niveau de l’Union. |
|
3.5. |
La diversité des villes et de leurs politiques de développement est difficile à appréhender. Les politiques de développement urbain de l’UE ne contiennent actuellement aucune solution générale à ce problème. Il est nécessaire d’adopter une approche personnalisée qui valorise le partenariat, la société civile et les partenaires sociaux. Les solutions pour l’avenir des stratégies de développement devraient inclure diverses perspectives, compétences et disciplines. Dans son avis intitulé «Révision de l’agenda territorial de l’UE, de la charte de Leipzig et du programme urbain pour l’UE» (2), le CESE recommande d’utiliser les instruments de soutien les plus appropriés pour les types de territoire concernés, tout en respectant le principe de subsidiarité, ce qui conduira à éliminer les symptômes de privation, de retard et d’isolement dans le cas des régions à risque. |
|
3.6. |
Il convient de garantir une concurrence loyale entre toutes les catégories de villes lors du financement de leur développement durable, ce qui suppose un accès égal aux fonds pour les villes petites et moyennes. Le principe de concurrence devrait également être adapté à cette situation et toujours être pris en compte. |
|
3.7. |
Un nouvel élément inclus dans l’accord de Ljubljana concerne l’évaluation ex ante des thèmes. Ces évaluations visent à mettre en œuvre une approche pragmatique, efficace et axée sur les résultats, dans le but d’augmenter les effets des futures réalisations du PUUE. Elles permettront également d’adapter les critères de sélection aux partenaires. Le CESE recommande que les parties prenantes de la politique urbaine et les futurs partenariats thématiques aient constamment à l’esprit l’échange de bonnes pratiques, y compris les modèles de partenariat et de coopération. |
|
3.8. |
Il convient de mettre en place des instruments adaptés financés par des fonds de l’UE et des fonds publics afin de mettre en œuvre les plans d’action de partenariat thématique. Il y a lieu de mettre en place un soutien adapté (instruments financiers, subventions et fonds) pour garantir que le processus de mise en œuvre des partenariats thématiques fonctionne de manière efficace, en particulier en ce qui concerne l’aide aux villes et organisations petites et moyennes. L’accès à ce soutien devrait également être équitable, en veillant à ce que les petites villes et organisations ne soient pas laissées pour compte. |
|
3.9. |
Des instruments comme les investissements territoriaux intégrés et le développement local participatif ont largement porté leurs fruits et leur utilisation devrait être poursuivie et renforcée sur la base de mécanismes de mise en œuvre stables et prévisibles. Le CESE estime qu’il est également possible d’adopter une approche intégrée (3) s’agissant de combiner des ressources financières de caractère public et privé de manière à accroître les capacités et à partager les risques, au bénéfice d’un développement aussi bien territorial qu’urbain qui s’inscrive dans le cadre d’un contrôle démocratique, d’une gouvernance transparente et du principe de responsabilité. |
|
3.10. |
L’innovation devrait toujours être prise en considération lorsqu’il s’agit de relever les défis du développement urbain durable. Il est recommandé d’intégrer l’accès à l’innovation, ainsi que le partage et l’expansion des idées en matière d’innovation, dans la politique de cohésion pour la période 2021-2027 et dans les accords de partenariat conclus au niveau des États membres. Il ne faut pas négliger l’expérimentation de nouvelles solutions pertinentes et innovantes, en particulier dans des domaines tels que les technologies 4.0, l’industrie 5.0 ou les technologies Web3, ainsi qu’en matière d’innovation sociale. L’initiative urbaine européenne a un rôle important à jouer dans le renforcement des capacités et le soutien aux actions innovantes. |
|
3.11. |
Les régions et les villes marginalisées et leurs populations vulnérables devraient faire l’objet d’une préoccupation constante dans les politiques de développement, afin d’améliorer la qualité de vie de tous les citoyens. La diminution de la pauvreté devrait également être une priorité majeure. L’accès à une éducation inclusive de qualité, aux services sociaux, aux soins de santé et à d’autres services publics est essentiel pour garantir aux villes une reprise équitable après la pandémie. Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de partenariats thématiques, il convient d’accorder une attention particulière aux groupes vulnérables d’habitants des villes, parmi lesquels, notamment, les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités, les immigrés, les réfugiés ou les personnes défavorisées sur le plan social, économique et culturel. Il y a lieu de garantir leur participation en renforçant les capacités dans le cadre du processus. Le CESE recommande vivement de faire de la réduction des nouvelles formes d’inégalités sociales, économiques, environnementales et territoriales une priorité et, à cette fin, de garantir une participation équitable et diversifiée des différentes parties prenantes. |
|
3.12. |
L’accord de Ljubljana recense les besoins d’assistance en matière d’organisation et d’expertise, ainsi que certains besoins de soutien pour les petites villes. Le PUUE demeurant une initiative informelle et volontaire, les membres devraient également contribuer à soutenir les partenariats et à mettre en œuvre les actions. Le CESE estime que le soutien technique requis dans le cadre des partenariats devrait tenir compte de la durabilité des résultats finaux des partenariats. Il faudrait aussi envisager continuellement une approche renforcée, intégrée et participative, parallèlement à la collecte et à l’utilisation de données pour des investissements fondés sur des éléments probants. |
|
3.13. |
Néanmoins, des mécanismes de mise en œuvre prévisibles et bénéficiant d’un soutien financier qui traduisent les stratégies européennes en actions concrètes ainsi qu’un financement adéquat au niveau local sont des éléments essentiels pour les petites et moyennes collectivités urbaines et pour leur participation continue aux dispositifs du PUUE. Il convient par ailleurs de bien tenir compte de ce principe dans la mise en œuvre des partenariats thématiques. |
|
3.14. |
La politique de cohésion offre un large éventail d’outils et d’instruments pour le développement urbain durable lors de la période de programmation 2021-2027. Le nouvel objectif stratégique no 5 «Une Europe plus proche des citoyens» vise à créer des outils spécifiques pour la mise en œuvre de stratégies de développement local dans les villes, quelle que soit leur taille. L’enveloppe minimale du FEDER dans chaque État membre destinée aux priorités et aux projets sélectionnés par les villes sur la base de ces stratégies a été portée de 5 % à 8 %. De plus, l’initiative urbaine européenne a été créée pour apporter un soutien plus cohérent aux villes. Le CESE recommande que les possibilités de partenariat thématique soient diffusées en permanence au niveau local et associent toutes les parties prenantes concernées, y compris le CESE. À l’avenir, l’enveloppe affectée au développement urbain pourrait être plus élevée. |
|
3.15. |
La volatilité accrue et la diversité des risques imposent aux partenariats thématiques de contribuer au renforcement de la résilience et de la réactivité aux chocs asymétriques, comme la COVID-19 et d’autres situations similaires. La guerre en Ukraine, qui est à condamner, influe sur le développement urbain dans les pays voisins. Les partenariats thématiques devraient être adaptés pour faire face aux crises à court terme et être associés à des approches stratégiques à long terme. |
4. Observations particulières
|
4.1. |
Le CESE estime que les critères utilisés pour sélectionner les partenaires dans le cadre des partenariats thématiques doivent être plus spécifiques. Il ne faut pas négliger la possibilité pour les partenaires sociaux et les organisations de la société civile de participer au processus de sélection aux côtés des collectivités urbaines, notamment les organisations qui représentent des groupes vulnérables tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les minorités, les immigrés, les réfugiés, les personnes défavorisées sur le plan social, économique et culturel, et d’autres groupes encore. Il faut encourager et motiver ces organisations à participer à des partenariats dans le cadre du PUUE. |
|
4.2. |
Le pacte d’Amsterdam reconnaît le CESE comme l’une de ses parties prenantes et l’invite à contribuer, dans le cadre de ses compétences, au développement du PUUE. La validité du pacte d’Amsterdam a été confirmée dans le texte d’application de la nouvelle charte de Leipzig et dans l’accord de Ljubljana. Le rôle du CESE dans le PUUE et l’accord de Ljubljana devrait être renforcé. Le Comité est un acteur européen important compétent pour les variables économiques et sociales des politiques de développement, et il a la capacité, l’expertise et la légitimité pour contribuer à la réalisation des trois piliers de l’accord de Ljubljana: un meilleur financement, une meilleure réglementation et de meilleures connaissances. Il convient que le CESE soit officiellement reconnu et joue un rôle dans les principaux organes de gouvernance de l’accord de Ljubljana, fasse partie à la fois du groupe de développement urbain et du groupe préparatoire technique du programme urbain, et participe à la réunion des directeurs généraux sur les questions urbaines. |
|
4.3. |
Le CESE estime que les futurs partenariats thématiques devraient inclure des thèmes tels que la démocratie participative, l’économie du bien-être dans les villes et les connexions entre zones urbaines et zones rurales (4), conformément au concept de développement territorial utilisé dans le cadre stratégique de l’Union européenne. Il recommande d’assurer un lien clair entre le processus de sélection des partenaires, la sélection des thèmes et les ODD, d’une part, et les contributions du partenariat à la mise en œuvre des ODD, d’autre part. |
|
4.4. |
À l’avenir, des partenariats thématiques pourraient être organisés en pôles thématiques, réseaux thématiques existants et réseaux en vue de l’élaboration de solutions adaptées et territorialisées pour les villes. Il convient de garder à l’esprit l’amélioration de l’accès aux réseaux, en particulier pour les villes petites et moyennes. Il convient de mettre les villes au cœur de l’approche ascendante des partenariats thématiques afin de garantir une synergie entre les situations locales et les partenariats thématiques en place. |
|
4.5. |
Le processus de consultation utilisé par les partenariats thématiques devrait inclure toutes les formes de dialogue et de consultations telles que le dialogue social, le dialogue avec les citoyens et le dialogue civique, et inclure tous les types d’acteurs civiques, comme les partenaires sociaux, les ONG et les citoyens. |
|
4.6. |
Le CESE suggère de créer un secrétariat spécifique avec la Commission et d’autres parties prenantes afin de soutenir les partenariats thématiques, de garantir un lien avec les politiques urbaines au niveau local, d’assurer une assistance technique et de faciliter la création de communautés thématiques et l’échange de bonnes pratiques thématiques. Des ressources suffisantes devraient être allouées pour garantir une bonne administration et des partenariats thématiques efficaces, notamment en vue de la mise en œuvre des plans d’action. |
|
4.7. |
Le CESE recommande de renforcer le lien entre le PUUE et la politique de cohésion. Bien qu’il s’agisse de deux politiques et initiatives distinctes poursuivant des objectifs différents et intégrées dans des structures différentes, des synergies devraient exister, notamment dans le cadre de la plateforme de partage des connaissances (5) et des activités de capitalisation à développer dans le cadre de l’initiative urbaine européenne. Les programmes opérationnels, les différents appels à propositions ou les critères d’évaluation des projets pourraient mentionner les actions existantes pour la mise en œuvre des partenariats thématiques. Les résultats des travaux des partenariats thématiques devraient être pris en compte dans la planification des nouveaux programmes opérationnels de cohésion. |
|
4.8. |
Il convient de renforcer la cohérence et le lien entre les politiques urbaines mises en œuvre au niveau local et les politiques de l’UE, en particulier la politique de cohésion. Il est nécessaire de bénéficier d’outils et d’instruments interconnectés pour assurer un soutien plus cohérent aux villes dans le cadre de la politique de cohésion, ainsi que d’une coopération et d’une intégration intersectorielles et interinstitutionnelles aux niveaux stratégique et opérationnel. La compétitivité régionale doit également être pourvue d’un élément de complémentarité entre les zones urbaines et rurales et d’une forte cohésion sociale dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2021-2027. |
|
4.9. |
Les conditions de travail, la prévisibilité des carrières ainsi que l’accès à des emplois de qualité, à des opportunités et à des salaires adéquats sont des variables importantes pour assurer que les processus de développement urbain soient justes et équitables. Elles devraient être abordées de manière transversale en ce qui concerne l’écologisation des villes, la durabilité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, l’économie circulaire et le tourisme durable. L’investissement dans les ressources humaines devrait rester l’une des principales priorités des stratégies de développement. Un accès équitable et l’égalité des chances, ainsi que la capacité à exercer les droits fondamentaux sont des éléments essentiels pour la réussite des partenariats thématiques. |
|
4.10. |
En raison de la concentration des ressources et des besoins dans les zones urbaines, le Semestre européen devrait adopter une approche plus individuelle de l’efficacité des politiques de développement urbain, de sorte que personne ne soit laissé pour compte. Il y a lieu de prendre constamment en considération la cohérence avec d’autres instruments européens tels que le socle européen des droits sociaux. |
|
4.11. |
Les stratégies et les projets de développement qui sont de nature très complexe font l’objet d’une demande croissante. Le CESE suggère que pour ces types d’investissements, les collectivités locales et régionales renforcent leurs capacités dans les domaines de la participation des citoyens, de la prospective stratégique et de la préparation à divers scénarios, de la planification stratégique et de la mise en œuvre des investissements publics. C’est essentiel pour assurer le succès du développement durable des villes européennes et pour réorienter les villes vers les citoyens. Il convient de tenir compte de la convergence des données résultant de différents partenariats et de l’accès aux données au moyen de plateformes de données ouvertes, ainsi que de la justice et de la démocratie numériques. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/themes/urban-development/agenda_en
(2) JO C 429 du 11.12.2020, p. 145.
(3) Voir avis du CESE intitulé «Révision de l’agenda territorial de l’UE, de la charte de Leipzig et du programme urbain pour l’UE»(JO C 429 du 11.12.2020, p. 145).
(4) Vers une stratégie globale en matière de développement rural et urbain durable (avis d’initiative) (JO C 105 du 4.3.2022, p. 49).
(5) https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/our-digital-future/era/knowledge-exchange-platform-kep_fr
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/88 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Lutte contre la précarité énergétique et résilience de l’Union: enjeux économiques et sociaux»
(avis exploratoire à la demande de la présidence tchèque)
(2022/C 486/13)
|
Rapporteur: |
Ioannis VARDAKASTANIS |
|
Demande de la présidence tchèque du Conseil |
Lettre du 26.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Avis exploratoire |
|
Compétence |
Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» |
|
Adoption en section |
22.6.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
137/2/5 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
L’Union européenne (UE) et ses États membres doivent faire de l’accès à l’énergie pour tous et de la sécurité de l’approvisionnement énergétique à un coût abordable une priorité absolue. En conséquence de la hausse des prix de l’énergie, de plus en plus de citoyens et de consommateurs de toute l’Europe sont touchés par la précarité énergétique. Ceux qui y étaient déjà confrontés voient leur cas s’aggraver et ceux qui, par le passé, n’ont pas éprouvé de difficultés à payer leurs factures énergétiques risquent de tomber dans la pauvreté. Les tensions géopolitiques actuelles, notamment la guerre en Ukraine et la dépendance des États membres à l’égard des importations d’énergie, ont également des répercussions sur cette situation. Des mesures doivent être adoptées de toute urgence pour prévenir et combattre la précarité énergétique à laquelle sont confrontés les citoyens et consommateurs européens. |
|
1.2. |
Le Comité économique et social européen (CESE) reconnaît l’importance accordée à la précarité énergétique dans les initiatives de l’UE, y compris la législation et les politiques, en particulier dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55», la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et la vague de rénovations. Ces démarches sont essentielles pour lutter contre la précarité énergétique à long terme et garantir la durabilité. Toutefois, la résilience de l’Union ne peut être mesurée qu’en fonction de la manière dont celle-ci et ses États membres s’attaquent aux défis majeurs que leurs citoyens et leurs entreprises rencontrent sur les plans social, environnemental et économique. |
|
1.3. |
Pour faire face à l’actuelle crise de la précarité énergétique, le CESE demande de mettre en place une coalition politique vaste et ambitieuse, ayant pour mission, selon une approche globale, d’analyser la précarité énergétique et de lutter contre ce phénomène afin de le réduire au minimum d’ici 2030 et de l’éradiquer totalement à long terme. Cette coalition devrait comprendre la Commission européenne et son groupe consultatif sur la précarité énergétique, le Parlement européen, le Conseil, les États membres, le Comité européen des régions, le Comité économique et social européen, la Convention des maires et des organisations de la société civile organisée, y compris des représentants des entreprises, des organisations de consommateurs et des organisations représentant les populations les plus exposées au risque de précarité énergétique. Les actions de la coalition devraient être définies plus en détail dans le cadre d’une stratégie de l’UE contre la précarité énergétique et la Commission devrait encourager les États membres à élaborer des politiques ou des plans nationaux visant à éradiquer la précarité énergétique, en intégrant tous les instruments politiques et de financement aux niveaux européen et national et en assurant leur cohérence. |
|
1.4. |
Compte tenu de l’importance du problème, le CESE invite instamment l’UE à promouvoir une approche commune qui permette une interprétation concrète et partagée de la précarité énergétique et la collecte de données statistiques, en prenant en considération les différences et les particularités des États membres. Une telle approche est également nécessaire pour suivre la situation et l’incidence des mesures prises dans l’ensemble de l’Union. |
|
1.5. |
Le CESE note que la Commission a déjà commencé à proposer des mesures immédiates et à long terme en vue de protéger les consommateurs et de lutter contre la précarité énergétique, par exemple au moyen de sa recommandation sur la précarité énergétique, de sa communication sur une panoplie d’instruments pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie, de sa communication «REPowerEU» et de la proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique. Tandis que les actions des États membres peuvent dépendre de particularités nationales et locales, il est essentiel, afin de garantir la résilience de l’UE, que dans des périodes d’urgence, les États membres activent toute une série de mesures (comme un soutien financier direct et des politiques sociales, ainsi que des mesures incitatives et des aides permettant de réduire la consommation d’énergie) en vue d’atténuer les effets négatifs de la hausse des prix sur les consommateurs et les entreprises les plus vulnérables. |
|
1.6. |
Le CESE souligne l’importance d’investir dans une énergie équitable et efficace afin de réduire la précarité énergétique à long terme. Cela implique de veiller à ce que les fonds disponibles soient investis dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, ainsi que dans la rénovation massive des bâtiments, de manière à soutenir les groupes aux revenus les plus faibles, en veillant à ce que les personnes vulnérables disposent de moyens pour investir dans l’efficacité énergétique, en donnant la priorité aux bâtiments les moins performants. La Commission devrait collaborer étroitement avec les États membres afin d’évaluer si le budget disponible répond aux besoins et aux demandes et de recenser les options qui permettraient de soutenir davantage les États membres. |
|
1.7. |
Étant donné que la précarité énergétique relève de la pauvreté au sens large, il est également essentiel que la Commission et les États membres continuent de se concentrer sur la réduction de la pauvreté dans son ensemble. Cette crise rappelle qu’il convient constamment d’améliorer l’accès à l’emploi, d’assurer l’inclusion sociale et un niveau de vie décent, en accordant une attention particulière aux personnes vivant dans les zones rurales et isolées, et de soutenir la croissance économique des États membres. |
|
1.8. |
L’UE et ses États membres doivent garantir un environnement propice aux investissements en Europe pour une énergie à émissions de carbone faibles ou nulles. En outre, la reconversion et le perfectionnement professionnels joueront un rôle important dans la transition écologique, la vague de rénovations et l’efficacité énergétique. Des formations, des conseils et des consultations relatifs à l’énergie, largement disponibles et abordables au niveau local (par exemple par l’intermédiaire de guichets uniques), pourraient constituer d’autres mesures bénéfiques. |
2. Observations générales
|
2.1. |
La précarité énergétique est un problème de plus en plus préoccupant pour les citoyens et les entreprises de l’Union européenne. En 2020, 8 % des Européens ont déclaré ne pas être en mesure de chauffer convenablement leur foyer (1). Aujourd’hui, ce nombre a probablement augmenté, étant donné que les prix de l’énergie sont montés en flèche depuis la mi-2021. En mars 2022, l’inflation annuelle de l’énergie au sein de l’UE a atteint 40,2 %, le taux annuel de variation des prix de l’énergie le plus élevé atteignant 99,6 % et le plus faible 0 % (2). Les tensions géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine et la dépendance des États membres de l’UE à l’égard des importations d’énergie, ont également des répercussions sur les prix de l’énergie (3). La hausse des prix de l’énergie combinée à une augmentation des prix des transports et des denrées alimentaires aggrave la pression sur tous les consommateurs, mais surtout sur les ménages à faibles revenus, qui souffrent davantage de la précarité énergétique. Cette précarité reste donc un défi majeur, avec une incidence sociale considérable. L’UE et ses États membres doivent en sortir leurs citoyens vulnérables sans délai. |
|
2.2. |
La précarité énergétique résulte d’une combinaison de facteurs, dont la faiblesse des revenus et la mauvaise efficacité énergétique des bâtiments et des appareils, ainsi que le manque d’informations sur les mesures incitant à réduire la consommation d’énergie et un accès restreint à ces mesures. Les prix élevés de l’énergie touchent également les citoyens et les entreprises, en augmentant les factures de consommation courante et en exposant les micro, petites et moyennes entreprises à une situation très précaire (4) et à un risque de faillite, ce qui pourrait entraîner des pertes d’emplois, qui, à leur tour, contribueraient à la pauvreté. Les «microentreprises vulnérables» subissent elles aussi de plein fouet les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover les bâtiments qu’elles occupent. La flambée des prix de l’énergie produit un effet en cascade et se traduit par une augmentation des coûts de toutes sortes de biens et de services. L’Europe est confrontée à un risque de stagflation, c’est-à-dire une croissance économique plus faible et une forte inflation, qui représentent des facteurs de pauvreté supplémentaires (5). |
|
2.3. |
Les Européens les plus durement touchés par la précarité énergétique sont ceux à bas revenus, tels que les travailleurs les plus pauvres, les retraités à faibles revenus, les étudiants, les jeunes adultes, les familles nombreuses et les parents isolés, ainsi que les populations défavorisées qui présentent déjà des taux de pauvreté élevés, comme les personnes handicapées, les personnes âgées, les migrants et les minorités roms. Les femmes sont plus exposées au risque de précarité énergétique et à ses incidences, étant donné qu’elles perçoivent en moyenne des salaires moins élevés et qu’elles dépendent davantage des systèmes domestiques de chauffage et de refroidissement car elles passent plus de temps à la maison pour assumer leurs responsabilités familiales. En outre, les populations d’Europe orientale et méridionale sont en moyenne plus touchées par la précarité énergétique (6). |
|
2.4. |
La garantie de l’égalité d’accès à une énergie propre et abordable pour tous les citoyens européens constitue un engagement de taille pour l’UE et ses États membres. Le socle européen des droits sociaux inclut l’énergie parmi les services essentiels auxquels chacun a le droit d’accéder (principe 20). La perspective de «garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable» figure également dans les objectifs énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ODD 7). Des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie sont des services indispensables au maintien d’un niveau décent de vie et de santé. L’accès aux services énergétiques s’avère, qui plus est, indispensable à l’inclusion sociale. Ensemble, les multiples avantages de la lutte contre la précarité énergétique peuvent directement stimuler la croissance économique et la prospérité dans l’UE. |
|
2.5. |
Ces dix dernières années, l’Union européenne a abordé la question de la précarité énergétique dans divers documents juridiques et politiques, tels que le troisième paquet «Énergie» (2009-2014), la stratégie européenne pour l’union de l’énergie de 2015 et le paquet législatif «Une énergie propre pour tous les Européens», adopté en 2019 et destiné à faciliter une transition énergétique juste. Ce sujet représente par ailleurs un élément important dans des initiatives plus récentes, comme le pacte vert pour l’Europe, y compris la vague de rénovations et le paquet «Ajustement à l’objectif 55». Ce paquet tient compte de la précarité énergétique dans plusieurs de ses propositions, dont celle relative à la création d’un nouveau Fonds social pour le climat, qui devrait atténuer les incidences sociales négatives de la nouvelle tarification du carbone envisagée pour les transports et les bâtiments, et la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique, qui propose une définition de la précarité énergétique (7). Le paquet comprend également une proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, qui définit des orientations spécifiques à l’intention des États membres sur la manière de traiter les aspects pertinents de la transition écologique liés à l’emploi et à la société. Ces orientations revêtent un intérêt particulier dans le contexte de l’accélération de la transition en raison de la hausse des prix de l’énergie et du contexte géopolitique. |
|
2.6. |
En 2020, la Commission européenne a adopté une recommandation sur la précarité énergétique, qui fournit des orientations sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique». Cette recommandation contribue également au partage de bonnes pratiques entre les États membres et recense les aides disponibles au niveau de l’UE grâce à diverses sources de financement qui permettent aux autorités nationales, régionales et locales d’utiliser pleinement leur force de frappe financière, y compris des subventions et des rénovations subventionnées, afin de limiter les investissements initiaux. Parmi les autres initiatives majeures figurent le soutien apporté aux projets locaux par le groupe consultatif sur la précarité énergétique, qui fournit une assistance technique depuis cette année, une communication relative à une panoplie d’instruments pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie, qui aide les États membres à utiliser les outils adéquats pour soutenir les citoyens et les entreprises face aux prix élevés de l’énergie, l’appui aux ménages et aux entreprises vulnérables étendu dans le cadre du plan REPowerEU (8) et, récemment, la création du groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables (9). |
|
2.7. |
Toutefois, le CESE note que, sans une mise en œuvre rapide, des engagements forts et des mesures concrètes de la part des États membres, y compris une approche commune pour comprendre et combattre la précarité énergétique au niveau de l’UE, qui pourrait déboucher sur une définition commune, laissant cependant à chaque État membre le soin de trouver des solutions sur mesure, les initiatives présentées jusqu’à présent par la Commission s’avéreront insuffisantes pour faire face à la crise actuelle, qui touche de plus en plus de consommateurs. |
3. Lutter contre la précarité énergétique selon une approche globale: un appel en faveur d’une coalition politique et d’une stratégie de lutte contre la précarité énergétique
|
3.1. |
Étant donné que la précarité énergétique découle de facteurs sociaux, environnementaux, économiques et géopolitiques, elle nécessite une approche globale, prévoyant une analyse rigoureuse du problème et la participation de diverses parties prenantes, allant des consommateurs aux autorités européennes, nationales, régionales et locales, en passant par les organisations de la société civile et les entreprises. Pour ce faire, le CESE demande la mise en place d’une coalition politique vaste et ambitieuse. Cette coalition devrait comprendre la Commission européenne et son groupe consultatif sur la précarité énergétique, le Parlement européen, le Conseil, les États membres, le Comité européen des régions, le Comité économique et social européen, la Convention des maires et des organisations de la société civile organisée, y compris des représentants des entreprises, des organisations de consommateurs et des organisations représentant les populations les plus exposées au risque de précarité énergétique. |
|
3.2. |
Les États membres devraient être en contact permanent avec les consommateurs et les autorités locales et municipales qui travaillent sur la question. Les villes et les régions sont souvent les mieux placées pour repérer les ménages menacés de précarité énergétique à un stade précoce et donc pour remédier à cette situation de la manière la plus efficace possible. Les entreprises locales et nationales peuvent également prendre une large part, avec les autorités nationales et locales (y compris les municipalités et les services municipaux) (10), aux activités visant à réduire la précarité énergétique, notamment en contribuant à la vague de rénovations. Étant donné que les consommateurs vulnérables sont généralement moins à même d’adapter rapidement leurs modes de consommation, ils devraient être consultés et associés à tous les niveaux. Il est essentiel de prendre leurs expériences et leurs comportements en compte dans la conception et la mise en œuvre des mesures. |
|
3.3. |
Les organisations de la société civile ont un rôle essentiel à jouer pour faciliter le dialogue entre les citoyens, les entreprises, les travailleurs, les consommateurs et les décideurs. Compte tenu de leur expertise et de leurs réseaux sur le terrain, ces organisations doivent être impliquées dans l’élaboration de mesures pour lutter contre la précarité énergétique, y compris en ce qui concerne la conception, la mise en œuvre et le suivi des stratégies dont l’objectif est de mettre fin à cette précarité. |
|
3.4. |
Le CESE recommande à la coalition d’élaborer une stratégie européenne contre la précarité énergétique à l’initiative de la Commission. La stratégie devrait se fonder sur la reconnaissance d’un droit à l’énergie. Elle devrait en outre fixer des objectifs ambitieux mais réalistes pour atteindre les objectifs définis dans le cadre du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, et viser à mettre un terme à la précarité énergétique à long terme. Elle devrait inclure des mesures, en lien ou non avec l’énergie, visant à s’attaquer aux causes profondes de la précarité énergétique et à améliorer les conditions des consommateurs vulnérables et en situation de précarité énergétique. Une telle stratégie est également nécessaire pour veiller à ce que les transitions climatique et énergétique soient conçues et mises en œuvre de manière à être justes, équitables et inclusives, sans laisser personne de côté. Elle pourrait prévoir la tenue d’une réunion annuelle (afin de suivre les progrès accomplis et de faire connaître les actions communes), comprendre des exigences relatives à l’organisation régulière de dialogues structurés et d’actions de sensibilisation à l’intention des États membres et de toutes les parties prenantes concernées, et créer des incitations supplémentaires à investir dans les transitions énergétiques. Le groupe consultatif sur la précarité énergétique pourrait jouer un rôle important dans la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie. |
|
3.5. |
Parallèlement, la Commission européenne, le Conseil, le Parlement et, au niveau national, les États membres doivent continuer à veiller à ce que les initiatives législatives et politiques existantes et nouvelles s’attaquent de manière adéquate à la précarité énergétique. Ils pourraient, par exemple, au cours de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et de la vague de rénovations, réexaminer les plans nationaux en matière d’énergie et de climat ainsi que les stratégies à long terme de rénovation des bâtiments, et rendre compte de leur état d’avancement, tout en mettant davantage l’accent sur la précarité énergétique dans le cadre du Semestre européen. Les initiatives législatives et les réexamens offrent d’excellentes occasions de lutter plus particulièrement contre la précarité énergétique, comme les révisions prévues de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, de la directive sur les énergies renouvelables et de la directive relative à l’efficacité énergétique, ainsi que la proposition de Fonds social pour le climat. De plus, l’Union européenne doit veiller à ce que toutes les nouvelles initiatives visant à fournir une énergie abordable, sûre et durable continuent d’accorder une attention particulière aux incidences sur les consommateurs les plus vulnérables afin d’atténuer les effets des prix élevés de l’énergie. Il s’agit notamment d’initiatives en faveur d’une économie à faible intensité de carbone ou ayant pour but de mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles russes, telles que la communication «REPowerEU». |
|
3.6. |
La Commission devrait encourager les États membres à élaborer des politiques ou des plans nationaux visant à éradiquer la précarité énergétique, en intégrant tous les instruments de financement et d’action aux niveaux européen et national et en assurant leur cohérence. Le CESE invite les États membres qui se montrent peu engagés en faveur de la lutte contre la précarité énergétique dans le cadre de leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat à intensifier leurs efforts au moyen de cadres de suivi et d’évaluation clairs. Il est essentiel d’améliorer la disponibilité d’informations précises, étant donné qu’il n’existe que peu d’éléments probants de qualité sur la manière dont la précarité énergétique devrait être quantifiée et contrôlée. |
4. Lutter contre la précarité énergétique en adoptant des mesures immédiates et à long terme pour évaluer le phénomène et protéger les consommateurs
|
4.1. |
Le CESE invite instamment l’UE à promouvoir une approche commune pour comprendre et combattre la précarité énergétique au niveau européen, qui pourrait déboucher sur une définition commune. Chaque État membre a la possibilité de définir cette précarité selon ses propres critères; l’absence d’approche commune pourrait entraver la capacité de la Commission à évaluer correctement la situation et empêcher les États membres d’avoir une interprétation générale du problème et d’y apporter une réponse coordonnée. La définition avancée dans la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique et les indicateurs établis par l’observatoire européen de la précarité énergétique (11) constituent un début. Compte tenu de l’urgence du problème, le CESE estime que la Commission et les États membres doivent promouvoir une approche commune qui permette une interprétation concrète et partagée de la précarité énergétique et la collecte de données statistiques (12). |
|
4.2. |
Dans le cadre de sa panoplie d’instruments pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie, la Commission a proposé plusieurs mesures immédiates que les États membres pourraient prendre pour atténuer la hausse des coûts de l’énergie pour les consommateurs. Il s’agit notamment de plafonds sur les prix, de réductions fiscales et de subventions en faveur des consommateurs et des entreprises, ainsi que de mesures sociales, telles que des prestations sociales spécifiques et des reports temporaires de paiement des factures d’énergie, compte tenu de la situation et des besoins des personnes vulnérables comme les personnes handicapées, les parents isolés et les familles nombreuses. En février 2022, les États membres avaient adopté une grande partie des mesures recommandées par la Commission dans le cadre de sa panoplie d’instruments. Par exemple, dix-huit d’entre eux ont transféré des fonds à des groupes vulnérables et onze ont réduit leur taxation de l’énergie (13). Eu égard à la diversité des situations dans chaque État membre (et au sein de chaque région) et des mesures prises, le nombre de citoyens européens exposés à la précarité énergétique varie d’un État membre à l’autre. |
|
4.3. |
Le CESE invite les États membres à continuer d’adopter des mesures immédiates, le cas échéant, afin de protéger les consommateurs touchés ou menacés par la précarité énergétique, tout en tenant compte des spécificités et des besoins nationaux, régionaux et locaux. S’il n’existe pas de solution universelle, étant donné que les prix de l’énergie fluctuent considérablement au sein de l’UE, notamment parce que les États membres interviennent aujourd’hui de manière très différente sur les marchés (par exemple, avec des droits et taxes, des exonérations ou des charges qui ne touchent souvent que certains consommateurs) (14), ces derniers doivent veiller à ce que les plus vulnérables ne soient pas privés de soutien. Une aide financière directe et des politiques sociales devraient être mises en place pour atténuer les effets négatifs des hausses de prix sur les groupes les plus vulnérables. |
|
4.4. |
L’aide directe aux personnes dans le besoin doit être ciblée et non uniforme. Elle doit refléter une dimension sociale et ne pas entraver la transition écologique. Une subvention limitée dans le temps (par exemple, pour les 300 premiers kWh d’électricité par personne dans un ménage), octroyée en deçà d’un plafond de revenus à définir, pourrait être envisagée. L’aide directe devrait également être accordée, en deçà d’un plafond de revenus à déterminer, pour autant qu’aucune autre solution abordable ne soit disponible dans la situation en question (15). |
|
4.5. |
En outre, les États membres devraient inciter davantage les consommateurs à réduire leur consommation d’énergie et à rénover de manière intelligente et durable aux niveaux national, régional et local, afin de garantir l’efficacité énergétique et de faire baisser leurs factures d’énergie. La Commission devrait encourager l’adoption de telles mesures. Celles-ci doivent être envisagées à titre complémentaire car elles ne peuvent remplacer le soutien financier et social qui doit servir de filet de sécurité immédiat lorsque les consommateurs sont gravement affectés, de manière momentanée, par la volatilité des prix. |
|
4.6. |
Des formations, des conseils et des consultations relatifs à l’énergie, largement disponibles et abordables au niveau local (par exemple par l’intermédiaire de guichets uniques), et soutenus par des subventions pourraient constituer d’autres mesures bénéfiques. Les passeports de rénovation des bâtiments (16), les passeports énergétiques et les compteurs intelligents peuvent également aider les consommateurs dans ce sens, y compris les propriétaires et les locataires de bâtiments. Les conseils en matière d’énergie doivent être adaptés aux besoins des consommateurs, étant donné que les solutions varient en fonction de chaque situation. Les organisations de consommateurs et les collectivités locales et régionales en particulier devraient être associées au processus d’élaboration des mesures et d’information des consommateurs. |
|
4.7. |
Étant donné que la précarité énergétique relève de la pauvreté au sens large, il est essentiel que la Commission et les États membres continuent de travailler sur la réduction de la pauvreté dans son ensemble, en accordant une attention particulière à la population déjà en situation de précarité énergétique et aux personnes qui risquent de tomber dans la pauvreté en raison de leur incapacité à suivre l’augmentation des prix de l’énergie. Cette crise rappelle qu’il convient constamment d’améliorer l’accès à l’emploi, d’assurer l’inclusion sociale et un niveau de vie décent, en accordant une attention particulière aux personnes vivant dans les zones rurales et isolées, et de soutenir la croissance économique des États membres de manière plus générale. Il est nécessaire de changer de vision afin d’améliorer les infrastructures d’intérêt général, les services essentiels et les transports. Il convient de soutenir l’emploi et les PME, en particulier dans les zones défavorisées et rurales. |
|
4.8. |
Les processus d’examen par les pairs dans les États membres et les échanges de bonnes pratiques peuvent déboucher, dans les secteurs social et énergétique, sur des projets fructueux pouvant être diffusés dans l’ensemble de l’Union. Il peut notamment s’agir de projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, de la connaissance des enjeux énergétiques et de l’énergie propre (pour fournir aux citoyens des énergies renouvelables), mais aussi de mesures sociales susceptibles de réduire les factures énergétiques et la pauvreté en général. |
5. Lutter contre la précarité énergétique en investissant dans une énergie équitable et efficace
|
5.1. |
Le CESE souligne l’importance d’investir dans une énergie équitable et efficace afin de réduire la précarité énergétique à long terme. Il est nécessaire d’investir dans le développement d’énergies renouvelables propres et dans la rénovation massive des bâtiments au sein de l’Union européenne, compte tenu du sous-investissement structurel de longue date dans ce domaine et des conséquences climatiques, environnementales, économiques et sociales qui en découlent. Ces rénovations auront également des effets positifs sur l’économie en matière de création d’emplois et d’innovation, et profiteront donc aux citoyens de l’UE à court, moyen et long termes. |
|
5.2. |
Le CESE se félicite de la proposition de créer un Fonds social européen pour le climat afin de relever les défis sociaux et distributifs découlant de la transition écologique (qui est essentielle pour lutter contre le changement climatique) et d’encourager l’adoption de mesures visant à atténuer les conséquences sociales de l’échange de quotas d’émission pour les secteurs du bâtiment et du transport routier. Toutefois, le CESE constate que ce Fonds à lui seul peut ne pas suffire pour répondre à toutes les exigences en matière d’efficacité énergétique et de transition, et qu’il pourrait être renforcé par des interventions pertinentes dans le cadre d’accords de partenariat nationaux et de plans pour la reprise et la résilience. |
|
5.3. |
Il est possible de réduire la précarité énergétique en facilitant les investissements et en orientant les financements vers les énergies renouvelables. La Commission devrait collaborer étroitement avec les États membres afin d’évaluer si le budget disponible répond aux besoins et aux demandes et de recenser les options qui permettraient de continuer à aider les États membres (y compris la proposition soutenue par plusieurs membres du Parlement européen (17) et par le CESE concernant un nouveau fonds d’ajustement climatique qui pourrait renforcer la capacité de l’UE à aider ses États membres à réagir rapidement aux urgences climatiques, environnementales et énergétiques). Elle devrait tenir compte de la reprise économique et de la nécessité de protéger le développement durable des finances publiques dans les États membres et dans l’UE. |
|
5.4. |
Le nouveau cadre financier pluriannuel et l’instrument de relance NextGenerationEU devraient continuer d’être utilisés pour lutter contre la précarité énergétique dans la période de l’après-COVID-19. Le CESE note que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a renforcé la nécessité pour l’UE d’assurer une transition rapide vers une énergie propre afin de devenir indépendante des importations de combustibles fossiles, d’accroître la résilience de son système énergétique et de garantir à tous ses citoyens un accès à une énergie équitable et efficace, tout en réalisant ses objectifs climatiques. Le CESE souligne que la guerre en Ukraine et le contexte géopolitique actuel ne devraient pas conduire l’UE à négliger sa mission consistant à atteindre les objectifs environnementaux et sociaux, qui sont à la base du renforcement de sa puissance économique sur le long terme. |
|
5.5. |
L’UE et les États membres doivent veiller à ce que les fonds disponibles soutiennent des investissements à grande échelle dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la rénovation des bâtiments, ainsi que dans des subventions à l’isolation des logements, des logements sociaux abordables et économes en énergie, et des projets de logement collectif. Il est clair que d’importants investissements privés sont nécessaires, ce qui requiert un environnement réglementaire et d’investissement encourageant. Les États membres, en collaboration avec les collectivités locales et régionales, devraient donner la priorité à des rénovations en profondeur qui permettraient de réaliser plus de 60 % d’économies d’énergie (18), et soutenir la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. |
|
5.6. |
Le Fonds de cohésion et le mécanisme pour une transition juste pourraient fournir des ressources aux régions et aux populations les plus touchées par la transition vers une énergie propre. La Commission européenne devrait également continuer à financer des projets relatifs à la précarité énergétique dans le cadre d’Horizon Europe et du sous-programme «Transition vers l’énergie propre» de LIFE. Par exemple, le financement de la recherche au titre d’Horizon Europe pourrait servir à créer des dispositifs et des technologies abordables permettant de réduire la consommation énergétique des ménages. La Commission et les États membres devraient, grâce aux fonds de l’UE, encourager les entreprises et les sociétés privées à mettre au point des innovations et des technologies adéquates en faveur de l’efficacité énergétique. |
|
5.7. |
Le CESE invite la Commission et les États membres à s’assurer que la stratégie pour une vague de rénovations est mise en œuvre de manière à soutenir les groupes aux revenus les plus faibles, en veillant à ce que les personnes vulnérables disposent de fonds pour investir dans l’efficacité énergétique, en donnant la priorité aux bâtiments les moins performants et en luttant ainsi contre l’exclusion en matière de logement. Il faudrait prévoir une augmentation substantielle des financements européens, notamment en faveur des acteurs de terrain, afin de rénover les bâtiments et de produire de l’énergie renouvelable de manière décentralisée. Les ménages vulnérables déjà en situation de pauvreté ou exposés au risque de précarité énergétique devraient en être les bénéficiaires prioritaires. Il convient pour cela de dégager des ressources suffisantes au titre du Fonds social pour le climat, de manière à compenser l’extension du système d’échange de quotas d’émission. Les États membres devraient en outre intensifier leurs investissements dans les énergies renouvelables et dans l’efficacité énergétique. Avec des coûts variables proches de zéro, des énergies renouvelables telles que les énergies éolienne et solaire pourraient, par exemple, entraîner une baisse des prix du marché de gros (19). |
|
5.8. |
La reconversion et le perfectionnement professionnels joueront un rôle important dans la transition écologique, la vague de rénovations et l’efficacité énergétique. Afin d’élaborer des stratégies concrètes de suivi et d’anticipation des besoins en matière de compétences, de perfectionnement et de reconversion des travailleurs des secteurs affectés, le CESE attire l’attention sur les résultats des projets des partenaires sociaux dans ce domaine (20). |
|
5.9. |
Le secteur privé a également un rôle essentiel à jouer dans la promotion de l’esprit d’entreprise et des investissements nécessaires, notamment pour favoriser le développement de compétences vertes pour accélérer la transition écologique et de réduire la précarité énergétique. Il convient d’accroître de manière significative les partenariats public-privé et le financement de la recherche et du développement, ainsi que l’assistance technique aux PME afin de respecter les normes environnementales telles que les audits énergétiques. Les États membres devraient également échanger de bonnes pratiques en vue d’encourager leur diffusion. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211105-1
(2) Source de l’ensemble de données: prc_hicp_manr.
(3) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Energy_production_and_imports
(4) REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable (8 mars 2022).
(5) La Commission a reconnu l’incidence négative des prix élevés de l’énergie sur l’économie, y compris sur la compétitivité des entreprises. Selon les estimations de la Banque centrale européenne (avant l’invasion russe), les chocs sur les prix de l’énergie réduiraient la croissance du PIB d’environ un demi-point de pourcentage en 2022. Voir REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable (8 mars 2022).
(6) Statistiques de l’UE sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC 2020), basées sur des variables relatives à la capacité déclarée des personnes à chauffer correctement leur logement, à la présence de mauvaises conditions de logement et à des arriérés de factures énergétiques. Ces données ont montré que, si la précarité énergétique existe dans l’ensemble de l’UE, elle est particulièrement répandue dans les États d’Europe orientale et méridionale.
(7) L’article 2, paragraphe 49, de la proposition de refonte de la directive relative à l’efficacité énergétique définit la précarité énergétique comme suit: «pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes.»
(8) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_1511
(9) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022D0589
(10) COM(2020) 662 final.
(11) https://energy-poverty.ec.europa.eu/observing-energy-poverty/national-indicators_en
(12) Par exemple, lors des négociations au Parlement européen sur la proposition de Fonds social pour le climat, il a été proposé de définir la précarité énergétique comme «la précarité touchant les ménages se trouvant dans les déciles de revenu les plus bas et dont les coûts d’énergie excèdent le double du ratio médian entre les coûts d’énergie et le revenu disponible, après déduction des coûts de logement».
(13) Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra et Georg Zachmann. National fiscal policy responses to the energy crisis Bruegel, le 8 février 2022.
(14) Avis du CESE sur les prix de l’énergie (JO C 275, du 18.7.2022, p. 80).
(15) Avis du CESE sur les prix de l’énergie (JO C 275, du 18.7.2022, p. 90).
(16) https://www.bpie.eu/publication/renovation-passports/
(17) Regional development MEPs suggest to set-up a Climate Change Adaptation Fund (Développement régional: des députés européens suggèrent de mettre en place un fonds d’adaptation au changement climatique) | Actualité | Parlement européen (europa.eu).
(18) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0786&from=FR
(19) On estime que l’augmentation de l’électricité produite à partir de sources renouvelables a été responsable, toutes choses égales par ailleurs, d’une baisse de 24 % des prix au comptant de l’électricité en Allemagne entre 2008 et 2015 et de 35 % en Suède entre 2010 et 2015 (Hirth, 2018).
(20) Avis du CESE sur les prix de l’énergie (JO C 275 du 18.7.2022, p. 80).
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/95 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Le dialogue social dans le cadre de la transition écologique»
(avis exploratoire à la demande de la présidence tchèque)
(2022/C 486/14)
|
Rapporteure: |
Lucie STUDNIČNÁ |
|
Consultation |
Présidence tchèque du Conseil, 26.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Agriculture, développement rural et environnement» |
|
Adoption en section |
5.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
162/1/7 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Répondre à l’urgence climatique est devenu une priorité politique absolue. Le modèle économique mis en place depuis la révolution industrielle doit être revu de fond en comble. La transformation colossale vers une économique circulaire numérisée et neutre pour le climat nécessite des efforts d’adaptation considérables. L’agression de la Russie contre l’Ukraine n’a fait que renforcer la nécessité de cette transition, tout en imposant à la société d’énormes coûts et contraintes. |
|
1.2. |
En tant que partie intégrante du modèle social européen et source de compétitivité en Europe, le dialogue social doit avoir un sens à tous les niveaux, c’est-à-dire aux échelons européen, national, sectoriel, régional ainsi qu’au niveau du lieu de travail. Les États membres devraient reconnaître l’intérêt du dialogue social, la valeur ajoutée qu’il représente et le rôle important qu’il joue dans le processus décisionnel. Le CESE fait valoir que le dialogue social doit être renforcé et encouragé activement. Cela signifie également que les partenaires sociaux doivent être dotés des compétences adéquates et avoir accès au soutien d’experts. |
|
1.3. |
Par conséquent, une forte participation des syndicats et des fédérations patronales grâce à un dialogue social solide et à l’engagement de la société civile doit faire partie intégrante de l’ensemble du cadre d’action pour le climat. Les États membres doivent redoubler d’efforts sur le plan de l’engagement et s’agissant de garantir qu’ils obtiennent le soutien des travailleurs dans la transition vers une société durable. Et cette démarche ne concerne pas seulement les États membres, mais aussi les institutions de l’UE. |
|
1.4. |
Les syndicats jouent un rôle essentiel pour ce qui est de préparer les travailleurs au processus de transformation sociale et écologique et de les représenter au cours de ce processus. Dès lors, il convient de garantir un dialogue social actif et cohérent afin que l’action pour le climat produise des résultats pour les travailleurs, rende la transition équitable et ne laisse personne de côté. |
|
1.5. |
Le dialogue social doit s’accompagner d’un dialogue civil continu et solide, en particulier avec la société civile organisée, et d’un engagement des parties prenantes. Pour mener à bien une transition juste vers une économie à zéro émission nette, il importe de construire des sociétés plus équitables, d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les problèmes d’adaptation qui sont inhérents à la transition écologique. Les organisations de la société civile représentent des millions de personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que celles qui sont systématiquement exclues. Elles constituent donc une voix qui, de par son importance, doit être prise en compte dans les décisions relatives à la transition. Une coopération étroite avec le Comité des régions sur cette question permettrait d’intégrer en plus la dimension régionale. |
|
1.6. |
Il importe au plus haut point d’accorder la priorité à la justice sociale et à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. En outre, l’UE doit également promouvoir et soutenir activement la négociation collective afin que les travailleurs puissent contribuer à donner forme à des lieux de travail durables ainsi qu’à des emplois verts, compétitifs et décents. Ce faisant, l’Union deviendra non seulement plus équitable et égalitaire, mais renforcera également sa compétitivité et sa résilience. |
|
1.7. |
Il est essentiel que tous les emplois créés grâce à la transition respectent la déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui comprennent le droit à un emploi décent, la liberté d’association et de négociation collective, l’absence de discrimination, l’absence de travail forcé et de travail des enfants, ainsi que l’élimination de la violence et du harcèlement au travail. |
|
1.8. |
Le CESE propose que soit réalisée une cartographie systématique du fonctionnement du dialogue social au niveau des États membres. Par ailleurs, des études comparatives supplémentaires sont nécessaires pour étudier le rôle du dialogue social dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, comme dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience (PNRR). |
|
1.9. |
Dans le cadre de l’effort global visant à renforcer la dimension sociale du pacte vert pour l’Europe, les structures de dialogue social doivent être activement soutenues et renforcées par des mesures incitatives et des financements, en accordant une attention particulière aux États membres et aux secteurs où ces institutions sont faibles. |
|
1.10. |
Conformément à la recommandation non contraignante du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, le CESE souligne qu’il convient de fournir aux États membres des orientations sur la manière de faire face aux effets sociaux et sur l’emploi de la transition. Il y aurait lieu de tenir compte des propositions, notamment celle formulée par le CESE dans son avis intitulé «Ajustement à l’objectif 55»: atteindre l’objectif climatique de l’UE à l’horizon 2030 sur la voie de la neutralité climatique» (1), qui consiste à encourager les États membres à créer «des commissions chargées de la transition juste». |
|
1.11. |
Le CESE souligne qu’il importe de fournir des informations et d’opérer des consultations en temps utile au cours du processus de restructuration. Conformément à la directive sur les droits de consultation et de participation (2), il convient de renforcer les droits des travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation à tous les niveaux de l’administration — européen, national comme local. Il convient d’éviter la prise de décisions sans consultation et de rendre obligatoire la fourniture d’informations à l’avance. |
2. Observations générales
Contexte
|
2.1. |
Le présent avis exploratoire a été demandé par la présidence tchèque de l’Union européenne dans le cadre de l’évaluation de la dimension sociale du pacte vert pour l’Europe, et en particulier du rôle à jouer par le dialogue social. |
|
2.2. |
Répondre à l’urgence climatique est devenu une priorité politique absolue. C’est la totalité du système de production et de consommation qui a besoin d’être remanié de fond en comble. Si cette transformation vers une économie circulaire neutre pour le climat et numérisée comporte des avantages indéniables, elle implique toutefois des efforts d’adaptation et des coûts considérables pour la société. |
|
2.3. |
Cette restructuration fondamentale que nos économies doivent traverser en quelques décennies pour atteindre la neutralité carbone est un processus politique qui aura des effets disparates sur les personnes, en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques, ainsi que sur les entreprises, en particulier les PME. Les décideurs politiques ont une grande responsabilité à cet égard. |
|
2.4. |
Le changement climatique induit sans nul doute de nouvelles inégalités, et les mesures d’atténuation et d’adaptation, si elles sont appliquées sans être adossées à des politiques de transition, sont susceptibles de générer des gagnants et des perdants. Ce fait a été pris en compte dès l’annonce du pacte vert pour l’Europe en 2019, avec la mise en avant d’engagements visant à «ne laisser personne de côté». |
|
2.5. |
Deux événements extraordinaires sont venus compliquer encore davantage le processus de transition en cours: la crise de la COVID-19 et le changement fondamental de la situation géopolitique de l’Europe induit par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Ces deux facteurs ont augmenté les charges pesant sur la société à court terme, tout en contribuant à accélérer la transformation. |
Le dialogue social
|
2.6. |
Au cours des dernières décennies, les importantes mutations qui ont touché les moyens de production ont été bien souvent à l’origine de problèmes d’adaptation ou de transition, en particulier lorsque ces changements ont fait apparaître des emplois précarisés et faiblement rémunérés, en excluant du travail décent une partie non négligeable de la population, notamment des femmes et des personnes appartenant aux communautés vulnérables. Par conséquent, si l’on souhaite faire advenir une économie juste, dans laquelle la pauvreté est éradiquée, il est nécessaire de s’attaquer à un certain nombre de problèmes liés à la transition, tels que les formes d’emploi précaires, la privatisation et la restructuration. Cette problématique est également abordée dans la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, adoptée lors du Conseil «Affaires sociales» du 16 juin 2022. |
|
2.7. |
La promotion du dialogue social est consacrée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’initiative «Un nouveau départ pour le dialogue social» (2016) a reconnu l’importance de ce dialogue pour la reprise et la compétitivité. Plusieurs avis du CESE (3) et une résolution (4) ont récemment souligné l’importance du dialogue social dans les transformations qui y sont liées. |
|
2.8. |
Le dialogue social a également démontré qu’il apporte une contribution positive à la réussite de tout processus de restructuration: les entreprises qui entretiennent un dialogue social performant obtiennent de meilleurs résultats, sont plus compétitives, plus résilientes et versent des salaires plus élevés. |
|
2.9. |
Le CESE souligne que tous les niveaux du dialogue social, à savoir l’échelon européen, national, sectoriel, régional et du lieu de travail, ont des fonctions essentielles mais distinctes pour ce qui est de gérer et de faciliter la transformation écologique. Toutefois, les structures et les institutions à ces niveaux présentent des atouts très variés. |
|
2.10. |
Le dialogue social doit s’accompagner d’un dialogue civil continu et solide, en particulier avec la société civile organisée, et d’un engagement des parties prenantes. Pour mener à bien une transition juste vers une économie à zéro émission nette, il importe de construire des sociétés plus équitables, d’éradiquer la pauvreté et de lutter contre les problèmes d’adaptation qui sont inhérents à la transition écologique. Les organisations de la société civile représentent des millions de personnes en situation de vulnérabilité, ainsi que celles qui sont systématiquement exclues. Elles constituent donc une voix qui, de par son importance, doit être prise en compte dans les décisions relatives à la transition. Une coopération étroite avec le Comité des régions sur cette question permettrait d’intégrer en plus la dimension régionale. |
|
2.11. |
Les institutions et les acteurs du dialogue social ont également des niveaux de capacité et d’influence différents suivant les États membres, ce qui s’explique en partie par la diversité des modèles sociaux et des modèles de relations industrielles dans les différents États membres, mais dans certains cas, les politiques de décentralisation ainsi que les recommandations formulées à la suite de la crise financière et de la crise de la zone euro ont contribué activement à leur affaiblissement. Le CESE souligne que le bon fonctionnement du dialogue social est un élément essentiel de l’économie sociale de marché européenne, et se réjouit du fait que la Commission européenne ait entériné cette réalité, en dernier lieu dans ses recommandations au Conseil. |
|
2.12. |
Dans le cadre de l’effort global visant à renforcer la dimension sociale du pacte vert pour l’Europe, les structures de dialogue social doivent être activement soutenues et renforcées, en accordant une attention particulière aux États membres et aux secteurs où ces institutions sont faibles. |
Une transition juste
|
2.13. |
Une transition juste signifie que la réponse apportée aux effets de la transition vers une économie à zéro émission nette — tant ses répercussions sur l’emploi que ses effets distributifs — doit être considérée comme faisant partie intégrante du cadre d’action en matière de climat (par exemple, le paquet «Ajustement à l’objectif 55») et ne pas seulement consister en des mesures correctives supplémentaires. Ces questions couvrent de nombreuses dimensions telles que les effets distributifs des politiques de décarbonation, les pertes d’emplois et les transitions professionnelles, la protection des droits sociaux fondamentaux et l’inclusion des citoyens et de la société civile organisée dans le processus décisionnel. |
|
2.14. |
Le Fonds pour une transition juste et le Fonds social pour le climat (FSC) proposé dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» figurent parmi les principales mesures annoncées à ce jour par l’Union en vue d’atténuer les effets de la transition sur les régions les plus touchées, les personnes vulnérables et les entreprises. Le CESE se félicite de la proposition de la Commission invitant le Conseil à émettre une recommandation visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, afin de fournir aux États membres des orientations sur la manière de faire face aux effets de la transition sur le plan social et sur l’emploi. |
|
2.15. |
Le test décisif permettant de déterminer «si la transition est juste» doit être l’efficacité avec laquelle seront traités les problèmes d’adaptation des entreprises, des salariés et des citoyens, consistant par exemple à encourager la restructuration des activités des entreprises, le perfectionnement et la reconversion des salariés et la prévention de la précarité en matière d’énergie et de mobilité, afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte, et plus particulièrement la mesure dans laquelle les femmes et les hommes dont les emplois disparaîtront ou seront déclassés ou menacés d’une quelconque manière se verront tendre la main et être assurés d’un avenir utile, épanouissant et sûr dans un emploi de qualité, ainsi qu’aidés à se former pour être capables de remplir ces fonctions. |
|
2.16. |
L’ampleur du défi ne peut être sous-estimée. Elle impliquera l’élaboration d’objectifs économiques et sociaux bien conçus et intégrés à moyen et long terme, en vue d’assurer la productivité et l’inclusion en tenant dûment compte des spécificités des différents États membres, et de garantir la participation des partenaires sociaux aux niveaux national, régional et local à toutes les étapes de l’élaboration des politiques, y compris, le cas échéant, par le dialogue social et la négociation collective. Ces objectifs reposeront sur une réorientation délibérée et consciente des ressources depuis le niveau national et central vers les zones et régions touchées. Outre l’incitation à de nouveaux investissements au moyen de subventions, de prêts et de la mise à disposition d’expertise, ainsi que l’aide apportée au fonctionnement des micro, petites et moyennes entreprises (MPME), il est possible de soutenir les jeunes pousses par l’intermédiaire d’une participation au capital, et de nouvelles entreprises publiques pourraient également être créées. Parallèlement à l’engagement de ressources publiques, il sera nécessaire d’optimiser la flexibilité des règles en matière d’aides d’État, voire de les suspendre dans certaines circonstances. |
|
2.17. |
Il est essentiel que cette restructuration à grande échelle, qui implique la transformation de dizaines de millions d’emplois dans l’ensemble de l’Europe, soit bien gérée et s’effectue de manière équilibrée et prospective. Le bon fonctionnement du dialogue social est fondamental à cet effet. Le Fonds pour une transition juste, destiné à soutenir les travailleurs en transition vers de nouveaux emplois, devrait être élargi, tant sur le plan des ressources que celui du champ d’application, par des mesures ciblées sur des secteurs spécifiques. |
|
2.18. |
Les trois dimensions du développement durable — économique, sociale et environnementale — sont étroitement liées entre elles et doivent être traitées par l’utilisation d’un cadre politique global et cohérent. Les principes directeurs de l’OIT de 2015 sur une transition juste fournissent un ensemble d’outils pratiques permettant aux gouvernements et aux partenaires sociaux de gérer ce processus de transformation. |
|
2.19. |
Ces principes indiquent qu’«il est essentiel de parvenir à un solide consensus social sur l’objectif de la durabilité et les voies à suivre pour le réaliser». Le dialogue social doit faire partie intégrante du cadre institutionnel régissant l’élaboration et la mise en œuvre des politiques à tous les niveaux. Toutes les parties prenantes concernées devraient être consultées dans le cadre d’un processus approprié, permanent et éclairé. |
Le dialogue social dans le cadre de la transition écologique
|
2.20. |
Le dialogue social ne doit pas être réduit à une formalité, mais doit être constructif à tous les niveaux — européen, national, sectoriel, régional et du lieu de travail. Cela signifie également que les partenaires sociaux doivent être dotés des compétences adéquates et avoir accès au soutien d’experts. |
|
2.21. |
Le CESE reconnaît que les institutions de dialogue social présentent un caractère très inégal dans l’ensemble de l’Union, en raison de la diversité des modèles nationaux, des modèles de relations industrielles et des traditions historiques dans les différents États membres. |
|
2.22. |
Le CESE propose que soient mises en place une cartographie et une surveillance systématiques du fonctionnement du dialogue social au niveau des États membres (5). Par ailleurs, des études comparatives supplémentaires sont nécessaires pour assurer le suivi du rôle du dialogue social dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, comme dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience (PNRR). |
|
2.23. |
Le CESE estime que les initiatives existantes visant à relever les défis sociaux liés à la transformation écologique sont restées fragmentées. Le mécanisme pour une transition juste est limité et ne concerne qu’une petite partie du processus de transition. Tel que proposé, le Fonds social pour le climat aura une portée et une finalité limitées et entend, surtout, équilibrer les effets distributifs régressifs du nouveau système d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SEQE2) qu’il est prévu de mettre en place pour les transports et les bâtiments (voir en particulier l’avis du CESE consacré au Fonds social pour le climat (6)). Si le CESE se félicite de la proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, il relève toutefois que cette recommandation non contraignante ne constitue pas la plateforme politique complète dont l’UE a besoin pour faire face aux conséquences de la transition sur les travailleurs, les régions et les personnes vulnérables touchés. |
|
2.24. |
Le CESE fait valoir que l’UE a besoin d’un cadre solide garantissant des conditions de concurrence équitables pour la gestion de la transition. Ce dernier devrait, entre autres, traiter les questions de l’anticipation et de la gestion du changement dans le contexte de la transformation écologique, au moyen d’une participation significative des travailleurs, des entreprises et des citoyens. |
|
2.25. |
Le CESE souligne qu’il importe de fournir des informations et d’opérer des consultations en temps utile au cours du processus de restructuration. Il convient d’éviter la prise de décisions sans consultation et de rendre obligatoire la fourniture d’informations à l’avance. |
|
2.26. |
Le CESE appelle à promouvoir le dialogue social et la participation des parties prenantes à tous les niveaux, et à veiller à ce que les nouveaux emplois verts soient des emplois de qualité, conformément au programme de l’OIT pour un travail décent et au socle européen des droits sociaux. Le CESE souligne, tout en faisant référence à son avis consacré au Fonds social pour le climat, que pour respecter l’esprit de la recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, un véritable Fonds social pour le climat devrait couvrir un éventail plus large des effets distributifs des politiques climatiques, au moyen de mesures ciblées contre la précarité en matière d’énergie et de transport, en soutenant et en facilitant le caractère abordable et l’accessibilité des technologies à faible intensité de carbone pour les ménages à faibles revenus. |
3. Observations particulières
|
3.1. |
Le CESE estime qu’il est essentiel de reconnaître la complémentarité qui existe entre les politiques climatique, environnementale et sociale. La dimension sociale devrait faire partie intégrante d’un cadre d’action global en matière de climat, de sa conception à sa mise en œuvre. Il s’agit notamment de l’ensemble du pacte vert pour l’Europe et de toutes les politiques concrètes de mise en œuvre dans le cadre des trains de mesures «Ajustement à l’objectif 55». |
|
3.2. |
Le CESE reconnaît également que ce processus de restructuration aura des effets considérables sur l’emploi, les relations de travail et la répartition des revenus. Tous les niveaux de la société et de l’économie seront touchés, de l’échelon transnational à celui du lieu de travail, et le dialogue social devrait jouer un rôle clé, de manière prospective, dans la gestion de ce processus. |
|
3.3. |
Si le CESE se félicite du cadre d’action solide et ambitieux en matière de climat que la Commission européenne a mis en place dans le contexte du pacte vert pour l’Europe, cadre d’action soutenu par les mesures législatives connexes, il souligne également que, malgré toutes les déclarations positives, sa dimension sociale reste sous-développée. |
|
3.4. |
La dimension sociale du pacte vert pour l’Europe continue de relever principalement de la compétence des États membres et des partenaires sociaux nationaux, étant donné qu’ils sont les mieux placés pour comprendre la situation et proposer des mesures aux niveaux local, régional et national. Cependant, les défis sociaux et liés à l’emploi de la transition écologique couvrent de nombreuses dimensions, telles que les pertes d’emplois et les transitions professionnelles, la reconversion et le perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre, les effets distributifs des politiques de décarbonation, mais aussi la protection des droits sociaux et la participation des citoyens. C’est pourquoi des mesures et des actions coordonnées au niveau de l’UE doivent accompagner et soutenir l’initiative nationale. Si elles ne sont pas dûment abordées à un niveau approprié, les mesures d’atténuation du changement climatique risquent d’accroître, voire d’exacerber, les inégalités sociales. |
Faire de la transition juste une réalité — exigences en matière de gouvernance/de réglementation pour renforcer le dialogue social
|
3.5. |
Les transitions sur le marché du travail, les plans sociaux et les parcours vers de nouveaux emplois durables et décents assortis d’un engagement à long terme en faveur du développement régional et local sont autant d’éléments essentiels d’une feuille de route pour une transition juste. |
|
3.6. |
Il convient d’encourager la mise en place de programmes de formation adaptés aux besoins individuels et à ceux du marché du travail et dispensés par des centres spéciaux de transition pour l’emploi. Pour ce faire, il faut s’engager dans un dialogue social proactif aux niveaux local et régional, en coopération avec toutes les parties prenantes. Les syndicats et les employeurs devraient agir de concert pour soutenir les programmes de transition professionnelle. |
|
3.7. |
Si le paquet «Ajustement à l’objectif 55» présente un ensemble ambitieux et coordonné de mesures environnementales contraignantes, ses éléments sociaux sont fragmentés, et la proposition de recommandation du Conseil n’a pas d’effet juridique contraignant. |
|
3.8. |
Ces caractéristiques doivent être renforcées et le dialogue social devrait devenir un élément obligatoire des principales politiques nationales mises en place afin d’atteindre les objectifs de la politique climatique à l’horizon 2050, y compris les plans nationaux en matière d’énergie et de climat, les PNRR et les plans pour une transition juste. |
|
3.9. |
Pour que le dialogue social soit fructueux, il importe de développer une confiance mutuelle et une ambition commune d’obtenir des résultats qui apportent une valeur ajoutée à toutes les parties concernées. |
|
3.10. |
Dans certains États membres de l’UE, ce type de dialogue social existe déjà, dans d’autres pas. Dans ce dernier cas, le dialogue social devrait être activement encouragé, par exemple en imposant l’échange en temps utile de certaines informations et en proposant le dialogue social comme un moyen de résoudre diverses questions de droit administratif et du droit du travail, rendant plus aisé l’accès au financement, facilitant les décisions en matière de planification, de permis de construire, etc. Afin de prévenir les abus, ces avantages devraient être liés à une obligation de résultat. |
|
3.11. |
Le CESE est conscient que, dans certains États membres, il s’agira d’un changement de culture et qu’il faudra peut-être un certain temps pour y parvenir. Le CESE est toutefois convaincu que le temps et les efforts investis seront très profitables. |
|
3.12. |
La dimension sociale du pacte vert pour l’Europe doit être liée au socle européen des droits sociaux et prise en compte dans le processus du Semestre européen. |
|
3.13. |
En février 2021, la Commission a publié un rapport (7) sur le renforcement du dialogue social, dont le contenu a été repris dans le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux, présenté en mars 2021. Le plan d’action contient un engagement de la part de la Commission à présenter une initiative visant à soutenir le dialogue social au niveau de l’Union et au niveau national en 2022. Le CESE est fermement convaincu que ces prochaines recommandations de la Commission contribueront fortement à la réalisation de cet objectif. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) JO C 275 du 18.7.2022, p. 101.
(2) JO L 80 du 23.3.2002, p. 29.
(3) Avis du CESE intitulés «La transition industrielle vers une économie européenne verte et numérique: exigences réglementaires et rôle des partenaires sociaux et de la société civile» (JO C 56 du 16.2.2021, p. 10), «Pas de pacte vert sans pacte social» (JO C 341 du 24.8.2021, p. 23), et «Le dialogue social comme pilier important de la durabilité économique et de la résilience des économies, en tenant compte de l’influence du dialogue animé avec la société civile dans les États membres» (JO C 10 du 11.1.2021, p. 14).
(4) Résolution sur les «Propositions du CESE pour la reconstruction et la relance après la crise de la COVID-19: “L’Union européenne doit être guidée par la volonté de se présenter comme une communauté de destin partagé”» sur la base des travaux du sous-comité «Relance et reconstruction après la COVID-19» (JO C 311 du 18.9.2020, p. 1).
(5) Résolution du CESE, (JO C 155 du 30.4.2021, p. 1.); avis du CESE, (JO C 220 du 9.6.2021, p. 38).
(6) JO C 152 du 6.4.2022, p. 158.
(7) Rapport sur le renforcement du dialogue social dans l’UE, élaboré par Andrea Nahles.
ANNEXE
L’amendement suivant, qui a recueilli au moins un quart des suffrages exprimés, a été rejeté au cours des débats:
Paragraphe 2.25
Modifier comme suit:
|
Avis de section |
Amendement |
|
Le CESE souligne qu’il importe de fournir des informations et d’opérer des consultations en temps utile au cours du processus de restructuration. Il convient d’éviter la prise de décisions sans consultation et de rendre obligatoire la fourniture d’informations à l’avance. |
Le CESE souligne qu’il importe de fournir des informations et d’opérer des consultations en temps utile au cours du processus de restructuration. Il convient d’éviter la prise de décisions sans consultation, et la fourniture d’informations à l’avance devrait devenir une pratique courante, conformément à la recommandation du Conseil susmentionnée . |
Résultat du vote
|
(pour/contre/abstentions) |
55/95/0 |
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/102 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Le rôle de l’énergie nucléaire dans la stabilité des prix de l’énergie au sein de l’UE»
(avis exploratoire à la demande de la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne)
(2022/C 486/15)
|
Rapporteure: |
Alena MASTANTUONO |
|
Consultation |
Présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne, lettre datée du 26.1.2022 |
|
Base juridique |
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Avis exploratoire |
|
Décision de l’assemblée plénière |
21.9.2022 |
|
Compétence |
Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
|
Adoption en section |
7.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
143/73/42 (vote par appel nominal — voir annexe II) |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
La stabilité et le caractère abordable des prix de l’énergie sont essentiels pour préserver à la fois le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité et la résilience du tissu industriel européen. Après une décennie de stabilité relative des prix à l’importation de l’énergie et une progression annuelle relativement faible des prix à la production pour le marché intérieur de l’énergie de 0,9 % entre 2010 et 2019, l’Europe connaît une forte hausse des prix de l’énergie depuis le second semestre 2021. La volatilité des prix de l’énergie et l’incertitude des approvisionnements énergétiques ont augmenté en raison de la guerre en Ukraine. |
|
1.2. |
Aujourd’hui, l’Europe est confrontée à un double enjeu: la nécessité de lutter contre le changement climatique et celle de garantir un approvisionnement énergétique stable, à un prix abordable. Comme l’indique la Commission dans son plan REPowerEU, le défi consiste à réduire rapidement notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes en accélérant la transition propre et en unissant nos forces pour parvenir à un système énergétique plus résilient et à une véritable union de l’énergie. La solution comprend trois échéances temporelles. La perspective à court terme vise avant tout à résoudre la situation en matière d’approvisionnement en énergie, étant donné qu’une éventuelle pénurie pourrait exacerber les hausses de prix. Aujourd’hui, la situation du marché est influencée par les facteurs actuels et attendus du côté de l’offre. Il est donc nécessaire d’utiliser toutes les sources d’énergie disponibles dans l’Union européenne, comme le prévoit le plan REPowerEU. Il s’agit d’un scénario de crise dont l’objectif est avant tout de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique. La perspective à moyen terme permet de respecter davantage la viabilité et l’équilibre des sources d’énergie, et la perspective à long terme, pour autant que les risques en matière de sécurité géopolitique soient réduits, consistera à mettre l’accent sur les objectifs écologiques. |
|
1.3. |
Les coûts supplémentaires de sûreté et de sécurité engendrés par la guerre risquent de contribuer de manière substantielle à l’augmentation des prix de l’énergie. À court terme, les centrales nucléaires existantes situées dans les États membres de l’Union qui ont choisi d’inclure l’énergie nucléaire dans leur bouquet énergétique, et dans lesquels cette solution est exploitable techniquement, contribueront à la stabilité de l’approvisionnement énergétique, ce qui influera dans une large mesure sur la stabilité des prix. Sans la capacité nucléaire existante, le choc sur le système énergétique causé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie serait certainement encore plus important. |
|
1.4. |
L’énergie nucléaire, source d’électricité à faibles émissions, est disponible sur demande pour compléter le rôle de premier plan joué par les énergies renouvelables, telles que l’énergie éolienne et solaire, dans la transition vers des systèmes électriques à émissions nulles. Le CESE souligne que le nucléaire, qui fournit une charge de base régulière, peut contribuer en ce moment à la stabilité de l’approvisionnement. Les coûts marginaux de l’énergie nucléaire sont stables et nettement inférieurs à ceux des centrales au gaz et au charbon. Le fonctionnement des centrales nucléaires n’entraîne pas d’émissions significatives de CO2: leurs coûts marginaux n’incluent donc aucun coût du CO2, à l’instar des énergies renouvelables, et ne sont pas affectés par la volatilité de la tarification du carbone comme on a pu le constater en 2021, lorsque le prix du carbone a bondi de plus de 200 %. La volatilité du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union affecte considérablement le prix du gaz et du charbon sur le marché européen. |
|
1.5. |
Du point de vue réglementaire, sur le marché de gros de l’Union, les prix de l’électricité sont déterminés par l’ordre de préséance et par la centrale qui figure au dernier rang de ce classement. Le plus souvent, lorsque le marché se comporte normalement, ce sont les centrales au gaz ou au charbon qui déterminent les prix sur les marchés au comptant. Ainsi, à moins que le bouquet énergétique ne comprenne une large part de sources à faibles émissions, l’énergie nucléaire n’influence pas les prix de l’énergie sur les marchés au comptant, lesquels ne représentent néanmoins qu’une partie des ventes réalisées sur le marché. Les entreprises énergétiques proposent souvent une fourniture physique d’électricité sur la base de contrats bilatéraux. Dans ce cas, les différents modèles de financement et de contrats bilatéraux utilisés dans les États membres de l’Union dont le bouquet énergétique comporte de l’énergie nucléaire contribuent à stabiliser les prix de l’énergie pour le client. |
|
1.6. |
La crise énergétique actuelle a perturbé le fonctionnement du marché de l’électricité de l’Union en faussant les principes qui le régissent, du fait des nombreuses interventions visant à atténuer le niveau élevé des prix de l’énergie ou à réduire sensiblement la demande. Cette situation montre bien l’importante corrélation qui unit la réduction de l’offre et l’augmentation de la demande, et qui fait grimper les prix de l’énergie. Un approvisionnement plus fiable, issu de sources d’énergie stables, à faible intensité de carbone, réduira la volatilité des prix de l’énergie et, grâce à l’interconnexion des marchés nationaux de l’énergie, toute l’Union pourra profiter de ces avantages. |
|
1.7. |
Le CESE estime que prolonger la durée de vie du parc de centrales nucléaires existant se justifie dans ce contexte particulier et favorisera, dans le même temps, la transition vers une économie neutre en carbone. Cette solution pourrait permettre de répondre aux attentes actuelles en matière d’approvisionnement énergétique, de diminuer la consommation de gaz dans le secteur de l’électricité, et ainsi de réduire le risque de pénurie de gaz. Elle pourrait aussi contribuer à atténuer la volatilité inédite des prix liée à des facteurs non économiques et à répondre aux attentes actuelles en matière d’approvisionnement énergétique. Le Comité recommande aux États membres de travailler sur des solutions pour les capacités de stockage et de renforcer les interconnexions de transport afin de réagir efficacement aux indisponibilités d’énergies renouvelables à long terme, et de gaz à court terme. |
|
1.8. |
Le CESE propose que la présidence tchèque discute, au sein du Forum européen de l’énergie nucléaire (FEEN), de la stabilité des prix dans le secteur nucléaire et du rôle de l’énergie nucléaire pour stabiliser les approvisionnements face à la réduction de la dépendance de l’Union à l’égard du gaz russe. Le CESE voudrait être étroitement associé à ce débat. |
|
1.9. |
Le Comité suggère de renforcer la coopération bilatérale avec les partenaires internationaux portant sur le secteur nucléaire afin de partager les conclusions en matière d’innovation et de progrès dans le domaine des nouvelles technologies. Le CESE recommande que la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne organise une conférence sur les petits réacteurs modulaires, qui pourrait prendre la forme d’un forum de haut niveau UE — États-Unis consacré à ce type de réacteurs et approfondir ces recherches prometteuses. |
2. Contexte et notes explicatives
|
2.1. |
L’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) constitue la base juridique de la politique énergétique de l’Union. Des dispositions spécifiques figurent dans d’autres articles du TFUE tels que l’article 122 (sécurité d’approvisionnement), les articles 170 à 172 (réseaux énergétiques), l’article 114 (marché intérieur de l’énergie) et les articles 216 à 218 (politique extérieure de l’énergie). Le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité Euratom) constitue la base juridique de la plupart des actions de l’Union dans le domaine de l’énergie nucléaire. |
|
2.2. |
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne garantit également aux États membres leur droit de déterminer les conditions d’exploitation de leurs ressources énergétiques, leur choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de leur approvisionnement énergétique (1). |
|
2.3. |
Le dessein de l’Union européenne de devenir le premier continent neutre pour le climat en 2050 nécessite une transition énergétique vers des sources d’énergie à émissions nulles et à faibles émissions. Il est impossible de continuer à accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique sans une réserve fournie par des sources d’énergie actuellement stables dont nous disposons, telles que l’énergie fossile ou nucléaire, et nous devons par ailleurs investir dans des centrales au gaz vert (non fossile) afin de faire face aux fluctuations d’énergies renouvelables. Il est en outre absolument nécessaire de disposer de capacités de stockage afin d’éviter les pannes généralisées d’électricité et de répondre à l’essor de la consommation d’énergie induite par l’électrification. Parmi les sources d’énergie stables actuellement disponibles, l’énergie nucléaire offre la seule source à faibles émissions qui permettrait de réduire la dépendance à l’égard du gaz russe. |
|
2.4. |
Avec une capacité de 413 gigawatts (GW), l’énergie nucléaire, exploitée dans 32 pays, contribue à la décarbonation et diminue la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles: tous les ans, à l’échelle mondiale, elle permet ainsi d’éviter 1,5 gigatonne (Gt) d’émissions et de réduire la demande de gaz de 180 milliards de mètres cubes (2). L’énergie nucléaire, source d’électricité à faibles émissions, est disponible sur demande pour compléter le rôle de premier plan joué par les énergies renouvelables volatiles, telles que l’énergie éolienne et solaire, dans la transition vers des systèmes électriques à émissions nulles. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit un doublement de la capacité mondiale de production nucléaire à l’horizon 2050 et estime qu’un recul de l’énergie nucléaire compliquerait la réalisation des ambitions en matière d’émissions nulles et en augmenterait le coût. |
|
2.5. |
Le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission (3) reconnaît que l’énergie nucléaire peut potentiellement contribuer à la décarbonation de l’économie de l’Union et considère l’énergie nucléaire comme une activité à faible intensité de carbone. Le rapport final du groupe d’experts techniques sur la finance durable, publié en mars 2020 (4), indiquait que «la production d’énergie nucléaire n’émet presque aucune émission de gaz à effet de serre au cours de la phase de production d’énergie» et que «les preuves de la contribution substantielle que pourrait apporter l’énergie nucléaire aux objectifs d’atténuation du changement climatique étaient nombreuses et claires». La taxinomie prévoit des exigences supplémentaires et plus contraignantes en matière d’élimination des déchets, de financement et de planification du déclassement. |
|
2.6. |
La stabilité et le caractère abordable des prix de l’énergie sont essentiels pour préserver à la fois le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité et la résilience du tissu industriel européen. Après la stabilité relative des prix à l’importation de l’énergie au cours de la dernière décennie (à l’exception de la baisse de 31 % enregistrée en 2020) et la progression annuelle relativement faible des prix à la production pour le marché intérieur de l’énergie de 0,9 % entre 2010 et 2019 (en 2020, les prix à la production de l’énergie ont chuté de près de 10 %), l’Europe connaît une forte hausse des prix de l’énergie depuis l’automne 2021 (5). |
|
2.7. |
Pour la première fois de son histoire, l’Union européenne est confrontée à plusieurs risques graves concernant son approvisionnement en énergie, sa sécurité énergétique et la montée en flèche des prix de l’énergie. Cette situation est notamment due au fait que certains États membres n’ont pas été prudents ou ont cédé aux pressions extérieures, et ont réduit trop rapidement toutes les ressources de secours, alors que l’ingérence étrangère a certainement joué un rôle à cet égard. |
|
2.8. |
Des évolutions fébriles et erratiques des prix de l’énergie se sont manifestées dès avant la guerre, depuis l’automne 2021, en raison de plusieurs ruptures d’approvisionnement et de l’augmentation mondiale de la demande de gaz. La hausse inhabituelle des prix de l’énergie depuis l’automne dernier est provoquée par la forte augmentation mondiale de la demande de gaz, elle-même causée par plusieurs facteurs clés: la montée en puissance de la reprise économique, la compression de l’approvisionnement de l’Union européenne, le manque d’investissements et des conditions météorologiques défavorables qui ont entraîné une baisse de la production des énergies renouvelables. Dans certains cas, la spéculation a amené à vider les installations de stockage de gaz (6). La volatilité actuelle des prix de l’énergie est principalement due aux effets de l’agression russe contre l’Ukraine, à l’incertitude quant à une éventuelle escalade dans d’autres pays et aux efforts déployés pour réduire le plus rapidement possible la dépendance énergétique de l’Union à l’égard de la Russie. |
|
2.9. |
Les coûts supplémentaires de sûreté et de sécurité engendrés par la guerre risquent de contribuer de manière substantielle à l’augmentation des prix de l’énergie. La prochaine période de diversification de l’apport énergétique de l’Union, marquée par des investissements massifs dans de nouvelles infrastructures (telles que des terminaux GNL, des hydrogénoducs) et des modifications du réseau de distribution d’énergie existant, pourrait s’accompagner d’une hausse supplémentaire des prix. Par ailleurs, la situation est aggravée par une importante diminution de la production nucléaire, qui devrait reculer de 12 % (soit plus de 100 TWh) en 2022. Dans son rapport de juillet 2022 sur le marché de l’électricité, l’Agence internationale de l’énergie estime que ce déclin est dû à une moindre disponibilité temporaire des centrales en France, au déclassement de 4 GW d’énergie nucléaire en Allemagne et aux conséquences que l’invasion de la Russie entraîne pour les centrales nucléaires ukrainiennes. |
|
2.10. |
Dans les circonstances actuelles, et au moins jusqu’à ce que la transition énergétique fondamentale de l’Union ait progressé, l’utilisation des sources d’énergie existantes disponibles sur l’ensemble du territoire de l’Union et utilisables immédiatement sans entrave et au sein d’infrastructures déjà installées constitue la priorité absolue. Dans le même temps, la réduction des fournitures russes de produits énergétiques de base est bien engagée, ce qui inclut le risque de limitations des livraisons de barres de combustible destinées aux centrales nucléaires, et la garantie d’un approvisionnement énergétique stable pour tous les Européens devient dès lors un défi pour ce qui est du respect des objectifs climatiques. |
|
2.11. |
Dans une certaine mesure, l’énergie nucléaire permet d’adapter la production d’électricité en fonction de la quantité d’électricité produite à partir de sources renouvelables. Les centrales nucléaires offrent moins de souplesse que le gaz, mais elles apportent un élément de stabilité au système en contribuant de manière significative à la charge énergétique de base, et la réglementation en vigueur dans certains États membres de l’Union admet des régimes flexibles pour l’exploitation des centrales nucléaires. |
|
2.12. |
Les sources nucléaires existantes sont en mesure de satisfaire immédiatement l’augmentation de la demande d’électricité et se caractérisent par de faibles coûts d’exploitation. On ne saurait nier que les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite à partir des sources nucléaires sont plutôt élevés, et ce notamment en raison des investissements considérables nécessaires pour respecter des normes de sécurité très strictes. Cependant, pour ce qui est du gaz, les coûts moyens actualisés sont encore plus élevés (7). Dans le même temps, et dans l’attente de trouver d’autres sources d’approvisionnement, nous n’avons aucune certitude que nous continuerons à être approvisionnés en gaz ou barres de combustibles russes compte tenu de la guerre qui sévit en Ukraine. |
|
2.13. |
Parmi les technologies modulables à faible intensité de carbone, le nucléaire offre la solution dont les coûts estimés à l’horizon 2025 devraient être les plus bas. Seuls les grands réservoirs hydroélectriques pourraient apporter une contribution similaire à des coûts comparables, mais ils restent fortement tributaires des conditions naturelles de chaque pays. Comparativement à la production issue de combustibles fossiles, les centrales nucléaires devraient être plus abordables que les centrales au charbon. Si, dans certaines régions, les turbines à gaz à cycle combiné (TGCC) sont concurrentielles, les coûts moyens actualisés de l’énergie (LCOE) qu’elles produisent dépendent fortement des prix du gaz naturel et des émissions de carbone dans chaque région. L’électricité obtenue grâce à l’exploitation à long terme d’installations nucléaires dont on prolonge la durée de vie est hautement compétitive. Cette solution reste l’option la moins coûteuse, non seulement en matière de production à faible intensité de carbone — par rapport à la construction de nouvelles centrales électriques — mais aussi globalement, pour l’ensemble de la production d’électricité (8). |
|
2.14. |
À l’instar des sources renouvelables, les coûts d’exploitation de l’énergie nucléaire sont faibles. Les coûts variables sont pratiquement indépendants du marché mondial des matières premières énergétiques. De ce fait, les centrales nucléaires présentent leurs offres sur le marché de l’électricité à un prix stable. Le prix des combustibles et la tarification du carbone ont généralement la plus forte incidence sur les coûts de production d’électricité. Ces coûts variables ou marginaux diffèrent considérablement d’une technologie à l’autre. Le coût marginal des centrales nucléaires dépend du prix du combustible nucléaire, qui est nettement inférieur à celui du gaz ou du charbon. La production nucléaire étant substantielle, le prix du combustible peut être réparti sur un volume de production important, une grande quantité de MWh. Étant donné que les centrales nucléaires n’émettent pas de CO2, leurs coûts marginaux n’incluent aucun coût lié aux quotas d’émissions de CO2, à l’instar des énergies renouvelables. |
|
2.15. |
Du point de vue réglementaire, sur le marché de gros de l’Union, les prix de l’électricité sont déterminés par l’ordre de préséance et par la centrale qui figure au dernier rang de ce classement. Le plus souvent, lorsque le marché se comporte normalement, ce sont les centrales au gaz ou au charbon qui déterminent les prix sur les marchés au comptant. Ainsi, l’énergie nucléaire n’influence pas les prix de l’énergie sur les marchés au comptant, à moins que le bouquet énergétique ne comprenne une large part de sources à faibles émissions, laquelle configuration est appelée à devenir le nouveau modèle européen. À l’heure actuelle, le modèle de marché standard a été bouleversé par le choc qui a touché l’offre, notamment dans le cas du gaz, lequel doit être associé aux autres sources disponibles pour contribuer à l’équilibre du marché et à la stabilité des prix, ainsi que par des mesures réglementaires telles que la réduction de la demande dans l’ensemble de l’Union (9). |
|
2.16. |
Néanmoins, les marchés au comptant ne représentent qu’une partie des ventes réalisées sur le marché. Les entreprises énergétiques proposent souvent une fourniture physique d’électricité sur la base de contrats bilatéraux. Dans ce cas, les différents modèles de financement et de contrats bilatéraux utilisés dans les États membres de l’Union dont le bouquet énergétique comporte de l’énergie nucléaire contribuent à stabiliser les prix de l’énergie pour le client, sans forcément les faire baisser. Il nous faut aussi distinguer les différentes catégories du marché de l’électricité (marché de gros ou de détail). Au sein de l’Union, les marchés de détail sont tributaires de nombreux facteurs, dont le niveau de concurrence, mais aussi de facteurs qui déterminent le prix final. Le prix que paient les ménages européens pour leur électricité comprend des taxes et des prélèvements, dont la proportion s’élève en moyenne à 36 % d’après Eurostat. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Le CESE est bien conscient et tient compte de la gravité de la situation. Eu égard aux circonstances actuelles, dans le cadre de la gestion des crises et des situations d’urgence, des livraisons d’énergie fiables à un prix acceptable permettent de survivre. C’est pourquoi toute source disponible qui peut être fiable devrait être utilisée non seulement pour répondre à la demande, mais aussi pour contribuer à la stabilité des prix pendant cette période très incertaine. |
|
3.2. |
Le CESE soutient pleinement le pacte vert pour l’Europe et la transition de l’économie européenne vers la neutralité climatique d’ici 2050. Dans le même temps, la transition climatique doit aller de pair avec les cinq piliers de l’union de l’énergie, et en particulier avec celui de la sécurité de l’approvisionnement et du caractère abordable des prix de l’énergie. Les futures politiques devraient viser à réduire la forte dépendance à l’égard des importations, comme l’a souligné le CESE dans plusieurs avis. |
|
3.3. |
Si l’on se réfère aux principaux objectifs énoncés par la communication de la Commission européenne intitulée «REPowerEU», l’effort en faveur de la stabilité des prix de l’énergie dans l’Union suivra deux phases: la première durera jusqu’à ce que certaines des premières initiatives visant à diminuer la dépendance de l’Union à l’égard de la Russie apportent des résultats visibles, et la seconde sera parachevée lorsque la dépendance énergétique de l’Union à l’égard de la Russie sera nulle. Le CESE reconnaît que, comme le souligne le plan REPowerEU (10), pour la première phase au cours de laquelle la stabilité et la sûreté joueront un rôle fondamental, l’énergie nucléaire provenant de sources existantes de l’Union sera utile également, étant donné qu’il ne sera pas aisé de préparer le système énergétique de l’Union en vue de l’hiver prochain (en créant des stocks et des réserves de gaz suffisants, en commençant à diversifier les fournitures, en utilisant davantage d’hydrogène et de méthane, et en consacrant des investissements supplémentaires massifs à des projets en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique), comme l’indique l’Agence internationale de l’énergie dans ses recommandations de mars 2022 (11). Quant à la seconde phase, le pacte vert pourra à nouveau être intégré dans les politiques lorsque tous les risques liés à la sécurité d’approvisionnement auront été écartés. |
|
3.4. |
Le CESE relève que la guerre en Ukraine pourrait mettre en péril l’approvisionnement en barres de combustible des centrales nucléaires équipées de réacteurs de type VVER, dans les pays de l’Union où de tels réacteurs sont en service (Bulgarie, Tchéquie, Finlande, Hongrie et Slovaquie). Dans le même temps, le Comité constate avec satisfaction que d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles (12) et encourage les États membres concernés à trouver d’autres fournisseurs dans les meilleurs délais. Les centrales nucléaires n’ont pas besoin de grandes capacités de stockage et peuvent facilement stocker du combustible pendant trois à cinq ans, de sorte qu’il est possible de changer de fournisseur ou d’acheter du combustible à un prix avantageux. |
|
3.5. |
Le CESE souligne qu’aujourd’hui, la stabilité du marché de l’énergie de l’Union constitue une priorité absolue, car elle peut mettre un terme à la volatilité des prix de l’énergie. L’énergie nucléaire, qui est une source d’énergie de base très stable (une alternative de réserve aux énergies renouvelables volatiles), peut contribuer de manière substantielle à la stabilité de l’approvisionnement dans les périodes de risques exceptionnels. |
|
3.6. |
Le CESE souligne que l’énergie nucléaire ne subit pas le risque de volatilité des prix du SEQE de l’Union, qui a atteint un niveau record de 100 EUR par tonne de CO2 au début du mois de février 2022. Étant donné que les centrales nucléaires n’émettent pas de CO2, leurs coûts marginaux n’incluent aucun coût du CO2, à l’instar des énergies renouvelables. La volatilité du SEQE de l’Union affecte considérablement le prix du gaz sur le marché de l’Union. |
|
3.7. |
Globalement, l’énergie nucléaire s’accompagne de coûts d’investissement élevés mais ses coûts d’exploitation sont relativement bon marché. Toutefois, nous ne partons pas de zéro et les capacités nucléaires existantes (modernisées) peuvent être utilisées pour stabiliser le marché. Les politiques devraient permettre aux États membres de prolonger l’exploitation du parc existant, car une utilisation à long terme des centrales nucléaires constitue, de loin, la solution la plus abordable pour 2030 et au-delà, qui permettra une transition en douceur vers la neutralité climatique. Il est nécessaire d’éviter toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur les capacités existantes de production à faible émission de carbone ou de décourager les investisseurs d’investir dans les technologies nécessaires. |
|
3.8. |
Le CESE suggère de tenir compte du rôle de l’énergie nucléaire dans la conception future des règles du marché de l’électricité. Les centrales nucléaires peuvent offrir de l’électricité aux consommateurs finaux à un prix fixe, étant donné que plusieurs pays européens ont recours à divers types de contrats assurant la stabilité au profit des consommateurs. Un prix de vente fixe garantit un retour sur investissement et des coûts d’investissement plus faibles, et fixe partiellement le prix de l’électricité pour les consommateurs finals. |
|
3.9. |
En 2020, l’énergie nucléaire représentait quelque 25 % de l’électricité produite dans l’Union. Renforcer la solidarité et les interconnexions de transport sur le marché de l’énergie aidera à réagir efficacement à la volatilité des énergies renouvelables à long terme, et aux indisponibilités de gaz à court terme. Le CESE invite par ailleurs les États membres à développer les capacités de stockage et à remplacer les centrales à gaz par de l’énergie issue de sources à faible émission de carbone. Toute disposition de la révision de l’organisation du marché de l’électricité devrait encourager les investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone nécessaires pour décarboner le secteur de l’électricité d’une manière sûre et abordable. |
|
3.10. |
Le CESE souligne l’autre élément de stabilité des prix de l’énergie nucléaire que garantit la stabilité des approvisionnements. Par rapport au gaz, les centrales nucléaires n’ont pas besoin de grandes capacités de stockage et peuvent facilement stocker leur combustible pendant trois ans (13). L’allongement de la capacité de ravitaillement et de stockage aide à acheter le combustible dans des conditions plus favorables et à changer de fournisseur. Dès lors, le Comité encourage les cinq États membres dotés de technologies VVER à chercher d’autres fournisseurs. |
|
3.11. |
Lorsque la dépendance énergétique de l’Union vis-à-vis de la Russie aura été réduite, le moment sera opportun pour commencer non seulement à réfléchir, mais aussi à mettre en œuvre et concrétiser le potentiel d’innovation en matière d’énergie nucléaire, à savoir l’utilisation de sources nucléaires pour la production d’hydrogène et le recyclage des déchets dans le cadre d’une chaîne d’économie circulaire. D’après l’Agence internationale de l’énergie, utiliser l’électricité issue du nucléaire pour produire de l’hydrogène et de la chaleur ouvre de nouvelles possibilités. L’électricité nucléaire excédentaire pourrait être exploitée pour produire environ 20 millions de tonnes d’hydrogène en 2050, tandis que la chaleur cogénérée par les centrales nucléaires pourrait être utilisée à la place du chauffage urbain et pour d’autres applications à haute température (14), bien que les coûts de construction doivent baisser pour rendre ces solutions compétitives. |
|
3.12. |
Le CESE propose que la présidence tchèque discute, au sein du Forum européen de l’énergie nucléaire (FEEN), de la stabilité des prix dans le secteur nucléaire ainsi que du rôle de l’énergie nucléaire dans la stabilité des approvisionnements en réponse à la réduction de la dépendance de l’Union à l’égard du gaz russe. Le CESE souhaite être étroitement associé à ce débat. |
|
3.13. |
Le CESE suggère de renforcer la coopération bilatérale avec les partenaires internationaux dans le secteur nucléaire, principalement avec les États-Unis, afin de partager les résultats en matière d’innovation et de progrès dans le domaine des nouvelles technologies. Le CESE recommande que la présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne organise une conférence sur les petits réacteurs modulaires, qui pourrait prendre la forme d’un forum de haut niveau UE — États-Unis consacré à ce type de réacteurs et approfondir ces recherches prometteuses. |
4. Observations particulières
|
4.1. |
Le CESE est bien conscient de certains risques liés à l’utilisation de l’énergie nucléaire et soutient la nécessité de poursuivre la recherche afin de la rendre encore plus sûre. Il serait absurde de penser que les risques n’existent pas. L’énergie nucléaire est utilisée pour produire de l’énergie depuis les années 1950 et, depuis lors, le niveau de sécurité et de sûreté a été renforcé, notamment pour faire face à des événements extérieurs extrêmes, naturels ou anthropiques, tels qu’un accident d’avion ou une explosion. Le CESE invite les États membres à ne pas mettre un terme à la recherche et à l’innovation dans ce domaine, et à se conformer aux strictes exigences relatives à la sécurité et à l’élimination des déchets. |
|
4.2. |
La situation actuelle sur le marché de l’énergie affecte également les prix de l’uranium, qui peuvent être stabilisés par une meilleure diversification des fournisseurs ou, à plus long terme, par la construction de centrales électriques nécessitant un ravitaillement moins fréquent. Les centrales électriques fonctionnant avec de petits réacteurs modulaires peuvent nécessiter un ravitaillement moins fréquent, tous les trois à sept ans, contre un à deux ans pour les centrales traditionnelles. Certains de ces réacteurs sont même conçus pour fonctionner jusqu’à 30 ans sans ravitaillement en combustible. En outre, la construction de centrales de génération III répond aux besoins des pays dont la demande énergétique est importante et les réseaux développés (comme le montrent les programmes en cours ou prévus dans différents pays). |
|
4.3. |
La conception des petits réacteurs modulaires est généralement plus simple, et le concept de sûreté concernant ces réacteurs repose souvent davantage sur des systèmes passifs et sur les caractéristiques de sûreté inhérentes au réacteur, telles que la faible puissance et la pression de fonctionnement. Les petits réacteurs modulaires permettent de réaliser des économies en termes de coûts et de temps de construction, et ils peuvent être déployés progressivement pour répondre à l’augmentation de la demande d’énergie. |
|
4.4. |
Le volume de combustible nécessaire aux centrales nucléaires est relativement faible par rapport aux besoins des centrales électriques utilisant des combustibles fossiles. Un petit granulé de dioxyde d’uranium qui pèse cinq grammes produit la même quantité d’énergie qu’une tonne de charbon ou qu’environ 480 mètres cubes de gaz naturel. Les centrales nucléaires n’ont pas besoin de grandes capacités de stockage et peuvent facilement stocker du combustible pendant trois à cinq ans. La capacité de stockage peut être considérée comme une source de stabilité pour l’installation, car elle réduit la dépendance à l’égard d’un fournisseur particulier et donne la possibilité d’acheter du combustible lorsque les prix sont favorables. |
|
4.5. |
Les investissements réalisés dans ce secteur signifient également que toute modernisation peut être utilisée au profit de la transition écologique. Les technologies et méthodes nucléaires sont utilisées pour contribuer à la transition vers un système énergétique de plus en plus fondé sur l’hydrogène dans deux domaines principaux, à savoir: 1) la production d’hydrogène à partir d’une dissociation de l’eau thermique/chimique grâce à l’énergie nucléaire; et 2) la contribution des méthodes et techniques nucléaires à une meilleure compréhension et à une adaptation ultérieure des matériaux afin de mieux répondre aux exigences en matière de stockage et de conversion de l’hydrogène (15). |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Article 194, paragraphe 2, du TFUE.
(2) Agence internationale de l’énergie, «Nuclear Power and Secure Energy Transitions: From Today’s Challenges to Tomorrow’s Clean Energy Systems» (Énergie nucléaire et sécurité des transitions énergétiques: des défis d’aujourd’hui aux systèmes d’énergie propre de demain).
(3) Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).
(4) Le rapport du groupe d’experts techniques peut être consulté (en anglais) sur le site internet de la Commission européenne, «TEG final report on the EU taxonomy».
(5) Données publiées par Eurostat en février 2022: https://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220210-2
(6) Pour plus de détails, voir l’avis TEN/761 (JO C 275 du 18.7.2022, p. 80).
(7) Agence internationale de l’énergie (AIE) — Agence pour l’énergie nucléaire (AEN), 2020.
(8) Agence internationale de l’énergie, «Projected Costs of Generating Electricity — 2020 Edition» (Coûts prévisionnels de production de l’électricité — Édition 2022).
(9) Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).
(10) Plan REPowerEU, COM(2022) 230 final.
(11) Agence internationale de l’énergie, 10-Point Plan to European Union for reducing reliance on Russian supplies by over a third while supporting European Green Deal, with emergency options to go further (Plan en dix points visant à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard de l’approvisionnement russe de plus d’un tiers tout en soutenant le pacte vert pour l’Europe, comprenant des options d’urgence pour aller plus loin), mars 2022.
(12) La centrale nucléaire de Temelín, en Tchéquie, a ainsi changé de fournisseurs.
(13) Selon le rapport annuel 2020 de l’Agence d’approvisionnement d’Euratom, «les stocks d’uranium peuvent alimenter» les réacteurs nucléaires des centrales européennes pendant 2,75 ans en moyenne.
(14) Agence internationale de l’énergie, «Nuclear Power and Secure Energy Transitions: From Today’s Challenges to Tomorrow’s Clean Energy Systems» (Énergie nucléaire et sécurité des transitions énergétiques: des défis d’aujourd’hui aux systèmes d’énergie propre de demain).
(15) Document technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique IAEA-TECDOC-1676.
ANNEXE I
Le contravis suivant, qui a recueilli plus d’un quart des suffrages exprimés, a été rejeté au cours des débats (article 71, paragraphe 7, du règlement intérieur):
|
AMENDEMENT 7 TEN/776 Le rôle de l’énergie nucléaire dans la stabilité des prix de l’énergie au sein de l’Union Remplacer l’avis présenté par la section TEN dans sa totalité par le texte suivant (l’explication/exposé des motifs figure à la fin du présent document): |
Proposé par: DIRX, Jan HERNÁNDEZ BATALLER, Bernardo IZVERNICEANU, Ileana KATTNIG, Thomas KUPŠYS, Kęstutis LOHAN, Cillian MOSTACCIO, Alessandro NABAIS, João NIKOLOPOULOU, Maria RIBBE, Lutz SCHMIDT, Peter SCHWARTZ, Arnaud |
|
Amendement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Conclusions et recommandations
2. Notes liminaires
3. Réponse à la question
3.5 A: Des centrales nucléaires existantes dans l’organisation actuelle du marché
3.6 B: Des centrales nucléaires existantes et une nouvelle organisation du marché
Cela signifie que cette nouvelle organisation du marché se compose de deux éléments: un segment du marché où s’applique l’organisation qui était en vigueur auparavant (ordre de préséance fondé sur les coûts marginaux) et un second segment dans lequel n’existent de facto que des contrats d’écart compensatoire. Dès lors, l’électricité produite dans le cadre des contrats d’écart compensatoire bénéficie d’un prix stable et garantit donc un prix plus stable au consommateur. Mais le prix pour le consommateur continuera de fluctuer, car une partie de l’électricité est toujours facturée sur la base de l’ordre de préséance économique. 3.7 C: De nouvelles centrales nucléaires dans l’organisation actuelle du marché
3.8 D: De nouvelles centrales nucléaires et une nouvelle organisation du marché
4. Synthèse
|
|
Exposé des motifs |
|
Dans leur déclaration du 8 septembre dernier, Christa Schweng, présidente du CESE, et Baiba Miltoviča, présidente de la section TEN, ont écrit: «Le CESE appelle de ses vœux une action européenne conjointe afin de garantir la stabilité des prix de l’électricité et de réformer de toute urgence le marché de l’énergie.» C’est précisément l’objet du présent amendement que nous avons élaboré afin de répondre de manière claire et honnête à la question posée par la présidence tchèque. Le projet d’avis TEN/776 qui est à l’examen ne s’applique pas à répondre à la question de la présidence tchèque, à savoir quel est le rôle de l’énergie nucléaire en matière de stabilité du prix de l’électricité. Ce projet d’avis traite d’une part de la sécurité d’approvisionnement et, d’autre part, transmet un message publicitaire en faveur de l’énergie nucléaire. Bien entendu, la sécurité de l’approvisionnement est également très importante, mais la présidence n’a pas posé de question à ce sujet. Et malheureusement, la rapporteure a également inclus dans son avis de nombreuses inexactitudes et points discutables. Nous avons présenté un florilège de 20 d’entre eux dans une note avant la réunion de la section TEN qui a eu lieu au début du mois. Nous tenons à souligner que la stabilité des prix est l’une des conditions préalables pour offrir aux consommateurs d’électricité, tant aux entreprises qu’aux particuliers, la certitude quant aux coûts qu’ils supporteront à court et moyen terme. La stabilité des prix de l’électricité joue donc un rôle crucial en matière de performance des entreprises européennes ainsi que pour la création et le maintien d’emplois. C’est pourquoi nous avons élaboré le présent amendement et nous demandons au bureau du CESE de l’accepter en tant que contravis. Nous apportons ainsi une réponse claire et univoque à la question à laquelle devrait répondre l’avis à l’examen, à savoir le rôle de l’énergie nucléaire dans la stabilité des prix de l’énergie dans l’Union. Nous NE discuterons donc PAS des avantages et des inconvénients de l’énergie nucléaire, ni du niveau des prix, car la stabilité des prix peut exister ou non quel que soit le niveau des prix. Il est important de comprendre que si l’on souhaite faire évoluer les prix de l’électricité, il est nécessaire de modifier le système actuel du marché des prix de l’énergie. Cette conclusion est désormais reprise par de nombreux acteurs en Europe, y compris par Ursula von der Leyen et par le Conseil «Énergie» du 9 septembre. Nous avons rappelé cette conclusion à plusieurs reprises au cours de la procédure d’élaboration du présent avis. C’est pourquoi nous avons présenté dans notre amendement quatre scénarios pour étudier dans quelles configurations de l’organisation du marché l’énergie nucléaire peut ou ne peut pas avoir un effet stabilisateur sur les prix de l’énergie. Notre conclusion est que l’énergie nucléaire ne saurait avoir d’effet stabilisateur dans deux de ces scénarios, mais qu’elle peut, sous certaines conditions, jouer ce rôle dans les deux autres. Notre point de vue a été soutenu par les trois experts invités à une réunion du groupe d’étude par son président et la rapporteure: Selon le professeur Keppler: «L’énergie nucléaire n’a pas d’incidence réelle sur les prix de l’électricité, pas plus qu’une augmentation de 10 ou 20 % de sa production.» M. Cometto (Agence internationale de l’énergie atomique, AIEA) estime que: «À court terme, le nucléaire a une incidence limitée pour faire baisser les prix de l’électricité.» Enfin, pour M. Goicea (FORATOM): «Le nucléaire peut, en théorie, apporter une stabilité aux prix finaux de l’électricité, mais cela reste une question d’organisation du marché.» |
|
Résultat du vote: |
||||||
|
(1) https://sweden.se/climate/sustainability/energy-use-in-sweden (en anglais).
(2) https://www.gov.uk/government/collections/hinkley-point-c
ANNEXE II
|
|
MEMBRE |
GROUPE |
MEMBRE |
Vote délégué |
|
1 |
ANDERSEN, Dorthe |
II |
A |
SORGENFREY, Bente |
|
2 |
ANDERSSON, Jan Torsten |
III |
N |
|
|
3 |
ANDERSSON, Krister |
I |
Y |
|
|
4 |
ANGELOVA, Milena |
I |
Y |
|
|
5 |
ANTONIOU, Michalis |
I |
Y |
|
|
6 |
ARDHE, Christian |
I |
Y |
|
|
7 |
ATS, Kerli |
III |
Y |
|
|
8 |
BABRAUSKIENĖ, Tatjana |
II |
A |
|
|
9 |
BACK, Thord Stefan |
I |
Y |
|
|
10 |
BALDZĒNS, Egils |
II |
Y |
|
|
11 |
BARBUCCI, Giulia |
II |
A |
|
|
12 |
BARCELÓ DELGADO Andrés |
I |
Y |
|
|
13 |
BARRERA CHAMORRO, Maria Del Carmen |
II |
N |
|
|
14 |
BARTELS, Holger |
II |
N |
|
|
15 |
BÄUMLER, Christian |
II |
N |
|
|
16 |
BERNIS CASTELLS, Jaume |
III |
Y |
|
|
17 |
BERTOLINI, Silvestre |
II |
Y |
|
|
18 |
BIEGON, Dominika |
II |
N |
|
|
19 |
BLANC, Patricia |
III |
Y |
|
|
20 |
BLIJLEVENS, Réné |
I |
A |
|
|
21 |
BOGUSZ, Małgorzata Anna |
III |
N |
|
|
22 |
BOLAND, Séamus |
III |
N |
|
|
23 |
BOLLON, Pierre |
I |
Y |
|
|
24 |
BORSANI, Matteo Carlo |
I |
Y |
|
|
25 |
BRISHOUAL, Rachel |
III |
A |
|
|
26 |
BRONIARZ, Wincenty Sławomir |
II |
A |
|
|
27 |
BRZOBOHATÁ, Zuzana |
III |
N |
|
|
28 |
BYRNE, Peter |
I |
Y |
|
|
29 |
CABRA DE LUNA, Miguel Ángel |
III |
Y |
|
|
30 |
CALDERONE, Marina Elvira |
III |
N |
|
|
31 |
CALISTRU, Elena-Alexandra |
III |
A |
|
|
32 |
CAÑO AGUILAR, Isabel |
II |
N |
|
|
33 |
CATSAMBIS, Constantine |
I |
Y |
|
|
34 |
CHAMPAS, Panagiotis |
III |
Y |
|
|
35 |
CHARRY, Philippe |
II |
Y |
DESIANO, Carole |
|
36 |
CHOIX, Bruno |
I |
Y |
|
|
37 |
CLEVER, Peter |
I |
Y |
HEMMERLING, Udo |
|
38 |
COMER, John |
III |
Y |
|
|
39 |
CORAZZA, Chiara |
III |
Y |
|
|
40 |
COULON, Pierre Jean |
II |
Y |
|
|
41 |
COUMONT, Raymond |
II |
Y |
|
|
42 |
CSER, Ágnes |
III |
Y |
|
|
43 |
DE FELIPE LEHTONEN, Helena |
I |
Y |
|
|
44 |
DE LEEUW, Rudy |
II |
N |
ULENS, Miranda |
|
45 |
DE LOTTO, Pietro Francesco |
I |
Y |
|
|
46 |
DE MELLO, Vasco |
I |
Y |
|
|
47 |
DE MÛELENAERE, Robert |
I |
Y |
|
|
48 |
DEGUARA, Jason |
II |
N |
|
|
49 |
DEL RIO, Cinzia |
II |
N |
|
|
50 |
DESTOM, Joël |
III |
Y |
|
|
51 |
DIAMANTOUROS, Konstantinos |
I |
Y |
|
|
52 |
DIMITRIADOU, Stavroula |
II |
N |
|
|
53 |
DIRX, Jan |
III |
N |
NEISINGH, Ody |
|
54 |
DOZ ORRIT, Javier |
II |
Y |
|
|
55 |
DROBINSKI-WEISS, Elvira |
III |
N |
|
|
56 |
DUFEK, Bohumír |
II |
Y |
|
|
57 |
DULEVSKI, Lalko |
III |
N |
|
|
58 |
DUTTO, Diego |
III |
N |
|
|
59 |
EDELÉNYI, András |
I |
Y |
|
|
60 |
FELSZEGHI, Sára |
II |
Y |
|
|
61 |
FORNEA, Dumitru |
II |
Y |
|
|
62 |
GARAT PÉREZ, Francisco Javier |
III |
Y |
|
|
63 |
GARCÍA DEL RIEGO, Antonio |
I |
Y |
SABATINI, Giovanni |
|
64 |
GARCÍA SALGADO, Manuel |
II |
Y |
|
|
65 |
GARDIAS, Dorota |
II |
Y |
|
|
66 |
GAVRILOVS, Vitālijs |
I |
Y |
|
|
67 |
GEISEN, Norbert |
III |
Y |
|
|
68 |
GKOFAS, Panagiotis |
III |
Y |
|
|
69 |
GOBINŠ, Andris |
III |
N |
|
|
70 |
GONDARD-ARGENTI, Marie-Françoise |
I |
Y |
|
|
71 |
GRABO, Louise |
III |
Y |
KILIM, Irma |
|
72 |
HÄGGLUND, Sam |
II |
A |
|
|
73 |
HÄGGMAN, Maria |
II |
A |
|
|
74 |
HAJNOŠ, Miroslav |
II |
Y |
|
|
75 |
HAUKANÕMM, Monika |
III |
N |
|
|
76 |
HEALY, Joe |
III |
Y |
|
|
77 |
HERNÁNDEZ BATALLER, Bernardo |
III |
N |
|
|
78 |
HOFFMANN, Reiner Gerd |
II |
N |
|
|
79 |
HOLST, Sif |
III |
A |
|
|
80 |
IOANNIDIS, Athanasios |
III |
Y |
|
|
81 |
IZVERNICEANU DE LA IGLESIA, Ileana |
III |
N |
|
|
82 |
JAHIER, Luca |
III |
N |
|
|
83 |
JOHANSSON, Benny |
II |
A |
|
|
84 |
JONUŠKA, Alfredas |
I |
Y |
|
|
85 |
JOÓ, Kinga |
III |
Y |
|
|
86 |
JUODKAITĖ, Dovilė |
III |
N |
|
|
87 |
KÁLLAY, Piroska |
II |
A |
|
|
88 |
KATTNIG, Thomas |
II |
N |
BUZEK, Tanja |
|
89 |
KIUKAS, Vertti |
III |
Y |
|
|
90 |
KLIMEK, Jan |
I |
Y |
|
|
91 |
KOKALOV, Ivan |
II |
Y |
|
|
92 |
KOLBE, Rudolf |
III |
N |
|
|
93 |
KOLYVAS, Ioannis |
III |
N |
|
|
94 |
KOMORÓCZKI, István |
I |
Y |
|
|
95 |
KONTKANEN, Mira-Maria |
I |
Y |
|
|
96 |
KOUTSIOUMPELIS, Stavros |
II |
Y |
|
|
97 |
KROPIL, Rudolf |
III |
Y |
|
|
98 |
KROPP, Thomas |
I |
Y |
GERSTEIN, Antje |
|
99 |
KRUPAVIČIENĖ, Kristina |
II |
Y |
|
|
100 |
KÜKEDI, Zsolt |
III |
Y |
|
|
101 |
KUNYSZ, Maciej Dawid |
III |
A |
|
|
102 |
LADEFOGED, Anders |
I |
Y |
|
|
103 |
LE BRETON, Marie-Pierre |
I |
Y |
|
|
104 |
LEFÈVRE, Christophe |
II |
Y |
|
|
105 |
LEITĀNE, Katrīna |
III |
A |
|
|
106 |
LOBO XAVIER, Gonçalo |
I |
A |
|
|
107 |
LOHAN, Cillian |
III |
N |
|
|
108 |
LUSTENHOUWER, Colin |
I |
N |
|
|
109 |
MACHYNA, Emil |
II |
Y |
|
|
110 |
MADSEN, Niels |
I |
Y |
|
|
111 |
MALLIA, Stefano |
I |
Y |
|
|
112 |
MANOLOV, Dimitar |
II |
Y |
|
|
113 |
MARCHIORI, Alberto |
I |
Y |
|
|
114 |
MARIN, Florian |
II |
N |
|
|
115 |
MARTINOVIĆ DŽAMONJA, Dragica |
I |
Y |
|
|
116 |
MASCIA, Sandro |
I |
Y |
|
|
117 |
MASTANTUONO, Alena |
I |
Y |
LEMCKE, Freya |
|
118 |
MATSAS, Andreas |
II |
Y |
|
|
119 |
MAVROMMATIS, Manthos |
I |
Y |
|
|
120 |
MEDINA, Felipe |
I |
Y |
|
|
121 |
MENSI, Maurizio |
III |
A |
|
|
122 |
MERLO, Nicoletta |
II |
Y |
|
|
123 |
MESKER, August Pierre |
I |
N |
|
|
124 |
MEYNENT, Denis |
II |
N |
|
|
125 |
MILTOVIČA, Baiba |
III |
Y |
|
|
126 |
MINCHEVA, Mariya |
I |
Y |
PANGL, Andreas |
|
127 |
MIRA, Luís |
I |
Y |
|
|
128 |
MISSLBECK-WINBERG, Christiane |
I |
Y |
|
|
129 |
MITOV, Veselin |
II |
Y |
|
|
130 |
MONE, Andrea |
II |
A |
|
|
131 |
MOOS, Christian |
III |
A |
|
|
132 |
MORENO DÍAZ, José Antonio |
II |
A |
|
|
133 |
MORKIS, Gintaras |
I |
Y |
|
|
134 |
MOSTACCIO, Alessandro |
III |
N |
|
|
135 |
MUREȘAN, Marinel Dănuț |
I |
Y |
|
|
136 |
MURGUÍA ESTEVE, Aitor |
II |
N |
|
|
137 |
NIKOLOPOULOU, Maria |
II |
N |
|
|
138 |
NIKOLOV, Bogomil |
III |
N |
|
|
139 |
NOWACKI, Marcin |
I |
Y |
|
|
140 |
NYGREN, Ellen |
II |
A |
|
|
141 |
OCHEDZAN, Justyna Kalina |
III |
A |
|
|
142 |
O’CONNOR, Jack |
II |
A |
|
|
143 |
ÖNGÖRUR, Berivan |
II |
A |
|
|
144 |
OSTROWSKI, Krzysztof |
I |
A |
|
|
145 |
PADURE, Decebal-Ștefăniță |
I |
Y |
HAUNERT, Nora |
|
146 |
PAIDAS, Ioannis |
II |
Y |
|
|
147 |
PALMIERI, Stefano |
II |
A |
|
|
148 |
PARTHIE, Sandra |
I |
A |
|
|
149 |
PATER, Krzysztof |
III |
Y |
|
|
150 |
PAVIĆ-ROGOŠIĆ, Lidija |
III |
A |
|
|
151 |
PENTTINEN, Markus |
II |
Y |
|
|
152 |
PETRAITIENĖ, Irena |
II |
Y |
|
|
153 |
PIETKIEWICZ, Janusz |
I |
Y |
|
|
154 |
PILAWSKI, Lech |
I |
Y |
|
|
155 |
PLOSCEANU, Aurel Laurenţiu |
I |
N |
|
|
156 |
POCIVAVŠEK, Jakob Krištof |
II |
A |
|
|
157 |
POPELKOVÁ, Hana |
II |
Y |
VAN KELLE, Lottie |
|
158 |
POTTIER, Jean-Michel |
I |
Y |
|
|
159 |
POTYRAŁA, Dariusz Miroslaw |
II |
Y |
|
|
160 |
PREDA, Bogdan |
I |
Y |
VUORI, Timo |
|
161 |
PROUZET, Emilie |
I |
Y |
|
|
162 |
PUECH d’ALISSAC, Arnold |
I |
Y |
|
|
163 |
PUXEU ROCAMORA, Josep |
I |
Y |
|
|
164 |
QUAREZ, Christophe |
II |
Y |
|
|
165 |
RAMMO, Alari |
III |
Y |
|
|
166 |
RAVNIK, Branko |
III |
Y |
|
|
167 |
REALE, Maurizio |
I |
Y |
|
|
168 |
REDING, Jean-Claude |
II |
N |
|
|
169 |
REISECKER, Sophia |
II |
A |
RUSU, Sabin |
|
170 |
RELIĆ, Danko |
III |
A |
|
|
171 |
REPANŠEK, Neža |
III |
N |
|
|
172 |
RIBBE, Lutz |
III |
N |
|
|
173 |
RISTELÄ, Pekka |
II |
A |
|
|
174 |
ROBYNS, Wautier |
I |
Y |
|
|
175 |
ROCHE RAMO, José Manuel |
III |
N |
|
|
176 |
RÖPKE, Oliver |
II |
N |
KLUGE, Norbert |
|
177 |
SAKAŘOVÁ, Dana |
II |
Y |
|
|
178 |
SALIS-MADINIER, Franca |
II |
N |
|
|
179 |
SAMMUT BONNICI, Dolores |
I |
A |
|
|
180 |
SCHAFFENRATH, Martin Josef |
III |
N |
|
|
181 |
SCHLÜTER, Bernd |
III |
A |
|
|
182 |
SCHMIDT, Peter |
II |
N |
|
|
183 |
SCHWARTZ, Arnaud |
III |
N |
|
|
184 |
SCHWENG, Christa |
I |
A |
|
|
185 |
SERRA ARIAS, Ricardo |
III |
Y |
|
|
186 |
SIBIAN, Ionuț |
III |
N |
|
|
187 |
SILVA, Carlos |
II |
N |
|
|
188 |
SILVA, Francisco |
III |
N |
|
|
189 |
SILVA, João |
II |
N |
|
|
190 |
SINKEVIČIŪTĖ, Elena |
III |
Y |
|
|
191 |
SIPKO, Juraj |
III |
A |
|
|
192 |
ŠIRHALOVÁ, Martina |
I |
Y |
|
|
193 |
SMOLE, Jože |
I |
N |
|
|
194 |
SÕBER, Kristi |
I |
Y |
|
|
195 |
SOETE, Paul |
I |
Y |
|
|
196 |
STOEV, Georgi |
I |
Y |
|
|
197 |
STUDNIČNÁ, Lucie |
II |
A |
MILIĆEVIĆ-PEZELJ, Anica |
|
198 |
SÜLE, Katalin Elza |
I |
Y |
|
|
199 |
SVENTEK, David |
I |
Y |
|
|
200 |
SZALAY, Anton |
II |
Y |
|
|
201 |
SZYMAŃSKI, Mateusz |
II |
Y |
|
|
202 |
TCHOUKANOV, Stoyan |
III |
N |
|
|
203 |
TEDER, Reet |
I |
Y |
MAJETIĆ, Davor |
|
204 |
THURNER, Andreas |
III |
N |
|
|
205 |
TIAINEN, Simo |
III |
Y |
|
|
206 |
TOPOLÁNSZKY, Ákos |
III |
A |
|
|
207 |
TRINDADE, Carlos Manuel |
II |
N |
MAURICIO DE CARVALHO, Fernando |
|
208 |
TUPILUȘI, Tudorel |
III |
Y |
|
|
209 |
TZOTZE-LANARA, Zoe |
II |
N |
|
|
210 |
ULGIATI, Luigi |
Non-insc |
Y |
|
|
211 |
UNGERMAN, Jaroslav |
Non-insc. |
Y |
|
|
212 |
VADÁSZ, Borbála |
I |
Y |
|
|
213 |
VARDAKASTANIS, Ioannis |
III |
N |
|
|
214 |
VASK, Kaia |
II |
Y |
|
|
215 |
VERNICOS, George |
I |
Y |
|
|
216 |
VIIES, Mare |
II |
Y |
|
|
217 |
VILARES DIOGO, Edgar |
III |
N |
|
|
218 |
VON BROCKDORFF, Philip |
II |
N |
|
|
219 |
VORBACH, Judith |
II |
N |
|
|
220 |
VYYRYLÄINEN, Tiina |
III |
Y |
|
|
221 |
WAGENER, Marco |
II |
N |
WOLFF, Romain |
|
222 |
WAGNSONNER, Thomas |
II |
N |
|
|
223 |
WILLEMS, Heiko |
I |
Y |
|
|
224 |
WILLEMS, Marie Josiane |
III |
A |
|
|
225 |
WRÓBLEWSKI, Tomasz Andrzej |
I |
Y |
|
|
226 |
WYCKMANS, Ferdinand |
II |
N |
|
|
227 |
YIAPANIS, Anastasis |
III |
Y |
|
|
228 |
YILDIRIM, Ozlem |
II |
Y |
|
|
229 |
YLIKARJULA, Janica |
I |
Y |
|
|
230 |
ZARINA, Katrina |
I |
Y |
|
|
231 |
ZIELENIECKI, Marcin Antoni |
II |
Y |
|
|
232 |
ZORKO, Andrej |
II |
N |
|
|
233 |
ZVOLSKÁ, Marie |
I |
Y |
HARTMAN RADOVÁ, Jana |
|
234 |
ZYCH, Tymoteusz Adam |
III |
N |
|
III Actes préparatoires
Comité économique et social européen
572e session plénière du Comité économique et social européen, 21.9.2022-22.9.2022
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/123 |
Avis du Comité économique et social européen sur la
communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — «Un espace européen des données de santé: exploiter le potentiel des données de santé pour les citoyens, les patients et l’innovation»
[COM(2022) 196 final]
et sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’espace européen des données de santé
[COM(2022) 197 final — 2022/0140 (COD)]
(2022/C 486/16)
|
Rapporteur: |
Gonçalo LOBO XAVIER |
|
Consultation |
Parlement européen, 6.6.2022 Conseil, 13.6.2022 |
|
Base juridique |
Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Marché unique, production et consommation» |
|
Adoption en section |
8.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
22.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
198/0/1 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE accueille favorablement la communication de la Commission sur l’espace européen des données de santé. Après la crise de la COVID-19, forts de quelques bons exemples de coopération tels que le certificat COVID européen, l’Union européenne et ses citoyens peuvent bénéficier de données sûres, harmonisées et partagées susceptibles de développer plus avant les systèmes de santé des États membres dans toutes leurs dimensions. Le CESE convient que la transformation numérique est indispensable pour fournir de meilleurs soins de santé aux citoyens, accroître la solidité et la résilience des systèmes de santé, soutenir la compétitivité et l’innovation à long terme dans l’écosystème médical de l’Union et aider l’Union à se relever de la pandémie. |
|
1.2. |
Du point de vue du CESE, il est capital de tirer parti des possibilités qu’offrent l’innovation et la numérisation afin d’accroître le bien-être des citoyens et d’améliorer la qualité des services de santé. Dans le même temps, la société civile organisée et les partenaires sociaux attirent l’attention sur les disparités existantes entre les États membres de l’Union pour ce qui est des niveaux d’aptitude numérique, auxquelles il convient de remédier dans le cadre du processus de mise en œuvre de la stratégie à l’examen. En ce domaine, l’impératif de «ne laisser personne de côté» importe plus que jamais. |
|
1.3. |
Pour le CESE, la proposition relative à l’espace européen des données de santé offre une excellente occasion de donner aux particuliers les moyens d’accéder à leurs données de santé à caractère personnel et d’en avoir la maîtrise. Dans le même ordre d’idées, le CESE estime que cette stratégie permettrait de mettre en place un cadre cohérent pour l’utilisation des données de santé des particuliers dans le domaine des politiques de recherche et de développement. Pour atteindre l’un et l’autre de ces objectifs, il importe grandement d’asseoir la confiance dans ce processus et sa sécurité. De ce fait, le CESE est partisan du lancement d’une campagne de communication à grande échelle pour contribuer à renforcer la confiance du grand public. Les citoyens doivent être conscients des avantages liés au processus de partage. De l’avis du CESE, il serait judicieux de mettre en relief les avantages qu’en retirent directement les citoyens et les consommateurs, à la manière de ce qui a été fait pour d’autres parties intéressées, mais il doit apparaître manifestement que des exigences obligatoires en matière de qualité sont en place, notamment en ce qui concerne l’autorisation et l’anonymat. |
|
1.4. |
Le CESE estime qu’en soi, l’espace européen des données de santé aura une incidence positive significative sur les droits fondamentaux pour ce qui est de la protection des données à caractère personnel et de la libre circulation. S’il est correctement lié à l’espace de données du nuage européen pour la science ouverte (EOSC) et aux infrastructures européennes de données pertinentes dans le domaine des sciences du vivant (1), il permettra aux chercheurs, aux innovateurs et aux décideurs d’utiliser les données d’une manière plus efficace, plus sûre et qui protège la vie privée. En ce sens, le CESE convient que la proposition à l’examen constitue un nouvel effort bienvenu pour stimuler le marché intérieur et les possibilités qu’il recèle lorsqu’il s’agit d’améliorer la vie des citoyens européens. |
|
1.5. |
Tout en soutenant ce programme, le CESE attire l’attention sur l’impossibilité pour l’Union européenne de solliciter le soutien du grand public en faveur d’un espace européen d’échange des données de santé si le financement des soins de santé demeure parcimonieux. La COVID-19 a durement frappé les systèmes de santé publique, et l’Union doit avoir conscience qu’il lui faut remédier aux dégâts et renforcer lesdits systèmes au moyen d’un budget adéquat avant de s’engager plus avant dans ce projet, dont il ne fait aucun doute qu’il est bénéfique. De l’avis du CESE, si l’Union européenne dispose d’un budget pour un «programme», elle se doit d’allouer des fonds en vue de renforcer les systèmes de santé et de n’avancer qu’ensuite dans ce projet intéressant. |
|
1.6. |
Le CESE fait valoir la nécessité d’apporter aux citoyens davantage de clarifications concernant l’utilisation primaire et secondaire des données. Les citoyens doivent avoir foi et confiance dans le système pour accepter de coopérer et doivent en comprendre les avantages, aussi bien à titre individuel que pour l’ensemble de la collectivité. Le CESE estime que les craintes les plus fortes touchent à l’utilisation secondaire des données. La plus grande clarté s’impose s’agissant de savoir en quoi consiste cette utilisation, quelles en sont les limites, quel organisme contrôlera et validera les données et quelles sont les sanctions en vigueur en cas de non-respect. Le CESE est convaincu que, dès lors que les organisations de la société civile et les partenaires sociaux sont associés de manière adéquate, ils peuvent aider à expliquer et propager ces messages. Les États membres pourraient tirer un réel parti des organisations de la société civile sur le terrain afin de soutenir la collectivité dans ces domaines pour s’assurer que personne ne passe à côté de ces avancées. Dans le même ordre d’idées, les médecins généralistes et les médecins traitants qu’ont choisis les patients constituent une pierre angulaire du cadre de confiance et d’assurance entre les patients et les utilisateurs des données de santé. Le CESE recommande d’associer tout spécialement ces professionnels à la stratégie de communication. |
|
1.7. |
Si le CESE est globalement favorable à la proposition à l’examen, il demande néanmoins à la Commission de mener une réflexion approfondie sur les avantages et les inconvénients de cette initiative afin de réduire les risques avant d’agir plus avant. Il faut garder à l’esprit que lorsque l’on évoque les systèmes de santé des États membres, de trop nombreux défis se présentent. Différents rythmes et différents points de vue prévalent en ce qui concerne les systèmes de santé publics et privés, et les citoyens doivent être conscients que la proposition à l’examen implique des choix en matière d’investissement et de politique publique. Pour les citoyens, il doit être clair que cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une stratégie et d’avancées qui ne visent pas à saper le système mais à lui apporter une valeur ajoutée. Il est nécessaire de communiquer afin d’éviter tout malentendu vis-à-vis du grand public. |
|
1.8. |
Dans le souci de favoriser un meilleur accès de tous à l’assurance, lequel suppose, de la part des assureurs, une meilleure compréhension des données probantes concernées, le CESE demande une réflexion sur la pertinence qu’il y aurait à réévaluer l’interdiction absolue faite aux assureurs de procéder à une utilisation secondaire des données. Néanmoins, face au risque concomitant d’individualisation des primes d’assurances et de sélection des risques, il a considéré préférable de s’en tenir à la position de la Commission européenne qui entend restreindre l’utilisation secondaire des données de santé électroniques aux seuls objectifs parfaitement légitimes d’amélioration et de conduite des politiques de santé publique ainsi que de recherche. Le CESE demande aussi de réfléchir à la possibilité d’ouvrir ces données aux assureurs à des fins de recherche à condition qu’elles soient parfaitement compatibles avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et les objectifs d’intérêt public évoqués ci-dessus, et contrôlées par les autorités compétentes en collaboration avec la société civile. |
|
1.9. |
Le CESE est fermement convaincu que l’espace européen des données de santé sera bénéfique pour les particuliers, les professionnels de la santé, les prestataires de soins de santé, les chercheurs, les autorités de réglementation et les décideurs, mais ces bénéfices ne se manifesteront que si les citoyens et les parties intéressées sont associés, dans le cadre de cette stratégie, à un investissement permanent dans les systèmes de santé nationaux. Il n’est pas possible de faire participer les citoyens s’ils ne perçoivent pas qu’ils sont la clé de voûte du processus. Le CESE recommande à la Commission et aux États membres d’associer les organisations de la société civile de manière à faire de la mise en œuvre de la stratégie une réussite et à tirer parti de l’expérience de ces organisations qui peuvent se faire l’écho du caractère transparent et fiable de l’initiative. Il est essentiel d’investir dans ces domaines. |
|
1.10. |
Le CESE approuve l’idée de permettre aux États membres et aux organismes participant à l’espace européen des données de santé de recourir à une combinaison d’investissements au titre du programme pour une Europe numérique, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et d’Horizon Europe pour mettre en œuvre la stratégie. En outre, le programme pour une Europe numérique soutiendra le déploiement des infrastructures nécessaires pour rendre les données de santé accessibles en toute sécurité par-delà les frontières de l’Union européenne et développer des espaces communs de données. Toutefois, le CESE attire également l’attention sur le temps que prendront ces investissements et sur leur absence de lien direct avec le calendrier de la stratégie. Il convient donc de faire correspondre les attentes des citoyens et l’état d’avancement desdits investissements pour éviter de les décevoir sans parvenir à gagner leur acceptation de la stratégie et du partage des données en général. |
|
1.11. |
En dernier lieu, le CESE presse la Commission d’investir de manière cohérente dans des systèmes de cybersécurité à même de prévenir d’immenses problèmes dans tous les États membres. Si l’opinion publique doit pouvoir se sentir en sécurité face à ces questions, les nombreux cas et problèmes rencontrés récemment aux quatre coins de l’Union européenne ont suscité un sentiment d’insécurité et de crainte concernant la protection des données et la sécurité des systèmes. L’Union se doit d’apporter une réponse coordonnée, qui pourrait faire toute la différence dans le contexte d’investissements sensibles tels que celui-ci. |
2. Cadre général
|
2.1. |
La Commission européenne a annoncé la création de l’espace européen des données de santé (ci-après l’«EHDS», pour «European Health Data Space»), l’un des fondements d’une union européenne de la santé forte. L’EHDS offre un cadre de partage de données axé sur la santé, qui établit des règles et pratiques claires ainsi qu’une infrastructure et un cadre de gouvernance en vue de l’utilisation des données de santé électroniques par les patients, de même qu’à des fins de recherche, d’innovation, d’élaboration des politiques et d’activités réglementaires, tout en garantissant le plein respect des normes européennes strictes en matière de protection des données. |
|
2.2. |
Ce dispositif aidera l’Union à réaliser des avancées décisives dans la manière dont les soins de santé sont fournis aux citoyens dans toute l’Europe. Il permettra aux intéressés de contrôler et d’utiliser leurs données de santé dans leur pays d’origine ou dans d’autres États membres. Il encourage la mise en place d’un véritable marché unique des services et produits de santé numériques. |
|
2.3. |
Les États membres veilleront à ce que les dossiers des patients, les prescriptions électroniques, les résultats de laboratoire et les lettres de sortie d’hospitalisation soient établis et admis dans un format européen commun. L’interopérabilité et la sécurité deviendront des exigences obligatoires. Pour garantir la protection des droits des citoyens, tous les États membres sont tenus de désigner des autorités de santé numérique. Ces autorités participeront à l’infrastructure numérique transfrontière «MaSanté@UE» (MyHealth@EU), qui aidera les patients à communiquer leurs données par-delà les frontières. |
|
2.4. |
L’espace européen des données de santé s’inscrit dans le prolongement du RGPD, de la proposition d’acte sur la gouvernance des données, de la proposition de règlement sur les données et de la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (directive NIS). L’EHDS complète ces initiatives et prévoit des règles mieux adaptées au secteur de la santé. |
|
2.5. |
L’utilisation primaire des données de santé électroniques consiste en l’exploitation de données aux fins de la fourniture de soins de santé de meilleure qualité, à l’échelon national ou transfrontière. Les données médicales sont généralement stockées dans des dossiers médicaux électroniques renfermant des parties des antécédents médicaux des patients (de manière centralisée ou avec le concours de différents prestataires de soins de santé). L’espace européen des données de santé permettra aux citoyens d’accéder à leurs données de santé et de les mettre à la disposition d’un professionnel de la santé de leur choix, même à l’étranger et dans la langue du professionnel de la santé en question. Ainsi, le patient peut obtenir un diagnostic et un traitement de meilleure qualité, les erreurs médicales deviennent plus rares, et les diagnostics inutiles sont évités. |
|
2.6. |
L’utilisation secondaire des données de santé électroniques consiste en un traitement des données de santé afin d’éclairer et d’évaluer les politiques de santé publique ou de faire des travaux de recherche. Ce type d’utilisation peut renforcer la sécurité des patients et stimuler le développement de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux, ainsi que de médicaments personnalisés et de produits reposant sur l’intelligence artificielle. Dans le cadre de l’espace européen des données de santé, les résultats des travaux de recherche sont publiés sous une forme agrégée qui préserve la confidentialité des données. |
|
2.7. |
L’espace européen des données de santé est un écosystème spécifique à la santé, qui se compose de règles, de pratiques, de normes communes, d’infrastructures et d’un cadre de gouvernance. Il répond aux objectifs suivants:
|
3. Exploiter le potentiel des données de santé: une stratégie fondée sur la confiance
|
3.1. |
Le CESE se félicite de l’initiative de la Commission relative à un «espace européen des données de santé», lequel pourrait améliorer la qualité de vie des citoyens, stimuler l’innovation et créer un environnement sûr pour la protection et le partage des données. |
|
3.2. |
À l’issue de la crise de la COVID-19, tous les États membres ont souffert de la pression subie par leurs systèmes de santé nationaux, et cette initiative de la Commission arrive à point nommé. |
|
3.3. |
Le CESE est convaincu qu’il règne un sentiment de méfiance généralisé quant à la solidité du système, malgré un certain nombre de résultats positifs observés dans plusieurs pays. Les médecins généralistes et les médecins traitants qu’ont choisis les patients constituent une pierre angulaire du cadre de confiance et d’assurance entre les patients et les utilisateurs des données de santé. Le CESE recommande de les faire activement participer à l’information des citoyens sur l’intérêt que présentent les échanges de données de santé aussi bien pour eux-mêmes à titre individuel que pour la collectivité. |
|
3.4. |
Afin de libérer le potentiel des données de santé, la Commission a présenté une proposition législative visant à créer un espace européen des données de santé, afin de donner aux individus les moyens de prendre le contrôle de leurs propres données de santé, de permettre l’utilisation de ces données pour assurer la prestation de meilleurs soins de santé et de donner à l’Union européenne la possibilité de tirer pleinement parti du potentiel offert par l’échange, l’utilisation et la réutilisation sûrs et sécurisés des données de santé, sans les obstacles existants. Le CESE approuve l’idée générale de ce dessein. |
|
3.5. |
Les citoyens de l’Union pourront accéder à leurs données et les partager en temps réel, tout en en ayant une plus grande maîtrise. L’espace européen des données de santé rendra les soins de santé plus efficaces, plus accessibles et plus résilients, et offrira une meilleure qualité de vie tout en permettant aux personnes de contrôler leurs données de santé et en libérant le potentiel de l’économie fondée sur les données. Derechef, le CESE et la société civile organisée sont convaincus de la nécessité pour l’Union européenne de tirer parti du fait que les citoyens sont bien disposés à l’endroit d’une telle initiative dès lors qu’ils comprennent le projet et les avantages que procure le concept. |
4. Les enjeux liés à l’utilisation des données de santé: risques et perspectives
|
4.1. |
Le CESE estime qu’il est primordial que les États membres prennent conscience de la nécessité d’investir afin de promouvoir ce projet et de la concurrence qui prévaut actuellement avec plusieurs autres priorités stratégiques. |
|
4.2. |
Le fait de bâtir l’espace européen des données de santé en l’adossant au règlement général sur la protection des données (2), au règlement sur la gouvernance des données (3), au projet de règlement sur les données (4) et à la directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (5) permet d’éveiller chez les citoyens la dimension de confiance et de transparence. Ces cadres horizontaux prévoient des règles (entre autres des mesures de sécurité) qui s’appliquent au secteur de la santé. Toutefois, il est de fait que les données de santé revêtent un caractère particulièrement sensible et il s’impose d’en tenir dûment compte. |
|
4.3. |
Plus de la moitié des États membres n’ont pas de cadre législatif qui porte spécifiquement sur la réutilisation des données de santé électroniques, par exemple à des fins de recherche, d’élaboration des politiques ou de réglementation. Ces États membres s’en remettent donc aux dispositions générales du RGPD et s’appuient souvent sur le consentement pour traiter les données de santé (6). Cette situation limite la réutilisation de ces données. Tous les États membres ne disposent pas d’un organisme compétent pour l’accès aux données de santé, mais, lorsque c’est le cas, le nombre de demandes d’utilisation de données de santé pour des projets de recherche ou d’élaboration des politiques augmente rapidement (7), ce qui atteste l’intérêt pour un tel système et l’ampleur de la demande insatisfaite. Le CESE entend et estime que cette idée appuie également la nécessité d’une telle stratégie. |
|
4.4. |
L’espace européen des données de santé ouvrira la voie à des approches innovantes en matière d’enregistrement des cancers, notamment à d’autres solutions pour recueillir en temps utile des informations géolocalisées sur différents types de cancers, ce qui pourrait permettre de dresser un état des lieux en temps réel des cancers dans l’ensemble de l’UE. On aurait également la possibilité de détecter les tendances, les disparités et les inégalités entre États membres et entre régions. |
|
4.5. |
Surtout, il pourrait être plus facile de repérer les défis et les domaines d’action appelant des investissements ou d’autres actions aux échelons européen, national et régional. Pour ne citer qu’un seul exemple, il sera ainsi possible de mieux cibler le dépistage et le traitement des cancers, d’en accroître l’efficacité et de les rendre plus accessibles. |
|
4.6. |
La cybersécurité joue un rôle capital dans la vie de tout un chacun. Les technologies procurent d’immenses avantages, susceptibles d’être bien plus importants encore lorsqu’elles touchent aux données des personnes, mais ceci vaut également pour le risque de perdre d’importantes et précieuses informations. Le CESE est conscient des risques encourus et les cas qui se sont récemment présentés dans différents États membres commandent d’agir. Il est primordial de mettre en place une stratégie coordonnée pour lutter contre la «piraterie informatique» et accroître les niveaux de cybersécurité. En l’absence d’investissement en ce sens, la proposition ne présente aucune utilité. |
5. Gouvernance, financement et articulation avec d’autres politiques de santé
|
5.1. |
Le CESE est fermement convaincu que ce projet offre à l’Union une occasion de se donner les moyens d’agir, et de se doter de droits et garanties plus solides en matière de données de santé. Il devrait être plus facile d’accéder aux données de santé et de les partager avec d’autres professionnels de la santé, sans devoir répéter les mêmes tests inutilement. Dans le même temps, un accès simplifié à des données interopérables de haute qualité facilitera également l’innovation et la mise au point de nouveaux traitements, de nouveaux vaccins et de la médecine personnalisée. Aussi s’impose-t-il, pour atteindre ces objectifs, d’assurer une coordination adéquate de tous les acteurs concernés, qu’il s’agisse des systèmes de santé publique, des gouvernements, des citoyens, des décideurs politiques ou des relais de communication. |
|
5.2. |
Le CESE convient qu’investir dans la numérisation revient à investir dans l’amélioration des soins de santé et la résilience des systèmes de santé des États membres. Il estime néanmoins que ces derniers ont la possibilité de mieux utiliser les ressources que procurent les dispositifs financiers européens, notamment la facilité pour la reprise et la résilience, laquelle constitue le principal axe du plan de relance pour l’Europe NextGenerationEU, qui vise à fournir une aide financière aux États membres afin de lutter contre les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19 et d’accroître la résistance de l’économie européenne face à de futurs chocs. |
|
5.3. |
Le CESE attire l’attention sur les avantages que produit le couplage des investissements dans les infrastructures, qui permet à l’ensemble des régions de se numériser et de progresser. Il est inutile de lancer un projet d’une telle ampleur sans disposer du réseau ou des infrastructures adéquats et sans investir dans l’amélioration de la formation et des aptitudes numériques des citoyens. |
|
5.4. |
Le CESE approuve l’idée selon laquelle plus de 480 millions d’EUR provenant du programme pour une Europe numérique, du mécanisme pour l’interconnexion en Europe et d’Horizon Europe peuvent être utilisés par les États membres et les organismes participant à l’espace européen des données de santé, ainsi que par d’autres secteurs. Ledit programme pour une Europe numérique soutiendra également le déploiement des infrastructures nécessaires pour rendre les données de santé accessibles en toute sécurité par-delà les frontières de l’UE et développer des espaces communs de données. Le CESE prend acte du temps que prendront ces investissements et de la nécessité de faire correspondre les attentes des citoyens et l’état d’avancement desdits investissements. |
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Par ses feuilles de route stratégiques, le forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche a facilité l’établissement d’une infrastructure de recherche européenne consacrée entre autres aux données de la recherche médicale, au recueil des banques de données biologiques et aux données d’imagerie médicale. Pour en savoir davantage, il convient de se reporter à son site internet: https://roadmap2021.esfri.eu/
(2) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(3) JO L 152 du 3.6.2022, p. 1.
(4) Proposition de règlement fixant des règles harmonisées pour l’équité de l’accès aux données et de l’utilisation des données (règlement sur les données), COM(2022) 68 final.
(5) JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.
(6) Hansen J. et al, Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR («Évaluation des règles des États membres de l’UE en matière de données de santé du point de vue du règlement général sur la protection des données»), disponible sur le site de la Commission européenne à l’adresse https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-02/ms_rules_health-data_en_0.pdf
(7) Selon l’analyse d’impact accompagnant la proposition (p. 15), à paraître.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/129 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels et modifiant les règlements (UE) 2017/1001 et 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil et la décision (UE) 2019/1754 du Conseil»
[COM(2022) 174 final — 2022/0115(COD)]
(2022/C 486/17)
|
Rapporteur: |
Paulo BARROS VALE |
|
Consultation |
Conseil de l’Union européenne, 11.5.2022 |
|
Base juridique |
Article 118, paragraphe 1, et article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Marché unique, production et consommation» |
|
Adoption en section |
8.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
227/2/2 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement l’initiative de la Commission qui vise à assurer au niveau de l’Union européenne la protection des indications géographiques (IG) des produits industriels et artisanaux, comblant ainsi le vide législatif qui prévaut actuellement pour ces types de productions. Il s’impose de préserver l’identité régionale et les savoir-faire traditionnels, et la législation en la matière constitue un important instrument au service du développement des régions, étant donné que la protection assurée par les indications géographiques prémunit tant les producteurs que les consommateurs. |
|
1.2. |
Le CESE juge que la protection assurée par les indications géographiques stimule le développement des régions, en particulier celles qui sont moins avancées, car elle constitue un encouragement pour le producteur, en garantissant que ses produits soient reconnus et protégés contre les imitations, elle attire des populations sur leur territoire et les y retient, en offrant des possibilités d’emplois, plus qualifiés et mieux rémunérés, et elle y soutient un tourisme durable, notamment une activité touristique de niche centrée sur leur renommée. |
|
1.3. |
La Commission présente une proposition de règlement relative à la protection des indications géographiques des produits artisanaux et industriels. Le CESE n’est pas certain que l’option qu’elle a retenue soit préférable à celle qui consisterait à élargir le cadre existant, tel qu’applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, vins et spiritueux, de façon à ce qu’il englobe les productions artisanales et industrielles. Cette deuxième option permettrait d’éviter de devoir multiplier les textes législatifs, les procédures et les instances, dès lors qu’elle instaurerait un dispositif unique de protection par les indications géographiques, qui s’appliquerait à tous les types de produits. |
|
1.4. |
Le CESE considère qu’il est primordial que le symbole à utiliser pour signaler une indication géographique soit attrayant et adapté à tous les nouveaux canaux de diffusion, couvrant tout l’éventail allant de l’étiquetage classique à la communication numérique la plus en pointe. Il doit inspirer au consommateur le sentiment d’avoir affaire à un produit de qualité et hautement fiable et faciliter le travail de communication du producteur. Le CESE considère qu’il serait envisageable de mettre à jour le symbole de l’indication géographique protégée qui, en vertu de l’annexe au règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 (1), est actuellement utilisé, et d’élaborer en ce qui le concerne un guide d’identité visuelle. |
|
1.5. |
De l’avis du CESE, il est primordial que dans le domaine de la protection assurée par les indications géographiques, le processus de transition du niveau national à celui de l’Union européenne soit rapide et simple. Il importe de ne pas prolonger dans le temps l’utilisation concomitante des deux systèmes, qui est une source de confusion pour les consommateurs comme pour les producteurs. Par ailleurs, les États membres qui recourent déjà à la protection géographique au titre de l’arrangement de Lisbonne se devront d’afficher rapidement le symbole de l’Union européenne sur les produits concernés, renforçant ainsi l’image de qualité qu’ils véhiculent. |
|
1.6. |
Le CESE recommande à la Commission d’effectuer un suivi attentif des conflits qui peuvent survenir dans les processus de certification, en particulier avec des pays tiers, et d’exercer son pouvoir de négociation. S’il est indubitable que le pouvoir de décider de l’octroi d’une certification doit revenir à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), organisme jouissant d’une compétence reconnue en matière de propriété industrielle, il n’en conviendra pas moins que la Commission établisse un canal de communication avec lui, afin d’analyser les dossiers qui donnent lieu à des hésitations et sont susceptibles de provoquer des litiges. Les régions tranfrontières, au sein de l’Union européenne comme avec des pays tiers, peuvent poser des défis spécifiques, pour ce qui est de dégager les consensus indispensables afin de protéger le producteur comme le consommateur. |
2. Observations générales
|
2.1. |
La proposition de la Commission a pour objectif de garantir que les produits artisanaux et industriels bénéficient au niveau de l’Union européenne d’une protection assurée par les indications géographiques (IG (2)). Ces produits sont exclus du champ d’application du mécanisme de protection actuel concernant ces indications géographiques, qui ne couvre que les produits agricoles et les denrées alimentaires, vins et spiritueux. Il existe, au sein de l’Union européenne, un grand nombre de produits d’origine artisanale et industrielle qui, présentant des caractéristiques uniques liées à leur région d’origine, font continuellement l’objet d’imitations et de contrefaçons et qu’il est urgent de protéger. |
|
2.2. |
L’absence d’un mécanisme de protection à l’échelle de l’Union et l’insécurité juridique découlant soit de l’existence de législations nationales différentes, soit de leur inexistence, ont pour effet qu’il est difficile de protéger les produits artisanaux et industriels présentant des caractéristiques uniques qui sont en rapport avec leur région d’origine. Ces lacunes peuvent conduire à ce que certains d’entre eux disparaissent, tout comme les compétences qui s’y rattachent. Il convient de préserver les produits qui présentent une identité régionale, sont dotés de caractéristiques singulières et font partie intégrante des traditions et de l’identité des régions, et de les exploiter afin de stimuler le développement de ces territoires, d’y assurer la transmission des savoir-faire qui leur sont inhérents, d’y attirer des habitants et de retenir leur population. |
|
2.3. |
En novembre 2019, l’Union européenne a adhéré à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (3). Il convient à présent d’établir un cadre législatif grâce auquel l’Union ait la possibilité de soumettre une liste de ses indications géographiques, pour les placer sous la protection du système, de manière que les producteurs européens puissent profiter de ce mécanisme protecteur. |
|
2.4. |
Comme il a déjà eu l’occasion de l’observer (4), le CESE estime que la protection des indications géographiques dote les producteurs européens d’un précieux instrument, et il est favorable à la création d’un système harmonisé qui protégerait ces indications dans le cas des produits non agricoles. Il juge que ce dispositif aidera lesdits producteurs à présenter leurs productions de qualité d’une manière qui soit plus efficace dans un marché mondialisé, libéralisé et concurrentiel, en générant des retombées positives, lesquelles seront encore plus marquées dans le cas des régions moins développées. |
|
2.5. |
Le CESE avait déjà défendu cette position en 2015, dans son avis sur les indications géographiques de l’Union européenne pour les produits non agricoles (5). En plus de se prononcer pour que la protection assurée par les indications géographiques soit étendue aux produits non agricoles, grâce à une réglementation au niveau de l’Union européenne, le CESE recommande que le nouveau dispositif puisse, dans toute la mesure du possible, se calquer sur le cadre existant couvrant les produits agricoles et les denrées alimentaires, vins et spiritueux. |
|
2.6. |
Le CESE considère que protéger les produits artisanaux et industriels au moyen des indications géographiques est une démarche susceptible d’avoir plusieurs effets positifs, lesquels ont trait à la qualité des productions qui est exigée pour satisfaire aux critères déterminant la protection assurée par ces indications, offrant par là même une sécurité aux consommateurs, à la possibilité d’attirer et de retenir des populations dans la région concernée, grâce à la création d’emplois, plus qualifiés et mieux rémunérés, et du fait de la fierté et de l’aura que confère le sentiment d’appartenir à une aire géographique présentant des caractéristiques exceptionnelles, ou encore au développement d’un tourisme durable, et à l’effet protecteur contre les préjudices subis du fait des imitations et contrefaçons. |
3. Observations particulières
|
3.1. |
La proposition de la Commission se fonde sur les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) qui ont trait à la propriété intellectuelle et à la politique commerciale commune (6). Son objectif est d’établir un système commun de protection pour les produits artisanaux et industriels, c’est-à-dire un droit européen homogène en matière de propriété intellectuelle, et d’instaurer des mécanismes centralisés en matière d’autorisation, de coordination et de contrôle, en concordance avec le système de Lisbonne et en exécution de l’accord conclu par la signature de l’acte de Genève. L’instrument choisi à cette fin est celui du règlement autonome, s’inscrivant dans la continuité de celui qui existe déjà pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, les vins et les spiritueux. Les parties prenantes ont été consultées et se sont dites favorables, en règle générale, à la création d’un système spécifique d’indications géographiques. |
|
3.2. |
En plus de l’hypothèse d’un maintien du cadre réglementaire en vigueur, lequel est fragmenté et n’assure qu’une piètre protection au niveau international, l’analyse d’impact réalisée sur la proposition a examiné trois options stratégiques: option stratégique 1 — étendre le système de protection des IG pour les produits agricoles aux IG pour les produits artisanaux et industriels; option stratégique 2 — règlement autonome de l’Union établissant une protection spécifique des IG; option stratégique 3 — réforme du système des marques. |
|
3.3. |
Le choix s’est porté sur l’option 2, sous la forme d’une proposition de règlement relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Le CESE n’est pas sûr qu’il s’agisse de la meilleure option, car dès lors que la proposition a pour but d’adopter un système identique à celui qui existe pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, vins et spiritueux, la démarche la plus simple pourrait consister à étendre le cadre existant aux produits artisanaux et industriels, soit l’option 1. L’intégration de cette nouvelle catégorie de produits dans le système s’inscrirait alors dans le cadre du processus de révision en cours dans le secteur agroalimentaire, de sorte que les procédures régissant la reconnaissance des indications géographiques seraient ainsi harmonisées sans qu’il faille multiplier les textes législatifs, les procédures et les instances responsables. |
|
3.4. |
En ce qui concerne le lien territorial, le CESE soutient le choix opéré en faveur des indications géographiques protégées (IGP) plutôt que des appellations d’origine protégées (AOP), car il n’est pas indispensable à ses yeux que dans le cas des produits de ce type, la protection envisagée ne soit accordée qu’à ceux dont tous les stades de la production, de la transformation ou de la préparation ont lieu dans l’aire géographique délimitée: un produit artisanal ou industriel peut tout à fait conserver son identité même si l’une de ces étapes se déroule dans une autre région, car c’est de son histoire ou de sa méthode de production qu’il tire son identité. |
|
3.5. |
Le CESE estime que prévoir un dispositif en deux phases, au niveau national dans un premier temps, puis à celui de l’Union, constitue l’option la plus indiquée. Ce sont les États membres qui connaissent le mieux les caractéristiques de leur territoire et des produits susceptibles de bénéficier du système de protection par les indications géographiques et, dans leur cas, il ne se pose pas d’obstacle linguistique. Il n’est guère besoin de préciser que ce système national devra être souple, avoir un coût modique et garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les producteurs, quelle que soit leur origine. |
|
3.6. |
Le CESE est favorable à ce que l’EUIPO (7) soit choisi pour assumer la responsabilité de la phase d’enregistrement au niveau de l’Union européenne. Cet office est une institution des plus expérimentées dans le domaine de la propriété industrielle, qui a fait la démonstration de ses capacités et de ses compétences dans l’exercice de ses responsabilités, et il dispose des outils nécessaires pour effectuer ces enregistrements. La portée de ce choix est d’autant plus cruciale qu’il sera ainsi possible de vérifier s’il n’existe pas d’incompatibilités entre les registres des indications géographiques et celui des marques et brevets. |
|
3.7. |
Le CESE est favorable à ce que les demandes concernant l’enregistrement des indications géographiques, leur annulation ou la modification de leur cahier des charges puissent être soumises directement à l’EUIPO par un groupement de producteurs quand elles émanent d’un État membre qui a demandé à être exempté de l’obligation de désigner une autorité compétente pour gérer la phase nationale de l’enregistrement et des autres procédures relatives à cette catégorie de produits. Il convient, en effet, que même si son pays d’origine ne reconnaît pas qu’il s’impose d’investir dans le système de protection assuré grâce aux indications géographiques, aucun producteur ne se trouve exclu de ce dispositif alors qu’il serait habilité à en bénéficier. |
|
3.8. |
Le CESE se félicite que la possibilité de l’autodéclaration ait été retenue en ce qui concerne la vérification de la conformité avec le cahier des charges d’une indication géographique. Dans ces cas, il est prévu que les États membres procèdent à des contrôles aléatoires. Le CESE tient à signaler que dans les cas où une indication géographique s’étend sur plusieurs États membres ou, tout particulièrement, qu’elle couvre également un pays tiers, lesdits contrôles peuvent être malaisés à effectuer et que des conflits de compétences peuvent même surgir. |
|
3.9. |
Le CESE juge qu’il est positif que les produits artisanaux et industriels soient protégés par un titre européen, qui remplace les régimes nationaux existants. Cette option évite que deux systèmes, européen et national, n’existent en parallèle et garantit une approche homogène. Elle s’avère particulièrement importante pour faciliter la procédure de protection dans les régions transfrontières, grâce à l’uniformisation des procédures. |
|
3.10. |
Le CESE souligne la portée que revêt la définition, figurant à l’article 3 de la proposition de règlement, qui établit qu’un produit est de nature artisanale ou industrielle. Il convient qu’elle suscite un large consensus parmi les parties intéressées, afin de ne laisser place à aucune ambiguïté quant aux produits qui peuvent prétendre à être protégés par les indications géographiques. |
|
3.11. |
Le CESE défend l’idée que le cahier des charges doit tenir compte du facteur de l’innovation, car elle peut contribuer à sauvegarder et développer le patrimoine culturel. Un changement qui est apporté dans une méthode de production sous l’effet d’une technologie ou d’un procédé novateurs mais ne remet pas en question la qualité du produit concerné, son authenticité, son renom ou ses caractéristiques, tels qu’ils peuvent être rapportés à son origine géographique, ne peut avoir pour conséquence qu’il cesse d’être ainsi protégé, ni donner lieu au lancement d’une nouvelle procédure de demande de protection. |
|
3.12. |
Le CESE s’inquiète de l’éventualité qu’en ce qui concerne le choix ou l’utilisation du nom d’une région, ainsi que lors des contrôles après certification, des conflits surviennent entre des États membres, ainsi que, tout particulièrement, avec des pays tiers. Dans le cas des indications géographiques transfrontières, le risque existe qu’un consensus sur la terminologie à employer ne puisse être atteint et que certains producteurs ne soient privés de l’accès à cette protection, et il convient par ailleurs que la Commission soit habilitée, sur un plan politique, à négocier des accords lorsque de telles situations se présentent. Qu’elle soit dotée d’un tel pouvoir est particulièrement important pour ce qui est du contrôle après certification, de manière à ce qu’il soit possible de définir des critères d’évaluation de la conformité qui soient applicables en toute équité de part et d’autre de la frontière. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.
(2) On entend par «indication géographique» toute indication relative à un produit qui est originaire d’une zone géographique particulière et présente une qualité spécifique, une renommée ou une autre caractéristique qui ont un lien intrinsèque avec son origine géographique.
(3) L’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne, qui est administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), donne à ses parties contractantes la possibilité de conférer à leurs indications géographiques une protection qui est obtenue dans un délai rapide, est de haut niveau et vaut pour une durée indéterminée. L’acte de Genève constitue une mise à jour de l’arrangement de Lisbonne et en élargit le champ d’application à toutes les indications géographiques.
(4) JO C 286 du 16.7.2021, p. 59.
(5) JO C 251 du 31.7.2015, p. 39.
(6) Articleso118 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(7) L’EUIPO est l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/133 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants»
[COM(2022) 209 final — 2022/0155 (COD)]
et sur le thème «Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants (BIK +)»
[COM(2022) 212 final]
(2022/C 486/18)
|
Rapporteur: |
Veselin MITOV |
|
Consultation |
Conseil de l’Union européenne, 22.7.2022 Parlement européen, 12.9.2022 Commission européenne, 28.6.2022 |
|
Base juridique |
Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Marché unique, production et consommation» |
|
Adoption en section |
8.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
233/0/1 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) salue la proposition de règlement «établissant des règles destinées à prévenir et lutter les abus sexuels commis sur les enfants» (1) et la stratégie intitulée «Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (2) qui arrivent à point nommé compte tenu de l’utilisation plus précoce et quasi quotidienne d’Internet par les enfants et corrélativement à la demande croissante de matériel pédopornographique constatée par Europol. |
|
1.2. |
Il soutient le volet éducatif de la stratégie car il est fondamental de renforcer les compétences, l’habileté numérique, et la sensibilisation à l’utilisation des données personnelles, pour que tous les enfants, quelle que soit leur situation, utilisent internet en connaissance de cause pour se préserver de ses dangers potentiels. |
|
1.3. |
La formation des responsables légaux, de l’environnement scolaire, éducatif, sportif… est aussi primordiale car de nombreux adultes ne possèdent pas les compétences requises. Le CESE se félicite de l’intention de la Commission d’organiser des campagnes d’éducation aux médias destinées aux enfants et à leurs responsables légaux, à travers les réseaux et les multiplicateurs susmentionnés. Il encourage vivement leur extension à d’autres organisations de la société civile organisée, afin d’accroître leur impact et de développer des solutions créatives, car dans certains États membres, elles ont une longue expérience de terrain et de première ligne. Elles devraient donc également être soutenus financièrement dans leurs activités. |
|
1.4. |
Il soutient le règlement proposé dans son principe, mais il est réservé quant au caractère disproportionné des mesures envisagées et au risque d’atteinte à la présomption d’innocence car elle vise à obliger les entreprises technologiques à scanner les messages, photos ou vidéos postés en ligne, pour détecter d’éventuels abus sur enfants puis, en cas de «certitude», à faire intervenir a posteriori, une «autorité de coordination» désignée par l’État membre, compétente pour demander au juge national ou à une autorité administrative indépendante d’émettre une injonction de détection. |
|
1.5. |
Lutter contre la pédopornographie en ligne est légitime et nécessaire, mais imposer un système de détection privé prima facie d’un certain type de contenu, aussi illicite, illégal et dangereux soit-il, fait peser le risque d’une surveillance généralisée de tous les échanges virtuels. |
|
1.6. |
Le règlement proposé prévoit que les entreprises devraient détecter les modèles de langage liés aux abus sexuels sur enfants, en utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les échanges où des adultes se livrent au grooming. Or, il est facile de constater dans notre vie numérique que les scans algorithmiques ne sont pas infaillibles. Leur utilisation prudente et encadrée est donc essentielle. |
|
1.7. |
Le propos du CESE est de préserver les intérêts de tous, tels que le secret des correspondances et du respect de la vie privée qui sont des exigences constitutionnelles (3). Or, un balayage des services d’hébergement et de communication fait peser un risque notamment sur le cryptage de bout en bout des échanges en ligne. Il demande à la Commission d’améliorer et de préciser le texte afin de préserver le secret des correspondances et le respect de la vie privée. |
|
1.8. |
Le CESE soutient la création d’une nouvelle agence européenne dont les compétences comprennent deux volets essentiels: un pôle opérationnel et un pôle de recherche et analyse, car la lutte contre la pédopornographie et la pédophilie en ligne appelle une coordination des opérations et des analyses du fait de son ampleur internationale. |
|
1.9. |
Le CESE verrait favorablement l’implication d’Eurojust dans l’architecture envisagée par la Commission, car qui dit enquêtes coordonnées, dit instructions judiciaires coordonnées. |
2. Aperçu des mesures prévues par la Commission
|
2.1. |
Le 11 mai 2022, la Commission a présenté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil «établissant des règles destinées à prévenir et lutter les abus sexuels commis sur les enfants» (4) et une stratégie intitulée «Une décennie numérique pour les enfants et les jeunes: la nouvelle stratégie européenne pour un Internet mieux adapté aux enfants» (5). |
|
2.2. |
Ce «paquet» repose sur la résolution du Parlement européen du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (6), des conclusions du Conseil sur l’éducation aux médias et de la recommandation du Conseil du 14 juin 2021 établissant une garantie européenne pour l’enfance (7). |
La stratégie contenue dans la communication
|
2.3. |
La stratégie européenne de l’année 2012 pour un internet mieux adapté aux enfants a joué un rôle central dans la protection, l’autonomisation des enfants en ligne, notamment grâce au réseau des centres pour un internet plus sûr et au portail «betterinternetforkids.eu», mais elle est devenue obsolète car les enfants utilisent plus précocement et plus souvent leur smartphone ou leur ordinateur, et ils en dépendent de plus en plus pour leurs activités scolaires ou récréatives. |
|
2.4. |
La pandémie du COVID-19 et le confinement ont mis en exergue les enjeux de la formation numérique des enfants, enseignants, éducateurs aux dangers potentiels d’internet. Selon Europol, la demande de matériel pédopornographique a augmenté de 25 % dans certains États membres. Les signalements d’enfants visés par des prises de contact à des fins sexuelles («grooming») ont augmenté de plus de 16 % entre 2020 et 2021. |
|
2.5. |
La stratégie proposée par la Commission en mai 2022 repose sur trois piliers:
|
|
2.6. |
Elle s’appuie sur une vaste consultation (8) #DigitalDecade4YOUth organisée de mars à août 2021 par European Schoolnet, avec le soutien du réseau Insafe des centres européens pour un internet plus sûr, complétée par de vastes consultations et elle repose sur le droit des enfants d’être entendus dans tout processus décisionnel qui les touche (9). |
|
2.7. |
Elle a été complétée par un MOOC «Better Internet for Kids» destiné aux enseignants en avril et mai 2021 sur «La culture numérique et la sécurité en ligne: comment la pandémie a mis à l’épreuve nos compétences?». |
|
2.8. |
En outre, des citoyens de l’UE (parents, enseignants, éducateurs, etc.) ont pu répondre à un sondage en ligne basé sur les mêmes questions que la consultation #DigitalDecade4YOUth. |
|
2.9. |
Les conclusions de l’enquête EU Kids Online (10) de 2020, font apparaître qu’une majorité d’enfants utilise leur outil numérique presque «quotidiennement», plus précocément et plus longtemps. |
|
2.10. |
La pandémie de COVID-19 et le confinement ont mis en lumière les enjeux de la formation numérique des enfants et adultes responsables légaux (voir plan d’action en matière d’éducation numérique pour la période 2021-2027 (11)). |
|
2.11. |
En effet, les informations collectées montrent que les enfants sont fréquemment exposés à des contenus, comportements, contacts préjudiciables, illicites, voire illégaux. L’utilisation des médias sociaux ou des jeux interactifs comporte des risques tels que l’exposition à des contenus inadaptés, le harcèlement, le pédopiégeage, les abus sexuels. |
|
2.12. |
Selon Europol (12), pendant les premiers mois de la crise de la COVID-19, la demande de matériel pédopornographique a augmenté jusqu’à 25 % dans des États membres. Le National Center for Missing and Exploited Children aux États-Unis a reçu près de 30 millions de signalements de suspicion d’exploitation sexuelle d’enfants en 2021, et les forces de l’ordre ont été alertées de plus de 4 000 nouveaux enfants victimes. Les signalements d’enfants sujets au grooming ont augmenté de plus de 16 % entre 2020 et 2021. Les enfants handicapés sont en outre particulièrement visés: jusqu’à 68 % des filles et 30 % des garçons ayant une déficience mentale ou physique seront victimes de violence sexuelle avant leur 18e anniversaire (13). |
|
2.13. |
Or, dans la législation existante de l’Union (directive SMA et RGPD), les mécanismes de vérification de l’âge et de consentement parental sont souvent inefficaces car en général les utilisateurs ne sont tenus d’indiquer que leur date de naissance au moment de la création de leur profil en ligne. |
|
2.14. |
Le règlement proposé impose aux fournisseurs de services d’hébergement ou de communication en ligne l’obligation de détecter, signaler et supprimer tout matériel lié à des abus sexuels en ligne sur des enfants. |
|
2.15. |
Il prévoit aussi la création d’une agence européenne pour prévenir et combattre les abus sexuels sur les enfants, faciliter la détection, le signalement et la suppression de contenus en ligne d’abus sexuels sur enfants, à fournir un soutien aux victimes et à constituer un pôle de connaissances, d’expertise et de recherche sur la prévention et la lutte contre les abus sexuels sur enfants. |
Commentaires généraux sur la proposition de règlement
|
2.16. |
Elle repose sur des obligations d’évaluation et d’atténuation des risques à la charge des fournisseurs de services d’hébergement et de services de communications interpersonnelles, avant toute injonction de détection émise par le juge national ou une autorité administrative indépendante désignée par l’État membre. |
|
2.17. |
Le CESE en soutient le principe qui complète les mesures existantes et les rend plus efficaces, grâce aux sanctions à l’encontre des fournisseurs de services d’hébergement et de services de communications interpersonnelles, tout en les rendant responsables de traquer prima facie les photos et vidéos de maltraitance d’enfants. |
|
2.18. |
Mais il est réservé quant aux risques pour le respect de la vie privée et le cryptage des conversations. La surveillance potentielle des échanges virtuels par des opérateurs privés et d’éventuelles accusations sans fondement, ont un caractère susceptible de porter atteinte à la présomption d’innocence. |
3. Observations particulières
Le volet éducatif prévu dans la stratégie
|
3.1. |
L’éducation des enfants et de leurs responsables légaux à l’utilisation des médias sociaux et d’autres outils numériques est fondamentale car les enfants utilisent souvent des produits et services numériques conçus pour les adultes, où le ciblage par des techniques de marketing, les algorithmes peuvent les inciter à ouvrir des contenus destinés à abuser de leur naïveté et de leur méconnaissance des outils numériques, voire à communiquer avec des personnes dangereuses dissimulées derrière des applications ludiques ou d’autres outils utilisés par les enfants. |
|
3.2. |
Souvent, ni les enfants ni les parents ne réalisent la quantité de données personnelles qu’ils partagent sur les médias sociaux. Les compétences et l’habileté numériques, la sensibilisation à l’utilisation des données personnelles sont essentielles pour que les enfants utilisent en connaissance de cause le monde virtuel. |
|
3.3. |
Les parents, éducateurs, enseignants, responsables de clubs, structures de loisirs, etc. ont aussi besoin de ces compétences pour guider les enfants. |
|
3.4. |
Le CESE considère que ce volet éducatif est majeur afin de protéger les enfants dans leur vie numérique et de les rendre autonomes dans le monde virtuel. |
|
3.5. |
En effet, de nombreux enseignants, parents, éducateurs ne possèdent pas les compétences requises, et il leur est difficile de se tenir au courant des évolutions technologiques.
Ces formations doivent aussi inclure un module sur les droits de l’enfant en ligne car les droits de l’enfant sont identiques en ligne et hors ligne. |
|
3.6. |
Ce volet de la stratégie doit reposer sur une coopération étroite à l’échelon européen et international, un renforcement du travail avec la société civile organisée et surtout avec l’école.
Il est fondamental que les programmes nationaux d’enseignement incluent des cours pratiques et obligatoires sur la navigation en ligne et ses risques, tout en étant inclusifs et respectueux de la diversité en général et de l’accessibilité en particulier. |
|
3.7. |
Le CESE apprécie l’intention de la Commission d’organiser des campagnes d’éducation aux médias destinées aux enfants et à leurs responsables légaux, à travers les réseaux précités et des multiplicateurs. Il encourage vivement à les élargir à d’autres organisations de la société civile organisée, pour en accroître l’impact et développer des solutions créatives, car dans certains États membres, elles ont une expérience de terrain et de première ligne de longue date. Le CESE considère que l’éducation joue un rôle critique dans ce contexte, car elle est le pendant de la prévention des abus sexuels en ligne sur les enfants. |
|
3.8. |
Le CESE se joint à la Commission pour encourager le rôle actif des enfants dans les débats stratégiques les concernant en leur accordant un droit de réunion et d’association sur des plateformes sociales en ligne, et les associer à l’élaboration de la stratégie numérique. Il salue donc la création de la nouvelle plateforme européenne de participation des enfants et appelle à ce que la parole des enfants soit suivie et pas seulement entendue. |
4. Les sanctions prévues dans la proposition de règlement
|
4.1. |
Jusqu’à présent, les fournisseurs de services d’hébergement et de services de communications interpersonnelles détectent volontairement les contenus illégaux. Déplorant implicitement l’échec de l’autorégulation, la Commission propose de les contraindre à agir, sous peine de sanction intervenant après une procédure d’enquête diligentée par des autorités nationales. Concrètement, cela signifie que les fournisseurs et les hébergeurs devront prima facie scanner tout ce qui circule sur leurs serveurs. |
|
4.2. |
Le CESE comprend que l’objectif de la Commission n’est pas de priver les citoyens du secret de leurs correspondances, mais il est préoccupé par l’utilisation potentiellement inappropriée de technologies intrusives qui pourraient nuire à la protection de la vie privée si elles n’étaient pas suffisamment bien conçues et encadrées. L’objectif visé est double: recourir à la technologie pour empêcher les abus sexuels sur les enfants et éviter la surveillance généralisée de la correspondance par des opérateurs privés via des algorithmes. |
|
4.3. |
Le CESE considère qu’il faut encadrer les pratiques de développement, de test et d’usage des algorithmes, en encourageant, voire en imposant aux acteurs de construire une gouvernance algorithmique pertinente et efficace pour assurer le bon fonctionnement de leurs outils. Il lui semble nécessaire que des méthodes de calcul d’explicabilité permettent de mieux comprendre les outils afin d’en souligner les biais et dysfonctionnements et donc de réparer le mal avant qu’il ne soit fait aux utilisateurs. |
|
4.4. |
Le CESE relève que la proposition prévoit des enquêtes coordonnées sous le contrôle du juge national, mais il invite instamment la Commission à l’améliorer pour préserver les libertés individuelles. |
|
4.5. |
Le CESE souligne l’importance d’une approche équilibrée, car le système envisagé consiste à analyser messages, photos ou vidéos pour détecter d’éventuels abus sur enfants et, en cas de «certitude», à alerter les autorités compétentes. Il est nécessaire que le mécanisme d’alerte englobe la nécessité, l’efficacité, la proportionnalité et l’équilibre des mesures envisagées. |
|
4.6. |
Il rappelle que dans l’affaire Schrems I (14), la Cour de justice a jugé que la législation permettant aux pouvoirs publics d’accéder de manière générale au contenu des communications compromet l’essence du droit à la vie privée garanti par la Charte des droits fondamentaux. La numérisation de contenu enregistré sur un serveur impliquant une analyse de toutes les communications passant par un serveur fait donc surgir des doutes. |
|
4.7. |
La responsabilité du traçage pèsera sur les plateformes et/ou les médias sociaux qui pourraient donc être sollicités pour traquer les matériaux d’abus d’enfants, sous peine de devoir payer des amendes à hauteur de 6 % de leur chiffre d’affaires mondial. Elles devraient utiliser l’intelligence artificielle et détecter des modèles de langage pour que les échanges où des adultes pratiquent le grooming puissent être bloqués. L’utilisation adéquate des scanners algorithmiques est donc essentielle pour éviter des erreurs engendrant des accusations non fondées, car ils ne sont pas infaillibles. |
|
4.8. |
La Commission prévoit aussi d’obliger les plateformes à évaluer le risque que leurs services soient utilisés pour diffuser des images pédopornographiques ou le grooming, et de favoriser un «code de conduite global de l’UE relatif à une conception adaptée à l’âge» (15), assorti de conditions générales qui laissent le CESE perplexe. |
|
4.9. |
Elle précise que les États membres devront désigner une autorité indépendante chargée de surveiller que les plateformes remplissent leurs obligation, autorité habilitée à demander le cas échéant au juge national ou à une autorité administrative indépendante d’émettre une injonction de détection, limitée dans le temps, ciblant un type de contenu spécifique sur un service donné, et de demander à l’entreprise concernée de rechercher tout contenu lié à des abus sexuels sur enfants ou aux fins de grooming, voire de pédopiégeage. |
|
4.10. |
Si ces autorités indépendantes estimaient qu’un service était trop risqué pour les enfants, elles pourraient demander aux fournisseurs de services d’hébergement et de services de communications interpersonnelles de numériser leur contenu et des échanges pendant une période précise. Le CESE préférerait que l’application de ce dispositif soit placée sous le contrôle effectif et préalable du juge national, en sa qualité de gardien des libertés individuelles, et considère que la compatibilité de ce type d’ordonnance avec la Charte des droits fondamentaux est sujette à caution. |
|
4.11. |
Si la proposition était adoptée en l’état, le règlement forcerait les entreprises technologiques à surveiller leurs plates-formes pour détecter les abus sur des enfants, grâce à des algorithmes. |
|
4.12. |
Même si le but poursuivi est louable, le CESE considère qu’il existe un risque d’entraver le respect de la correspondance privée en ligne, du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, et que tout doit être mis en œuvre pour l’éviter. |
|
4.13. |
Le propos du CESE est de préserver les intérêts de toutes les personnes, car certains d’entre eux sont des exigences constitutionnelles; c’est le cas du secret des correspondances et du respect de la vie privée (16). |
|
4.14. |
Il souligne que la perspective d’une obligation de balayage général des services d’hébergement et de communication fait peser un risque sur toutes les techniques destinées à garantir le secret des correspondances, comme le cryptage de bout en bout. |
|
4.15. |
La Commission reconnaît d’ailleurs que trouver des échanges où des adultes pratiquent le grooming est «de façon générale la plus intrusive pour les utilisateurs», parce qu’elle exige de «lire automatiquement des communications interpersonnelles». |
5. La création d’une nouvelle agence européenne
|
5.1. |
La proposition de règlement prévoit de créer une agence européenne indépendante basée à La Haye, aux côtés d’Europol, dotée d’un budget de 26 millions d’euros, qui sera chargée d’analyser les signalements de matériel illégal, de coordonner les bases de données d’empreintes digitales et de matériel illégal et d’aider les entreprises à trouver des technologies fiables.
Elle servirait aussi d’intermédiaire entre les entreprises technologiques, les forces de l’ordre et les victimes. |
|
5.2. |
Le CESE se réjouit que les compétences de cette agence soient organisées en deux volets essentiels: un pôle opérationnel et un pôle de recherche et analyse, car l’importance de lutter contre la pédopornographie et la pédophilie en ligne appelle une coordination des opérations et des analyses. |
|
5.3. |
L’aspect opérationnel est fondamental et justifie qu’elle coopère étroitement avec Europol dont l’efficacité n’est plus à démontrer. L’ampleur européenne et internationale de la délinquance sexuelle en ligne visant les enfants justifie son existence. |
|
5.4. |
Le CESE verrait favorablement l’implication d’Eurojust dans les opérations dans l’architecture envisagée par la Commission, car qui dit enquêtes coordonnées, dit instructions judiciaires coordonnées. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) COM(2022) 209 final.
(2) COM(2022) 212 final.
(3) La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée
(4) COM(2022) 209 final — 2022/0155 (COD).
(5) COM(2022) 212 final.
(6) JO C 232 du 16.6.2021, p. 2.
(7) JO L 223 du 22.6.2021, p. 14.
(8) https://europa.eu/!XXv6kx
(9) Article 12 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
(10) EU Kids Online.
(11) COM(2020) 624 final.
(12) https://europa.eu/!Jh78ux
(13) Children with disabilities.
(14) Affaire C-362/14, paragraphe 94.
(15) COM(2022) 212 final.
(16) La constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/139 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE
[COM(2022) 204 final — 2022/0147 (COD)]
(2022/C 486/19)
|
Rapporteur: |
Gonçalo LOBO XAVIER |
|
Consultation |
Parlement européen, 18.5.2022 Conseil de l’Union européenne: 23.5.2022 |
|
Base juridique |
Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Marché unique, production et consommation» |
|
Adoption en section |
8.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
229/0/3 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) accueille favorablement l’initiative de la Commission visant à modifier la directive 2011/83/UE en ce qui concerne les contrats de services financiers conclus à distance et abrogeant la directive 2002/65/CE. L’évolution de la société et des comportements, les nouvelles solutions techniques qui émergent et le renforcement du marché unique comme moyen de garantir la libre circulation des services financiers et les règles de protection des consommateurs sont autant de facteurs qui rendent cette démarche nécessaire. La crise de la COVID-19 a constitué un formidable test de la résilience de l’Union européenne et imposé des tendances et des idées nouvelles, qui doivent être prises en compte. C’est dans cette perspective également que le CESE soutient la proposition à l’examen. |
|
1.2. |
Le CESE est certes favorable à la proposition de directive, mais il insiste néanmoins sur la nécessité d’investir dans les compétences numériques et financières des citoyens afin de permettre aux consommateurs de bien comprendre leurs droits et leurs obligations en rapport avec les contrats financiers conclus à distance, en particulier le droit de rétractation d’un contrat et celui d’obtenir des informations complémentaires au stade précontractuel. Il est nécessaire que les États membres investissent dans un programme de communication stratégique afin de renforcer le potentiel du marché unique, dans le respect des droits fondamentaux des consommateurs. |
|
1.3. |
Le CESE affirme qu’une approche ménageant un bon équilibre entre l’expérience numérique et celle du commerce dans les établissements physiques revêt une importance cruciale. S’il porte un regard favorable sur les avancées rendues possibles par l’innovation technologique, il n’en souligne pas moins que les contacts humains restent essentiels dès lors qu’il est besoin d’apporter des précisions et que la protection des données est en jeu. Le CESE n’est pas sans savoir que la numérisation et la modernisation revêtent une grande importance s’agissant d’améliorer le bien-être des citoyens, et il observe également que subsistent de nombreuses différences entre les États membres, et même d’une région à l’autre, et que d’aucuns en appellent au maintien d’un certain nombre de composantes de l’infrastructure «physique» afin de soutenir le tissu local. Le CESE est convaincu que la démarche consistant à associer les autorités locales aux processus de prise de décision des entreprises financières, en particulier pour ce qui concerne l’existence d’infrastructures physiques dans les zones rurales, pourrait contribuer à soutenir ce tissu local. Le CESE demande que soit garanti le droit à une «intervention humaine» dans le cadre des services financiers à distance. |
|
1.4. |
Le CESE partage avec les organisations de la société civile qui sont représentées en son sein la conviction que le marché unique peut constituer un outil à même de renforcer le projet européen. Améliorer la confiance dans nos systèmes financiers est un principe fondamentalement utile à la société dans le domaine des services financiers aux consommateurs. À cet égard, le CESE attire également l’attention sur la nécessité d’investir de manière cohérente dans la cybersécurité. Les citoyens doivent être conscients des risques liés à la conclusion de contrats à distance. Plus encore, c’est leur confiance à l’égard du système qui est indispensable si nous voulons renforcer le marché unique et la libre circulation des services financiers, qui acquièrent une importance grandissante, et ce d’autant plus au lendemain de la situation créée par la COVID-19 et en particulier face au développement des activités de commerce en ligne et des services numériques. |
|
1.5. |
Le CESE rappelle à la Commission qu’il est nécessaire d’harmoniser la proposition à l’examen avec la directive relative aux droits des consommateurs. Après tant de progrès obtenus dans le cadre de cette même directive, et sans oublier le lancement du «Nouvel agenda du consommateur» (1), le dossier dont il est question ici concernant les services financiers à distance représente la parfaite occasion de faire mieux respecter les droits des consommateurs et de stimuler les investissements consentis par les entreprises dans ce domaine. Le CESE demande que les organisations de la société civile soient associées aux démarches afin de mieux préparer la mise en œuvre prochaine de la directive et d’en améliorer le suivi. Il s’agit d’un bon exemple de domaine dans lequel les organisations de la société civile peuvent apporter leur appui et leur contribution à un environnement amélioré et concourir à l’adoption d’une approche constructive. |
|
1.6. |
Les mécanismes de l’intelligence artificielle (IA) peuvent fournir un environnement sûr et fiable aux fins de la proposition de directive à l’examen. Le CESE a bien conscience de l’action puissante que l’innovation exerce pour la société et il plaide pour que tout soit mis en œuvre afin de procurer aux consommateurs et aux entreprises une expérience sécurisée et moderne dans ce domaine. Le CESE travaille depuis un certain temps sur ces questions et il recommande vivement que l’IA soit utilisée afin de bâtir un marché unique amélioré et plus intégré, placé au service des citoyens et garant d’opérations sécurisées au sein du système financier (2). |
|
1.7. |
Compte tenu des objectifs et des principes qui sont ceux du marché unique, le CESE fait valoir que l’Union européenne peut établir de bonnes pratiques en matière de réglementation des services financiers à distance. Si la proposition à l’examen met en avant des mesures pertinentes pour les entreprises et les consommateurs, le CESE insiste néanmoins sur le besoin de clarifier les activités des entreprises établies en dehors de l’Union, qui peuvent avoir des retentissements sur les citoyens européens. Le CESE estime qu’il faut aussi tenir compte du besoin d’harmonisation et s’y conformer en conséquence. |
|
1.8. |
Le CESE demande que des mesures soient prises concernant des règles et normes relatives à la publicité en rapport avec le processus sensible que représente la prestation de services financiers à distance. Il est crucial d’harmoniser les règles encadrant la publicité pour ces services afin de prévenir la concurrence déloyale et un fonctionnement délétère pour le système. Pour autant que le message soit adressé avec force, les résultats devraient en bénéficier aux entreprises et aux citoyens, et exercer une influence positive sur le comportement des consommateurs, y compris au regard des questions de durabilité. Le CESE insiste aussi sur la nécessité d’associer à ces démarches les organisations de consommateurs afin de faire émerger un dialogue plus constructif entre les entreprises et les citoyens. |
|
1.9. |
Enfin, le CESE considère que, pour améliorer la mise en œuvre de la directive et tirer véritablement profit de ses principes, il est crucial d’investir dans les infrastructures afin d’obtenir de meilleurs résultats. Des services améliorés et plus transparents pourront sans nul doute procurer des avantages aux citoyens, mais encore faut-il que ces derniers aient accès à la 5G, à une couverture de réseau complète, ainsi qu’à d’autres installations d’infrastructure dans tous les domaines, ce qui est encore loin d’être vrai partout. Le CESE plaide pour une utilisation plus opérante et efficace des ressources financières au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, afin de répondre à ces besoins d’investissement et de veiller à ce que personne ne soit oublié. |
2. Observations générales
|
2.1. |
La directive 2002/65/CE concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (ci-après la «directive concernant la commercialisation à distance de services financiers») vise à assurer la libre circulation des services financiers au sein du marché unique en harmonisant certaines règles de protection des consommateurs dans ce domaine, et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. Il importe de souligner qu’il existe déjà un certain nombre de directives et règlements qui, à date récente, ont établi des normes élevées de protection des consommateurs, et la proposition de nouvelle directive a le mérite d’apporter un filet de sécurité là où cette protection est manquante ou risquerait de l’être. Dans la mesure où il n’existe pas de législation de l’Union spécifique aux produits ou de règles horizontales de l’Union couvrant le service financier aux consommateurs en question, la directive s’applique horizontalement à tout service présent ou futur ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements ou aux paiements, contracté par une technique de communication à distance (c’est-à-dire sans qu’il y ait présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur). La directive définit les informations à fournir au consommateur avant la conclusion du contrat à distance (informations précontractuelles), accorde, pour certains services financiers, un droit de rétractation au consommateur et établit des règles sur les services non sollicités et les communications non sollicitées. |
|
2.2. |
La commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs a rapidement évolué au cours des 20 dernières années. Les prestataires de services financiers et les consommateurs ont abandonné le télécopieur, et de nouveaux acteurs (tels que les entreprises de technologie financière) dotés de nouveaux modèles économiques et de nouveaux canaux de distribution (par exemple, les services financiers vendus en ligne) sont apparus. |
|
2.3. |
La proposition de la Commission vise à simplifier et à moderniser le cadre législatif en abrogeant la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers existante tout en incluant les aspects pertinents des droits des consommateurs concernant les contrats de services financiers conclus à distance dans le champ d’application de la directive relative aux droits des consommateurs applicable horizontalement. |
|
2.4. |
L’objectif général de la législation reste inchangé: promouvoir la fourniture de services financiers au sein du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. Cet objectif est atteint de cinq manières distinctes:
|
3. Les services financiers et le marché unique
|
3.1. |
Le CESE considère que l’Union européenne dans son ensemble fait face à de graves défis dans le sillage de la crise de la COVID-19, avec l’agression de l’Ukraine par la Russie et une crise financière qui s’annonce à l’horizon. De fait, la confiance des consommateurs est ébranlée. Par ailleurs, le haut niveau d’endettement des ménages est un problème qui doit être traité et qui est encore loin d’être surmonté. Ces éléments doivent être pris en considération dans le contexte de toute mesure relevant des politiques financières. Il est crucial que les consommateurs jugent le système digne de confiance pour que cette confiance s’installe et pour assurer le redressement de nos économies et de la société. |
|
3.2. |
Le CESE convient de la nécessité d’une harmonisation. Celle-ci ne saurait toutefois être opérée au désavantage ou au préjudice des citoyens. Il faut bien comprendre que tous les citoyens n’embrassent pas au même rythme le processus de la numérisation et que celui-ci ne doit laisser personne de côté. Le CESE estime que l’investissement dans les compétences financières doit constituer une priorité, en rapport étroit avec la proposition à l’examen. |
|
3.3. |
Il importe de veiller à ce que la protection des données soit placée au centre de ce processus. Les citoyens européens doivent pouvoir en toute confiance partager leurs données à des fins juridiques et pour faire valoir leurs droits en tant que consommateurs, ce qui n’est possible qu’à condition de disposer d’un système solide et fiable. La protection des données figure aujourd’hui au premier plan des préoccupations des citoyens, et la cybersécurité apparaît essentielle pour renforcer le processus de communication dans le cadre des services financiers à distance. |
|
3.4. |
Il est indispensable de veiller à ce que la proposition à l’examen soit harmonisée avec la directive relative aux droits des consommateurs. Il est tout aussi crucial de faire en sorte que les principes du «Nouvel agenda du consommateur» (3) s’inscrivent au cœur de cette démarche. Le CESE a la conviction que la société civile organisée et les partenaires sociaux peuvent jouer un rôle positif dans le processus, avant tout en aidant les citoyens à défendre leurs droits, mais aussi en créant une atmosphère constructive au sein de laquelle les entreprises peuvent se livrer concurrence et créer des services améliorés et plus clairs pour les consommateurs. |
|
3.5. |
Les mécanismes de l’intelligence artificielle sont d’une importance centrale pour la proposition de directive. Ils pourraient faciliter les opérations des consommateurs en fluidifiant les processus et les exigences connexes, en particulier pour les citoyens qui y sont moins bien préparés ou moins «adeptes» du numérique. Le CESE demande que ces outils fassent l’objet de clarifications et qu’il en soit fait usage dans la perspective d’un aboutissement plus fructueux du processus de mise en œuvre à venir. |
|
3.6. |
Le CESE préconise des conditions de concurrence équitables dans ce domaine, de sorte que chaque acteur (chaque entreprise) puisse offrir aux citoyens un service fiable. Par conséquent, il est essentiel d’investir dans la transparence et d’adresser des messages clairs afin d’éviter que des pays tiers ne livrent une concurrence déloyale qui risquerait de saper les effets positifs escomptés dans la proposition de directive. |
4. L’impact sur les consommateurs et les entreprises: opérations en ligne et hors ligne
|
4.1. |
La numérisation est une nécessité pour stimuler la compétitivité et faciliter la vie au quotidien. Le CESE juge essentiel de faire en sorte que chacun puisse évoluer dans des conditions propices et disposer du même niveau de connaissances. Cette aspiration est toutefois loin d’être une réalité. |
|
4.2. |
Le CESE en appelle à une «numérisation intelligente», où la technologie est placée au service des citoyens, facilite la communication et favorise le bien-être de la population. Cependant, la numérisation n’est pas une panacée ni une fin en soi, et il s’agit plutôt de la faire cadrer avec d’autres priorités. Le niveau des connaissances de la population concernant l’utilisation des technologies reste très inégal dans l’Union, et il est nécessaire de réaliser des investissements en gardant ce constat à l’esprit. Enfin, le CESE rappelle à la Commission que, si l’usage des technologies est important, le droit à la «déconnexion» ne l’est pas moins, et il convient de prendre cet aspect en considération dans le processus d’élaboration des politiques. |
|
4.3. |
Les entreprises financières doivent veiller à ce que tous les changements soient bien perçus par le marché. La communication est par conséquent essentielle pour obtenir des résultats et guider le processus de transformation. |
|
4.4. |
Le CESE est évidemment favorable aux technologies et innovations susceptibles d’apporter une meilleure expérience de consommation et de faciliter la vie des citoyens. L’évolution des comportements des consommateurs offre l’occasion d’imprimer un changement positif ainsi qu’une chance de renforcer la résilience et la durabilité des opérations dans le domaine des contrats financiers conclus à distance. Le CESE estime que les règles régissant la publicité doivent être claires et harmonisées avec d’autres opérations connexes qui peuvent avoir un impact sur les consommateurs. Il est nécessaire de garantir les droits et les obligations des consommateurs. |
|
4.5. |
Le CESE considère que la proposition à l’examen est conforme à la charte des droits fondamentaux et, partant, au principe de proportionnalité pour ce qui concerne les sanctions imposées aux entreprises et aux consommateurs dans ce domaine. Il estime qu’il s’agit là d’un aspect très positif, qui mérite d’être souligné. Le CESE tient pour principe fondamental que la sévérité des sanctions doit refléter la gravité de l’infraction, en l’occurrence les infractions à la protection des consommateurs au sens de la proposition de directive. |
|
4.6. |
Le CESE juge primordiale la nécessité d’adopter une approche équilibrée en ce qui concerne le droit de demander une assistance humaine au sujet des contrats financiers conclus à distance. Un large pan de la population continue d’avoir besoin de ce type d’assistance, et les banques et établissements doivent avoir conscience de ces limites. Cet aspect doit être pris en compte lorsque les établissements prennent des décisions en matière d’investissement et quant au maintien de certains services «physiques». |
|
4.7. |
Le CESE estime que non seulement les banques, mais tous les établissements financiers, doivent investir dans des systèmes d’éducation et de formation afin d’aider leurs employés à apporter une assistance aux consommateurs. Les services financiers à distance sont certes très importants, mais les ressources humaines qui assurent une assistance dans ce domaine le sont aussi. Les employés doivent être dotés des compétences et formations adéquates pour pouvoir orienter les consommateurs. Enfin, lorsque l’IA est utilisée à l’appui des services, une dose d’intervention humaine est nécessaire pour que les interactions avec les consommateurs soient plus efficaces. |
5. Analyse d’impact — le rôle de la société civile
|
5.1. |
Une fois de plus, le CESE attitre l’attention de la Commission et des États membres sur l’opportunité d’associer les partenaires sociaux et la société civile organisée au processus de communication et de mise en œuvre dans le cadre de cette directive. Vu non seulement les connaissances dont ces acteurs disposent, mais aussi et surtout leur présence «sur le terrain», les organisations de la société civile peuvent aider à trouver le ton juste dans la communication, par exemple pour s’adresser à des segments fondamentaux de la société qui vivent en milieu rural ou éprouvent des difficultés pour accéder aux canaux de communication de masse. Les organisations de la société civile représentées au sein du CESE peuvent concourir à la bonne mise en œuvre de la proposition de directive afin d’obtenir de meilleurs résultats et de renforcer la participation des citoyens au processus. |
6. Les services financiers et la facilité pour la reprise et la résilience — la voie à suivre
|
6.1. |
La facilité pour la reprise et la résilience est le principal pilier du plan de relance pour l’Europe, Next Generation EU, conçu pour apporter une aide financière aux États membres afin d’affronter les contrecoups économiques et sociaux de la pandémie de COVID-19 et de rendre l’économie européenne plus résistante à de futurs chocs. Le CESE estime aussi que, dans la perspective d’améliorer le système, les États membres pourraient faire un usage approprié de ce mécanisme afin de faciliter la vie des citoyens dans le domaine dont il est question ici. |
|
6.2. |
La nécessité d’investir dans les compétences numériques et financières pour favoriser l’éducation et la protection des consommateurs apparaît primordiale. Il est essentiel de développer les aptitudes numériques et financières des consommateurs pour atteindre les objectifs de la «stratégie numérique», notamment la mise en place d’un marché performant et le renforcement de la protection des consommateurs. Le CESE est bien conscient de l’importance de la protection de données et il soutient le droit des consommateurs à jouir d’une pleine garantie de cette protection. Le CESE est convaincu qu’un développement équilibré de la commercialisation à distance de produits financiers ne pourra porter ses fruits qu’à la condition que les États membres mobilisent suffisamment de ressources pour relever ces défis et susciter la confiance à l’égard du commerce en ligne de services financiers, et qu’ils mesurent les progrès obtenus dans ce domaine et en fassent rapport à la Commission, laquelle évaluera les résultats et formulera des recommandations de bonnes pratiques. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) JO C 286 du 16.7.2021, p. 45.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/144 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne une flexibilité supplémentaire pour faire face aux conséquences de l’agression militaire menée par la Fédération de Russie — FAST (Assistance flexible aux territoires) — CARE
[COM(2022) 325 final — 2022/0208 (COD)]
(2022/C 486/20)
|
Rapporteure: |
Elena-Alexandra CALISTRU |
|
Consultation |
Parlement européen, 4.7.2022 Conseil de l’Union européenne, 15.7.2022 |
|
Base juridique |
Article 177 et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale» |
|
Adoption en section |
9.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
189/0/1 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Grâce à sa proposition FAST-CARE relative à l’assistance flexible aux territoires (FAST) dans le cadre de l’initiative «Action de cohésion pour les réfugiés en Europe» (CARE), la Commission a pris des mesures supplémentaires des plus nécessaires pour aider les États membres, les autorités locales et les partenaires de la société civile à faire face aux conséquences de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Le CESE se félicite vivement de ce nouveau train exhaustif de mesures qui élargit l’aide déjà prodiguée au titre de l’initiative CARE en apportant un surcroît d’aide et de flexibilité dans le cadre des financements de la politique de cohésion. |
|
1.2. |
Le CESE est également conscient que les effets directs et indirects de cette invasion lancée le 24 février en l’absence de toute provocation ont entraîné une augmentation continue du nombre de réfugiés qui se présentent dans tous les États membres mais tout particulièrement dans ceux qui jouxtent les frontières de l’Union, et il reconnaît donc la nécessité de prendre des mesures supplémentaires. La situation actuelle est sans précédent et nécessite de prendre toutes les mesures possibles et adaptées qu’il y a lieu d’appliquer dans ces circonstances particulières. À cet effet, le Comité considère que FAST-CARE apporte une réponse auxdites circonstances en offrant des financements supplémentaires au titre des défis migratoires qui résultent de l’agression militaire menée par la Russie mais aussi en contribuant à atténuer les retards pris dans la mise en œuvre de projets sous l’effet conjugué de la COVID-19 et des coûts élevés de l’énergie et des pénuries de matières premières et de main-d’œuvre causées par la guerre. |
|
1.3. |
Le CESE n’a cessé de souligner la nécessité d’une réaction immédiate et efficace, par tous les moyens possibles. Les efforts déployés en permanence pour faire jouer la flexibilité dans les financements devraient garantir une efficacité maximale de la mise en œuvre des investissements au titre de la politique de cohésion en vertu du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 et également garantir un démarrage sans heurts des programmes relevant de la période 2021-2027. Le Comité accueille favorablement la possibilité d’accorder temporairement, pour la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion, un taux de cofinancement de 100 % provenant du budget de l’Union. Il salue de même les possibilités de transfert supplémentaires entre le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion, ainsi qu’entre les catégories de régions. |
|
1.4. |
Le CESE se félicite vivement que la Commission reconnaisse le poids du fardeau qui échoit aux autorités locales et aux organisations de la société civile qui œuvrent au sein des communautés locales pour relever les défis migratoires provoqués par l’agression militaire menée par la Russie. Le Comité accueille favorablement la disposition qui prévoit de réserver un pourcentage minimal de 30 % de l’aide au titre des priorités concernées aux autorités locales, aux partenaires sociaux ou aux organisations de la société civile afin de garantir que ces types de bénéficiaires reçoivent une part appropriée des ressources, compte tenu de leur rôle actif dans les actions d’accueil et d’intégration des réfugiés. Toutefois, ce pourcentage pourrait s’avérer trop faible pour les pays qui accueillent un nombre important de réfugiés; aussi convient-il d’étudier plus avant la possibilité de l’accroître pour les pays frontaliers de l’Ukraine. |
|
1.5. |
Le CESE estime qu’il incombe un rôle capital aux organisations non gouvernementales et aux partenaires sociaux en qualité aussi bien d’organismes d’exécution que de partenaires précieux pour mener à bien le suivi de la mise en œuvre de tels programmes; aussi le Comité est-il disposé à animer la poursuite du débat touchant à cet engagement de la part des organisations de la société civile et des partenaires sociaux, que ce soit au sein de l’Union européenne ou en Ukraine. La société civile a démontré toute son efficacité pour apporter une réponse immédiate au cours des premières phases de la guerre; une fois dotée de ressources suffisantes, elle constituera un relais puissant entre les besoins qui se présentent sur le terrain et leur traduction en termes de politiques au plus haut niveau. Le Comité continue de viser à approfondir sa participation dans le cadre de la réponse immédiate et à améliorer son association à long terme à la définition de la stratégie en matière d’intégration alors que la guerre se poursuit. |
|
1.6. |
Le CESE salue la proposition de la Commission de dispenser les États membres de l’obligation de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, afin de leur donner la possibilité, compte tenu mutations rapides que connaît la situation sur le terrain, de réorienter leurs ressources entre objectifs thématiques relevant d’une même priorité d’un même Fonds et d’une même catégorie de région. Le Comité se félicite également de la disposition visant à rendre admissibles, à titre exceptionnel, les dépenses nécessaires pour les opérations achevées ou mises en œuvre intégralement à compter de la date de l’invasion. |
|
1.7. |
Le CESE prend acte de la panoplie de mesures exhaustives qui tiennent compte des besoins qui se présentent au niveau microéconomique ou individuel, consistant par exemple à prolonger et à augmenter le coût unitaire récemment établi autorisé pour couvrir les besoins essentiels des personnes auxquelles a été accordée une protection temporaire et l’aide qui leur est prodiguée, ainsi qu’au niveau macroéconomique ou de l’État membre, consistant par exemple à faciliter la possibilité d’échelonner des opérations des programmes 2014-2020 à celles de la période 2021-2027 afin d’élargir cette possibilité à un plus grand nombre d’opérations accusant des retards, sans affecter les obligations des États membres de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique et aux objectifs de contribution au climat. |
|
1.8. |
Le CESE prend tout aussi dûment acte des dispositions visant à alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres, ainsi que des engagements de la Commission européenne à aider les bénéficiaires et les parties prenantes en offrant un surcroît d’assistance et de conseil, s’agissant par exemple de gérer des contrats de marchés publics qui subissent des dépassements de coûts, ainsi que d’autres mesures non législatives et d’orientation. Le CESE presse la Commission d’œuvrer en lien étroit avec les États membres, les autorités locales et la société civile afin de supprimer toutes les éventuelles charges administratives superfétatoires, tout en faisant preuve d’une transparence complète s’agissant de l’allocation et de l’exécution des mesures visant à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Dans ce contexte, le Comité fait également valoir la nécessité d’associer plus activement la société civile et les partenaires sociaux de l’Union et d’Ukraine afin de garantir l’efficacité de la planification, de la gestion et du suivi des ressources et de faire en sorte que ces dernières parviennent à ceux qui en ont le plus besoin et là où il en est le plus besoin. |
|
1.9. |
Le CESE reconnaît qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures possibles au titre du cadre financier pluriannuel actuel. À cet égard, le Comité approuve l’intention de la Commission de modifier le règlement relatif au cadre financier pluriannuel de sorte à utiliser de manière optimale le reliquat des ressources pour la période 2014-2020 et à permettre une transition sans heurts vers le programme pour la période 2021-2027. Toutefois, il convient de noter que si le Comité n’a eu de cesse de plaider en faveur d’une flexibilité maximale (1) à tous les échelons du début à la fin des programmes afin de s’assurer d’une utilisation aussi complète que possible des ressources disponibles, il estime, au vu de l’accumulation des conséquences directes et indirectes de la guerre en Ukraine, qu’il pourrait également s’avérer nécessaire de prévoir de nouveaux instruments financiers innovants (2). Le Comité a précédemment recommandé à cet égard une solution éventuelle qui consiste en un fonds spécifique de l’Union européenne pour la reconstruction et le développement de l’Ukraine afin de compléter les mesures mises en place pour aider les États membres touchés par la guerre (3). |
|
1.10. |
Le CESE invite le Conseil et le Parlement européen à approuver promptement le règlement à l’examen afin qu’il puisse être adopté dès que possible. L’ampleur du défi commande une réponse collective et mieux coordonnée, tout spécialement alors que la saison froide s’approche à grands pas. |
2. Observations générales
|
2.1. |
Depuis le 24 février, la Commission a présenté un certain nombre de propositions dans le cadre de l’initiative CARE pour faire en sorte de mobiliser rapidement les financements disponibles au titre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD), ainsi que les préfinancements en vertu des programmes REACT-EU, afin de faire face aux conséquences immédiates de la guerre d’agression que mène la Russie contre l’Ukraine, tout en permettant aux États membres de poursuivre leurs efforts en vue d’une relance écologique, numérique et résiliente de leurs économies à la suite de la crise provoquée par la pandémie de COVID-19. |
|
2.2. |
Toutefois, du fait des besoins qui ne cessent de croître, le Conseil européen, le Parlement européen et les régions de l’Union européenne ont invité la Commission à présenter de nouvelles initiatives au titre du cadre financier pluriannuel pour appuyer les efforts que consentent les États membres à cet égard. À l’heure actuelle, un soutien est requis du fait des besoins à plus long terme des civils déplacés, qu’il convient d’aider à s’intégrer en leur fournissant un logement et des soins de santé, ainsi qu’un accès à l’emploi et à l’éducation pendant qu’ils résident dans l’un des États membres de l’Union. Il convient de relever que le problème de la réponse aux besoins à plus long terme des réfugiés touche des collectivités qui ont été déjà durement frappées par la pandémie de COVID-19, du fait par exemple du fardeau pesant sur le système de soins de santé, mais qu’il engendre également de nouveaux problèmes, tels que les aspects touchant à la dimension de genre des actions politiques, comme par exemple le trop faible nombre d’enfants inscrits dans les écoles qui entrave sensiblement l’intégration professionnelle des femmes. |
|
2.3. |
La guerre a suscité des goulets d’étranglement sur la chaîne d’approvisionnement et des pénuries de main d’œuvre. Elle a également exacerbé les hausses des prix des matières premières, notamment pour l’énergie et les matériaux. Cette situation intervient en sus des conséquences de la pandémie et crée des pressions supplémentaires sur les finances publiques et retarde encore les investissements notamment dans les infrastructures. |
|
2.4. |
Le train de mesures FAST-CARE introduit plusieurs modifications significatives de la législation relative à la politique de cohésion pour les périodes 2014-2020 et 2021-2027 afin d’accélérer et de simplifier l’aide aux États membres en vue de l’intégration de ressortissants de pays tiers, tout en continuant à soutenir les régions dans leur redressement après la pandémie de COVID-19. |
|
2.5. |
Les mesures suivantes doivent faire en sorte d’aider davantage ceux qui accueillent des personnes déplacées, qu’il s’agisse d’États membres, d’autorités locales ou d’organisations de la société civile:
|
|
2.6. |
Afin de s’assurer que les investissements soient orientés là où il en est le plus besoin, FAST-CARE introduit deux changements importants:
|
|
2.7. |
Pour ce qui est du soutien concret en vue de résoudre le problème des retards pris dans la mise en œuvre, les projets d’un montant supérieur à 1 million d’EUR, et tout spécialement ceux concernant des infrastructures, financés au titre des programmes de la période 2014-2020 mais qui n’ont pu être achevés à temps en raison des hausses de prix et des pénuries de matières premières et de main-d’œuvre, pourraient continuer à bénéficier d’un financement au titre des programmes pour la période 2021-2027 même lorsque les règles d’admissibilité applicables pour cette dernière période les en excluraient. |
3. Observations particulières
|
3.1. |
Le CESE approuve les efforts déployés par la Commission pour mettre en place des moyens adéquats et efficaces afin d’apporter un soutien financier pour faire face aux conséquences de l’agression militaire russe, qui ont gagné en ampleur et dont les effets se sont étendus. Dès lors, les États membres sont confrontés à un afflux important continu de personnes fuyant l’agression russe. Cette situation vient s’ajouter aux conséquences de la pandémie de COVID-19, notamment la perturbation des chaînes de valeur, qui met en péril les budgets publics axés sur la relance de l’économie, mais risque également de retarder les investissements, en particulier dans les infrastructures. |
|
3.2. |
Le CESE est également conscient, alors que les effets directs et indirects de la guerre en Ukraine ne cessent de s’amplifier au sein de tous les États membres, qu’il est capital de disposer des moyens de faire face aux défis migratoires et aux perturbations des marchés, ainsi que d’y réagir rapidement, grâce à une panoplie de financements, de procédures et d’assistance technique, tous associés avec flexibilité et agilité. |
|
3.3. |
Le CESE souscrit pleinement à l’idée que les financements doivent être mis à disposition au moyen d’un examen ciblé du cadre financier actuel, afin de prévenir toute interruption des financements qui sont nécessaires pour les mesures essentielles d’atténuation de la crise et de soutien aux personnes dans le besoin. Dans des avis précédents (4), le Comité avait déjà recommandé d’allouer aux États membres des ressources supplémentaires sous la forme d’un préfinancement immédiat. |
|
3.4. |
Le CESE se félicite de l’extension de la possibilité de recourir à un cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % pour ces mesures à l’exercice comptable prenant fin le 30 juin 2022 afin de contribuer à alléger la charge pesant sur les finances publiques des États membres, ainsi que de l’augmentation substantielle du préfinancement (5) provenant des ressources REACT-EU qui a fourni aux États membres les liquidités nécessaires pour couvrir les besoins les plus urgents. |
|
3.5. |
Le CESE se félicite également de la proposition de la Commission selon laquelle il convient de prévoir un taux de cofinancement allant jusqu’à 100 % pour les priorités visant à promouvoir l’intégration socio-économique des ressortissants de pays tiers dans le cadre des programmes pour la période 2021-2027. Bien que cette disposition soit assortie d’une date d’expiration au 30 juin 2024, la possibilité qu’elle fasse l’objet d’un réexamen s’appuyant sur les modalités de son usage et qu’elle soit étendue si elle s’avère efficace, ouvre à la voie à une feuille de route en vue d’offrir davantage de flexibilité et de liquidités lorsque surviennent des besoins urgents de financement. |
|
3.6. |
Le CESE approuve vivement la disposition qui prévoit qu’au moins 30 % de l’aide au titre des priorités concernées devrait être accordée aux bénéficiaires qui sont des autorités locales, des partenaires sociaux ou des organisations de la société civile actives au sein des communautés locales afin de garantir que ces types de bénéficiaires reçoivent une part appropriée de ces ressources, compte tenu de leur rôle actif dans les actions d’accueil et d’intégration des réfugiés. Nonobstant, ce pourcentage pourrait s’avérer trop faible pour les États frontaliers de l’Ukraine qui accueillent un nombre sensiblement plus important de réfugiés. Par conséquent, même si ce pourcentage est un minimum, il convient d’encourager une allocation supérieure, d’au moins 50 % de l’aide au titre de la priorité donnée, qu’il conviendra d’octroyer aux bénéficiaires que sont les autorités locales et les organisations de la société civile actives au sein des communautés locales. |
|
3.7. |
Le CESE est conscient de la nécessité de préserver les objectifs initiaux de la politique de cohésion et de l’impératif de ne pas transformer celle-ci en une «aide humanitaire» universelle pour toutes les situations d’urgence susceptibles de survenir. Aussi peut-on tenir pour judicieuses les dispositions qui plafonnent à cette fin le montant total programmé au titre des priorités en matière d’intégration des réfugiés dans un État membre à 5 % de la dotation nationale initiale de cet État membre provenant du FEDER et du FSE+ confondus. Il conviendrait toutefois de prévoir de soumettre ces seuils à un examen préalable afin de laisser une marge de manœuvre suffisante en cas de besoin, notamment dans le cas des États frontaliers. Il est évident que les problèmes qui se posent aux pays qui accueillent la plupart des réfugiés qui fuient l’Ukraine sont plus importants que ceux que rencontrent les autres États membres de l’Union. Aussi, les limites exprimées en pourcentage devraient-elles tenir compte des réalités du terrain et des disparités qui se manifestent dans l’ampleur des défis auxquels sont confrontés les différents États membres. |
|
3.8. |
Le CESE presse la Commission d’œuvrer en lien étroit avec les États membres, les autorités locales et les organisations de la société civile afin de faire l’usage le plus efficace et le plus rapide des possibilités qu’offre FAST-CARE pour aider les réfugiés ukrainiens. Si le règlement à l’examen exige des États membres de rendre compte, dans le rapport final de mise en œuvre, du respect de la condition touchant au minimum de 30 %, le Comité plaiderait plutôt en faveur d’un compte rendu continu, ainsi que de l’association de la société civile au suivi de la mise en œuvre de ces dispositions. |
|
3.9. |
Les observations développées ci-dessus sont également applicables à la planification, à l’application et au suivi des programmes en rapport avec la mise en œuvre de la politique de cohésion, ainsi qu’au processus de sélection des projets qui seront choisis pour être réalisés. Dans ce contexte, il convient de prêter tout particulièrement attention au risque de transformer la politique de cohésion en une panoplie de réponses dispersées aux situations d’urgence qui ont ébranlé notre continent. |
|
3.10. |
Pour parvenir dans les faits à un taux d’absorption approprié, symptomatique d’une efficacité maximale dans l’utilisation des ressources existantes, il convient de s’attacher avant tout à susciter une synergie manifeste entre d’une part, les principes de la cohésion et les objectifs primordiaux de cette politique et d’autre part, les nouvelles réalités sociales, économiques et environnementales touchant aux pénuries de main d’œuvre, aux difficultés que connaît la chaîne d’approvisionnement, à la hausse des prix et des coûts de l’énergie. |
|
4. |
Le CESE prend acte du choix de la Commission de ne pas prolonger d’une année supplémentaire la règle N+3 au titre de période 2014-2020, ainsi que de son avis selon lequel FAST-CARE est neutre sur le plan budgétaire pour la période 2021-2027, en dépit de l’engagement anticipé de crédits de paiement pour 2022 et 2023 principalement au titre des préfinancements, et ne requiert pas de modifier les plafonds annuels du cadre financier pluriannuel en matière d’engagements et de paiements. Toutefois, le CESE encourage vivement la Commission à suivre l’incidence des modifications proposées et à prévoir une marge de manœuvre pour faire face aux besoins ou aux priorités qui surviennent ou gagnent en ampleur. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Exposé de position du CESE sur le thème «COVID-19: Fonds structurels et d’investissement européens — Flexibilité exceptionnelle».
(2) Dans ses avis, le CESE a constamment souligné la nécessité de faire en sorte que le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 offre la possibilité d’adjoindre de nouveaux instruments financiers innovants, allant au-delà des dispositifs prévus dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience (JO C 364 du 28.10.2020, p. 132), du règlement faisant l’objet de l’avis COVID-19: Fonds structurels et d’investissement européens — Flexibilité exceptionnelle, du règlement relatif à l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus et du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)/crise de la COVID-19.
(3) Avis du CESE sur le 8e rapport sur la cohésion (JO C 323 du 26.8.2022, p. 54).
(4) Exposé de position du CESE sur REACT-EU.
(5) Dans des avis précédents, le CESE n’a cessé de faire valoir qu’il est souhaitable d’accroître le pourcentage de paiements par avance ou de préfinancement, mais qu’il convient de faire bien davantage pour s’assurer d’une mobilisation aussi rapide que possible des ressources financières. Il en a ainsi fait état dans l’exposé de sa position sur l’aide financière aux États membres touchés par une urgence de santé publique majeure».
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/149 |
Avis du Comité économique et social européen sur le travail décent dans le monde
[COM(2022) 66 final]
(2022/C 486/21)
|
Rapporteure: |
Maria del Carmen BARRERA CHAMORRO |
|
Consultation |
Commission européenne, 2.5.2022 |
|
Base juridique |
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» |
|
Adoption en section |
6.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
22.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
132/23/33 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) souligne qu’il importe que la Commission mette en place une stratégie visant à promouvoir le travail décent dans le monde, et pas seulement au sein de l’Union européenne (UE). Le CESE relève que la Commission présente, parallèlement à une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité, une communication sur le travail décent dans le monde pour une transition juste et une reprise durable — qui réaffirme l’engagement de l’UE à défendre plus efficacement le travail décent au moyen de règles, de politiques de commerce et d’investissement — ainsi qu’un instrument visant à interdire l’entrée dans l’Union européenne de produits issus du travail forcé, y compris en provenance de pays situés en dehors du marché intérieur. Le CESE se félicite que le nouveau cadre associe aux interdictions qu’il édicte un système de garantie de leur exécution, fondé sur des normes internationales et des obligations de diligence et de transparence. Il juge toutefois opportun que la Commission procède à une évaluation de son impact économique, social et environnemental, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME). |
|
1.2. |
Le CESE constate qu’en dépit d’améliorations, le travail décent n’est toujours pas une réalité pour de nombreuses personnes, partout dans le monde. Face à cette situation inquiétante, la Commission constate que la pandémie de COVID-19 et les transformations du monde du travail, en raison des progrès technologiques, du changement climatique, de la transition démographique et de la mondialisation, confrontent les entreprises à de sérieux défis. Ces défis peuvent également avoir une incidence négative sur le respect effectif des normes en matière de travail et de protection sociale pour les travailleurs du monde entier. Le CESE est convaincu que l’Union européenne doit continuer à renforcer son rôle de chef de file socialement responsable dans le monde en utilisant et en développant tous les instruments disponibles, y compris législatifs. À l’instar de la Commission, le CESE relève que les consommateurs réclament de plus en plus de biens et de services produits de manière inclusive, durable et équitable, garantissant un travail décent aux personnes qui les produisent, y compris celles qui travaillent dans l’économie informelle. |
|
1.3. |
Le CESE accueille favorablement le fait que la communication, adoptée par la Commission pour promouvoir le travail décent dans tous les secteurs et domaines d’action, propose une approche globale à l’intention de tous les travailleurs actifs sur les marchés nationaux, dans les pays tiers et dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Le CESE souligne que l’Union doit utiliser toutes ses politiques, tant internes qu’externes (y compris la politique commerciale), pour promouvoir et garantir le travail décent dans le monde, en plaçant cet objectif au cœur d’une reprise durable et inclusive et de la transition numérique. |
|
1.4. |
Le CESE se félicite que l’UE propose un ensemble complet d’actions et d’instruments ayant une incidence sur la promotion des quatre piliers du concept universel de travail décent, établi par la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, amendée en 2022 et reflétée dans les ODD: promotion de l’emploi; normes garantissant les droits du travail, y compris l’élimination du travail forcé et du travail des enfants; protection sociale adéquate; dialogue social et tripartisme, l’égalité entre les hommes et les femmes étant un objectif transversal. |
|
1.5. |
Le CESE invite instamment la Commission à développer certains aspects du principe du travail décent qui ont aujourd’hui une valeur particulière, tant sociale qu’économique. À titre d’exemple, le CESE souligne, outre l’égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination (promotion d’une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de l’objectif du travail décent), la lutte contre le risque d’exclusion des groupes les plus vulnérables — notamment les personnes handicapées — sur les marchés du travail, la santé et la sécurité au travail, ainsi que le caractère durable de l’emploi dans le contexte de la transition écologique. Tous ces objectifs sont des objectifs transversaux de l’OIT et du programme à l’horizon 2030. Dans ce contexte, le CESE se félicite que la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ait été amendée aux fins d’y inclure le droit à un milieu de travail sûr et salubre. |
|
1.6. |
Le CESE apprécie que la communication de la Commission propose à la fois de renforcer la mise en œuvre des instruments existants et d’adopter de futurs instruments, y compris réglementaires, ressortissant aux quatre piliers de l’Agenda pour un travail décent. Dans le premier domaine, celui des politiques de l’Union ayant une portée en dehors de ses frontières, le CESE se félicite que l’Union promeuve des normes pionnières à l’échelle mondiale en faveur de la responsabilité sociale, de la transparence et de la durabilité de l’activité des entreprises. Il accueille tout aussi favorablement l’adoption par le Parlement européen de la résolution sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (1). |
|
1.7. |
Dans le cadre de son «paquet pour une économie équitable et durable», la Commission a également présenté une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (voir l’avis INT/973). Le CESE considère cette proposition comme une étape importante dans la promotion du respect des droits de l’homme en tant que devoir des entreprises et de leur personnel d’encadrement. Il estime toutefois que la proposition comporte encore de nombreuses lacunes (par exemple, le champ d’application réduit, étant donné qu’elle ne s’applique directement qu’aux grandes entreprises, et seulement de façon indirecte aux PME; ou encore la faible représentation des travailleurs), ainsi que des notions juridiques peu claires (par exemple l’exigence de relations commerciales «bien établies»), susceptibles de se prêter à des applications différentes par les autorités et les juridictions nationales, ce qui crée une insécurité juridique tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Aussi le CESE plaide-t-il en faveur d’un processus de dialogue équilibré entre la Commission, le Parlement et le Conseil afin de remédier à ces lacunes et d’améliorer l’efficacité de l’instrument réglementaire qui sera en définitive approuvé. |
|
1.8. |
Le CESE prend note des difficultés rencontrées par certaines entreprises pour contrôler l’ensemble de leur chaîne de valeur et garantir un travail décent. Il estime toutefois que la manière d’y parvenir ne devrait pas consister à réduire les garanties à cet effet, car cela affaiblit l’efficacité de la mesure, crée une insécurité juridique pour les entreprises et ouvre la voie à une concurrence déloyale. En revanche, le CESE est convaincu que la manière appropriée de remédier à ces difficultés mondiales en matière de contrôle sans entraîner de tels effets négatifs consiste à mettre en place des instruments de soutien et de collaboration adéquats pour garantir l’efficacité des instruments proposés. À cette fin, outre le soutien public et les instruments d’orientation, les canaux de participation des représentants des travailleurs tout au long de la chaîne de valeur et du dialogue social, aux différents niveaux correspondants, peuvent jouer un rôle crucial. Le CESE est convaincu que cette amélioration de l’efficacité de la gouvernance en matière de devoir de diligence tout au long de la chaîne de valeur, qui facilite le travail des entreprises, constitue une raison puissante de reconnaître et de garantir la participation des représentants des travailleurs. |
|
1.9. |
Dans le domaine des relations bilatérales et régionales de l’Union, le CESE apprécie tout particulièrement la proposition de la Commission consistant à utiliser la politique commerciale comme un instrument qui, en favorisant le respect des normes internationales du travail par les entreprises de pays tiers, promeuve le travail décent dans toutes les entreprises et dans tous les pays, y compris les pays voisins. À cette fin, le CESE souligne la proposition de réforme du règlement de l’Union européenne sur les préférences commerciales. Le CESE fait valoir que l’un de ses objectifs est de faciliter les importations en provenance de pays dont les entreprises respectent les exigences sociales, environnementales et du travail, y compris le travail décent. Il est convaincu que cela améliorera un modèle de compétitivité mondiale fondé non seulement sur la justice sociale, mais aussi sur une concurrence loyale entre toutes les entreprises. |
|
1.10. |
Le CESE soutient la décision de l’Union de s’engager activement dans la réforme de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’intégrer la dimension sociale dans la croissance économique mondiale, eu égard aux énormes défis auxquels elle est confrontée (transitions numérique et écologique, vieillissement, prévention des futures pandémies, etc.). L’optimisation de la croissance, de la compétitivité et des bénéfices, aux fins de créer davantage de richesses, d’emplois et de bien-être, passe par la mise en place de cadres et de politiques de transition juste, qui incluent la garantie et la promotion d’un travail décent et durable dans le monde, en suivant une transition juste fondée sur le dialogue social, comme cela s’est fait précédemment. |
|
1.11. |
Le CESE accueille favorablement la proposition d’inclure des mécanismes permettant d’évaluer et de contrôler le respect de la directive relative au devoir de diligence. Il constate toutefois avec inquiétude que ces mécanismes ne prévoient pas de dialogue social avec les partenaires sociaux. Le CESE invite dès lors la Commission à prévoir clairement de tels mécanismes dans le texte législatif proposé. |
|
1.12. |
En outre, le CESE demande que l’UE soutienne un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, et que soit envisagé l’établissement d’une convention de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. |
2. Introduction et contexte
|
2.1. |
La garantie et la promotion du travail décent et de la justice sociale sont au cœur des cadres réglementaires et des politiques qui ont fait l’objet d’un accord tripartite dans l’Agenda pour le travail décent de l’OIT, dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée en 1998 (amendée en 2022) et réaffirmée dans la déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail (2019). De même, veiller à ce que le travail décent devienne la norme dans le monde est au cœur des engagements pris par l’ensemble de la communauté internationale dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD) du programme à l’horizon 2030, en particulier, mais pas uniquement, dans l’objectif no 8. Cet objectif promeut une croissance économique soutenue, partagée et durable qui crée des emplois productifs et un travail décent pour tous. |
|
2.2. |
Le CESE partage l’avis de la Commission européenne selon lequel cette stratégie de défense et de promotion du travail décent dans le monde est non seulement appropriée, mais également nécessaire, dans le cadre du modèle de relance durable établi et financé au titre de NextGenerationEU. Les chiffres fournis par la Commission et par l’OIT ont montré que malgré des améliorations, le travail décent n’est toujours pas une réalité pour de nombreuses personnes dans le monde. Selon les estimations de l’OIT, 4 milliards de personnes n’ont pas accès à la protection sociale et 205 millions sont sans emploi. Un enfant sur dix dans le monde (soit 160 millions d’enfants) est au travail, et 25 millions de personnes sont en situation de travail forcé. En moyenne, près d’une victime sur quatre du travail forcé est exploitée en dehors de son pays d’origine, avec une différence marquée selon le type de situation. En outre, bien que la santé et la sécurité au travail soient un aspect fondamental du travail décent, plus de cinq travailleurs meurent chaque minute dans le monde en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, selon l’OIT. |
|
2.3. |
Le CESE se félicite que l’UE ait décidé de donner un nouvel élan à un modèle de relance économique qui concilie la création de richesses et de possibilités d’emploi dans le monde entier avec la garantie et la promotion du respect des droits de l’homme, du travail décent et de l’environnement. La communication conjointe au Parlement européen et au Conseil sur le renforcement de la contribution de l’Union européenne à un multilatéralisme fondé sur des règles mentionne les difficultés qu’il y a à faire progresser ces objectifs à la suite de la crise pandémique dont ont souffert les personnes, les entreprises et les États. Elle propose dès lors, pour faire avancer les choses, des réglementations, des politiques et des investissements qui garantissent et favorisent une reprise économique numérique, verte et inclusive. |
|
2.4. |
Dans ce contexte, la Commission a présenté 1) une communication au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur un travail décent dans le monde pour une transition juste à l’échelle mondiale et une reprise durable [COM(2022) 66 final du 23 février 2022] et 2) une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité, qui fait l’objet d’un avis distinct du CESE (INT/973), en cours d’élaboration. |
|
2.5. |
Le CESE a déjà fait valoir que les entreprises opèrent de plus en plus par-delà les frontières. Les entreprises multinationales, avec leurs chaînes d’approvisionnement mondiales, sont les principaux acteurs, et les PME en constituent une part toujours plus importante. Le CESE a proposé des initiatives réglementaires et politiques visant à améliorer la durabilité, à garantir le respect des droits de l’homme et à promouvoir le travail décent dans les chaînes de valeur des entreprises (2). |
|
2.6. |
Le CESE reconnaît l’importance des instruments fondés sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour parvenir à un développement équitable, étant donné que la RSE encourage des changements de comportement positifs vers la durabilité environnementale et sociale. Toutefois, le Comité a également attiré l’attention sur la nécessité d’améliorer la situation. Il demande donc à l’UE et à ses États membres de veiller à une mise en œuvre plus efficace des instruments internationaux existants en faveur d’une croissance et d’une reprise durables, équitables et résilientes après la COVID-19, en plaçant le travail décent au cœur de leurs efforts. Le CESE réclame à la fois que l’Union soutienne un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (3) et que soit envisagée l’élaboration d’une convention de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. Le CESE a également exprimé son soutien à un cadre européen obligatoire efficace et cohérent en matière de devoir de diligence et de responsabilité des entreprises, qui soit fondé sur le dialogue social avec les partenaires sociaux et sur une approche multipartite. |
|
2.7. |
Le CESE reconnaît les avantages d’un cadre réglementaire harmonisé de l’UE en matière de diligence raisonnable et de durabilité. Entre autres avantages, il requiert une concurrence loyale de la part de toutes les entreprises, y compris celles de pays tiers opérant dans l’Union, étant donné qu’elles sont soumises à des conditions de concurrence équitables, et il offre une plus grande sécurité juridique. Un tel cadre réglementaire harmonisé facilitera la transition des entreprises et des travailleurs vers une économie neutre pour le climat dans des conditions de justice sociale et du travail pour toutes les chaînes mondiales. En conséquence, le CESE plaide en faveur d’un cadre réglementaire européen cohérent, équilibré, efficace et proportionné s’agissant du devoir de diligence des entreprises. |
|
2.8. |
Le CESE est pleinement conscient de la nécessité urgente de mettre en œuvre un mécanisme de relance financière après la pandémie qui a frappé tous les États membres et de soutenir tous les processus de reprise post-pandémie à l’échelle mondiale, ainsi que les différentes transitions vers une économie verte (neutre en carbone et circulaire) et innovante (numérique), dans des conditions globales de durabilité sociale et environnementale et dans un cadre où prévalent un dialogue social avec les acteurs sociaux et des modèles de gouvernance tripartite. C’est là ce qu’attend le CESE de la nouvelle communication et de la recommandation sur l’avenir du dialogue social. |
|
2.9. |
Le CESE prend note des enquêtes menées par des observateurs internationaux des droits de l’homme, parmi lesquels l’Organisation internationale du travail, le Conseil de l’Europe et la Confédération syndicale internationale (indice CSI des droits dans le monde), qui confirment que l’absence de garanties en matière de droits de l’homme (y compris les garanties pour les droits individuels et collectifs des travailleurs) et le non-respect de l’environnement continuent de croître au niveau mondial. La pandémie n’a fait qu’aggraver la situation dans plusieurs pays du monde où des conditions de vie déjà précaires et abusives se sont encore détériorées. Le travail des enfants et le travail forcé ont également augmenté. |
|
2.10. |
Le CESE reconnaît que les données scientifiques actuelles montrent que les entreprises intègrent de plus en plus de systèmes de gestion fondés sur la RSE et développent leurs modèles commerciaux conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et aux ODD. Toutefois, à l’instar de la Commission, il estime que des améliorations sont possibles. En outre, les progrès sont non seulement plus lents, mais aussi très inégaux. Le CESE est convaincu que le passage à des cadres réglementaires européens harmonisés, complétés par le soutien technique et les orientations pratiques de la Commission, est positif, en particulier pour les PME. Les engagements seront ainsi plus efficaces et profiteront aux entreprises actives sur le marché de l’UE, en leur offrant une plus grande sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables. |
3. Principales actions proposées par la Commission pour promouvoir le travail décent
|
3.1. |
Le suivi des progrès accomplis sur la voie du travail décent est une préoccupation de longue date pour l’OIT, qui promeut des indicateurs permettant de mesurer ces progrès réels. Le CESE juge ce suivi important, dès lors que la Commission a déjà publié une communication sur le sujet il y a plusieurs années (4). Le CESE invite instamment la Commission à mieux mettre en œuvre un programme ambitieux et innovant et à veiller à ce que ces progrès marient effectivement compétitivité et justice sociale. Il souligne en outre que le travail décent n’est pas seulement une question d’emploi et de protection sociale, mais aussi une question de gouvernance, qui doit inclure le dialogue social avec les partenaires sociaux à tous les niveaux de la chaîne mondiale et à toutes les étapes des processus de production. |
|
3.2. |
Le CESE se félicite que l’UE continue de promouvoir son propre programme visant à créer une communauté de travail qui conduise à la réalisation effective de tous les éléments qui participent du concept universel de travail décent de l’OIT et qui soit plus qu’une simple déclaration formelle. Cette vision est cohérente avec l’inclusion de toutes les composantes de la norme internationale du travail décent dans la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998) (5). |
|
3.3. |
Le CESE juge inacceptable que le travail décent soit encore loin d’être une réalité pour des centaines de millions de personnes dans le monde, ce qui nuit à la réalisation effective par la communauté internationale des objectifs de développement durable (ODD) fixés dans le programme des Nations unies à l’horizon 2030. Bien que les ODD soient intégrés dans la notion de travail décent, la récente série de crises, conjuguée aux énormes défis économiques et sociaux de notre époque, menacent quotidiennement le travail décent pour tous (ODD 8 et autres ODD connexes). |
|
3.4. |
L’élimination du travail des enfants et du travail forcé est au cœur de ces efforts. Le travail des enfants concerne un nombre de personnes mineures qui a augmenté de plus de huit millions entre 2016 et 2020, inversant ainsi la tendance précédente à la baisse. Le CESE se félicite de la proposition de la Commission d’élaborer de nouvelles mesures juridiques et autres plus efficaces dans le cadre de la politique de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants, y compris l’interdiction de mettre sur le marché de l’UE les produits fabriqués ou distribués au moyen du travail forcé ou du travail des enfants. À cet égard, il estime nécessaire de compléter le nouveau cadre par une évaluation de l’impact économique, social et environnemental des différentes mesures législatives et non législatives. Le CESE plaide également en faveur d’une intensification de la nouvelle politique commerciale de l’UE, qui constitue l’un des moteurs de la croissance économique, afin de respecter l’engagement de respecter les droits de l’homme internationaux, ses instruments et la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé tout au long de la chaîne d’approvisionnement. De cette manière, les nouvelles mesures s’harmoniseront avec un modèle de reprise économique et de compétitivité mondiale et inclusive. |
|
3.5. |
Le CESE accueille favorablement tant la proposition de directive sur le devoir de diligence que les nouvelles garanties juridiques permettant de lutter plus efficacement contre le travail forcé et le travail des enfants dans l’ensemble de la chaîne de valeur mondiale. Il partage l’avis de la Commission selon lequel les autorités ne peuvent à elles seules remporter la bataille contre le travail forcé. Le CESE accueille tout aussi favorablement l’adoption par le Parlement européen de la résolution sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (6). De nombreuses entreprises privées sont déjà engagées en faveur de ces objectifs, mais elles doivent aller plus loin, conformément à la proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises, qui devrait promouvoir l’efficacité et la proportionnalité de ce cadre cohérent de l’UE pour améliorer la compétitivité. |
|
3.6. |
Le CESE se félicite que la Commission encourage le recours à un cadre juridique cohérent de l’UE et à la politique de marchés publics socialement responsables en tant qu’outils puissants pour lutter en faveur du travail décent et contre le travail forcé et le travail des enfants. Il estime toutefois que pour aller dans ce sens, il s’impose d’appliquer plus efficacement le cadre réglementaire afin de renforcer l’efficacité réelle des clauses sociales et environnementales, tant en ce qui concerne les marchés publics européens que le commerce équitable. |
|
3.7. |
Le CESE se félicite de la proposition de nouveau règlement de l’UE relatif au système de préférences généralisées (SPG) visant à promouvoir le développement durable dans les pays à faible revenu au cours de la période 2024-2034. Il apprécie que le nouveau SPG accroisse les possibilités offertes à l’Union d’utiliser les préférences commerciales pour créer des débouchés économiques et promouvoir un développement durable respectant la norme du travail décent. L’intégration de conventions relatives à la gouvernance, telles que celle relative à la consultation tripartite, renforcera le rôle du dialogue social avec les partenaires sociaux. |
|
3.8. |
Le CESE prend acte de l’engagement, dans le domaine d’action no 2, de considérer le travail décent comme une priorité du nouvel IVCDCI — Europe dans le monde (7). Ce programme relatif aux droits de l’homme et à la démocratie prévoit des actions spécifiques visant à promouvoir le travail décent pour tous, y compris la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé, en particulier aux niveaux national et régional. Le CESE se félicite que les nouvelles actions de l’IVCDCI — Europe dans le monde comprennent la promotion du dialogue social et une autonomie accrue des partenaires sociaux, ainsi que le dialogue avec les pays partenaires, soit autant d’outils qui contribueront à la ratification et à la mise en œuvre effective des conventions actualisées de l’OIT, en particulier les conventions fondamentales et celles relatives à la gouvernance. |
4. Observations générales
|
4.1. |
Le CESE partage la préoccupation de l’OIT qui veut que les entreprises et les travailleurs les plus touchés par la série de crises qui a débuté en 2008 bénéficient moins de l’amélioration des conditions tant économiques que technologiques, dès lors que les efforts de relance favorisent certains secteurs de l’économie et du marché du travail, tandis que d’autres restent à la traîne. |
|
4.2. |
Le CESE réaffirme que la protection du travail décent dans le monde entier est une exigence de respect de la dignité humaine; il considère par conséquent que cette proposition constitue une étape importante dans le respect et la promotion des droits de l’homme dans les entreprises et espère qu’elle donnera une impulsion significative à la poursuite des progrès. |
|
4.3. |
Toutefois, il estime qu’il existe encore de nombreuses lacunes et notions juridiques peu claires et sujettes à interprétation, susceptibles de se prêter à des applications différentes par les autorités et les juridictions nationales, ce qui crée une insécurité juridique tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Par exemple, le recours à des notions floues telles que celle de «relation commerciale bien établie» ou à de simples «garanties contractuelles» de respect des codes de conduite mettrait en péril l’efficacité de la directive. Le CESE propose à la Commission, d’une part, de clarifier avec rigueur ces concepts juridiques, y compris les lacunes du régime de responsabilité civile prévu, et, d’autre part, d’intégrer des voies pour la représentation syndicale des entreprises au niveau approprié pour en rendre le respect plus effectif. |
|
4.4. |
Le CESE prend note de l’accent placé sur la participation des parties prenantes, qui constitue la base de l’ensemble de la proposition. La participation effective des syndicats et des représentants des travailleurs est en effet un facteur de réussite. Toutefois, le Comité regrette que cela ne soit pas suffisamment pris en compte dans la proposition. Le CESE estime que cette absence de protection, en raison de son impact collectif, est préjudiciable tant aux travailleurs qu’aux entreprises. Dans ce contexte, les vecteurs de participation des représentants des travailleurs organisés déjà opérationnels, par exemple sur la base des travaux des comités d’entreprise européens (CEE) ou des accords-cadres internationaux (ACI), devraient fournir des orientations adéquates et un soutien au nouveau cadre réglementaire. |
|
4.5. |
Le CESE accueille avec satisfaction l’approche globale en matière de travail décent adoptée dans la communication de la Commission. Cette communication tient compte de la volonté des consommateurs de privilégier des modèles de production et de distribution de biens et de services plus respectueux des conditions de durabilité sociale et environnementale. La Commission a constaté que la majorité des consommateurs préfèrent, y compris en matière de commerce électronique, des modes de consommation qui privilégient les produits respectant les normes du travail décent et l’équilibre environnemental. Par conséquent, le CESE demande que ce rôle socialement responsable des consommateurs soit promu par une meilleure information et une meilleure formation, afin d’améliorer l’efficacité des mesures proposées par la Commission pour garantir et promouvoir un travail décent dans le monde. |
|
4.6. |
Le CESE se félicite que la Commission ait accepté la demande du Parlement européen de présenter une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (INT/973). Il note que la proposition de la Commission limite le nombre d’entreprises incluses dans la proposition de directive, restreignant ainsi la portée de la demande du Parlement européen. Le CESE appelle de ses vœux un processus de dialogue entre les trois institutions européennes en vue de parvenir à un accord sur ce cadre réglementaire et cohérent de l’UE portant notamment sur une extension adéquate du champ d’application de la future directive, ce qui améliorera son efficacité, notamment pour ce qui est d’assurer une concurrence loyale entre toutes les entreprises, et comblera certaines des lacunes réglementaires du texte proposé, afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises. |
5. Observations particulières
|
5.1. |
Le CESE prend acte des efforts proposés par la Commission européenne pour que l’Union utilise tous les instruments, les politiques et les ressources relevant de sa compétence (marchés publics, accords commerciaux, politique de développement, politique d’investissement, fonds, etc.) afin de promouvoir le travail décent dans le monde entier. Le CESE demande en particulier un développement et une mise en œuvre plus efficaces de la boîte à outils visant à garantir et à promouvoir des conditions de travail décentes et la ratification des normes internationales du travail, ainsi que l’accomplissement des réformes nécessaires pour soutenir la reprise de l’économie, la compétitivité des entreprises européennes et leur capacité à créer des emplois décents dans le monde. |
|
5.2. |
Le CESE note que la proposition de directive sur le devoir de diligence dans les entreprises durables accorde une grande valeur aux techniques de RSE, telles que les codes de conduite unilatéraux. Ces instruments ne tiennent pas compte de la position des travailleurs. Le CESE juge opportun d’inclure également des techniques de gouvernance collective afin de promouvoir des canaux utiles pour la participation des représentants des travailleurs à l’élaboration et au suivi des engagements en matière de travail décent tout au long de la chaîne de valeur. Comme mentionné au paragraphe 4.4, les accords-cadres internationaux devraient fournir des orientations et un soutien appropriés. |
|
5.3. |
Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel des mesures plus nombreuses et de meilleure qualité sont nécessaires pour lutter efficacement contre le travail forcé. À cette fin, il soutient la Commission s’agissant d’imposer dès que possible une interdiction de mise sur le marché de l’Union des produits (nationaux et importés) qui ont été fabriqués en recourant au travail forcé, y compris au travail des enfants. Dans le même temps, le CESE recommande une analyse des différentes mesures et une évaluation complète des incidences économiques, sociales et environnementales des différentes options. Cette interdiction doit être conforme à la fois aux conditions du commerce équitable et aux engagements pris par l’Union européenne dans le cadre de la politique commerciale commune et en faveur de la compétitivité de l’Europe au niveau mondial. |
|
5.4. |
Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel des mesures supplémentaires sont nécessaires pour lutter efficacement contre le travail des enfants, compte tenu de la grande complexité des facteurs qui en sont à l’origine (notamment les difficultés financières, l’absence de meilleures possibilités d’éducation, les habitudes locales concernant le rôle des enfants dans la société, etc.). Dans le même temps, le CESE plaide en faveur d’une mise en œuvre et d’une application cohérentes des instruments internationaux existants. Il est dès lors nécessaire pour éradiquer le travail infantile de déployer une approche globale (holistique) du développement économique durable fondée sur la norme du travail décent: des ressources pour une éducation de qualité, des revenus décents et une protection sociale suffisante pour tous. |
|
5.5. |
Le CESE attache également une importance particulière à la révision de la directive de l’UE relative à la prévention de la traite des êtres humains et à la lutte contre ce phénomène (8), qui oblige les États membres à l’interdire par la loi, avec pour objectif supplémentaire d’offrir une protection contre le travail forcé (qui touche de manière disproportionnée les femmes et les filles, et en particulier les immigrants, parmi d’autres groupes plus vulnérables). Le CESE s’est déjà félicité de l’approche globale et intégrée de la protection des personnes victimes de la traite des êtres humains (9). |
|
5.6. |
Le CESE souligne l’importance de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes [COM(2021) 391 final], qui vise à mieux exploiter le potentiel du marché unique et de l’union des marchés des capitaux pour contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement, conformément à l’article 2, paragraphe 1, point c), de l’accord de Paris de 2016 sur le climat et au pacte vert pour l’Europe. Dès le départ, le CESE a fait valoir que le pacte vert ne peut être et ne sera couronné de succès qu’à condition d’être également un accord social appelant à une définition plus précise de la notion d’«investissement social» afin d’offrir une plus grande sécurité juridique aux marchés et aux entreprises (10). |
|
5.7. |
Le CESE soutient les travaux de la Commission en vue d’un nouveau règlement de l’UE relatif au système de préférences généralisées (SPG) pour la période 2024-2034. Il note que la Commission a renforcé son soutien à la promotion du respect des normes internationales du travail dans les pays bénéficiaires du SPG, en ajoutant deux nouvelles conventions sur les droits du travail (convention no 81 de l’OIT sur l’inspection du travail et convention no 144 sur les consultations tripartites), et reconnaît que l’exportation de produits issus du travail des enfants et du travail forcé est une cause de retrait des préférences commerciales. Le CESE recommande que le projet de règlement SPG pour la période 2024-2034 inclue la déclaration de l’OIT de 1998 et son amendement de 2022. |
|
5.8. |
En outre, le CESE accueille favorablement l’intention de la Commission de soutenir la réforme de l’OMC afin de continuer à contribuer au développement durable, d’intégrer la dimension sociale de la mondialisation et de favoriser les accords au sein de l’OMC qui promeuvent le travail décent et la justice sociale. Le CESE espère qu’un juste équilibre entre les objectifs sociaux et ceux visant à l’amélioration de la compétitivité économique mondiale sera atteint dans le cadre des processus de négociation ouverts. |
|
5.9. |
Le CESE se félicite de l’inclusion de mécanismes d’évaluation et de suivi du respect de la directive sur le devoir de diligence, et notamment de la mise en place d’un réseau européen des autorités de contrôle afin d’aider à sa mise en œuvre. Toutefois, il constate avec inquiétude que, d’une part, le mandat (la compétence) de cet organe de contrôle n’est pas clairement défini et, d’autre part, que ces mécanismes ne prévoient pas de dialogue social avec les partenaires sociaux. Le CESE invite dès lors la Commission à prévoir clairement de tels mécanismes dans le texte législatif proposé. |
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0245_FR.html
(2) Avis du CESE sur le thème «Des chaînes d’approvisionnement durables et un travail décent dans le commerce international», 2020/02161 (JO C 429 du 11.12.2020, p. 197).
(3) Le CESE a déjà abordé cette question en détail dans son avis «Un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme» (JO C 97 du 24.3.2020, p. 9).
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52006DC0249
(5) www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453911:NO
(6) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0245_FR.html
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32021R0947
(8) Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).
(9) JO C 51 du 17.2.2011, p. 50.
(10) Le CESE élabore actuellement un avis d’initiative en la matière: ECO/581 — «Taxinomie sociale: enjeux et possibilités» (voir page 15 du présent Journal officiel).
ANNEXE
Les amendements suivants, qui ont recueilli au moins le quart des suffrages exprimés, ont été rejetés au cours des débats (article 43, paragraphe 2, du règlement intérieur):
|
AMENDEMENT 3 SOC/727 Le travail décent dans le monde Paragraphe 2.6 Modifier comme suit: |
Proposé par: BLIJLEVENS René GERSTEIN Antje Sabine KONTKANEN Mira-Maria MINCHEVA Mariya MURESAN Marinel Dănuț POTTIER Jean-Michel |
|
Avis de section |
Amendement |
|
Le CESE reconnaît l’importance des instruments fondés sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour parvenir à un développement équitable, étant donné que la RSE encourage des changements de comportement positifs vers la durabilité environnementale et sociale. Toutefois, le Comité a également attiré l’attention sur la nécessité d’améliorer la situation. Il demande donc à l’UE et à ses États membres de veiller à une mise en œuvre plus efficace des instruments internationaux existants en faveur d’une croissance et d’une reprise durables, équitables et résilientes après la COVID-19, en plaçant le travail décent au cœur de leurs efforts. Le CESE réclame à la fois que l’Union soutienne un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (1) et que soit envisagée l’élaboration d’une convention de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. Le CESE a également exprimé son soutien à un cadre européen obligatoire efficace et cohérent en matière de devoir de diligence et de responsabilité des entreprises, qui soit fondé sur le dialogue social avec les partenaires sociaux et sur une approche multipartite. |
Le CESE reconnaît l’importance des instruments fondés sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour parvenir à un développement équitable, étant donné que la RSE encourage des changements de comportement positifs vers la durabilité environnementale et sociale. Toutefois, le Comité a également attiré l’attention sur la nécessité d’améliorer la situation. Il demande donc à l’UE et à ses États membres de veiller à une mise en œuvre plus efficace des instruments internationaux existants en faveur d’une croissance et d’une reprise durables, équitables et résilientes après la COVID-19, en plaçant le travail décent au cœur de leurs efforts. Le CESE réclame à la fois que l’Union soutienne un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme (1) et que l’OIT mène une réflexion sur la mise au point et l’adoption future des instruments pertinents et adaptés (2) concernant le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. Le CESE a également exprimé son soutien à un cadre européen obligatoire efficace et cohérent en matière de devoir de diligence et de responsabilité des entreprises, qui soit fondé sur le dialogue social avec les partenaires sociaux et sur une approche multipartite. |
Résultat du vote:
|
Pour: |
65 |
|
Contre: |
97 |
|
Abstentions: |
13 |
|
AMENDEMENT 4 SOC/727 Le travail décent dans le monde Paragraphe 2.7 Modifier comme suit: |
Proposé par: BLIJLEVENS René GERSTEIN Antje Sabine KONTKANEN Mira-Maria MINCHEVA Mariya MURESAN Marinel Dănuț POTTIER Jean-Michel |
|
Avis de section |
Amendement |
|
Le CESE reconnaît les avantages d’un cadre réglementaire harmonisé de l’UE en matière de diligence raisonnable et de durabilité. Entre autres avantages, il requiert une concurrence loyale de la part de toutes les entreprises, y compris celles de pays tiers opérant dans l’Union, étant donné qu’elles sont soumises à des conditions de concurrence équitables, et il offre une plus grande sécurité juridique. Un tel cadre réglementaire harmonisé facilitera la transition des entreprises et des travailleurs vers une économie neutre pour le climat dans des conditions de justice sociale et du travail pour toutes les chaînes mondiales. En conséquence, le CESE plaide en faveur d’un cadre réglementaire européen cohérent, équilibré, efficace et proportionné s’agissant du devoir de diligence des entreprises. |
Le CESE reconnaît les avantages d’un cadre réglementaire harmonisé de l’UE en matière de diligence raisonnable et de durabilité. Entre autres avantages, il requiert une concurrence loyale de la part de toutes les entreprises qui relèvent de son champ d’application , y compris celles de pays tiers opérant dans l’Union, étant donné qu’elles sont soumises à des conditions de concurrence équitables, et il offre une plus grande sécurité juridique. Un tel cadre réglementaire harmonisé facilitera la transition des entreprises et des travailleurs vers une économie neutre pour le climat dans des conditions de justice sociale et du travail pour toutes les chaînes mondiales. En conséquence, le CESE plaide en faveur d’un cadre réglementaire européen cohérent, équilibré, efficace et proportionné s’agissant du devoir de diligence des entreprises. |
Résultat du vote:
|
Pour: |
73 |
|
Contre: |
100 |
|
Abstentions: |
14 |
|
AMENDEMENT 5 SOC/727 Le travail décent dans le monde Paragraphe 4.6 Modifier comme suit: |
Proposé par: BLIJLEVENS René GERSTEIN Antje Sabine KONTKANEN Mira-Maria MINCHEVA Mariya MURESAN Marinel Dănuț POTTIER Jean-Michel |
|
Avis de section |
Amendement |
|
Le CESE se félicite que la Commission ait accepté la demande du Parlement européen de présenter une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (INT/973). Il note que la proposition de la Commission limite le nombre d’entreprises incluses dans la proposition de directive, restreignant ainsi la portée de la demande du Parlement européen. Le CESE appelle de ses vœux un processus de dialogue entre les trois institutions européennes en vue de parvenir à un accord sur ce cadre réglementaire et cohérent de l’UE portant notamment sur une extension adéquate du champ d’application de la future directive , ce qui améliorera son efficacité, notamment pour ce qui est d’assurer une concurrence loyale entre toutes les entreprises, et comblera certaines des lacunes réglementaires du texte proposé, afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises. |
Le CESE se félicite que la Commission ait accepté la demande du Parlement européen de présenter une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (INT/973). Il note que la proposition de la Commission limite le nombre d’entreprises incluses dans la proposition de directive, restreignant ainsi la portée de la demande du Parlement européen. Le CESE appelle de ses vœux un processus de dialogue entre les trois institutions européennes en vue de parvenir à un accord sur ce cadre réglementaire et cohérent de l’UE et tient notamment à souligner que les décideurs politiques doivent garder à l’esprit l’épineuse situation des micro, petites et moyennes entreprises, et veiller à ce que, dès l’entrée en vigueur de la législation sur le devoir de vigilance, des outils de soutien soient disponibles aux niveaux européen et national (1), ce qui améliorera son efficacité, notamment pour ce qui est d’assurer une concurrence loyale entre toutes les entreprises relevant de son champ d’application , et comblera certaines des lacunes réglementaires du texte proposé, afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises. |
Résultat du vote:
|
Pour: |
68 |
|
Contre: |
97 |
|
Abstentions: |
15 |
|
AMENDEMENT 1 SOC/727 Le travail décent dans le monde Paragraphe 1.7 Modifier comme suit: |
Proposé par: BLIJLEVENS René GERSTEIN Antje Sabine KONTKANEN Mira-Maria MINCHEVA Mariya MURESAN Marinel Dănuț POTTIER Jean-Michel |
|
Avis de section |
Amendement |
|
Dans le cadre de son «paquet pour une économie équitable et durable», la Commission a également présenté une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (voir l’avis INT/973). Le CESE considère cette proposition comme une étape importante dans la promotion du respect des droits de l’homme en tant que devoir des entreprises et de leur personnel d’encadrement. Il estime toutefois que la proposition comporte encore de nombreuses lacunes (par exemple, le champ d’application réduit, étant donné qu’elle ne s’applique directement qu’aux grandes entreprises, et seulement de façon indirecte aux PME ; ou encore la faible représentation des travailleurs), ainsi que des notions juridiques peu claires (par exemple l’exigence de relations commerciales «bien établies»), susceptibles de se prêter à des applications différentes par les autorités et les juridictions nationales, ce qui crée une insécurité juridique tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Aussi le CESE plaide-t-il en faveur d’un processus de dialogue équilibré entre la Commission, le Parlement et le Conseil afin de remédier à ces lacunes et d’améliorer l’efficacité de l’instrument réglementaire qui sera en définitive approuvé. |
Dans le cadre de son «paquet pour une économie équitable et durable», la Commission a également présenté une proposition de directive sur le devoir de diligence des entreprises en matière de durabilité (voir l’avis INT/973). Le CESE considère cette proposition comme une étape importante dans la promotion du respect des droits de l’homme en tant que devoir des entreprises et de leur personnel d’encadrement. Il estime toutefois que la proposition comporte encore de nombreuses lacunes (par exemple, il est à craindre que les dispositions de la directive ne soient, de facto, étendues indirectement aux micro, petites et moyennes entreprises, alors que la proposition ne les inclut pas explicitement (1); ou encore la faible représentation des travailleurs), ainsi que des notions juridiques peu claires (par exemple l’exigence de relations commerciales «bien établies»), susceptibles de se prêter à des applications différentes par les autorités et les juridictions nationales, ce qui crée une insécurité juridique tant pour les travailleurs que pour les entreprises. Aussi le CESE plaide-t-il en faveur d’un processus de dialogue équilibré entre la Commission, le Parlement et le Conseil afin de remédier à ces lacunes et d’améliorer l’efficacité de l’instrument réglementaire qui sera en définitive approuvé. |
Résultat du vote
|
Pour: |
72 |
|
Contre: |
107 |
|
Abstentions: |
12 |
|
AMENDEMENT 2 SOC/727 Le travail décent dans le monde Paragraphe 1.12 Modifier comme suit: |
Proposé par: BLIJLEVENS René GERSTEIN Antje Sabine KONTKANEN Mira-Maria MINCHEVA Mariya MURESAN Marinel Dănuț POTTIER Jean-Michel |
|
Avis de section |
Amendement |
|
En outre, le CESE demande que l’UE soutienne un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, et que soit envisagé l’établissement d’une convention de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. |
En outre, le CESE demande que l’UE soutienne un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, et que l’OIT mène une réflexion sur la mise au point et l’adoption future des instruments pertinents et adaptés (1) concernant le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. |
Résultat du vote: il n’y a pas eu de vote sur cet amendement, le texte étant rigoureusement identique à celui de l’amendement proposé au paragraphe 2.6, ci-avant.
|
Pour: |
sans objet |
|
Contre: |
sans objet |
|
Abstentions: |
sans objet |
(1) Le CESE a déjà abordé cette question en détail dans son avis REX/518 — «Un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme», https://webapi2016.EESC.europa.eu/v1/documents/eesc-2019-01278-00-01-ac-tra-fr.docx/content.
(1) Le CESE a déjà abordé cette question en détail dans son avis REX/518 — «Un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme», https://webapi2016.EESC.europa.eu/v1/documents/eesc-2019-01278-00-01-ac-tra-fr.docx/content.
(2) REX/462 — «Un travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales», paragraphe 1.9, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/un-travail-decent-dans-les-chaines-dapprovisionnement-mondiales-avis-dinitiative.
(1) INT/973 — «Gouvernance d’entreprise durable», paragraphe 1.6, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/gouvernance-dentreprise-durable.
(1) INT/973 — «Gouvernance d’entreprise durable», paragraphe 4.9, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/gouvernance-dentreprise-durable.
(1) REX/462 — «Un travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales», paragraphe 1.9, https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/opinions-information-reports/opinions/un-travail-decent-dans-les-chaines-dapprovisionnement-mondiales-avis-dinitiative.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/161 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres
[COM(2022) 241 final]
(2022/C 486/22)
|
Rapporteure: |
Mariya MINTCHEVA |
|
Consultation |
Conseil de l’Union européenne, 14.6.2022 |
|
Base juridique |
Article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté» |
|
Adoption en section |
6.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
22.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
146/0/2 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le Comité estime que les lignes directrices proposées pour les politiques de l’emploi des États membres sont adéquates, dans la mesure où elles répondent aux problèmes les plus urgents qui se posent sur le marché du travail. |
|
1.2. |
Le CESE souhaite attirer l’attention sur les incertitudes grandissantes de la conjoncture géopolitique et sur l’impact qu’elles exerceront à l’avenir sur la demande, qui devraient, selon toute attente, affecter les décisions d’investissement des entreprises et la sécurité de l’emploi, retardant ainsi le déploiement des plans d’investissement, qu’ils émanent du secteur privé ou public. Face à une forte inflation et à la hausse des prix de l’énergie, qui ont une profonde incidence sur le pouvoir d’achat, ainsi qu’à la perspective d’une récession, il est plus nécessaire que jamais de garantir que les investissements durables puissent s’appuyer sur une base compétitive. Les États membres devraient œuvrer en faveur d’un marché unique qui soit véritablement intégré et aider les petites et moyennes entreprises à monter en puissance. |
|
1.3. |
En ces temps troublés que nous traversons, il est nécessaire de prendre des initiatives pour accroître tout à la fois leur rôle et leur participation à l’élaboration et l’exécution des réformes et politiques sociales et économiques, notamment en renforçant leurs capacités. Cette nécessité s’impose également pour mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux et les plans nationaux pour la reprise et la résilience. Les organisations de la société civile actives dans les domaines de l’emploi et des questions sociales, les prestataires d’enseignement et de services sociaux, les entreprises sociales et les organisations caritatives ont besoin d’un environnement adéquat qui leur permette d’offrir leurs services aux groupes vulnérables. |
|
1.4. |
Alors que les pénuries de main-d’œuvre prennent à nouveau un tour plus aigu, il convient de mettre en œuvre des mesures efficaces pour encourager les partenaires sociaux à se pencher sur les besoins en matière de compétences au niveau national, en prenant des mesures qui soient adaptées à chaque secteur et chaque contexte local. Du fait de l’évolution accélérée des technologies et de la double transition, la «durée de vie» des qualifications et compétences déjà acquises par les travailleurs ne cesse de se raccourcir et il devient toujours plus important, pour eux comme pour les entreprises, qu’ils se dotent tout au long de leur existence des aptitudes qui leur sont nécessaires. Il conviendrait d’encourager au sein de l’Union la mobilité de la main-d’œuvre et les migrations légales à des fins professionnelles. |
|
1.5. |
Le CESE estime que la réduction de la pauvreté des travailleurs doit passer par une action combinée menée au moyen de différents instruments et mesures d’intervention négociés par les partenaires sociaux. Outre des rémunérations décentes, y compris des salaires minimaux adéquats, ces actions peuvent inclure des incitations financières bien conçues et limitées dans le temps, accompagnées de mesures ciblées et efficaces pour l’acquisition de compétences ou leur perfectionnement. Il conviendrait d’encourager et de soutenir les États membres afin qu’ils mettent en œuvre ces mesures sur un mode coordonné. |
|
1.6. |
Un mécanisme de soutien ciblé est particulièrement important dans le cas des chômeurs de longue durée ou des personnes inactives, car il accroît leurs chances de parvenir à s’insérer sur le marché du travail ou à y faire leur retour et constitue un facteur important de préservation de l’emploi. La pandémie ayant touché les jeunes avec une intensité particulière, il est primordial de procéder à des interventions les ciblant, qui doivent être inclusives et tournées vers l’avenir, pour garantir qu’ils ne se trouvent pas laissés pour compte. |
|
1.7. |
Pour faire baisser le taux d’inactivité, il s’impose de déployer des efforts qui ramènent à l’emploi les populations qui sont plus éloignées du marché du travail. À condition d’être dûment encadrés par la législation ou la négociation collective au niveau national, les différentes modalités d’emploi, les formules d’activité flexibles et le télétravail pourraient constituer de puissants facteurs pour ouvrir aux personnes issues de groupes vulnérables la possibilité de trouver du travail. Il conviendrait de renforcer les capacités des services publics de l’emploi, notamment en les amenant à numériser leurs prestations et en les encourageant à coopérer avec leurs homologues privés et d’autres acteurs pertinents du marché du travail. |
|
1.8. |
Les États membres, en particulier ceux que le tableau de bord social range dans la catégorie des moins performants en la matière, devraient être incités, notamment grâce à une utilisation cohérente de ressources de l’Union, à arrêter des mesures qui encouragent les employeurs à recruter des personnes handicapées ou, si possible, promeuvent l’emploi indépendant. À cet égard, les acteurs de l’économie sociale apportent une contribution essentielle lorsqu’il s’agit de soutenir et de mettre en œuvre des projets en matière d’emploi. |
|
1.9. |
L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes reste problématique et il convient de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène. Actuellement à l’examen, la proposition de directive sur la transparence des rémunérations devrait aider à mettre en place, dans le cadre des mesures prises pour combler l’écart salarial entre les hommes et les femmes, une application plus rigoureuse du principe de rémunération égale pour travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, sans toutefois perdre de vue les préoccupations relatives aux contraintes supplémentaires imposées aux entreprises, en particulier aux PME. |
|
1.10. |
Eu égard au vieillissement démographique de plus en plus marqué, à l’allongement de l’espérance de vie et à la contraction du nombre d’actifs, il est nécessaire d’étudier soigneusement les défis liés aux systèmes de sécurité sociale et de soins de santé dans les États membres, afin que les régimes de retraite restent adéquats et viables d’un point de vue financier. Il y a lieu d’agir pour augmenter les effectifs de la main-d’œuvre grâce à des marchés du travail plus inclusifs, notamment en activant des groupes qui en sont actuellement exclus ou y sont sous-représentés. |
|
1.11. |
Dès que la directive relative à la protection temporaire est entrée en vigueur, les États membres ont agi sans tarder pour adapter leur cadre réglementaire national de manière à pouvoir venir en aide aux réfugiés d’Ukraine et aux ressortissants de pays tiers qui vivaient dans ce pays et ont fui en Europe à la suite du conflit qui y a éclaté. Tous les points d’engorgement, quels qu’ils soient, doivent être traités. |
2. Observations générales et contexte
|
2.1. |
Au cours de son cycle 2022, le Semestre européen a recommencé à coordonner à grande échelle les politiques en matière d’économie et d’emploi, tout en s’adaptant de manière plus poussée aux conditions à respecter pour mettre à exécution la facilité pour la reprise et la résilience. Les rapports par pays publiés en mai 2022 (1) comportent une évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et du plan d’action afférent, fixant des objectifs et indicateurs sociaux qui font partie intégrante du Semestre européen et des plans nationaux pour la reprise et la résilience (PNRR). Le lien établi avec le tableau de bord social offre une vue d’ensemble ciblée concernant la mise en œuvre du plan d’action et une harmonisation a été opérée dans les recommandations par pays. |
|
2.2. |
En 2021, les lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres figurant à l’annexe de la décision (UE) 2020/1512 du Conseil ont été maintenues sans modification aucune. En 2022, la Commission européenne a proposé d’y apporter un certain nombre de corrections, de manière à tenir compte d’initiatives récentes en la matière et à y ajouter de nouveaux éléments, liés à l’invasion russe de l’Ukraine. Le CESE se félicite que la Commission mette l’accent sur le contexte de l’après-COVID, afin d’assurer une croissance durable. |
|
2.3. |
La guerre en Ukraine a aggravé les ruptures d’approvisionnement et accru les incertitudes. L’économie de l’Union est également exposée, de manière indirecte, à la situation sanitaire en rapport avec la COVID-19 qui prévaut dans d’autres régions du monde. Ses perspectives économiques laissent entrevoir un ralentissement de la croissance et une montée de l’inflation, en particulier pour 2022 (2). Les taux élevés qu’elle atteint dans ses frontières, ainsi que la forte augmentation des prix de l’énergie et du gaz, aggravent la pression qui s’y exerce sur les entreprises et leur compétitivité, de même que sur les ménages et leur pouvoir d’achat. Cette situation aura inévitablement des répercussions sur la capacité de certaines sociétés à créer des emplois supplémentaires et, ces prochains mois, représentera un défi pour les systèmes de protection sociale, de sorte qu’il sera nécessaire de mener des politiques ciblées pour soutenir les transitions sur le marché du travail. |
|
2.4. |
Tout en s’employant à assurer l’inclusion et l’équité, les politiques des États membres en matière d’emploi devraient également épouser les évolutions économiques et sociales. Il y a lieu d’évaluer soigneusement les effets produits par les politiques du marché du travail, afin de s’assurer qu’elles encouragent bien une reprise pérenne et qu’elles n’aboutissent pas au contraire à faire baisser le taux d’emploi, produire des emplois de moindre qualité et affaiblir le pouvoir d’achat des particuliers. La question des pénuries de main-d’œuvre et de compétences devrait bénéficier d’une plus grande attention, donnant lieu par la suite à des recommandations d’action et des initiatives spécifiques, s’inscrivant dans la logique du plan d’action du socle européen des droits sociaux (SEDS). |
3. Observations particulières
3.1. Ligne directrice no 5: stimuler la demande de main-d’œuvre
|
3.1.1. |
Assurer une croissance durable, créer des postes de travail de qualité et favoriser la participation à l’emploi, notamment dans le cas des personnes âgées et des jeunes, des femmes, des catégories plus éloignées du marché du travail ou des inactifs, restent pour l’Europe des défis économiques et sociaux d’importance majeure. Pour les relever, il convient de garantir l’assise compétitive des investissements en exploitant le potentiel des transitions écologique et numérique. Le CESE se félicite que la Commission européenne encourage les États membres à créer un environnement économique susceptible de favoriser l’entrepreneuriat responsable et le véritable travail indépendant, de réduire les formalités administratives, d’œuvrer en faveur d’un marché unique véritablement intégré et fonctionnel et d’aider les petites et moyennes entreprises à se développer. Le CESE recommande vivement que les microentreprises restent incluses dans la ligne directrice no 5. |
|
3.1.2. |
Il est possible de stimuler la demande de main-d’œuvre dans l’ensemble de l’Union par différents moyens: en accroissant les investissements, en particulier ceux qui sont productifs, dans certains secteurs clés de l’économie, en allégeant, le cas échéant, les contraintes que les taxes font peser sur la main-d’œuvre, sans affaiblir la protection sociale et tout en garantissant les recettes nécessaires pour la pérennité des systèmes de protection sociale, en luttant plus vigoureusement contre l’évasion et la fraude fiscales et contre l’économie informelle, ou encore en mettant à la disposition des employeurs et des travailleurs des formes de travail variées, réglementées par la législation ou la négociation collective, tout en déployant des efforts pour améliorer les conditions de travail dans les nouvelles formes d’emploi de manière à les rendre plus attrayantes pour les salariés. |
|
3.1.3. |
Les incertitudes grandissantes de la conjoncture géopolitique et l’impact qu’elles exerceront à l’avenir sur la demande devraient, selon toute attente, affecter les décisions d’investissement des entreprises et la sécurité de l’emploi, retardant ainsi le déploiement des plans d’investissement, qu’ils émanent du secteur privé ou public. Du fait de l’inflation, les taux de croissance devraient diminuer et les rémunérations réelles baisser, avant qu’elles ne renouent, l’année prochaine, avec une augmentation modérée. Le CESE prend acte du point de vue de la Commission estimant que pour certains secteurs, «dans les accords salariaux, les préoccupations relatives à la sécurité de l’emploi sont susceptibles de prévaloir sur l’augmentation des rémunérations» (3). L’inflation exerce une pression sur les augmentations salariales et le pouvoir d’achat. Pour parer au danger qu’un cercle vicieux ne s’enclenche entre les salaires et les prix et augmenter la productivité, il est primordial de ménager aux partenaires sociaux une marge de manœuvre afin d’améliorer la couverture et les pratiques de la négociation collective, au niveau des secteurs et des entreprises, où des mesures concrètes pourraient être prises. |
|
3.1.4. |
Dans le même temps, il y a lieu de prendre des mesures structurelles sur le marché du travail, afin d’ouvrir des pistes pour des emplois de qualité. Il conviendrait d’encourager au sein de l’Union la mobilité de la main-d’œuvre et les migrations légales à des fins professionnelles. Le CESE escompte que l’initiative «Migration légale: train de mesures relatives aux compétences et aux talents», adoptée par la Commission le 27 avril 2022, fournira un soutien appréciable au marché du travail dans l’Union européenne. |
|
3.1.5. |
Le CESE se félicite de l’accent qui a été placé sur l’économie circulaire, en ce qu’elle constitue un secteur à haut potentiel de création d’emplois, tout comme il salue le soutien apporté aux secteurs et régions qui sont particulièrement touchés par la transition écologique, en raison d’une spécialisation sectorielle ou de la concentration régionale d’une activité industrielle spécifique. |
|
3.1.6. |
Le CESE attire également l’attention sur la résolution que la 110e conférence internationale du travail a adoptée, demandant que les principes et droits fondamentaux de l’Organisation internationale du travail incluent le principe d’un environnement de travail sûr et salubre, et il souligne qu’investir dans une culture de prévention des accidents, maladies professionnelles et risques sur les lieux de travail représente un impératif à respecter en permanence. |
|
3.1.7. |
Le CESE considère que la fixation de salaires minimums adéquats, qu’elle s’opère par le truchement d’une loi ou de la négociation collective, représente un instrument précieux pour lutter contre le phénomène des travailleurs pauvres. Ils ne représentent cependant pas une mesure qui serait suffisante à elle seule, et il est nécessaire de mener une action combinant différents instruments d’intervention. Ces actions peuvent inclure, entre autres, des incitations financières bien conçues et limitées dans le temps ou une reconfiguration, le cas échéant, des effets redistributifs du système fiscal. Les instruments financiers devraient être combinés avec des mesures ciblées et efficaces en matière de qualification et de perfectionnement, étant donné que les travailleurs peu qualifiés sont exposés à un risque plus élevé de pauvreté au travail que les travailleurs hautement qualifiés, à raison, respectivement, de 19 % contre 4,9 % (4). Il conviendrait d’encourager et de soutenir les États membres afin qu’ils mettent en œuvre ces mesures sur un mode coordonné. |
|
3.1.8. |
Il importe de respecter l’autonomie des partenaires sociaux et leur liberté de négocier collectivement sur une base volontaire. En matière de fixation des salaires, la négociation collective et l’élargissement de son taux de couverture restent, encore et toujours, les outils par excellence à utiliser pour parvenir à un juste équilibre, du point de vue de l’équité et de la possibilité d’adapter les rémunérations à l’évolution de la productivité, en améliorant les conditions de travail et les rentrées des cotisations sociales. Là où des salaires minimums légaux s’appliquent, la participation effective des partenaires sociaux est tout aussi importante pour déterminer quelles sont les solutions qui sont appropriées afin d’enclencher une convergence socio-économique vers le haut qui soit adaptée à l’environnement national concerné. Dans les cas où le taux de couverture de la négociation collective est faible, les États membres devraient s’efforcer de créer des conditions favorables pour que les partenaires sociaux puissent œuvrer à l’accroître. |
|
3.1.9. |
La mobilisation des partenaires sociaux s’est révélée très précieuse pendant la crise de la COVID-19. En ces temps troublés que nous traversons, il est nécessaire de prendre des initiatives pour accroître tout à la fois leur rôle et leur participation à l’élaboration et l’exécution des réformes et politiques sociales et économiques, notamment en renforçant leurs capacités. Cette nécessité s’impose également pour mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux et les plans nationaux pour la reprise et la résilience. En outre, il convient de prendre en considération le rôle des organisations de la société civile, en lien avec leurs domaines d’action respectifs. |
3.2. Ligne directrice no 6: renforcer l’offre de main-d’œuvre et améliorer l’accès à l’emploi ainsi que l’acquisition de qualifications et de compétences tout au long de la vie
|
3.2.1. |
Le CESE se réjouit de constater que l’intitulé de cette ligne directrice a été modifié afin d’inclure la notion d’apprentissage tout au long de la vie. Du fait de l’évolution accélérée des technologies et de la double transition, verte et numérique, la «durée de vie» des qualifications et compétences que les travailleurs ont acquises antérieurement ne cesse de se raccourcir et il devient toujours plus important, pour eux comme pour les entreprises, qu’ils se dotent tout au long de leur existence des aptitudes qui leur sont nécessaires. En conséquence, évaluer les responsabilités conjointes en matière d’apprentissage tout au long de la vie sur les lieux de travail constitue un enjeu crucial. |
|
3.2.2. |
Le CESE accueille favorablement l’approche proposée, consistant à offrir des mesures de soutien globales, lesquelles facilitent les adaptations aux évolutions du marché du travail. Pour être à même de suivre les évolutions du marché de l’emploi, tout travailleur doit absolument avoir à sa disposition des possibilités de perfectionnement et de reconversion en matière professionnelle (5), lesquelles devront lui être assurées et lui rester accessibles tout au long de son parcours d’activité, conformément au premier principe du socle européen des droits sociaux. Toutefois, le peu d’empressement à prendre part à des formations continue à poser un sérieux problème, et il convient d’étudier des pistes pour y remédier. Les partenaires sociaux assument une mission importante pour évaluer les besoins en matière de compétences. Les fonds consacrés à la formation doivent jouer un rôle de premier plan pour financer celle qui est d’ordre professionnel et il conviendrait que les bonnes pratiques nationales soient mises en avant et partagées entre les États membres (6). |
|
3.2.3. |
Un mécanisme de soutien ciblé est particulièrement important dans le cas des chômeurs de longue durée ou des personnes inactives, car il accroît leurs chances de parvenir à s’insérer sur le marché du travail ou à y faire leur retour et constitue un facteur important de préservation de l’emploi. Les États membres devraient être encouragés à raccourcir le délai à respecter pour établir des contacts avec les chômeurs de longue durée, qui est actuellement fixé à 18 mois de chômage. D’urgence, il s’impose de concevoir des mesures ciblées afin d’attirer les jeunes dans des parcours de carrières professionnelles. |
|
3.2.4. |
Alors qu’elles s’étaient atténuées pendant la crise de la COVID-19, les pénuries de main-d’œuvre prennent à nouveau un tour plus aigu (7). L’absence de véritables prévisions en matière de compétences représente un problème crucial pour les employeurs sur tout le territoire de l’Union européenne. Investir dans la formation et le développement des compétences des adultes, d’une manière étroitement liée aux besoins du marché du travail, peut constituer un facteur essentiel pour assurer la relance économique et construire une Europe sociale. |
|
3.2.5. |
Cette observation s’applique également aux réfugiés qui ont fui la guerre en Ukraine. En plus de leur dispenser une formation linguistique, il y a lieu de prendre des initiatives afin de faciliter le processus de reconnaissances des qualifications qu’ils ont déjà acquises et qui leur sont nécessaires pour intégrer le marché du travail. À cet égard, le CESE se félicite des orientations présentées par la Commission en matière d’accès au marché du travail, d’enseignement professionnel et de formation des adultes concernant les personnes qui fuient la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine (8). |
|
3.2.6. |
Les investissements qu’il est nécessaire de consentir pour mettre en œuvre l’initiative RePowerEU seront étroitement corrélés à la nécessité de disposer d’une main-d’œuvre formée. En ce qui concerne les comptes de formation individuels (CFI) (9), le CESE réaffirme estimer qu’il doit rester totalement du ressort des États membres de les adopter ou non pour les faire figurer parmi les mécanismes régissant l’offre de formations et leur financement. En tout état de cause, il convient que ces comptes favorisent l’accès à des formations reconnues et validées. Les partenaires sociaux jouent un rôle très important dans la conception des fonds de formation concernés, tout comme dans leur gestion. |
|
3.2.7. |
Le CESE convient qu’il y a lieu de déployer des efforts pour augmenter, dans tous les États membres, le niveau général en matière de qualifications. Cette observation s’applique tout particulièrement au début du processus d’apprentissage, mais également à tous les stades de la vie professionnelle. Comme le souligne à juste titre le rapport conjoint sur l’emploi 2022 (10), la tendance positive à la réduction de la proportion de jeunes quittant prématurément l’école a ralenti: ces taux n’ont diminué que de 1,1 point de pourcentage entre 2015 et 2020. Il importe tout spécialement de renforcer dans les États membres les systèmes d’enseignement et de formation professionnels (EFP) fondés sur le travail et de veiller à ce que l’enseignement supérieur soit en adéquation avec le marché du travail, tout comme d’augmenter, en particulier parmi les femmes, le nombre de titulaires de diplômes décernés dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), dans le cadre tant de l’enseignement et de la formation professionnels que de la filière éducative supérieure. |
|
3.2.8. |
La pandémie a touché les jeunes avec une intensité particulière, car ils comptent parmi les catégories qui ont été les plus affectées par la crise économique et sociale qui en est résultée et a détricoté dix années de progrès concernant les emplois de cette tranche d’âge. Pour se préparer dûment à un monde du travail qui est en phase de mutation, sous l’effet de la mondialisation, de la crise climatique, des changements démographiques et des avancées technologiques, les gouvernements et les institutions doivent prendre en compte les effets de chacune de ces grandes évolutions. Il est primordial de procéder à des interventions ciblant la jeunesse, qui doivent être inclusives et tournées vers l’avenir, pour garantir qu’elle ne se trouve pas laissée pour compte (11). |
|
3.2.9. |
Dans l’Union européenne, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes reste problématique. Étant donné qu’il varie considérablement d’un État membre à l’autre, il convient de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène, qu’il s’agisse, par exemple, de la ségrégation sur les marchés du travail et dans l’éducation, des stéréotypes de genre, du manque d’accessibilité des infrastructures de garde d’enfants et autres services de prise en charge, ou encore de la répartition inégalitaire des tâches ménagères et des responsabilités familiales. Il convient d’éliminer toute discrimination salariale, y compris celle qui est fondée sur l’âge. Actuellement à l’examen, la proposition de directive de la Commission européenne sur la transparence des rémunérations devrait aider les États membres à mettre en place, dans le cadre des mesures prises pour combler l’écart salarial entre les hommes et les femmes, une application plus rigoureuse du principe de rémunération égale pour travail de valeur égale entre les hommes et les femmes, sans toutefois perdre de vue les préoccupations relatives aux contraintes supplémentaires imposées aux entreprises, en particulier aux PME. |
3.3. Ligne directrice no 7: améliorer le fonctionnement des marchés du travail et l’efficacité du dialogue social
|
3.3.1. |
Afin d’améliorer le fonctionnement des marchés du travail, il est nécessaire de revoir les rôles et les responsabilités de leurs différents acteurs, à savoir les services publics de l’emploi (SPE) et les services sociaux. Il y a lieu d’examiner les possibilités qui existent pour nouer des partenariats associant, par exemple, les services sociaux, s’agissant d’établir un contact avec les personnes plus éloignées du marché du travail et de les préparer à suivre des programme de formation, les services publics de l’emploi, afin de mener des politiques actives du marché du travail sur mesure, avec un volet relatif au maintien de l’emploi et des prestations d’orientation et de conseil, et, enfin, les services privés de l’emploi, pour des actions conjointes ou complémentaires, comme le partage de la base de données des offres d’emploi. Il s’impose d’évaluer l’efficacité des mesures d’intervention et, au besoin, de les repenser ou de les reconfigurer. Les capacités des services publics de l’emploi doivent être renforcées, notamment grâce à la numérisation de leurs prestations. De même, il conviendrait de les encourager à coopérer avec les services privés de l’emploi et d’autres acteurs pertinents du marché du travail. |
|
3.3.2. |
Les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer dans cette entreprise, en particulier dans le contexte des marchés du travail locaux et des secteurs en transition, où ils peuvent contribuer à ce qu’entre secteurs, emplois ou métiers, les transitions s’opèrent en douceur. Les organisations de la société civile apportent elles aussi une contribution appréciable, de par leur expertise spécifique concernant les différentes formes d’emploi, en particulier pour les groupes vulnérables, et les questions sociales, ainsi qu’en leur qualité de prestataires d’enseignement et de services sociaux d’intérêt général. |
|
3.3.3. |
Le taux d’inactivité reste relativement élevé dans l’ensemble de l’Union européenne (12). Le moment est venu de ramener à l’emploi les populations qui sont plus éloignées du marché du travail. À condition d’être dûment encadrés par la législation ou la négociation collective au niveau national, afin d’offrir des conditions de travail équitables, les différentes modalités d’emploi, les formules d’activité flexibles et le télétravail pourraient constituer de puissants facteurs pour donner la possibilité de trouver du travail, notamment dans le cas des personnes issues de groupes vulnérables. Grâce aux infrastructures et services sociaux, par exemple dans le domaine de la garde d’enfants ou de la prise en charge de longue durée, les personnes qui assument des responsabilités de prise en charge de proches ont la possibilité d’envisager d’intégrer le marché du travail. |
|
3.3.4. |
La collaboration avec les partenaires sociaux est essentielle pour promouvoir des conditions de travail équitables, transparentes et prévisibles, qui tiennent la balance égale entre les droits et les obligations. Le CESE estime lui aussi qu’il y a lieu d’éviter les formules d’emploi débouchant sur des conditions de travail informelles et précaires, y compris dans le cadre du travail via une plateforme, pour lequel un projet de directive est en cours d’examen. Le CESE souligne que toute mesure régissant les nouveaux modes de travail, dont celui s’exerçant par l’intermédiaire de plateformes, devrait réglementer les formules de travail flexibles au niveau européen et national approprié, tout en offrant des garanties essentielles pour préserver la protection adéquate de leurs travailleurs. Il convient de respecter le rôle des partenaires sociaux. |
3.4. Ligne directrice no 8: promouvoir l’égalité des chances pour tous, favoriser l’inclusion sociale et combattre la pauvreté
|
3.4.1. |
Alors que l’Europe est confrontée à une série de crises, il est aujourd’hui particulièrement important de promouvoir l’égalité des chances pour tous et l’inclusivité des marchés du travail, dans la perspective, d’une part, de parvenir à ce que 78 % de sa population occupe un emploi, suivant l’objectif fixé par le plan d’action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, et, d’autre part, de remédier aux pénuries de main-d’œuvre. Cet impératif vaut non seulement pour toute personne se rattachant à une catégorie sous-représentée sur le marché du travail mais aussi dans le contexte de l’afflux massif de personnes qui ont fui la guerre en Ukraine. Dès que la directive relative à la protection temporaire est entrée en vigueur, les États membres ont agi sans tarder pour adapter leur cadre réglementaire national de manière à pouvoir venir en aide aux réfugiés de ce pays et aux ressortissants de pays tiers qui y vivaient et ont fui en Europe à la suite du conflit qui y a éclaté. Tous les points d’engorgement, quels qu’ils soient, doivent être traités. |
|
3.4.2. |
Il est nécessaire d’adopter une approche individualisée pour les différents groupes vulnérables, comme les travailleurs âgés, les personnes handicapées, dont celles qui sont jeunes, les citoyens assumant des responsabilités de prise en charge de proches, les chômeurs de longue durée ou les travailleurs qui ont un parcours professionnel en pointillés, les jeunes qui ne travaillent pas ni ne sont aux études ou en formation (NEET), ou encore les migrants. Les différences qui, en matière d’emploi, existent entre les zones rurales et urbaines doivent également être prises en considération. Il convient de mobiliser les fonds de l’Union européenne pour en faire des leviers qui incitent les États membres, en particulier ceux que le tableau de bord social range dans la catégorie des moins performants en la matière, à arrêter des mesures qui encouragent les employeurs à recruter des personnes handicapées ou promeuvent l’emploi indépendant. Le travail décent offre le meilleur des instruments pour lutter contre la pauvreté et préserver la dignité humaine. |
|
3.4.3. |
Les prestations et les mesures d’aide au revenu temporaires devraient être fournies aussi longtemps qu’elles sont nécessaires, de manière à orienter les chômeurs ou les personnes à faibles revenus vers des gisements d’activité nouveaux et de meilleure qualité. Les prestations liées à l’emploi (13), associées à des mesures structurelles visant à faciliter l’inclusion des groupes vulnérables, peuvent faciliter leur intégration sur le marché du travail, mais devraient constituer des mesures d’urgence transitoires et complémentaires, puisqu’il convient d’encourager et de soutenir l’adoption d’une politique de rémunération adéquate qui garantisse un niveau de vie décent. |
|
3.4.4. |
Les entreprises ressortissant à l’économie sociale assument une mission importante, en particulier en fournissant aux plus vulnérables des emplois d’entrée de gamme et en dispensant des services au niveau régional. Le CESE salue le plan d’action de la Commission en faveur de l’économie sociale et il la presse de lancer des initiatives d’évaluation pour détecter au niveau national quels sont les meilleurs projets qui s’y rattachent. |
|
3.4.5. |
Il est particulièrement opportun que l’accent soit mis sur les enfants. La pauvreté qui les touche doit être combattue par des mesures globales et intégrées, et il est nécessaire d’encourager l’action menée afin de mettre en œuvre la garantie pour l’enfance. Le Comité adhère totalement à l’idée que la disponibilité de services aux tarifs abordables, de bonne accessibilité et de grande qualité, notamment en matière d’éducation et de garde d’enfants en bas âge, d’accueil extrascolaire, d’enseignement, de formation, de logement, de soins de santé et de prise en charge de longue durée, joue un rôle essentiel pour réduire la pauvreté des enfants et garantir l’égalité des chances. Il y a lieu, plus largement, de renforcer l’accès effectif à des services sociaux de qualité en rapport avec les besoins individuels; sous l’effet de la COVID-19, cette problématique s’est trouvée sous le feu des projecteurs, et il importe qu’elle ne retombe pas dans l’oubli une fois la pandémie terminée. |
|
3.4.6. |
Parallèlement, la transition écologique, qui induit un basculement en matière énergétique, et, plus spécifiquement, les récentes augmentations des prix de l’énergie ont pour effet que la vie des groupes vulnérables est devenue encore plus difficile (14). En dépit des engagements politiques, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour lutter contre la pauvreté énergétique et garantir que les mesures prises soient dûment ciblées et efficaces. |
|
3.4.7. |
En se combinant, le vieillissement démographique de plus en plus marqué, l’allongement de l’espérance de vie et la contraction du nombre d’actifs aboutiront à ce que le nombre de personnes âgées, en situation de dépendance financière, va augmenter si nous ne réussissons à accroître les effectifs de la population active en donnant un caractère plus inclusif aux marchés de l’emploi, notamment par l’activation de groupes qui en sont actuellement exclus ou y sont sous-représentés. Il y a lieu de prendre des mesures pour relever les défis auxquels sont confrontés les systèmes de sécurité sociale et de soins de santé dans les États membres. Pour chacun d’entre eux, disposer de régimes de retraite adéquats et viables d’un point de vue financier représente une politique d’une importance capitale. Le CESE salue l’approche globale d’égalité entre les hommes et les femmes que la Commission propose en ce qui concerne l’acquisition de droits à pension, ainsi que les stratégies de vieillissement actif qui sont nécessaires pour faciliter la participation des personnes âgées au marché du travail et contribuer à réduire les inégalités entre les sexes en matière de retraites. Le CESE souligne que durant la vie active de tout travailleur, il importe d’éviter l’intermittence dans ses périodes d’activité, de manière à ce qu’il soutienne les régimes de sécurité sociale grâce à ses cotisations et qu’il ait la garantie, une fois qu’il prendra sa retraite, d’avoir droit à une pension d’un montant adéquat. |
Bruxelles, le 22 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Semestre européen 2022: rapports par pays.
(2) European Economic Forecast. Spring 2022 («Prévisions économiques européennes, printemps 2022»).
(3) Spring 2022 Economic Forecast: Russian invasion tests EU economic resilience («Prévisions économiques, printemps 2022: l’invasion russe met la résilience économique de l’UE à l’épreuve»).
(4) Rapport conjoint sur l’emploi 2022.
(5) Voir également l’étude de l’observatoire du marché du travail (OMT) sur Le travail de demain: assurer l’apprentissage et la formation des salariés tout au long de la vie.
(6) Avis du CESE sur le paquet «Apprentissage et employabilité» (JO C 323 du 26.8.2022, p. 62).
(7) Rapport conjoint sur l’emploi 2022.
(8) C(2022) 4050 final.
(9) Recommandation du Conseil relative aux comptes de formation individuels.
(10) Rapport adopté par le Conseil le 14 mars 2022.
(11) Le CESE travaille actuellement à l’élaboration d’un rapport d’information sur le thème «L’égalité de traitement des jeunes sur le marché du travail».
(12) Le taux d’inactivité le plus élevé est enregistré en Italie (plus de 37 % en 2021). Ceux relevés en Croatie, en Roumanie, en Grèce et en Belgique dépassent également les 30 %. Des données plus complètes sur la population économiquement inactive en Europe sont disponibles à cette adresse.
(13) L’OCDE définit les prestations liées à l’emploi comme «des crédits ou abattements d’impôt permanents liés à l’emploi, ou des régimes équivalents de prestations liés à l’emploi, conçus dans le double but de réduire la pauvreté des travailleurs et de renforcer les incitations au travail pour les travailleurs à faibles revenus».
(14) Voir également l’avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat (JO C 152 du 6.4.2022, p. 158).
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/168 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en place de l’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes
[COM(2022) 349 final]
(2022/C 486/23)
|
Rapporteur général: |
Maurizio MENSI |
|
Corapporteur général: |
Jan PIE |
|
Consultation |
Conseil, 22.7.2022 Parlement européen, 12.9.2022 |
|
Base juridique |
Article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Commission consultative des mutations industrielles |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
155/1/13 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE accueille favorablement la proposition de règlement relatif à la mise en place de l’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes (ci-après l’«instrument»), afin de solidifier rapidement les industries et les capacités de défense de l’Europe eu égard aux défis immédiats qui découlent de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. |
|
1.2. |
Le CESE souscrit aux objectifs de ce règlement, qui consistent, d’une part, à améliorer la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) sur le plan de l’efficacité et de la rapidité de réaction aux urgences pour parvenir à une Europe plus résiliente, et d’autre part, à encourager la coopération et l’interaction entre les États membres dans le domaine de la passation des marchés de défense. Ces deux objectifs sont plus importants que jamais, alors que la guerre fait son retour en Europe et que la société dans sa globalité doit aussi bénéficier d’une protection adéquate, face au risque de voir se développer à l’avenir d’autres tensions de nature stratégique. |
|
1.3. |
Le CESE estime que l’instrument s’avérera utile pour mieux structurer et orchestrer le pic actuel de la demande d’équipements d’urgence prêts à l’emploi, mais il fait observer que celui-ci ne peut pour autant être considéré comme le précurseur d’un futur programme européen d’investissement dans le domaine de la défense, dans la mesure où, dans une perspective de politique industrielle, il apparaît comme un outil relativement faible. |
|
1.4. |
Le CESE convient qu’il est nécessaire d’agir pour accélérer, de manière collaborative, l’adaptation de l’industrie européenne aux changements structurels, notamment en démultipliant ses capacités de production, de manière à pouvoir satisfaire en temps utile la demande croissante des États membres. |
|
1.5. |
Le CESE est également d’avis que, pour éviter que l’augmentation des investissements nationaux dans le domaine de la défense ait pour effet d’aggraver la fragmentation du secteur européen de la défense, de restreindre le potentiel de coopération, d’accroître les dépendances extérieures et d’entraver l’interopérabilité, la passation conjointe de marchés s’impose. Cette dernière permettrait à chaque État membre de répondre rapidement à ses besoins capacitaires les plus urgents, qu’ils aient été révélés ou exacerbés par la réaction à l’agression de la Russie contre l’Ukraine. |
|
1.6. |
Dans le même temps, le CESE estime que la reconstitution des stocks implique souvent le remplacement de produits expédiés en Ukraine par des produits identiques. Il ne faut pas s’attendre à ce que de tels achats aient une incidence structurelle significative sur l’industrie ou à ce qu’ils stimulent l’innovation technologique. Le CESE se demande dès lors si la logique de l’instrument proposé devrait être directement étendue à un futur programme européen d’investissement dans le domaine de la défense. |
|
1.7. |
Le CESE se félicite de l’approche visant à encourager la passation conjointe de marchés par un soutien financier direct provenant du budget de l’UE, tout en se demandant si l’enveloppe financière de 500 millions d’euros suffira à changer la donne dans les décisions des États membres en matière de marchés publics. |
|
1.8. |
Le CESE s’interroge sur l’intérêt d’utiliser le soutien financier pour obtenir une aide technique et administrative en vue de la mise en œuvre de l’instrument, mais il se demande également s’il est judicieux d’accorder des subventions sous la forme d’un financement non lié aux coûts; il invite donc les colégislateurs à clarifier cette méthode pour garantir l’efficacité des dépenses de l’UE. |
|
1.9. |
Le CESE se félicite que le soutien financier de l’UE soit limité aux achats de produits de défense fabriqués sur le territoire européen ou dans les pays associés, et il adhère aux conditions spécifiques applicables aux entreprises européennes contrôlées par des pays tiers. Ces limitations, qui sont dans l’intérêts du contribuable européen, apparaissent également nécessaires pour atteindre l’objectif de renforcement des capacités industrielles européennes de défense et elles s’inscrivent dans le droit fil de l’objectif d’autonomie stratégique. |
|
1.10. |
Dans le même temps, le CESE plaide en faveur d’une interprétation souple de l’exigence selon laquelle les produits liés à la défense ne doivent pas être soumis à une restriction de la part d’un pays tiers ou d’une entité non associé(e) à l’UE. L’instrument proposé étant destiné à couvrir les acquisitions d’équipements prêts à l’emploi et à répondre aux besoins de produits les plus urgents, le CESE estime qu’il est moins pertinent de lui appliquer cette exigence, laquelle est en revanche plus appropriée au Fonds européen de la défense (FED), qui a pour objectif de développer des capacités futures. Ces restrictions devraient donc être appliquées avec précaution, avec le souci de trouver un équilibre entre, d’une part, la recherche d’une plus grande autonomie, et de l’autre, le caractère urgent de la passation de marché et les besoins d’interopérabilité avec les équipements existants. |
|
1.11. |
Le CESE soutient le mode de mise en œuvre de l’instrument qui est envisagé, à savoir la gestion directe, mais insiste sur la nécessité de veiller à ce que les services compétents de la Commission disposent en temps utile des ressources humaines nécessaires pour faire face à la charge de travail induite. |
|
1.12. |
Le CESE invite les États membres à coopérer étroitement avec la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense mise en place par la Commission et le haut représentant/chef de l’Agence européenne de défense, de manière à garantir la bonne mise en œuvre de l’instrument proposé. |
2. Contexte de l’avis
|
2.1. |
En réaction à l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine, les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne réunis à Versailles le 11 mars 2022 ont affirmé leur détermination à «renforcer les capacités européennes de défense». La déclaration de Versailles affirme que les États membres doivent augmenter les dépenses en matière de défense, intensifier la coopération au moyen de projets conjoints, combler les lacunes pour atteindre les objectifs en matière de capacités, favoriser l’innovation, y compris par des synergies dans les domaines civil et militaire, et renforcer l’industrie de la défense de l’Union européenne. Par ailleurs, le Conseil européen a invité «la Commission, en coordination avec l’Agence européenne de défense, à présenter une analyse des déficits d’investissement dans la défense d’ici la mi-mai et à proposer toute initiative supplémentaire nécessaire pour renforcer la base industrielle et technologique de défense européenne». |
|
2.2. |
En réponse à cette invitation, la Commission et le haut représentant ont présenté, le 18 mai 2022, une communication conjointe sur l’analyse des déficits d’investissement dans le domaine de la défense et sur la voie à suivre. Il est relevé, dans cette communication conjointe, qu’un sous-investissement flagrant dans la défense pendant plusieurs années a entraîné des lacunes industrielles et capacitaires dans l’Union, aboutissant aux faibles niveaux actuels de stocks d’équipements de défense. Les transferts d’équipements de défense vers l’Ukraine, conjugués à un niveau de stocks adapté à celui prévu en temps de paix, ont fait apparaître des déficits urgents et critiques en ce qui concerne les équipements militaires. |
|
2.3. |
Il est rappelé, dans la communication conjointe, que les États membres doivent renouer de toute urgence avec la préparation au combat défensif, compte tenu de la situation en matière de sécurité et des transferts déjà effectués vers l’Ukraine. Une reconstitution des stocks de matériel leur permettrait aussi de fournir une aide supplémentaire à l’Ukraine. En parallèle, le CESE adhère aux appels que la communication conjointe lance aux États membres pour qu’ils acquièrent sur un mode collaboratif les équipements et le matériel de défense dont ils ont besoin. Ces achats groupés de biens qu’ils doivent acquérir d’urgence présenteraient l’avantage d’accroître le rendement des dépenses engagées, de renforcer l’interopérabilité des matériels et d’éviter que les plus exposés d’entre eux ne soient dans l’impossibilité d’obtenir les dispositifs qui leur sont nécessaires, parce que l’industrie de défense, incapable de répondre à un tel afflux de commandes à échéances brèves, se trouvera confrontée à des demandes qui entrent en conflit. |
|
2.4. |
Dans ce contexte, la communication conjointe propose de stimuler, grâce à un instrument spécifique de court terme, les acquisitions conjointes effectuées par l’intermédiaire du budget de l’Union. Le soutien financier qu’elle apportera grâce à cet instrument devrait encourager les États membres à s’engager dans des procédures d’acquisitions conjointes dans le domaine de la défense et s’avérer bénéfique pour la BITDE, tout en garantissant la capacité d’action des forces armées européennes, leur sécurité d’approvisionnement et une interopérabilité accrue. |
|
2.5. |
En réaction à l’urgence de la situation, la Commission a présenté, le 19 juillet 2022, une proposition de règlement relatif à la mise en place de l’instrument visant à renforcer l’industrie européenne de la défense au moyen d’acquisitions conjointes. La Commission compte sur une adoption rapide du règlement et sur son entrée en vigueur d’ici la fin de 2022. |
|
2.6. |
Une fois l’instrument créé, la Commission entend proposer un règlement établissant un programme européen commun d’investissement dans la défense (EDIP). Elle indique qu’un tel règlement pourrait servir d’ancrage pour de futurs projets conjoints de développement et d’acquisition, présentant un intérêt commun élevé pour la sécurité des États membres et de l’Union, et, par extension de la logique de l’instrument à court terme, pour une éventuelle intervention financière de l’Union qui y serait associée en faveur du renforcement de la base industrielle de défense européenne, en particulier dans le cas de projets qu’aucun État membre ne pourrait développer ou acquérir seul. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Le contexte géopolitique de l’Union a radicalement changé à la suite de l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine. Le retour d’un conflit territorial et d’une guerre de haute intensité sur le sol européen exige des États membres qu’ils repensent leurs plans et capacités de défense. Ce réexamen doit aller de pair avec un ajustement de la base industrielle et technologique, laquelle devrait permettre de soutenir et d’appuyer les forces armées des États membres, qui constituent un outil fondamental d’une démocratie mature, protégeant la liberté des citoyens européens. |
|
3.2. |
Le CESE se félicite de l’augmentation annoncée des dépenses des États membres en matière de défense en vue de combler rapidement les lacunes urgentes dans le domaine militaire. Toutefois, faute d’une coordination et d’une coopération adéquate, cette hausse des dépenses risque d’aggraver la fragmentation du secteur européen de la défense, de limiter le potentiel de coopération tout au long du cycle de vie des équipements achetés et d’entraver l’interopérabilité. Par ailleurs, les choix opérés en matière d’acquisitions à court terme ont souvent une incidence à plus long terme sur la puissance de marché de la BITDE et sur les perspectives pour les prochaines décennies. |
|
3.3. |
Le CESE se positionne donc en faveur de l’initiative visant à encourager la passation conjointe de marchés pour les besoins les plus urgents en matière de produits se rapportant à la défense. La passation conjointe de marchés semble particulièrement importante dans la situation actuelle, compte tenu de la soudaine augmentation de la demande de produits de ce type, qui fait face à une offre industrielle encore dans un régime de temps de paix, de sorte qu’il est difficile d’obtenir une adéquation entre offre et demande. Il est donc indispensable d’instaurer une coopération en matière de marchés publics de défense afin de garantir la solidarité entre les États membres, de renforcer l’interopérabilité, de prévenir les effets d’éviction et d’améliorer l’efficacité des dépenses publiques. |
|
3.4. |
Il importe tout autant d’aider l’industrie à s’adapter aux changements structurels du nouvel environnement sécuritaire. Dans la mesure où le renforcement nécessaire des capacités militaires de l’Europe demande un effort à long terme et où un soutien continu à l’Ukraine pourrait s’imposer pour une période plus longue, la BITDE devra renforcer ses capacités de production, non seulement pour faire face à la hausse actuelle de la demande, mais aussi à plus long terme. |
|
3.5. |
À cet égard, le CESE estime que l’instrument proposé est trop limité dans son approche, sa portée et son enveloppe financière pour faire la différence dans le renforcement des capacités industrielles de l’Europe. La reconstitution des stocks limite, par définition, le choix des produits et des fournisseurs, et un montant de 500 millions d’euros réparti en 27 États membres sur deux ans représente un investissement relativement modeste. |
|
3.6. |
En résumé, le CESE estime que le règlement proposé peut apporter une contribution utile pour mieux structurer et orchestrer le pic actuel de la demande d’équipements d’urgence prêts à l’emploi, mais fait observer que l’instrument présente une certaine faiblesse sur le plan de la politique industrielle. Par conséquent, le CESE estime que celui-ci ne devrait pas nécessairement être considéré comme le précurseur d’un futur programme européen d’investissement dans le domaine de la défense, lequel est annoncé comme un instrument destiné à soutenir la passation conjointe de marchés pour des systèmes développés conjointement tout au long de leur cycle de vie. |
4. Observations particulières
|
4.1. |
Selon la proposition, l’instrument s’appuiera sur les travaux de la task-force pour les acquisitions conjointes dans le domaine de la défense mise en place par la Commission et le haut représentant/chef de l’Agence européenne de défense. Cette task-force a pour but de faciliter la coordination des besoins des États membres en matière d’acquisitions à très court terme et de dialoguer avec les États membres et les industriels de la défense de l’UE afin d’encourager la passation conjointe de marchés pour reconstituer les stocks. Les travaux de cette task-force sont donc essentiels au succès de l’instrument, et le CESE invite les États membres à en faire pleinement usage. |
|
4.2. |
Le CESE doute que l’enveloppe budgétaire proposée soit suffisamment importante pour influencer sensiblement les décisions des États membres en matière de marchés publics. Dans le même temps, il est bien conscient de la pression financière qui pèse sur l’actuel cadre financier pluriannuel et de la nécessité de dégager un financement supplémentaire pour un futur programme européen d’investissement dans le domaine de la défense. Dans ce contexte, il sera particulièrement important d’axer le financement limité octroyé à cet instrument sur les marchés publics conjoints les plus pertinents. |
|
4.3. |
En ce qui concerne les contraintes budgétaires et la sélection des projets, le CESE s’interroge sur la manière dont le concept de financement non lié aux coûts peut s’appliquer dans la pratique aux acquisitions visées par l’instrument. Le CESE se demande aussi dans quelle mesure il est judicieux d’utiliser le budget alloué pour l’assistance technique et administrative en vue de la mise en œuvre de l’instrument. |
|
4.4. |
Le CESE soutient le mode de mise en œuvre de l’instrument qui est envisagé, à savoir la gestion directe, mais insiste sur la nécessité de veiller à ce que les services compétents de la Commission disposent en temps utile des ressources humaines nécessaires pour faire face à la charge de travail induite. |
|
4.5. |
Le CESE approuve les critères d’éligibilité mentionnés dans la proposition de règlement, en particulier la possibilité d’étendre les marchés publics existants. |
|
4.6. |
Le CESE soutient également la condition supplémentaire visant à limiter l’octroi de fonds européens à l’acquisition d’équipements fabriqués dans l’UE ou dans des pays associés, y compris par des entreprises sous le contrôle d’un pays ou d’une entité tiers qui peuvent fournir des garanties de sécurité par l’État membre dans lequel ils sont situés. Cette condition fait écho aux dispositions pertinentes du FED et garantit la réalisation de l’objectif de renforcement de la BITDE. |
|
4.7. |
Dans le même temps, le CESE remet en cause l’importance de l’exigence voulant que les produits utilisés pour la défense ne fassent pas l’objet d’une restriction de la part d’un pays tiers ou d’une entité non associé(e) à l’UE. L’instrument proposé étant destiné à couvrir les acquisitions d’équipements prêts à l’emploi et à répondre aux besoins les plus urgents en matière de produits, il semble moins pertinent de lui appliquer cette exigence, laquelle est en revanche plus appropriée dans le cadre du FED, qui vise à développer des capacités futures et compte parmi ses objectifs déclarés la garantie de la souveraineté technologique. Le CESE plaide donc en faveur d’une interprétation souple de cette disposition, en laissant aux États membres la possibilité de trouver un équilibre entre, d’une part, la recherche d’une liberté opérationnelle, et d’autre part, le caractère urgent des acquisitions et l’interopérabilité avec les équipements existants. |
|
4.8. |
Enfin, le CESE s’interroge sur le caractère approprié de certains critères d’attribution proposés, à savoir ceux qui relèvent de l’incidence positive des acquisitions sur la BITDE. Étant donné que le règlement proposé vise surtout à répondre aux besoins les plus urgents et à permettre l’acquisition d’équipements prêts à l’emploi et rapidement disponibles, cette incidence ne figure probablement pas parmi les critères de premier plan aux yeux des États membres, à moins que le contractant ne soit situé sur leur propre territoire. En outre, il sera sans doute difficile pour les États membres qui réalisent des acquisitions de démontrer leur incidence positive sur la BITDE, en particulier lorsque leur principale préoccupation est de remédier à une situation d’urgence. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/172 |
Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027
[COM(2022) 57 final — 2022/0039 (COD)]
et sur la
communication conjointe au Parlement européen et au Conseil — «Une approche de l’UE en matière de gestion du trafic spatial — Une contribution de l’UE pour faire face à un défi mondial»
[JOIN(2022) 4 final]
(2022/C 486/24)
|
Rapporteur: |
Pierre Jean COULON |
|
Consultation |
Commission européenne, 2.5.2022 |
|
Base juridique |
Article 189, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
|
Adoption en section |
7.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
222/0/1 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE considère que la communication et la proposition, qui marquent le début de l’élaboration d’un paquet spatial européen, sont nécessaires et indispensables dans la période actuelle. Il recommande que la communication conjointe promeuve fermement, dans le cadre d’une diplomatie active, une gestion multilatérale du trafic spatial dans le cadre des Nations unies, notamment au sein du CUPEEA et de la Conférence du désarmement, car nous n’avons pas assez de règles en la matière. |
|
1.2. |
La priorité absolue que constitue la gestion du trafic spatial, y compris des débris, nécessite une prise en compte européenne de tous les acteurs. Comme le constate la communication conjointe et le montre le présent avis, le principal problème lié à la mosaïque des programmes de gestion du trafic spatial (STM) réside dans l’absence de normalisation internationale. Il est donc évident qu’il faut élaborer des normes, des lignes directrices et des pratiques internationales exemplaires. |
|
1.3. |
Le CESE appelle de ses vœux une mise en œuvre concrète d’un système de veille spatiale pour garantir la durabilité à long terme de l’espace pour tous les États membres.
En effet, le deuxième principe central du droit de l’espace est la responsabilité des différents acteurs pour leurs activités spatiales. Elle se décline en une responsabilité internationale pour le contrôle des activités et une responsabilité pour dommage du fait de ces activités dans l’espace extra-atmosphérique. C’est dans le volet de la responsabilité internationale pour le contrôle des activités que la communication conjointe s’inscrit. |
|
1.4. |
Le CESE déplore l’absence de normalisation internationale et recommande l’adoption de normes, y compris pour la gestion des débris de satellites, et de lignes directrices à l’échelle européenne associant la société civile organisée.
La lutte entre acteurs spatiaux jusqu’alors essentiellement étatiques et ceux qui aspirent à devenir des acteurs majeurs, privés ou publics, appelle une réforme en profondeur des normes internationales qui furent adoptées lorsque l’espace était l’affaire d’un groupe restreint de puissances technologiques et industrielles. |
|
1.5. |
Comme le souligne l’avis complémentaire CCMI/196 consacré au «Nouvel espace»:
|
2. Contexte de l’avis
|
2.1. |
L’espace est aujourd’hui à bien des égards un territoire économique supplémentaire. L’accélération des investissements publics et privés entraîne une densification des activités spatiales et transforme l’espace en un enjeu géostratégique majeur. La compétition technologique, l’éclosion de jeunes entreprises dédiées au secteur spatial, l’ouverture de nouveaux marchés et services, la volonté des États et des opérateurs privés de renforcer les activités en orbite exacerbent l’exploitation de l’espace spatial. |
|
2.2. |
Malgré l’ampleur stratégique de l’espace, il n’existe pas d’autorité globale ni de lois contraignantes applicables aux orbites basses et géostationnaires, ni de régulation ou de système de gestion du trafic spatial, alors que le nombre de satellites en orbite augmente. |
|
2.3. |
À ce jour, la gestion du trafic spatial repose uniquement sur de bonnes pratiques volontaires et non contraignantes, pas toujours bien gérées ou appliquées, et qui visent à limiter les risques statistiques de collision entre les satellites et des débris. Elles prévoient qu’il ne faut pas produire intentionnellement de débris en orbite et demandent de passiver les satellites en fin de vie en consommant le carburant résiduel, de respecter la «règle des 25 ans» pour les satellites en orbite basse (les satellites en fin de vie opérationnelle doivent rentrer dans l’atmosphère dans les 25 ans) et de placer les satellites géostationnaires inutilisés en «orbite cimetière». Mais ces règles ne suffisent plus pour limiter les risques de collision. |
|
2.4. |
À ceci s’ajoute l’émergence de nouveaux concepts opérationnels: surveillance de l’espace et suivi des objets en orbite (Space Surveillance and Tracking ou SST), coordination du trafic spatial (Space Traffic Coordination ou STC), coordination et gestion du trafic spatial (Space Traffic Coordination and Management ou STCM) (1). |
|
2.5. |
Une véritable législation sur les activités spatiales et le trafic des satellites pour garantir la durabilité à long terme de l’espace s’avère donc aussi urgente que stratégique, tout comme le recours à l’intelligence artificielle pour éviter les risques de collision. |
|
2.6. |
En début d’année, la Commission européenne a donné le coup d’envoi du projet Spaceways dont le but est de dessiner les contours d’un système de gestion du trafic spatial afin de «définir un code de la route et [de] déterminer sous quelles conditions des licences et des autorisations de vol pourraient être délivrées». |
|
2.7. |
L’objectif des projets Spaceways et EUSTM, lancé pour sa part en janvier 2021, est de fournir, d’ici respectivement juin et août 2022, des recommandations et des orientations à la Commission européenne sur la «gestion du trafic spatial, ainsi qu’une évaluation juridique, politique et économique menant à des recommandations finales et des lignes directrices pour la mise en œuvre» (2). |
|
2.8. |
La Communication conjointe de la Commission et du haut représentant reconnaît la nécessité d’une approche de l’Union et prévoit une consultation, des discussions et dialogues réguliers avec toutes les parties prenantes concernées dans l’Union, civiles et militaires, dans le domaine des transports, en particulier l’aviation, et l’industrie spatiale européenne, tout en tenant compte des besoins en termes de défense et de sécurité, avec le soutien de l’Agence européenne de défense. Le CESE souhaite que l’ensemble du corps social, et pas seulement l’industrie, participe à ce processus. |
|
2.9. |
La communication envisage de recourir au consortium EU SST (3) pour mettre en place la capacité opérationnelle essentielle à la future gestion du trafic spatial de l’Union, ce qui suppose d’améliorer ses performances, de mettre au point des services de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite (SST), ainsi que de nouvelles technologies grâce à l’intelligence artificielle et aux technologies quantiques, de soutenir les opérations de réduction des débris et d’entretien en orbite, et d’établir des synergies de financement entre l’Union, les fonds nationaux, l’Agence spatiale européenne (ESA), Horizon Europe et le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID). |
|
2.10. |
Le renforcement de la couverture de l’espace en dehors du continent européen est un aspect majeur du programme de l’Union pour une connectivité sécurisée pour la période 2023-2027; l’Union devra compter notamment sur le Bureau des affaires spatiales de l’Organisation des Nations unies (UNOOSA), et sur des organismes nationaux pour développer les normes qui seront applicables à la gestion du territoire spatial, tout en encourageant le développement de normes communes dans le cadre d’un forum spécifique, et promouvoir une approche intégrée au sein des organisations internationales de normalisation. |
|
2.11. |
Les ambitions énoncées supposent à court terme que l’industrie adopte certaines obligations, et à moyen terme que les États membres élaborent une proposition législative pour remédier à la fragmentation des approches nationales et éviter les distorsions de concurrence avec les opérateurs établis hors de l’Union, en imposant le principe de l’égalité de traitement entre opérateurs. Des mesures non contraignantes telles que des lignes directrices sont aussi envisagées.
La proposition législative serait la première étape; les organisations européennes devront ensuite adopter des exigences techniques, que ce soient des normes ou des lignes directrices applicables à tous. |
|
2.12. |
La communication indique que l’Union donnera sa préférence à une approche multilatérale dans le cadre des Nations unies, en favorisant le dialogue avec le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) et la Conférence du désarmement. Elle devra donc identifier les organes onusiens compétents pour déployer son action, car il en va de l’avenir de l’humanité, sans oublier l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
La méthode envisagée dans la communication est ascendante: elle partira des contributions nationales et régionales en visant un consensus entre les règles et normes envisagées, pour ensuite intégrer les composantes régionales à la gestion mondiale, dont la gouvernance reste à définir. |
3. Observations générales
|
3.1. |
La communication de la Commission évalue les besoins en matière de gestion du trafic spatial et propose une approche européenne de l’utilisation, y compris civile, de l’espace applicable à l’échelle mondiale. Le développement des activités spatiales, la multiplication et la diversification des acteurs impliqués dans l’exploitation de l’espace extra-atmosphérique, ainsi que la dépendance de l’ensemble des secteurs d’activité vis-à-vis des technologies satellitaires et des services ont conduit à une surexploitation progressive des orbites et à une saturation du spectre des fréquences qui nécessite une rationalisation de ces dernières. |
|
3.2. |
Les orbites terrestres sont considérées en droit international (Union internationale des télécommunications ou UIT) comme des ressources naturelles limitées. Les principes de liberté et de non-appropriation qui régissent l’emploi des orbites terrestres sont confrontés à des demandes d’attribution de fréquences et à la prolifération des systèmes satellitaires de pays et d’entreprises qui s’affranchissent parfois des règles de l’UIT. |
|
3.3. |
La lutte entre acteurs spatiaux jusqu’alors essentiellement étatiques et ceux qui aspirent à ce statut, y compris des acteurs privés, appelle une réforme en profondeur des normes internationales qui furent adoptées lorsque l’espace était l’affaire d’un groupe restreint de puissances technologiques et industrielles. |
|
3.4. |
Au-delà des questions juridiques, l’utilisation du territoire spatial s’inscrit dans un contexte marqué par le retour de tensions géopolitiques internationales, comme le montre l’actualité: c’est le cas notamment des opérations co-orbitales d’intimidation, des démonstrations de surenchère technologique ou des essais d’armes antisatellites, qui ont installé un climat de méfiance entre les États. |
|
3.5. |
Les défis posés par la saturation des orbites et du spectre des fréquences, ainsi que la menace créée par la multiplication des débris spatiaux, ont amené les États membres, l’ESA et le consortium EU SST (4) à envisager une meilleure coordination des outils et des technologies de surveillance. Le CESE appelle de ses vœux des régulations strictes face à la multiplication de constellations privées et de possibles zones de non-droit. |
|
3.6. |
La communication conjointe illustre la délicate relance du dialogue international en faveur d’un code de conduite et de mesures, y compris législatives, destinées à garantir la pérennité de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. |
Considérations juridiques et politiques
|
3.7. |
Le CESE soutient les objectifs opérationnels énoncés dans la communication et la proposition de règlement, et souhaite attirer l’attention sur des considérations juridiques et politiques qui ne sauraient être omises compte tenu des enjeux en cause. |
|
3.8. |
La notion de droit de l’espace n’est pas facile à définir. La question de la délimitation de l’espace ne fait pas l’objet d’un consensus, mais il est toutefois admis que le droit de l’espace se caractérise notamment au regard de ses principes directeurs. |
|
3.9. |
Si de grands principes ont été adoptés, après cinq traités internationaux et huit résolutions internationales (5), la question de la définition du droit de l’espace est restée en suspens, car les préoccupations du début de l’exploration spatiale étaient surtout d’empêcher que les premières puissances spatiales s’approprient les corps célestes, au lieu de définir explicitement l’objet de ce droit. |
|
3.10. |
Les principes du droit de l’espace ont été établis dès la résolution des Nations unies 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963, et réitérés dans le premier traité de l’espace de 1967.
Ils prévoient les éléments suivants:
|
|
3.11. |
Deux autres principes du droit de l’espace témoignent de son orientation pacifique.
Le premier est l’obligation de coopération et d’assistance mutuelle imposée à tous les États participant à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. Elle implique un dialogue effectif et transparent entre les puissances spatiales afin d’assurer la pérennité et la sécurité des activités menées. Aujourd’hui, ce dialogue est notamment tourné vers la problématique des débris spatiaux, comme l’illustre la communication. |
|
3.12. |
Le deuxième principe central du droit de l’espace est la responsabilité des États et des nouveaux acteurs pour leurs activités spatiales. Elle se décline en une responsabilité internationale pour le contrôle des activités et une responsabilité pour dommage du fait de ces activités dans l’espace extra-atmosphérique. C’est dans le volet de la responsabilité internationale pour le contrôle des activités que la communication conjointe tend à s’inscrire. |
|
3.13. |
Lors de l’élaboration des principaux traités spatiaux, le sujet des débris spatiaux et celui de la saturation des orbites et des fréquences n’étaient pas à l’ordre du jour, mais aujourd’hui, la dépendance de nos sociétés vis-à-vis des ressources satellitaires a entraîné une forte augmentation du lancement d’objets dans l’espace, au point que la question des orbites et des allocations de fréquences est devenue un véritable enjeu stratégique. |
|
3.14. |
Nous avons donc assisté, après soixante ans d’exploitation spatiale, à une augmentation sans précédent des enjeux de sécurité liés aux orbites. Depuis le test ASAT chinois de janvier 2007, les démonstrations de force dans l’espace se sont multipliées, sous diverses formes. La question de l’«arsenalisation» de l’espace se pose également.
En droit international, cette question est au cœur d’une zone grise car il n’existe encore aucune définition de ce qui constitue un moyen d’attaque dans l’espace, ni de ce qui constitue une agression, alors que les méthodes d’attaque dans l’espace sont diverses et variées; elles comprennent la frappe de missiles, la cécité du faisceau laser, les cyberattaques sur les relais de communication, les manœuvres co-orbitales, etc. |
|
3.15. |
L’orbite géostationnaire est, quant à elle, confrontée à une difficulté de nature différente: la congestion des fréquences et le risque d’interférences. L’orbite géostationnaire représente une zone critique pour la continuité des services de télécommunications pour tous les États de la planète. Cette évolution n’est pas sans poser un certain nombre de difficultés juridiques car le développement de l’orbite géostationnaire a conduit à la création d’un marché économique, et même à la naissance de la spéculation. |
|
3.16. |
Compte tenu de ce qui précède, le CESE considère donc que la communication conjointe doit fermement promouvoir, dans le cadre d’une diplomatie active, une gestion multilatérale du trafic spatial dans le cadre des Nations unies, notamment au sein du CUPEEA et de la Conférence du désarmement, car nous n’avons pas assez de règles en la matière. |
La gestion du trafic spatial, un enjeu de gouvernance européenne
|
3.17. |
La gestion du trafic spatial n’est pas un nouveau concept. Cependant, en raison de la nature et de l’importance des défis pour la sécurité, la sûreté et la durabilité des activités spatiales, la gestion du trafic spatial (STM) a acquis un degré de priorité sans précédent parmi les acteurs de l’espace et les États conscients de leur dépendance à l’égard des biens spatiaux. Or, seuls les États disposant de capacités technologiques sont déjà dotés de programmes de surveillance et de suivi spatiaux (SST) et de veille spatiale (Space Situational Awareness ou SSA). |
|
3.18. |
Le département de la défense des États-Unis exploite actuellement le système le plus avancé. Son Space Surveillance Network (SSN), qui repose sur des radars terrestres et spatiaux, fournit aux États-Unis une capacité unique de détection et d’identification, qu’ils utilisent également comme un instrument d’influence auprès de leurs alliés et partenaires.
D’autres États comme la Russie, la Chine, le Japon, l’Inde et certains pays européens (France, Allemagne) ont également élaboré des programmes de surveillance spatiale. Compte tenu de leur fonction stratégique, la grande majorité de ces programmes relèvent du contrôle militaire, avec l’appui des agences spatiales. Dans l’UE, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et l’Espagne ont créé le consortium EU SST pour évaluer gratuitement le risque de collisions en orbite et de rentrée non contrôlée de débris spatiaux dans l’atmosphère terrestre, et détecter les fragmentations en orbite. En 2023, l’EU SST deviendra un partenariat incluant davantage d’États membres, destiné à fournir un service d’évaluation des risques de collisions aux opérateurs de satellites européens et mondiaux. Certaines entreprises privées ont également établi leurs propres systèmes de SST/SSA afin de fournir des données et des services commerciaux. |
|
3.19. |
Comme le constate la communication conjointe et comme le montre le présent avis, le principal problème lié à la mosaïque des programmes de STM réside dans l’absence de normalisation internationale. Pourtant, il est clair qu’il faut élaborer des normes, des lignes directrices et des pratiques internationales exemplaires. |
|
3.20. |
Les initiatives et décisions globales concernant la STM sont susceptibles de créer un environnement difficile pour l’Europe et ses acteurs spatiaux. La politique américaine a pris les devants en énonçant que les États-Unis devraient montrer la voie au reste du monde en élaborant de meilleures normes de données et de connaissance de la situation spatiale, élaborer un ensemble de techniques normalisées pour atténuer les risques de collision et promouvoir à l’échelle internationale un éventail de normes techniques, de pratiques et de normes en matière de sécurité des opérations dans l’espace. |
|
3.21. |
L’Union a pris la mesure des dimensions stratégique, commerciale et géopolitique de la gestion du trafic spatial qui ne se limite pas à la durabilité de l’espace extra-atmosphérique, mais porte également sur la future autonomie de l’Europe en matière d’accès et d’utilisation de l’espace.
Les acteurs spatiaux européens ont déjà développé certaines politiques et initiatives visant à gérer directement ou indirectement les préoccupations de gestion du trafic spatial. Cependant, le retard pris par l’Europe lorsqu’il s’agit d’aborder la question par des projets communs a des conséquences. |
|
3.22. |
En effet, la future compétitivité de la fabrication européenne de satellites pourrait être menacée si les entreprises étaient forcées de recourir aux données de la STM américaine ou de déposer une licence de la STM américaine, avec la possibilité qu’elle leur soit refusée. Des risques considérables existent également pour les prestataires européens de services de lancement.
De nombreux acteurs européens comptent beaucoup sur les accords de partage de données signés avec les États-Unis en ce qui concerne le nouveau système européen de veille spatiale de 2021 (Space Situational Awareness ou SSA). Parmi eux figurent des ministères et des armées (6), des organisations intergouvernementales européennes (ESA, EUMETSAT), des opérateurs commerciaux de satellites et des prestataires de services de lancement. |
|
3.23. |
Selon le CESE, l’Union doit adopter des dispositions visant à garantir non seulement un niveau de performance certifié, mais aussi la disponibilité à long terme de services basés dans l’espace. En outre, à l’heure où elle tente de mettre en œuvre une politique de sécurité et de défense commune crédible à laquelle les biens spatiaux apportent une contribution essentielle, voire vitale, l’Europe doit satisfaire aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et de sûreté pour les utilisateurs gouvernementaux et de défense. |
|
3.24. |
Le CESE relève que bien que, par le passé, l’approche de l’UE ait été principalement orientée vers la protection physique des biens spatiaux, qui repose sur une stratégie rigide et coûteuse, les récentes initiatives de l’Union suggèrent une transition vers une approche plus axée sur la résilience. L’UE plaide aujourd’hui en faveur d’une stratégie d’anticipation en matière de sécurité des infrastructures spatiales. À cette fin, elle a lancé deux initiatives importantes: la proposition d’établir un code international de conduite pour les activités spatiales et le programme européen de veille spatiale. |
|
3.25. |
Néanmoins, le CESE déplore une première insuffisance qui réside dans la difficulté de coordonner les capacités de certains États membres dotés de leurs propres moyens de surveillance et de contrôle. Aujourd’hui, il est difficile de parvenir à un consensus sur les objectifs à atteindre dans le cadre d’un programme européen de STM. La question de la gestion du trafic spatial est, dans une large mesure, l’illustration parfaite de la difficulté de faire émerger une véritable gouvernance européenne dans le secteur spatial, même si les questions de durabilité de l’espace et de sécurité de l’espace extra-atmosphérique sont communes à tous les États membres, soit parce qu’ils déploient des capacités spatiales, soit parce qu’ils utilisent des ressources spatiales. |
|
3.26. |
Ces difficultés sont autant d’obstacles à la compétitivité de l’industrie spatiale européenne à l’échelle internationale. À long terme, l’absence de normes établies par l’Europe et de compatibilité avec les autres normes pourrait compromettre la liberté d’accès à l’espace. Avoir sa propre capacité de lancement n’est pas suffisant. Il est également nécessaire de pouvoir déployer des satellites indépendamment des normes définies en dehors de l’Europe afin de maintenir la compétitivité spatiale européenne, comme a pu l’illustrer, le 22 juin 2022, le succès de la première mission de l’année d’Ariane 5, dont le but était la mise sur orbite de deux satellites, un malaisien et un indien. De plus, Ariane 6, la prochaine étape, ne tardera pas à devenir réalité; plus flexible et moins coûteuse qu’Ariane 5 (et donc plus compétitive face à la concurrence de l’américain SpaceX), son premier vol est prévu en 2023. |
|
3.27. |
Le CESE profite de l’occasion de cette communication, pour rappeler:
|
|
3.28. |
Si l’existence de normes et de standards élaborés au niveau national par certains États membres peut s’avérer utile pour le développement de dispositions communes, il sera néanmoins impératif pour l’Europe de s’imposer comme l’arbitre final des mesures de normalisation. Cela exige que les États membres de l’UE et de l’ESA s’entendent sur les objectifs et les principes des efforts européens dans le domaine de la STM, qu’ils définissent des mécanismes de consultation et de coordination, et qu’ils déterminent une délimitation claire des rôles, un partage sans équivoque des responsabilités et une répartition transparente des activités entre les États membres et les parties prenantes européennes, et ce sans contradiction avec les systèmes existants dans d’autres pays. |
|
3.29. |
Selon le CESE, la communication conjointe est une reconnaissance tardive, mais néanmoins bienvenue, de l’importance de relever les défis à plusieurs niveaux qui découleront de l’augmentation des activités spatiales, dont l’absence d’encadrement contraignant risque de compromettre l’équilibre mondial. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) JOIN(2022) 4 final.
(2) Le projet Spaceways, financé par le programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020», est composé de 13 acteurs européens majeurs: fabricants et lanceurs de satellites, opérateurs et fournisseurs de services, ainsi que centres et instituts de recherche dans le domaine politique et juridique.
L’EUSTM est composé de 20 acteurs européens majeurs.
(3) La France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et l’Espagne.
(4) https://www.eusst.eu
(5) I. Chalaye, «Le statut des orbites terrestres et leur utilisation à la lumière des principes du droit spatial», Institut d’études de géopolitique appliquée (IEGA), Paris, octobre 2021.
(6) https://www.esa.int/Safety_Security/SSA_Programme_overview
ANNEXE
L’avis complémentaire de la commission consultative des mutations industrielles — CCMI/196 — «Nouvel espace» figure sur les pages ci-après:
«Avis de la Commission consultative des mutations industrielles sur le thème “Connectivité spatiale sécurisée et nouvel espace: une voie industrielle européenne vers la souveraineté et l’innovation”
(avis complémentaire à l’avis TEN/775)
|
Rapporteur: |
Maurizio MENSI |
|
Corapporteur: |
Franck UHLIG |
|
Décision de l’assemblée plénière |
22.2.2022 |
|
Base juridique |
Article 56, paragraphe 1, du règlement intérieur |
|
|
(avis complémentaire) |
|
Compétence |
Commission consultative des mutations industrielles |
|
Adoption en section |
24.6.2022 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
21/0/1 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le Comité économique et social européen (CESE) soutient les initiatives de la Commission européenne sur la connectivité spatiale sécurisée et le nouvel espace visant à renforcer la souveraineté industrielle et opérationnelle des États membres. Il est essentiel de garantir l’autonomie de l’Europe, non seulement pour sa compétitivité industrielle future, mais aussi pour assurer sa non-dépendance stratégique et sa résilience (1) , comme l’a révélé récemment la pénurie de composants électroniques, en particulier à la suite de la crise de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine, qui ont durement touché l’industrie spatiale européenne. |
|
1.2. |
Le CESE estime qu’une connectivité sûre, accessible et abordable constitue non seulement un outil essentiel au bon fonctionnement de la démocratie participative, mais aussi une condition préalable à la mise en œuvre adéquate des droits fondamentaux et une occasion de renforcer les moyens d’action des citoyens et de la société civile. |
|
1.3. |
Le CESE reconnaît l’importance de l’espace pour notre économie et notre société, ainsi que sa pertinence stratégique du point de vue de la sécurité et de la défense, comme l’a montré la guerre russo-ukrainienne. En outre, la sécurité physique et la cybersécurité des infrastructures au sol et spatiales, ainsi que les données y afférentes, sont essentielles pour assurer la continuité du service et le bon fonctionnement des systèmes. |
|
1.4. |
Le CESE estime qu’il est essentiel de stimuler l’écosystème spatial européen pour faire progresser la double transition et relever les grands défis mondiaux tels que le changement climatique. Il reconnaît également les avantages potentiels de la participation des jeunes pousses et des PME du secteur spatial aux programmes spatiaux de l’Union, notamment leur contribution à la résilience et à l’autonomie stratégique de l’UE. |
|
1.5. |
La gouvernance d’un système de connectivité spatiale sécurisé et autonome (ci-après le “programme”) nécessitant une collaboration entre différents organismes, le CESE a la ferme conviction qu’il convient de garantir un degré efficace et approprié de coordination. |
|
1.6. |
Le CESE estime que le programme-cadre Horizon Europe, déjà en place, devrait être utilisé pour stimuler le marché de l’espace, soutenir la création de solutions commerciales innovantes pour les secteurs spatiaux de l’UE en aval et en amont, et accélérer la disponibilité des technologies clés nécessaires au programme, en liaison avec les initiatives EuroQCI (2) et ENTRUSTED (3). En particulier, un système européen de composants, de systèmes et de sous-systèmes nécessiterait des efforts colossaux de longue haleine pour rétablir une industrie européenne forte. |
|
1.7. |
Le CESE recommande le développement de synergies avec le Fonds européen de la défense ainsi que dans le cadre du plan d’action de la Commission sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense. |
|
1.8. |
Le CESE est d’avis que, pour garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne, les initiatives de la Commission devraient contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et appuyer des activités d’enseignement et de formation afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine, de manière à améliorer la dimension sociale du programme, qui est un élément important. |
|
1.9. |
Le CESE souligne la nécessité de tenir compte de toutes les capacités spatiales pour la modernisation des moyens spatiaux existants (Galileo (4), Copernicus (5)) ainsi que pour le développement ultérieur de constellations et services. Cela permettra de renforcer la résilience des moyens spatiaux de l’UE et de favoriser la compétitivité de son industrie. L’attribution des responsabilités sur la base de compétences démontrées devrait garantir une mise en œuvre efficace du programme. |
|
1.10. |
Le CESE estime que l’Union doit encourager le progrès scientifique et technique et soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation du secteur spatial, en particulier en ce qui concerne les PME, les jeunes pousses et les entreprises innovantes, de manière à stimuler les activités économiques en amont et en aval. En fait, les programmes de recherche et d’innovation jouent un rôle fondamental dans le renforcement des capacités technologiques de l’Union et de ses membres. |
2. Contexte de l’avis, y compris la proposition législative à l’examen
|
2.1. |
La proposition de la Commission européenne vise à élaborer un programme pour la fourniture de services de télécommunications par satellite garantis et résilients. La Commission s’est engagée à encourager l’innovation dans le secteur spatial et à contribuer davantage au développement d’un écosystème européen dynamique du nouvel espace, un engagement qui figure en tête des priorités de son programme spatial. À cette fin, elle a lancé l’initiative “Cassini” (6). En particulier, ce programme garantira aux utilisateurs gouvernementaux la disponibilité à long terme, dans le monde entier, de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés et présentant un bon rapport coût-efficacité, ce qui contribuera à la protection des infrastructures critiques, à la surveillance, aux actions extérieures et à la gestion des crises, renforçant ainsi la résilience des États membres. |
|
2.2. |
L’initiative est censée bénéficier de l’expertise de l’industrie spatiale industrielle européenne, comprenant à la fois les acteurs industriels bien établis et l’écosystème du “nouvel espace”. Ainsi, la connectivité mondiale par satellite est devenue un atout stratégique pour la sécurité, la sûreté et la résilience de l’Union et de ses États membres. La proposition vise également à permettre la disponibilité commerciale d’une connectivité à haut débit dans toute l’Europe, en supprimant les zones mortes et en améliorant la cohésion entre les territoires des États membres, ainsi qu’à offrir une connectivité dans des zones géographiques d’intérêt stratégique, telles que l’Afrique et la région arctique. Après Galileo et Copernicus, la troisième constellation proposée s’appuiera sur trois nouveaux différenciateurs: la sécurité dès le stade de la conception (grâce à l’utilisation de nouvelles technologies, telles que les technologies quantiques) pour les communications sensibles (défense), une constellation multiorbitale et une architecture fondée sur des partenariats public-privé (de manière à renforcer encore la dimension commerciale). |
|
2.3. |
La proposition est en cohérence avec plusieurs autres politiques européennes et initiatives législatives de l’Union en cours concernant les données (telles que la directive INSPIRE (7) et la directive sur les données ouvertes (8)), l’informatique en nuage et la cybersécurité. La fourniture de services gouvernementaux raffermirait notamment la cohésion, en accord avec la stratégie numérique et la stratégie de cybersécurité de l’UE, en garantissant l’intégrité et la résilience des infrastructures, réseaux et télécommunications européens. La proposition soutiendra également la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial au sein de l’Union et contribuera grandement à garantir à l’Europe un accès autonome et abordable à l’espace dans les années à venir, tout en ayant une incidence favorable profonde et cruciale sur la compétitivité des modèles d’exploitation des lanceurs européens (9). |
|
2.4. |
Les conclusions du Conseil européen des 21 et 22 mars 2019 ont souligné que l’Union devait aller plus loin dans la mise en place d’une économie numérique compétitive, sûre, inclusive et éthique, dotée d’une connectivité de rang mondial (10). En particulier, l’objectif annoncé du plan d’action de la Commission du 22 février 2021 sur les synergies entre les industries civile, spatiale et de la défense est de permettre “à tout un chacun en Europe d’avoir accès à une connectivité à haut débit” et de fournir “un système de connectivité résilient permettant à l’Europe de rester connectée quelle que soit la situation” (11). |
|
2.5. |
Le programme compléterait les arrangements établis dans le cadre du programme EU Govsatcom (12) existants en matière de mise en commun et de partage des capacités gouvernementales actuelles dans le domaine des télécommunications par satellite. En raison de la durée de vie limitée d’un satellite, plusieurs des infrastructures publiques qui feront partie de l’infrastructure mutualisée et partagée Govsatcom devront être remplacées au cours de la prochaine décennie (13). |
|
2.6. |
Devant l’accroissement des menaces hybrides et des cybermenaces ainsi que des risques de catastrophe naturelle, les besoins des acteurs gouvernementaux évoluent dans le sens de solutions de télécommunication par satellite adaptées qui soient davantage sécurisées et fiables et plus aisément disponibles. En outre, la montée en puissance des ordinateurs quantiques fait planer une menace supplémentaire, étant donné que ces ordinateurs devraient pouvoir décrypter des informations qui sont actuellement cryptées. |
|
2.7. |
Différentes mégaconstellations de satellites non européennes soutenues ou subventionnées par l’État sont apparues aux États-Unis, en Chine et en Russie. Cet état de fait, conjugué au manque de fréquences et de créneaux orbitaux disponibles et à la durée de vie limitée des capacités Govsatcom, confère un caractère d’urgence à la mise en place d’un système spatial de connectivité sécurisée de l’Union. Le programme porterait sur les lacunes actuelles et anticipées des capacités des services gouvernementaux de télécommunications par satellite. |
|
2.8. |
Il devrait également permettre au secteur privé de fournir des services commerciaux de télécommunications par satellite. Il ressort de l’analyse d’impact qu’un partenariat public-privé constitue le modèle de mise en œuvre le plus approprié pour garantir que les objectifs du programme peuvent être poursuivis. Il stimulerait notamment l’innovation au sein de toutes les composantes de l’industrie spatiale européenne (grands intégrateurs de systèmes, sociétés indépendantes à moyenne capitalisation, PME et jeunes pousses). |
|
2.9. |
Alors que les gouvernements, les citoyens et les institutions de l’UE sont de plus en plus tributaires de la connectivité, leurs besoins requièrent des solutions offrant un degré de sécurité plus élevé, une faible latence (14) et un plus haut débit, d’où la nécessité de leur garantir l’accès à des solutions résilientes fondées sur des technologies innovantes, ainsi qu’à de nouvelles tendances et approches industrielles. Le système envisagé servira donc de moteur au développement technologique, comme le souligne la proposition. |
|
2.10. |
Pour gagner en rentabilité et tirer parti des économies d’échelle, le programme devrait optimiser l’adéquation entre l’offre et la demande en services gouvernementaux. |
|
2.11. |
En fait, les télécommunications par satellite offrent une couverture ubiquitaire, qui vient en complément des réseaux terrestres. Le fait que ces infrastructures sont de plus en plus considérées comme un atout stratégique témoigne d’un besoin général croissant de doter les services gouvernementaux d’une connectivité résiliente, non seulement pour appuyer les opérations de sécurité des États, mais aussi pour connecter les infrastructures critiques, faciliter une interaction électronique transfrontière ou transsectorielle efficace et effective entre les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens, contribuer à la mise en place d’une administration en ligne plus efficace, moins complexe et plus conviviale aux niveaux national, régional et local de l’administrations (15), gérer les crises et renforcer la surveillance des frontières ainsi que des mers et des océans. |
|
2.12. |
La mise en place du programme se fera progressivement et en veillant à garantir la qualité. Le développement et le déploiement initiaux pourraient commencer à partir de 2023, et la fourniture des premiers services de même que les essais en orbite de la cryptographie quantique d’ici à 2025; le déploiement complet du système et de sa cryptographie quantique intégrée permettrait la fourniture des services complets d’ici à 2028. Son coût total est estimé à 6 milliards d’EUR et le financement proviendra de différentes sources du secteur public (budget de l’Union, contributions des États membres et de l’ESA) et d’investissements du secteur privé. Quant au financement de l’Union, il sera conçu de manière à ne pas compromettre la mise en œuvre des composantes spatiales existantes dans le cadre du règlement de l’Union sur l’espace, notamment Galileo et Copernicus. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Le CESE estime que, dans le monde numérique actuel, la connectivité spatiale est un atout essentiel et stratégique pour des sociétés modernes. Elle garantit la puissance économique, le leadership numérique et la souveraineté technologique, la compétitivité économique et le progrès sociétal. En accordant un rôle plus important aux acteurs du secteur spatial, le programme vise à garantir des données et des services spatiaux de haute qualité et sécurisés, susceptibles d’apporter des avantages socio-économiques aux citoyens et aux entreprises d’Europe, de renforcer la sécurité et l’autonomie de l’Union ainsi que son rôle de chef de file dans le secteur spatial, afin de lui permettre de concurrencer d’autres économies spatiales de premier plan et des nations émergentes dans le domaine de l’espace. La connectivité spatiale est en outre un outil technique important qui permet la liberté d’expression et la libre circulation des idées. |
|
3.2. |
Le CESE considère qu’une connectivité sûre, accessible et abordable constitue une condition préalable non seulement au bon fonctionnement de la démocratie participative, mais aussi à la mise en œuvre résiliente des droits fondamentaux, et une occasion de renforcer les moyens d’action des citoyens et de la société civile. Les citoyens européens dépendent de plus en plus de la technologie, des données et des services spatiaux. Cela implique notamment le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. En outre, l’espace joue un rôle de plus en plus important dans la croissance économique, la sécurité et le poids géopolitique de l’UE. En ce sens, une connectivité fiable et sécurisée pourrait être considérée comme un bien public pour les gouvernements et les citoyens. |
|
3.3. |
Le CESE encourage le recours aux partenariats public-privé (PPP) car il s’agit d’un modèle de mise en œuvre approprié pour garantir que les objectifs du programme puissent être poursuivis. La participation directe du secteur privé permet la création d’un environnement favorable à la poursuite du développement d’une connectivité à haut débit et sans discontinuité dans toute l’Europe, en éliminant les zones mortes en matière de communication et en garantissant la cohésion entre les territoires des États membres ainsi qu’en offrant une connectivité qui couvre des zones géographiques d’intérêt stratégique. |
|
3.4. |
À l’issue d’une procédure de passation de marché avec mise en concurrence, la Commission pourrait conclure un contrat de concession ayant pour objet la livraison de la solution requise et la protection des intérêts de l’Union et des États membres. La participation du secteur, par l’intermédiaire d’un tel contrat, devrait offrir au partenaire privé la possibilité de compléter les infrastructures du programme par des capacités supplémentaires, à l’aide d’investissements propres supplémentaires. |
|
3.5. |
À cet égard, le CESE souligne que la future gouvernance du programme devra dûment refléter le rôle du secteur public, en accordant une attention toute particulière à la sécurité des infrastructures et au contrôle rigoureux des coûts, du calendrier et des performances. La Commission interviendra en tant que gestionnaire du programme pour la mise en place et la surveillance de la concession. L’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial sera chargée de la prestation des services gouvernementaux tandis que l’ESA se verra confier le suivi des activités de développement et de validation. Le CESE estime que les PME sont également essentielles à l’innovation et à l’écosystème dans la nouvelle économie spatiale. À ce titre, il convient d’encourager activement le développement des services spatiaux fournis par les PME, ainsi que la passation de marchés les concernant, tant par les pouvoirs publics que par le secteur privé. Cela contribuerait à la création d’emplois, à l’amélioration des compétences technologiques et à la stimulation de la compétitivité de l’Europe, qui revêtent une importance croissante pour la double transition de l’UE vers une économie durable et numérique. Cette démarche permettrait une concurrence effective et transparente, en renforçant l’autonomie de l’UE sur le plan technologique grâce à des exigences spécifiques en matière de sécurité, de continuité des services et de fiabilité. |
|
3.6. |
Le CESE estime que, dans le cadre de la procédure de passation de marché, il conviendrait de définir des critères précis d’attribution de la concession, garantissant la participation des jeunes pousses et des PME tout au long de sa chaîne de valeur, encourageant ainsi le développement de technologies innovantes et de rupture. Dans les cas où le recours à des fournisseurs de pays tiers pourrait poser des problèmes d’un point de vue sécuritaire et stratégique, des règles de participation appropriées devraient être mises en place. |
|
3.7. |
Le CESE est d’avis qu’il convient d’encourager les PME à tirer parti des multiples instruments de financement dont dispose l’UE pour dynamiser l’écosystème spatial, car cela permettrait de créer des emplois, d’améliorer les compétences technologiques et de renforcer la compétitivité industrielle de l’Europe. |
4. Observations particulières
|
4.1. |
Le CESE est convaincu que la souveraineté stratégique de l’Union et des États membres dépend principalement de l’autonomie et des capacités technologiques de l’industrie européenne ainsi que de la sécurité des communications par satellite, en particulier dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Il soutient dès lors fermement les initiatives visant à renforcer la souveraineté industrielle et technologique des États membres de l’UE. |
|
4.2. |
Le CESE est favorable à la proposition et considère les synergies potentielles entre les activités gouvernementales et les activités civiles commerciales comme une occasion précieuse d’un point de vue économique, y compris pour les services supplémentaires offerts aux citoyens européens, dans le contexte d’une augmentation, à l’échelle mondiale, des investissements publics et privés dans les activités spatiales. |
|
4.3. |
Le CESE souligne l’intérêt de soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation des industries du secteur spatial au sein de l’Union. Cela contribuera grandement à garantir à l’Europe un accès autonome et abordable à l’espace dans les années à venir, tout en ayant une incidence favorable profonde et cruciale sur la compétitivité des modèles d’exploitation des lanceurs européens. |
|
4.4. |
Le CESE fait observer que le programme devrait permettre aux opérateurs de télécommunications de bénéficier d’une capacité accrue et de services fiables et sûrs. Par ailleurs, la dimension commerciale permettra de proposer des services de détail à davantage d’utilisateurs privés dans l’ensemble de l’UE. |
|
4.5. |
S’agissant de la gouvernance du programme (chapitre V de la proposition de règlement), il est clair que les principaux rôles seront assumés par quatre acteurs: la Commission, l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial (“l’Agence”), les États membres et l’ESA. |
|
4.6. |
À cet égard, le CESE est fermement convaincu qu’il est impératif de veiller à une répartition claire des tâches, des rôles et des responsabilités, ainsi qu’à une coordination appropriée entre les différents acteurs, pour assurer le bon fonctionnement du programme. Pour cette raison, une répartition précise des responsabilités sur la base des compétences démontrées devrait également garantir l’exécution efficace du programme en matière de coûts et de délais. Une gestion efficace du trafic spatial est également essentielle pour améliorer la sécurité, compte tenu de la quantité croissante de débris dans l’espace. |
|
4.7. |
Le CESE souligne que la cybersécurité des infrastructures, tant au sol que dans l’espace, est essentielle pour assurer le fonctionnement et la résilience du système. |
|
4.8. |
Le CESE fait observer que, pour garantir la compétitivité de l’industrie spatiale européenne, le programme devrait contribuer au développement de compétences avancées dans des domaines liés à l’espace et appuyer des activités d’enseignement et de formation, en promouvant l’égalité des chances, et notamment l’égalité entre les femmes et les hommes et l’émancipation des femmes, afin de tirer pleinement parti du potentiel des citoyens de l’Union dans ce domaine. |
|
4.9. |
Le CESE fait remarquer que la mise en place et la mise à niveau des infrastructures peuvent faire intervenir de nombreux acteurs industriels dans plusieurs pays; leurs travaux doivent être coordonnés de façon efficace pour aboutir à des systèmes fiables et parfaitement intégrés, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la cybersécurité. |
Bruxelles, le 24 juin 2022.
Le président de la commission consultative des mutations industrielles (CCMI)
Pietro Francesco DE LOTTO»
(1) L’industrie spatiale européenne est la deuxième plus grande au monde: elle emploie plus de 231 000 professionnels et l’on estime que sa valeur se situe entre 53 et 62 milliards d’euros [étude sur le marché spatial (Space Market), Parlement européen, novembre 2021].
(2) “European Quantum Communication Infrastructure” (Infrastructure européenne de communication quantique).
(3) Projet de recherche dans le domaine des communications par satellite sécurisées (SatCom) pour les acteurs gouvernementaux de l’UE. ENTRUSTED: “European Networking for satellite Telecommunication Roadmap for the governmental Users requiring Secure, inTeroperable, innovativE and standardiseD services” (Feuille de route européenne pour la mise en réseau dans le domaine des télécommunications par satellite pour les utilisateurs gouvernementaux nécessitant des services sécurisés, interopérables, innovants et standardisés).
(4) Le système mondial de navigation par satellite européen, opérationnel depuis décembre 2016, date à laquelle il a commencé à fournir des services aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux citoyens.
(5) Le programme européen d’observation de la Terre, fournisseur de données d’observation de la Terre, qui est utilisé pour les prestataires de services, les pouvoirs publics et les organisations internationales.
(6) “Competitive Space Start-ups for INnovatIon” est l’initiative de la Commission européenne en faveur de l’entrepreneuriat spatial, dont l’objectif principal est de soutenir les jeunes pousses et les PME à différents stades de leur croissance au moyen d’un ensemble d’outils et de financements.
(7) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(8) Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).
(9) Avec dix-huit satellites déjà en orbite et plus de trente autres qui seront mis en orbite dans les dix à quinze prochaines années, l’Union est le plus gros client institutionnel de services de lancement en Europe. Les lanceurs constituent, après les satellites commerciaux, le deuxième domaine d’activité de fabrication spatiale en Europe, et stimulent ainsi l’industrie européenne. La Commission va regrouper les besoins en matière de services de lancement des programmes de l’Union et agir en client intelligent de solutions de lancement européennes fiables et rentables. Il est essentiel que l’Europe continue à disposer d’infrastructures de lancement modernes, efficaces et souples.
(10) En juin 2019, les États membres ont signé la déclaration relative à l’infrastructure européenne de communication quantique (EuroQCI), convenant ainsi de travailler ensemble, en collaboration avec la Commission et avec le soutien de l’Agence spatiale européenne (ESA), afin de mettre en place une infrastructure de communication quantique couvrant l’ensemble de l’Union.
(11) COM(2021) 70 final.
(12) L’Union a adopté la composante Govsatcom du règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 afin de garantir aux utilisateurs de Govsatcom la disponibilité sur le long terme de services de télécommunications par satellite fiables, sécurisés et présentant un bon rapport coût-efficacité. Le règlement (UE) 2021/696 prévoit que les capacités actuelles seront utilisées au cours de la première phase de la composante Govsatcom, jusqu’en 2025 environ. Dans ce contexte, la Commission doit acquérir des capacités Govsatcom auprès des États membres ayant des systèmes nationaux et des capacités spatiales, ainsi qu’auprès de fournisseurs commerciaux de capacités ou de services de télécommunications par satellite, en tenant compte des intérêts essentiels de la sécurité de l’Union.
(13) En fait, les télécommunications gouvernementales par satellite sont un atout stratégique — intimement lié à la sécurité nationale — utilisé par la plupart des États membres. Les utilisateurs publics ont tendance à privilégier soit des solutions publiques (parmi les propriétaires de télécommunications gouvernementales par satellite figurent l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie et le Luxembourg), soit des solutions publiques-privées (comme SATCOMBw en Allemagne ou GovSat au Luxembourg), ou à recourir à des prestataires privés homologués. Les télécommunications gouvernementales par satellite sont considérées, depuis 2013 (conclusions du Conseil européen, 19 et 20 décembre 2013), comme un domaine prometteur susceptible de contribuer sensiblement à la construction d’une Union européenne forte, sûre et résiliente. Elles font désormais partie intégrante de la stratégie spatiale pour l’Europe [COM(2016) 705 final], du plan d’action européen de la défense [COM(2016) 950 final] et de la stratégie globale de l’Union européenne.
(14) Par “faible latence”, on entend un délai minimal dans le traitement des données informatiques par une connexion de réseau. Plus la latence de traitement est faible, plus elle se rapproche de l’accès en temps réel. Une connexion de réseau à latence plus faible se caractérise par des délais très courts.
(15) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil. Résultats de l’évaluation intermédiaire du programme ISA (solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes), 23 septembre 2019, COM(2019) 615 final.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/185 |
Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Plan REPowerEU»
[COM(2022) 230 final]
et sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/241 en ce qui concerne les chapitres REPowerEU des plans pour la reprise et la résilience et modifiant le règlement (UE) 2021/1060, le règlement (UE) 2021/2115, la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814
[COM(2022) 231 final — 2022/0164 (COD)]
(2022/C 486/25)
|
Rapporteurs: |
Stefan BACK Thomas KATTNIG Lutz RIBBE |
|
Consultation |
Parlement européen, 6.6.2022 Conseil européen, 3.6.2022 Commission européenne, 28.6.2022 |
|
Bases juridiques |
Articles 304 et 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Décision de l’assemblée plénière |
21.9.2022 |
|
Compétence |
Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
|
Adoption en section |
7.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
220/01/07 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Avant d’aborder le contenu du plan REPowerEU, le CESE, en tant que représentant de la société civile, qui est indûment touchée par les fortes hausses de prix actuelles, souligne que bon nombre des problèmes qui doivent être résolus aujourd’hui auraient pu être évités, ou du moins atténués, si la dépendance à l’égard des importations d’énergie avait été réduite — comme l’avait proposé la Commission ces dernières années. Le CESE rappelle les déclarations figurant dans la stratégie de l’Union pour la sécurité énergétique de 2014 et dans la stratégie pour l’union de l’énergie de 2015, selon lesquelles l’UE reste vulnérable aux chocs énergétiques extérieurs, et qui appellent les décideurs politiques aux niveaux national et européen à indiquer clairement aux citoyens les choix qui s’imposent pour réduire notre dépendance vis-à-vis de certains combustibles, fournisseurs et voies d’acheminement. Toutefois, la plupart des responsables politiques et une grande partie de notre société ont été aveuglés par les ressources fossiles bon marché et n’ont pas mené de politiques de précaution. La situation actuelle est le retour de bâton de cette négligence. Le CESE regrette qu’il ait fallu connaître la guerre en Ukraine et les distorsions qui en découlent dans la fourniture d’énergie russe pour attirer l’attention sur cette question fondamentale de sécurité énergétique et déclencher les mesures proposées dans le plan REPowerEU pour garantir l’indépendance par rapport aux importations de produits énergétiques russes. |
|
1.2. |
Le CESE se félicite de l’objectif du plan REPowerEU visant à rendre l’UE indépendante de l’approvisionnement en gaz et en pétrole russes et approuve l’approche fondée sur quatre piliers, à savoir les économies d’énergie, la diversification des importations de gaz, le remplacement des combustibles fossiles par l’introduction plus rapide des énergies renouvelables et une bonne articulation des solutions de financement. Le CESE prend note de la distinction établie entre les mesures à court et à moyen termes. |
|
1.3. |
Le CESE souligne la nécessité de garantir la sécurité de l’approvisionnement à un coût aussi abordable que possible tant pour les consommateurs que pour l’industrie, et fait valoir qu’un approvisionnement énergétique reposant essentiellement sur les énergies renouvelables européennes et les sources d’énergie à faibles émissions de carbone contribuerait de manière significative à une meilleure sécurité énergétique. |
|
1.4. |
Dans ce contexte, le CESE attire l’attention sur les possibilités de soutien offertes par le Fonds social pour le climat envisagé aujourd’hui et, en ce qui concerne les entreprises, par les lignes directrices temporaires sur les aides d’État liées à la crise. L’objectif doit être de faciliter la transition. |
|
1.5. |
Le CESE estime que le niveau d’effort prévu dans le plan doit être considéré comme adéquat, compte tenu de l’urgence induite par la situation de l’approvisionnement, et convient dès lors de la nécessité de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne l’utilisation transitoire des combustibles fossiles et à faibles émissions de carbone, du charbon et de l’énergie nucléaire. Cette période doit être la plus courte possible, ne doit pas conduire à de nouvelles dépendances et ne doit pas nuire aux efforts visant à parvenir à la neutralité climatique dès que possible, d’ici à 2050 au plus tard. Il convient en outre de garder à l’esprit que la question du statut de l’énergie nucléaire reste ouverte et appartient actuellement à chaque État membre. |
|
1.6. |
Compte tenu de l’urgence de la situation et du risque de perturbations imprévues dans la fourniture d’énergie russe, le CESE attache de l’importance aux mesures qui peuvent être mises en œuvre immédiatement, en particulier des économies substantielles d’énergie, étayées par des accords de partenariat et la mise en œuvre rapide de nouvelles initiatives. Le CESE attire l’attention sur le risque de voir les effets économiques et sociaux combinés de la crise actuelle mettre le système démocratique sous pression, à moins que des solutions adéquates ne soient trouvées. |
|
1.7. |
Le CESE soutient la proposition de porter, d’ici à 2030, l’objectif d’efficacité énergétique de 9 % à 14 % laquelle figure dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55», de même qu’il est favorable aux efforts généraux d’économie de gaz qui devraient atteindre, selon les estimations, 30 % d’ici à 2030. Le CESE se félicite également de l’adoption récente du règlement du Conseil relatif à une réduction coordonnée de 15 % de la consommation de gaz au cours de l’hiver 2022-2023, et souligne que la capacité à réaliser des économies varie d’un État membre à l’autre. Ces nouvelles propositions plus strictes montrent qu’il a fallu connaître l’urgence découlant de la guerre en Ukraine pour revoir les ambitions à la hausse. Le CESE soutient tout particulièrement les mesures précoces d’économies d’énergie, telles que celles qui sont réalisées par l’intermédiaire des consommateurs individuels, lancées par la Commission en partenariat avec l’AIE, les mesures axées sur le marché telles que les enchères inversées et les mesures de participation active de la demande. |
|
1.8. |
Le CESE invite également les colégislateurs à donner suite à la demande de la Commission d’inclure dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» l’objectif accru d’économies d’énergie qu’elle propose dans le plan à l’examen, ce qui est essentiel dans la situation actuelle. |
|
1.9. |
En ce qui concerne la diversification des importations, le CESE attire l’attention sur les perspectives offertes par l’achat commun volontaire par le truchement de la plateforme de l’UE pour l’énergie et de nouveaux partenariats dans le domaine de l’énergie, qui constituent des options pouvant être mises en œuvre dès aujourd’hui. Cependant, le CESE invite la Commission à élaborer une stratégie géopolitique d’importation d’énergie qui tienne compte des urgences énergétiques et climatiques avant de proposer des partenariats énergétiques avec des pays non démocratiques ou politiquement instables. |
|
1.10. |
Le CESE est favorable à une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE et soutient fermement la demande de la Commission d’inclure dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» la part de 45 % proposée dans le plan. |
|
1.11. |
Pour atteindre ces objectifs plus ambitieux, certains équipements techniques doivent être importés, étant donné que l’UE ne dispose plus de capacités de production. Par exemple, les panneaux solaires sont principalement importés de Chine. Ainsi, les énergies fossiles dépendent non seulement des importations, mais aussi des équipements qui s’avèrent nécessaires. Le CESE invite tous les décideurs politiques à promouvoir massivement l’expansion, en Europe, des sites de production des équipements liés aux énergies renouvelables, y compris le stockage des batteries. L’alliance européenne de l’industrie solaire pourrait être considérée comme une première étape. |
|
1.12. |
Toutefois, des investissements considérables sont nécessaires pour accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE. Cela étant, la part des investissements publics dans la recherche et le développement de technologies de décarbonation est plus faible au sein de l’UE que dans d’autres grandes économies, ce qui compromet la compétitivité de l’Union dans les technologies clés de l’avenir. Le CESE note que pour mener la transition écologique à bien et garantir la sécurité de l’approvisionnement, il est nécessaire de disposer en quantités suffisantes d’un mélange adéquat de sources d’énergie renouvelables pour l’électrification, de parvenir à produire de l’hydrogène vert, de développer des technologies de stockage et d’exploiter pleinement les possibilités offertes par la numérisation. Des investissements considérables dans la recherche et le développement restent donc indispensables. |
|
1.13. |
Le CESE insiste sur la valeur ajoutée des propositions concernant les procédures rapides d’autorisation pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et la définition des zones dites propices à leur déploiement. Là encore, le CESE fait valoir qu’il est judicieux de suivre les recommandations visant à appliquer ces principes à un stade précoce. |
|
1.14. |
Dans ce contexte, le CESE attire l’attention sur l’importance de la production nationale d’énergies renouvelables, y compris l’hydrogène, mais relève également que certaines des énergies renouvelables prioritaires, telles que l’hydrogène, peuvent ne pas être immédiatement disponibles en quantité suffisante et/ou à des prix abordables. Afin de pouvoir se passer des solutions de transition exposées au paragraphe 1.3 à moyen terme, il importe de concevoir une politique européenne de décarbonation mettant particulièrement l’accent sur les secteurs où cette réduction est plus difficile à réaliser, comme les industries dépendantes de hautes capacités thermiques ou encore les locataires d’immeubles à appartements et le secteur des transports). Des instruments pratiques sont déjà disponibles, par exemple les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et l’autoconsommation collective. Ceux-ci doivent être déployés le plus rapidement possible en tenant compte des effets sociaux et de la nécessité de garantir la compétitivité des entreprises à l’échelle internationale. |
|
1.15. |
En ce qui concerne les possibilités de développement des énergies renouvelables, le CESE attire l’attention sur le potentiel de l’autoconsommation, des communautés d’énergie renouvelable et du partage de l’énergie, dont il est question dans le plan sans qu’il soit malheureusement expliqué comment supprimer les obstacles auxquels les entreprises actives dans ces secteurs sont confrontées. |
|
1.16. |
Le CESE souligne également qu’à l’échelle nationale, les modèles de comportement et les traditions influencent grandement les choix en matière de bouquets énergétiques durables. Le CESE est favorable à une utilisation accrue des ressources disponibles pour développer les énergies renouvelables. Compte tenu des choix nationaux divergents, il convient d’encourager la polyvalence et donc d’avoir recours à une grande variété de sources d’énergie renouvelables et à faibles émissions de carbone qui s’intègrent économiquement et écologiquement dans un nouveau système énergétique reposant principalement sur des sources d’énergie européennes. Le CESE prend note du fait que le statut de l’énergie nucléaire reste ouvert jusqu’à présent et est actuellement laissé à l’appréciation de chaque État membre. |
|
1.17. |
Le CESE convient que les énergies renouvelables et les réseaux de stockage et de distribution devraient être considérés comme relevant de l’intérêt public supérieur, mais aurait souhaité que les implications concrètes de cette démarche soient mieux expliquées. Dans de précédents avis, le CESE a déjà mis en évidence le fort potentiel que présentent les voitures électriques sous l’angle du «stockage stratégique de l’électricité». Force est de regretter que le plan n’aborde pas non plus ce point. |
|
1.18. |
En ce qui concerne les investissements, le CESE souligne la nécessité de mettre davantage en avant les effets positifs potentiels sur l’emploi et les économies régionales, et insiste également sur l’importance d’associer les aspects liés à l’énergie et au climat à la cohésion sociale et régionale. |
|
1.19. |
Le CESE déplore que le plan ne s’attaque pas de manière adéquate au refinancement des fonds publics qui pourraient servir de capital d’amorçage pour attirer les investissements privés vers l’indépendance énergétique. Il pourrait notamment être envisagé d’affecter à cette fin les recettes d’une taxe spécifique sur les «bénéfices exceptionnels» résultant des prix élevés du pétrole et du gaz. Le CESE est conscient du caractère sensible d’une telle mesure, compte tenu de la nécessité d’éviter de décourager les investissements dans les sources d’énergie renouvelables et à faibles émissions de carbone. |
|
1.20. |
Si le récent règlement du Conseil concernant des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz et la communication connexe intitulée «Des économies de gaz pour un hiver sûr» constituent un pas dans la bonne direction pour améliorer la préparation aux crises, le CESE souhaiterait que soit élaboré un cadre de crise plus général qui permettrait de faire face à une crise de l’ampleur de celle que l’UE connaît aujourd’hui en raison de la guerre en Ukraine. |
|
1.21. |
Le CESE prend note des récentes observations de la présidente de la Commission sur l’inadéquation de la structure actuelle du marché de l’énergie de l’Union et sur la nécessité de réformer le marché de l’électricité. Le CESE se félicite de l’intention d’explorer les possibilités d’optimiser le marché de l’électricité, mais fait observer que toute proposition doit être précédée d’une analyse d’impact exhaustive. |
|
1.22. |
Le plan, qui, en tout état de cause, nécessitera des crédits conséquents, sera très difficile à financer dans le cadre financier actuel. À cet égard, le CESE insiste sur l’importance d’introduire une règle d’or pour les investissements dans le comportement socio-écologique de notre société (1). |
2. Informations contextuelles
|
2.1. |
Dans son plan REPowerEU (2), la Commission propose un ensemble complet de mesures visant à réduire la dépendance de l’UE à l’égard des combustibles fossiles russes en accélérant la transition propre et en déployant un effort conjoint pour parvenir à un système énergétique plus résilient et à une véritable union de l’énergie. Le plan s’articule autour de quatre piliers. |
|
2.2. |
Le premier pilier concerne les économies d’énergie: une réduction de 5 % supplémentaires de la consommation d’énergie d’ici à 2030 en plus des 9 % proposés dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» grâce à une meilleure efficacité énergétique (3). Pour la consommation de gaz, le paquet «Ajustement à l’objectif 55» permettra une réduction globale de 30 % d’ici à 2030. La Commission a demandé aux colégislateurs d’inclure cette proposition dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55» avant son adoption. La Commission lancera une mesure immédiate à court terme sous la forme d’une campagne d’économies d’énergie avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Cette campagne ciblera les choix individuels des particuliers et des entreprises et invitera les États membres à utiliser pleinement les outils disponibles, y compris une mise en œuvre et une mise à jour plus efficaces des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (PNEC) (4). Le CESE note que le règlement récemment adopté par le Conseil prescrit une réduction collective de 15 % de la consommation de gaz au cours de l’hiver 2022-2023 par rapport à la moyenne des cinq années précédentes (5). Le règlement est accompagné d’une communication contenant des suggestions de mise en œuvre (6). |
|
2.3. |
Le deuxième pilier vise une réduction de 2/3 de la dépendance à l’égard du gaz russe d’ici la fin de l’année et la fin de cette dépendance d’ici à 2027, grâce à la diversification des importations de gaz, à l’augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis, d’Égypte, d’Israël et des pays d’Afrique subsaharienne (+ 50 milliards de m3), ainsi qu’aux importations par gazoduc en provenance de fournisseurs non russes (+ 10 milliards de m3). En outre, la plateforme énergétique de l’UE, créée en avril, permettra de mettre en commun la demande, de faciliter l’achat commun volontaire, d’optimiser l’utilisation des infrastructures et d’établir des partenariats internationaux à long terme. Par ailleurs, la production de gaz naturel au sein de l’UE sera accrue et, à moyen terme, des solutions de substitution telles que le biométhane et l’hydrogène renouvelable seront déployées. La diversification inclut également le combustible nucléaire, pour lequel certains États membres dépendent actuellement de sources russes. |
|
2.4. |
Le troisième pilier propose de procéder à la substitution des combustibles fossiles et d’accélérer la transition vers une énergie propre en Europe: en premier lieu, l’objectif de la directive sur les énergies renouvelables est porté de 40 % à 45 % d’ici à 2030. Des technologies clés sont ciblées, telles que l’énergie solaire (avec un objectif visant plus de 320 GW d’énergie solaire photovoltaïque installée d’ici à 2025, soit le double de la capacité installée en 2022, et 600 GW d’ici à 2030; ainsi que la stratégie solaire de l’UE et la nouvelle initiative européenne sur l’installation de panneaux solaires), l’énergie éolienne (accélération de l’octroi de permis, par exemple par la désignation de zones propices au déploiement des énergies renouvelables), les pompes à chaleur (doublement du taux de déploiement pour atteindre les 10 millions d’unités au cours des 5 prochaines années) et les électrolyseurs. Les colégislateurs sont invités à adapter les sous-objectifs pour les combustibles renouvelables d’origine non biologique au titre de la directive sur les énergies renouvelables (75 % pour l’industrie, 5 % pour les transports), à accélérer l’adoption de l’hydrogène en doublant le nombre de vallées de l’hydrogène, et à achever l’évaluation des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) relatifs à l’hydrogène d’ici l’été afin de mettre en place les infrastructures nécessaires pour la production, l’importation et le transport de 20 millions de tonnes d’hydrogène d’ici à 2030 (7). De nouveaux partenariats pour l’hydrogène seront établis avec la région méditerranéenne et l’Ukraine. La production de biométhane sera portée à 35 milliards de m3 d’ici à 2030. La conversion des installations de biogaz existantes nécessitera des investissements de 37 milliards d’EUR sur la période concernée. Pour stimuler l’électrification et le déploiement de l’hydrogène dans l’industrie, la Commission mettra en place des contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone et des volets spécifiquement consacrés au plan REPowerEU dans le cadre du Fonds pour l’innovation, de même qu’elle établira une alliance européenne de l’industrie solaire. L’accent est également placé sur la biomasse et les résidus agricoles et forestiers. La Commission demande aux colégislateurs d’adopter rapidement les propositions en cours sur les carburants alternatifs et d’autres dossiers liés aux transports qui soutiennent la mobilité verte. Une initiative sur l’écologisation du transport de marchandises est prévue en 2023. La Commission souligne la nécessité d’accélérer les procédures d’octroi de permis également en appliquant promptement les propositions en cours. |
|
2.5. |
Le dernier pilier porte sur les investissements intelligents: quelque 210 milliards d’EUR supplémentaires sont nécessaires d’ici à 2027 et s’ajoutent aux besoins liés au paquet «Ajustement à l’objectif 55». Le financement du GNL et du gaz de gazoducs provenant d’autres fournisseurs nécessite 10 milliards d’EUR d’ici à 2030. En outre, il faudra investir 29 milliards d’EUR dans le réseau électrique dans le même délai. Pour contribuer au financement de ces investissements, la Commission se concentre sur les plans pour la reprise et la résilience, la mise aux enchères des certificats du système d’échange de quotas d’émission, les fonds provenant de la politique de cohésion, la politique agricole commune, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme InvestEU, le Fonds pour l’innovation et des mesures fiscales. |
|
2.6. |
La Commission a présenté un règlement modifiant le règlement (UE) 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que la décision (UE) 2015/1814, la directive 2003/87/CE et le règlement (UE) 2021/1060 afin de permettre l’utilisation de la facilité pour contribuer aux objectifs du plan REPowerEU. |
|
2.7. |
D’une manière générale, il peut s’avérer nécessaire de continuer à utiliser du pétrole, d’autres combustibles fossiles et du charbon pendant une période de transition. L’énergie nucléaire a également un rôle à jouer. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Avant d’aborder le contenu du plan REPowerEU, le CESE, en tant que représentant de la société civile, qui est indûment touchée par les fortes hausses de prix actuelles, souligne que bon nombre des problèmes qui doivent être résolus aujourd’hui auraient pu être évités, ou du moins atténués, si la dépendance à l’égard des importations d’énergie avait été réduite — comme l’avait proposé la Commission ces dernières années. Le CESE rappelle les déclarations figurant dans la stratégie de l’Union pour la sécurité énergétique de 2014 et dans la stratégie pour l’union de l’énergie de 2015, selon lesquelles l’UE reste vulnérable aux chocs énergétiques extérieurs, et qui appellent les décideurs politiques aux niveaux national et européen à indiquer clairement aux citoyens les choix qui s’imposent pour réduire notre dépendance vis-à-vis de certains combustibles, fournisseurs et voies d’acheminement. Toutefois, la plupart des responsables politiques et une grande partie de notre société ont été aveuglés par les ressources fossiles bon marché et n’ont pas mené de politiques de précaution. La situation actuelle est le retour de bâton de cette négligence. Le CESE regrette qu’il ait fallu connaître la guerre en Ukraine et les distorsions qui en découlent dans la fourniture d’énergie russe pour attirer l’attention sur cette question fondamentale de sécurité énergétique et déclencher les mesures proposées dans le plan REPowerEU pour garantir l’indépendance par rapport aux importations de produits énergétiques russes. |
|
3.2. |
Les atrocités commises par la Russie à l’encontre du peuple ukrainien ont notamment engendré des sanctions relatives aux importations de pétrole et de gaz russes et une baisse des exportations russes d’énergie vers certains États membres de l’UE. Il est donc nécessaire de réduire rapidement les importations d’énergie en provenance de Russie. Le CESE soutient pleinement toutes les initiatives qui poursuivent cet objectif. Il s’agit de supprimer progressivement toutes les importations d’énergie en provenance de Russie dès que possible, idéalement dans les trois prochaines années. |
|
3.3. |
Par conséquent, le CESE soutient pleinement le principe du plan REPowerEU. Ce plan établit l’objectif qui convient — mettre fin dès que possible à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations d’énergie russe — et englobe un ensemble approprié d’actions à court et à moyen termes visant à soutenir cet objectif. |
|
3.4. |
La situation est absolument dramatique, surtout d’un point de vue international. Tant qu’elle importe du gaz et du pétrole en provenance de Russie, l’Europe contribue à la guerre d’agression de Poutine. L’UE a besoin de gaz russe pour que son industrie continue de fonctionner et que ses citoyens puissent se chauffer, ce qui affaiblit sa position diplomatique. Dans la mesure où la Russie peut utiliser les quantités qu’elle fournit à l’Europe pour manipuler les prix de gros du gaz, l’industrie et les citoyens européens subissent des prix élevés et des répercussions économiques sérieuses sont à craindre si l’approvisionnement en gaz russe devait être totalement coupé. La situation actuelle a des effets néfastes à la fois sur les prix et sur la sécurité de l’approvisionnement, et les entreprises comme les consommateurs sont ainsi pris en otages. En effet, certaines entreprises ont déjà été contraintes de limiter ou d’interrompre leur production en raison des prix élevés de l’énergie, ce qui a un effet négatif sur l’emploi. Dans le même temps, les ménages rencontrent souvent des difficultés pour payer leurs factures d’énergie. Cette situation contrastée met également à rude épreuve le système démocratique de l’UE et doit être résolue dès que possible. |
|
3.5. |
Il faut se demander si le plan REPowerEU est suffisamment ambitieux. L’effort doit être considéré comme adéquat, étant donné que le principal objectif est d’éliminer progressivement la dépendance à l’égard des importations de gaz et de pétrole russes et de parvenir à l’indépendance énergétique de l’UE à l’égard de la Russie, essentiellement en augmentant la part des énergies renouvelables, en améliorant l’efficacité énergétique et en recourant à des importations de substitution ainsi que, si nécessaire, à l’énergie fossile, à l’énergie à faible intensité de carbone et au charbon comme solutions transitoires pendant une très courte période. Une question doit toutefois être posée: l’Union européenne et, en particulier, ses États membres mettent-ils tout en œuvre pour stopper dès que possible l’approvisionnement en gaz russe? Du point de vue du plan REPowerEU uniquement, et compte tenu de ce que nous savons jusqu’à présent des résultats du processus législatif concernant le paquet «Ajustement à l’objectif 55», la réponse est discutable. |
|
3.6. |
Seules deux options totalement convaincantes apporteront une contribution immédiate au remplacement à long terme du gaz naturel et seront parfaitement conformes aux objectifs stratégiques du paquet «Ajustement à l’objectif 55»: le déploiement massif des énergies renouvelables et une réduction drastique de la demande. |
|
3.7. |
En raison du coût et du temps nécessaires pour mettre au point les principales solutions à moyen et à long termes, le CESE souligne l’importance des mesures qui peuvent être prises immédiatement, telles que les choix des particuliers et des entreprises, les achats communs volontaires par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour l’énergie, la création de nouveaux partenariats énergétiques avec des soutiens fiables, le stockage du gaz, la mise en œuvre des recommandations prônant une application précoce des procédures d’autorisation rapides, l’établissement de zones propices au déploiement des énergies renouvelables et l’augmentation de la production de biométhanol. Afin de gagner du temps, les colégislateurs pourraient répondre immédiatement à la demande de la Commission d’inclure, dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55», les objectifs énoncés dans des propositions distinctes et visant à porter les niveaux d’énergies renouvelables de 40 à 45 %, à accroître encore l’efficacité énergétique de 5 % et à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. Les colégislateurs pourraient également donner suite à la demande d’adopter rapidement les propositions pertinentes. |
|
3.8. |
Le CESE se félicite en outre du récent règlement du Conseil sur la réduction coordonnée de la consommation de gaz au cours de l’hiver 2022-2023. |
|
3.9. |
Compte tenu de l’extrême urgence de la situation, le CESE souscrit aussi à la manière dont le plan REPowerEU tient compte de la nécessité éventuelle de recourir aux combustibles fossiles et à faibles émissions de carbone et au charbon pendant une période de transition, qui doit être la plus courte possible afin d’éviter l’épuisement de ces sources. Le CESE note également avec satisfaction que, jusqu’à présent, la question de l’énergie nucléaire est laissée à l’appréciation de chaque État membre. |
|
3.10. |
Le CESE se félicite de la décision de créer un Fonds social pour le climat afin d’atténuer les incidences économiques et sociales négatives et de fournir un financement aux États membres pour soutenir les mesures qu’ils mettent en place en vue de lutter contre les conséquences sociales sur les ménages, les microentreprises et les usagers des transports financièrement vulnérables. Dans le même temps, le CESE souligne que l’enveloppe financière proposée pour le Fonds social pour le climat ne sera pas suffisante pour faire face de manière responsable aux effets socio-économiques de la réalisation des objectifs en matière de climat et de mobilité. Un budget élevé en proportion s’impose dès lors. Le CESE fait également remarquer que les États membres n’ont pas tous la même capacité à attirer et à gérer des fonds privés. |
|
3.11. |
Les États membres devraient aussi soutenir les citoyens et, en particulier, les ménages financièrement faibles, tant à court terme, pendant les deux prochains hivers, qu’à long terme. |
|
3.12. |
En ce qui concerne les économies d’énergie, la Commission vise une réduction immédiate de 5 % de la consommation de gaz (environ 13 milliards de m3) et de pétrole (environ 16 mégatonnes équivalent pétrole). Cet objectif est loin d’être ambitieux et ne correspond pas à l’ampleur de la crise déclenchée par la guerre contre l’Ukraine. Néanmoins, la réalité politique est telle que le Conseil «Énergie» du 27 juin 2022 a accepté le taux de réduction de 9 % proposé par la Commission en 2021, sans prêter attention aux suggestions du plan REPowerEU visant à inclure la proposition dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55». |
|
3.13. |
En Allemagne, la consommation de gaz a été réduite de près de 15 % déjà entre les mois de janvier et mai 2022 (8), même si, selon des études de marché, les consommateurs résidentiels pourraient encore économiser davantage. Ce constat montre clairement que la situation et la volonté ou la capacité d’agir peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre. Il est possible que des mesures susceptibles de tenir compte de ce fait aient les meilleures chances de réussir, comme le montre le règlement du Conseil concernant des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz, adopté le 26 juillet 2022, qui prend également en considération les besoins de l’industrie. |
|
3.14. |
Les campagnes dans le domaine de l’énergie ne devraient pas se contenter d’appeler à réaliser des économies d’énergie, mais devraient comprendre des mesures ayant une incidence directe, comme les enchères inversées, qui consistent à ce qu’une autorité centrale — l’autorité de régulation ou le gestionnaire du réseau — organise un appel d’offres à l’intention des consommateurs industriels, qui peuvent alors soumettre leur offre de réduction volontaire de gaz en fonction de leurs coûts spécifiques. Ces mesures pourraient contribuer à atteindre les niveaux nécessaires de stocks de gaz et augmenteraient la probabilité que, dans un scénario sans approvisionnement en gaz russe, l’Union européenne passe l’hiver sans subir trop de dommages sociaux et économiques. Le CESE attire l’attention sur le potentiel de la participation active de la demande en tant que moyen de réduire la demande. |
|
3.15. |
En ce qui concerne les énergies renouvelables, l’objectif général fixé par la Commission d’atteindre un taux accru de 45 % d’énergies renouvelables, au lieu des 40 % proposés en 2021, semble ne pas avoir été entendu jusqu’à présent, du moins par le Conseil «Énergie» du 27 juin 2022, malgré la demande de la Commission de l’inclure dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55». Le CESE regrette que cette demande soit restée sans suite, étant donné que cela retarde les effets de l’évolution souhaitée. Néanmoins, le CESE se félicite de la proposition distincte, présentée en mai 2022, visant à accélérer les procédures d’autorisation pour les projets dans le domaine des énergies renouvelables et à établir des zones propices à de tels projets afin de supprimer un obstacle majeur au déploiement rapide des énergies renouvelables, en particulier les projets mis sur pied dans le domaine des ’énergies solaire et éolienne. Par conséquent, le CESE accueille favorablement, en tant que telle, la recommandation formulée dans la communication REPowerEU visant à la mise en œuvre immédiate des procédures d’autorisation rapides et des zones propices au déploiement des énergies renouvelables, dans l’attente de l’acceptation de la proposition de la Commission. |
|
3.16. |
Pour atteindre ces objectifs plus ambitieux, certains équipements technologiques doivent être importés, étant donné que l’UE ne dispose plus de capacités de production. Les panneaux solaires, par exemple, sont principalement importés de Chine. Ainsi, les énergies fossiles dépendent non seulement des importations, mais aussi des équipements qui s’avèrent nécessaires. Le CESE invite tous les décideurs politiques à promouvoir massivement en Europe l’expansion des sites de production des équipements liés aux énergies renouvelables. L’alliance européenne de l’industrie solaire pourrait être considérée comme une première étape. |
|
3.17. |
Toutefois, des investissements considérables sont nécessaires pour accroître la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de l’UE. Cela étant, la part des investissements publics dans la recherche et le développement de technologies de décarbonation est plus faible au sein de l’UE que dans d’autres grandes économies, ce qui compromet la compétitivité de l’Union dans les technologies clés de l’avenir. Le CESE note que pour mener la transition écologique à bien et garantir la sécurité de l’approvisionnement, il est nécessaire de disposer en quantités suffisantes d’un mélange adéquat de sources d’énergie renouvelables pour l’électrification, de parvenir à produire de l’hydrogène vert, de développer des technologies de stockage et d’exploiter pleinement les possibilités offertes par la numérisation, afin de concrétiser des concepts tels que les centrales électriques virtuelles. Des investissements considérables dans la recherche et le développement restent donc indispensables. |
|
3.18. |
Des concepts tels que l’autoconsommation, les communautés d’énergie renouvelable et le partage d’énergie renouvelable, qui étaient largement reconnus dans le paquet «énergie propre» et qui ont toujours été soutenus par le CESE, sont très importants pour accroître le déploiement des sources d’énergie renouvelables. Les besoins d’investissements sont énormes. Les citoyens sont disposés à investir dans l’autoconsommation ou la consommation communautaire s’ils comprennent que cela leur est également bénéfique. Il convient de les encourager plutôt que de les dissuader. Cependant, dans de nombreux États membres, les citoyens se sentent encore découragés. La stratégie solaire de l’UE qui est connexe au plan REPowerEU reconnaît cet état de fait, mais elle reproduit à cet égard la directive sur les énergies renouvelables II sans préciser comment contraindre les États membres à enfin supprimer les obstacles concernés. |
|
3.19. |
Il est logique de considérer les énergies renouvelables et les moyens de stockage comme relevant de l’intérêt public supérieur, mais l’effet direct de cette qualification reste flou. Le réseau de distribution reliant les installations respectives au consommateur doit également être reconnu comme relevant de l’intérêt public supérieur. |
|
3.20. |
Même avec des améliorations considérables en ce qui concerne la réduction de la demande d’énergie (voir paragraphes 3.7 à 3.9) et l’augmentation des énergies renouvelables (voir paragraphes 3.10 à 3.12), il est évident que l’UE ne sera pas en mesure d’atteindre une autonomie énergétique, que ce soit à court ou à moyen terme. L’autosuffisance semble possible à long terme, mais est-elle souhaitable? La question reste ouverte. La mauvaise expérience vécue avec la dépendance à l’égard de la Russie impose l’adoption d’une approche bien réfléchie pour déterminer quels pays ou régions pourraient être nos partenaires à l’avenir. Si l’urgence exige des décisions rapides en ce qui concerne les importations de GNL et d’hydrogène (vert), il convient d’éviter de prendre des décisions contraignantes à long terme sans effectuer d’analyse de risques complète. Le CESE invite la Commission à élaborer une stratégie géopolitique d’importation d’énergie avant de proposer des partenariats énergétiques avec des pays non démocratiques ou politiquement instables, en tenant compte de l’atténuation du changement climatique et des urgences énergétiques. |
|
3.21. |
Le GNL semble être une solution pour de nombreux États membres, mais son empreinte carbone en fait une technologie passerelle à utiliser le moins longtemps possible. Dans les 20 prochaines années, toutes les infrastructures GNL nouvellement construites devront être enlevées ou capables de transporter et de distribuer de l’hydrogène vert. Ce point doit constituer un principe fondamental pour toutes les décisions d’investissement à prendre dans les prochains mois. La maturité de l’hydrogène («H2 readiness») est souvent utilisée comme critère de classification, mais en réalité, sa signification n’est pas du tout claire. Comme elle a défini l’hydrogène vert dans l’acte délégué correspondant, la Commission doit définir la maturité de l’hydrogène afin de combiner la sécurité des investissements avec une orientation claire sur les objectifs climatiques. La taxinomie devrait être modifiée en conséquence. |
|
3.22. |
Cette situation montre l’importance de tenir compte des modèles de comportement et des approches propres à chaque État lors de l’examen des bouquets énergétiques durables. Le CESE note que la Commission mentionne brièvement le rôle de l’énergie nucléaire dans son plan REPowerEU, sachant que cette option relève de la seule responsabilité des États membres. Le CESE est favorable à une utilisation accrue des ressources disponibles dans l’UE, notamment et prioritairement à une expansion rapide et massive des énergies renouvelables, comme le propose la Commission. Les options de production d’énergie polyvalentes contribuent à la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Outre l’énergie éolienne et solaire, il convient donc d’utiliser la variété de sources d’énergie à faibles émissions de carbone qui s’intègrent dans un nouveau système énergétique reposant principalement sur des sources d’énergie européennes fluctuantes. |
|
3.23. |
Le pilier sur les investissements intelligents établit les bonnes priorités. Le CESE rappelle toutefois qu’avec la bonne approche, une structure d’approvisionnement en énergie sans carbone, décentralisée et numérisée peut avoir des effets positifs considérables sur l’emploi et les économies régionales (voir TEN/660). Dans la crise actuelle, l’Union européenne a besoin d’une approche générale de l’énergie qui combine les questions spécifiques liées à l’énergie et au climat avec les objectifs de la politique de cohésion sociale et régionale. Cet aspect est largement ignoré dans la stratégie solaire que la Commission a présentée en même temps que le plan REPowerEU. |
|
3.24. |
La Commission souligne à juste titre que les investissements publics peuvent et doivent mobiliser des fonds privés. Le plan REPowerEU n’évoque cependant pas le refinancement des fonds publics concernés. La suppression des subventions en faveur des ressources fossiles serait un moyen d’y procéder; la taxation des bénéfices exceptionnels, qui proviennent de la crise majeure du pétrole et du gaz et qui trouvent leur expression dans d’énormes bénéfices supplémentaires, en particulier pour les grandes compagnies pétrolières, en serait un autre. Le CESE propose que ces bénéfices soient retirés au moyen de taxes et transmis en tant que compensation financière aux consommateurs d’énergie, par exemple les ménages financièrement plus faibles ou les entreprises à forte intensité énergétique, et qu’ils soient utilisés pour développer la production d’énergie renouvelable et les infrastructures de réseau nécessaires, d’autant plus que cette mesure est déjà en cours de discussion ou de mise en œuvre dans certains États membres. Le CESE est d’avis que, pour ne pas dissuader les entreprises du secteur de l’énergie d’investir dans des solutions à faible intensité de carbone, de telles taxes devraient être définies de manière très sensible. Le CESE invite la Commission à proposer sans plus tarder des mesures en la matière. |
|
3.25. |
Compte tenu de l’utilité probable de la promotion de solutions adaptées aux circonstances locales, le CESE approuve pleinement la proposition de la Commission de recourir aux plans pour la reprise et la résilience et à la facilité pour la reprise et la résilience pour contribuer à la mise en œuvre du plan REPowerEU. |
|
3.26. |
Le plan, qui, en tout état de cause, nécessitera des crédits conséquents, sera très difficile à financer dans le cadre financier actuel. À cet égard, le CESE souligne l’importance d’introduire une règle d’or pour les investissements dans le comportement socio-écologique de notre société (9). |
4. Observations particulières
|
4.1. |
Le biométhane peut jouer un rôle pour réduire ou mettre fin à la dépendance de l’Europe au gaz russe. Il convient toutefois, notamment dans le but d’éviter les conflits avec la protection de la biodiversité, de moderniser les installations de biogaz existantes pour sa production. À l’heure actuelle, les usines de biogaz ne sont souvent utilisées que pour produire de l’électricité en charge de base, c’est-à-dire 24 heures sur 24. La chaleur qui en résulte est rarement utilisée. Ces pratiques sont inefficaces. Soit le biogaz obtenu devrait être traité et injecté directement dans le réseau gazier, soit il devrait également être utilisé pour l’approvisionnement en chaleur sous la forme de centrales locales de production combinée de chaleur et d’électricité. De plus petites installations de stockage de gaz pourraient aider à produire de l’électricité lorsque le vent ou l’ensoleillement font défaut. Il importe également d’investir dans la reconfiguration des systèmes existants. La communication mentionne des mesures incitatives à cet égard, mais sans fournir de détails, ce à quoi il faut remédier sans délai. |
|
4.2. |
Comme indiqué au paragraphe 3.14, le GNL devra jouer un rôle à court et à moyen termes. Le plan REPowerEU promet des évaluations et une planification, des achats communs volontaires et une meilleure coordination. Entretemps, toutefois, certains États membres sont déjà actifs. La solidarité européenne est nécessaire et la Commission doit veiller à ce qu’aucun État membre ne prenne de mesure allant à l’encontre des intérêts d’un autre État membre, comme le prévoit le règlement (UE) 2017/1938 sur la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. |
|
4.3. |
Ce règlement prévoit également un mécanisme global de solidarité européenne en cas d’urgence en matière d’approvisionnement en gaz. Si le récent règlement du Conseil concernant des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz et la communication connexe intitulée «Des économies de gaz pour un hiver sûr» constituent un pas dans la bonne direction pour améliorer la préparation aux crises, le CESE souhaiterait que soit élaboré un cadre de crise plus général adapté pour faire face à une crise de l’ampleur de celle que l’UE connaît aujourd’hui en raison de la guerre en Ukraine. |
|
4.4. |
La conversion de l’électricité en chaleur et les pompes à chaleur, y compris pour le chauffage urbain, apparaissent comme l’approche la plus prometteuse pour remplacer le gaz naturel dans le secteur du chauffage. Il existe pourtant de nombreux obstacles (allant du besoin en travailleurs qualifiés aux questions sociales, en particulier dans les quartiers où la portion de locataires est élevée). La communication n’en tient pas compte. Une approche plus détaillée mais également plus critique, à laquelle la société civile serait associée, est nécessaire. |
|
4.5. |
La flambée des prix de l’énergie a mis en évidence les faiblesses du marché de l’énergie. La présidente de la Commission, Mme von der Leyen, a déclaré elle-même que le système actuel du marché de l’électricité ne fonctionne plus et doit être réformé. Il y a lieu de se poser des questions essentielles concernant notre avenir énergétique, afin d’assurer dans ce domaine un approvisionnement qui soit respectueux de l’environnement, abordable et fiable, ainsi que de garantir le droit à l’énergie. L’organisation et sa réglementation doivent être adaptées aux nouvelles réalités des énergies renouvelables dominantes, elles doivent créer les conditions nécessaires pour les différents acteurs et renforcer une protection adéquate des consommateurs. Le CESE salue l’intention de la Commission d’étudier les possibilités d’optimiser l’organisation du marché de l’électricité et soutient fermement les évaluations du marché qui analysent le comportement de tous les acteurs potentiels du marché de l’énergie et de l’organisation du marché de l’énergie. En tout état de cause, le CESE met en évidence l’importance d’une analyse d’impact exhaustive avant toute proposition. Il attire l’attention sur la nécessité urgente de lutter contre les prix élevés de l’électricité, y compris le groupement des prix de l’électricité et du gaz, qui a une incidence négative sur les économies des États membres. |
|
4.6. |
En outre, le CESE souligne qu’il est de plus en plus nécessaire de prévoir systématiquement l’augmentation de la demande en énergie par zone et par type d’énergie, en tenant compte de la transformation des types d’énergie, ainsi que de la planification conceptuelle de l’architecture du futur système énergétique, afin de veiller à ce que les investissements soient correctement placés et que la sécurité de l’approvisionnement soit garantie. La Commission devrait établir cette vue d’ensemble et la communiquer largement, car l’opinion publique manque souvent d’éléments précis quant à la mesure dans laquelle l’Europe peut s’approvisionner elle-même en énergie. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Avis du CESE, JO C 105 du 4.3.2022, p. 11.
(2) COM(2022) 230 final.
(3) COM(2022) 222 final.
(4) COM(2022) 240 final.
(5) Document 11625/22 du Conseil.
(6) COM(2022) 360 final.
(7) COM (2022) 230 final, p. 7, et SWD (2022) p. 26.
(8) Industrie spart Gas, Sparpotenzial bei Verbrauchern nicht gehoben («Des économies de gaz du côté de l’industrie, mais le potentiel d’économie ne s’améliore pas chez les consommateurs») (handelsblatt.com) [en allemand].
(9) Avis du CESE, JO C 105 du 4.3.2022, p. 11.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/194 |
Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Allègement temporaire des règles relatives aux créneaux horaires dans les aéroports en raison de la COVID-19»
[COM(2022) 334 final]
(2022/C 486/26)
|
Rapporteur général: |
Thomas KROPP |
|
Consultation |
Commission européenne, 12.7.2022 Parlement européen, 19.7.2022 Conseil, 4.8.2022 |
|
Base juridique |
Article 100, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Compétence |
Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information» |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
143/1/2 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
Le CESE note que l’aviation assure une connectivité intra-européenne et internationale, laquelle constitue une condition préalable essentielle aux échanges commerciaux et au tourisme, et donc également à la prospérité économique de l’Europe. Le secteur de l’aviation reste ébranlé par l’effet combiné de plusieurs crises mondiales, telles que la pandémie de COVID-19, la fermeture de l’espace aérien de plusieurs partenaires commerciaux de l’Europe (dont la Chine), la guerre en cours en Ukraine, la flambée de l’inflation, la probabilité croissante d’une récession mondiale et la pénurie de main-d’œuvre que connaissent plusieurs secteurs économiques, et notamment l’aviation elle-même. D’autres régions du monde suivent attentivement la manière dont l’aviation européenne fait face à ces défis. Les plateformes aéroportuaires voisines d’Istanbul, de Dubaï, de Doha et de Londres bénéficieront de la compétitivité bridée de leurs homologues européennes et des transporteurs européens appartenant à un réseau international. Le CESE a donc toujours plaidé pour que l’on veille à ce qu’aucune mesure réglementaire, effective ou potentielle, ayant une incidence sur l’aviation n’affecte la compétitivité internationale de l’Europe. Il serait néfaste pour l’environnement et pour la main-d’œuvre employée en Europe que les flux de voyageurs empruntant les liaisons internationales disponibles depuis l’Europe soient réorientés vers des plateformes extérieures à l’UE lorsqu’il s’agit de rejoindre des destinations internationales. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement sur les créneaux horaires doivent également être considérées dans ce contexte plus large. |
|
1.2. |
Le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (1) (règlement sur les créneaux horaires) fixe les procédures et les règles d’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de l’UE. Son article 10 prévoit que les transporteurs aériens sont tenus d’exploiter, au cours d’une période de planification horaire donnée, au moins 80 % des créneaux qui leur sont attribués afin de conserver leur droit à ces créneaux pour la période de planification correspondante l’année suivante. |
|
1.3. |
Compte tenu de la portée et de la durée inattendues de la pandémie, la Commission a modifié à deux reprises depuis l’apparition de celle-ci le règlement sur les créneaux horaires, afin de suspendre effectivement la disposition relative au créneau utilisé ou perdu et de s’accorder des pouvoirs délégués pour faire face à de nouvelles évolutions inattendues. Ces mesures d’allègement des règles relatives aux créneaux horaires arriveront à échéance le 29 octobre 2022, les pouvoirs délégués accordés à la Commission ayant quant à eux expiré dès le 21 février 2022. Un nouvel examen et des ajustements supplémentaires s’imposent aujourd’hui de toute urgence afin de tenir compte de la réalité du marché. |
|
1.4. |
S’appuyant sur les prévisions d’Eurocontrol, la Commission s’attend à ce que le marché de l’aviation retrouve progressivement ses niveaux d’avant la pandémie, mais cette hypothèse pourrait s’avérer par trop optimiste (2). Le CESE estime que si la proposition part de bonnes intentions, elle n’offre pas les garanties nécessaires pour éviter des revers involontaires pour la compétitivité de l’Europe. |
|
1.5. |
Le CESE se félicite que cette nouvelle proposition de la Commission vise avant tout à préserver autant que faire se peut la compétitivité sur le marché de l’aviation. Toutefois, l’analyse de marché effectuée par la Commission, ainsi que ses prévisions d’évolution du marché au cours des trois prochaines saisons, ne sont pas suffisamment solides pour expliquer, ni même justifier, le retour proposé à la règle des 80-20. Le Comité ne partage pas le raisonnement suivi par la Commission selon lequel le marché de l’aviation connaît un «retour à la normale». À la lumière des données qu’elle fournit, un seuil inférieur, par exemple de 70-30, serait plus approprié jusqu’à ce que le marché se stabilise. |
|
1.6. |
Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission d’étendre la portée de la non-utilisation justifiée des créneaux horaires, de manière à couvrir également les troubles politiques et les catastrophes naturelles lorsque ces situations entraînent des restrictions, décrites avec précision, dans le domaine de l’aviation. Il n’est toutefois pas convaincu que les modifications proposées des dispositions actuelles en matière de non-utilisation justifiée soient fondées. Les procédures envisagées par la Commission ajoutent un niveau de complexité inutile. En réalité, les écarts par rapport aux procédures actuelles ne peuvent plus être qualifiés de mesures d’urgence, ce qui crée des incertitudes juridiques à un moment où l’ensemble du secteur a cruellement besoin d’un cadre réglementaire stable. |
|
1.7. |
Le CESE soutient la proposition visant à rendre plus transparente l’attribution des créneaux horaires en conférant un rôle accru à l’Association européenne des coordonnateurs d’aéroports et en introduisant l’obligation pour les coordonnateurs de publier les destinations auxquelles s’appliquent les exceptions. |
|
1.8. |
Le CESE se félicite des mesures proposées en vue d’atténuer les effets actuels et prévisibles de l’agression militaire russe en Ukraine sur l’aviation européenne. Le postulat de la Commission selon lequel le retour à des dispositions normales pourra intervenir quatre mois après la fin des hostilités semble néanmoins excessivement optimiste. |
|
1.9. |
S’il soutient pleinement les intentions de la Commission, le CESE estime qu’en dépit des évidentes contraintes de temps, il aurait été judicieux de procéder à une analyse d’impact pour mieux cerner les conséquences des modifications qu’il est proposé d’apporter à l’actuel règlement sur les créneaux horaires. En l’absence des éléments d’information concrets qu’aurait fournis une telle analyse d’impact, la Commission s’appuie sur les prévisions d’Eurocontrol, qui ne reflètent pas nécessairement la complexité de l’évolution actuelle du marché. |
|
1.10. |
Une analyse d’impact ne servirait pas uniquement à justifier les modifications apportées à l’actuel règlement sur les créneaux horaires. Comme l’a déjà souligné le CESE (3), l’UE devrait prendre ses mesures en étroite coordination avec le Worldwide Airport Slot Board (WASB) afin d’éviter que la même question ne soit abordée de manière différente dans différentes régions du monde. |
|
1.11. |
Les crises mondiales actuelles doivent être considérées dans le contexte de leur effet cumulatif sur l’aviation internationale. Compte tenu des difficultés que l’on éprouve à juguler ces effets à l’heure actuelle, le CESE est d’avis que la Commission devrait réexaminer la proposition à l’examen dans le but de réduire au minimum les modifications apportées aux dispositions existantes de façon à ce qu’elles conservent leur caractère de «législation d’urgence». L’urgence actuelle ne s’est en aucun cas atténuée, de sorte que les dispositions d’urgence devraient être prolongées au moins pour la période envisagée par la Commission, mais il semble prématuré de prévoir des modifications telles que celles proposées par cette dernière. |
2. Observations générales
|
2.1. |
Comme la Commission l’indique dans son exposé des motifs, le défi réglementaire dans le contexte du règlement sur les créneaux horaires consiste à faire en sorte que les créneaux bénéficiant de droits acquis soient utilisés. La Commission a modifié par deux fois le règlement afin d’adapter la règle du créneau utilisé ou perdu. Elle a également reçu des pouvoirs délégués l’autorisant à modifier le seuil d’utilisation des créneaux en fonction de la baisse persistante de la demande. |
|
2.2. |
Ces mesures d’allègement des règles relatives aux créneaux horaires arriveront à échéance le 29 octobre 2022, les pouvoirs délégués accordés à la Commission ayant quant à eux expiré dès le 21 février 2022. En ce qui concerne la règle fondamentale du créneau utilisé ou perdu, la Commission propose à présent de rétablir le taux standard d’utilisation des créneaux horaires de 80 % à compter du 29 octobre 2022. Le raisonnement avancé est qu’Eurocontrol a estimé en juin 2022 qu’au cours de la saison d’hiver2022-2023, les volumes de trafic reviendraient à 90 % des niveaux de 2019. |
|
2.3. |
Le CESE n’est pas convaincu par ce raisonnement. En conséquence de l’agression militaire russe contre l’Ukraine, les vols militaires ont considérablement augmenté, au même titre que les reroutages dans les cas de survol, mais aucun de ces phénomènes n’est pertinent pour l’attribution des créneaux horaires. En outre, il y a lieu d’établir une distinction entre les mouvements de fret aérien, qui n’ont pas diminué de manière significative au cours de la période de crise, et les mouvements de passagers qui, eux, ont enregistré une baisse. Une différenciation supplémentaire doit être opérée au sein de ce marché des passagers: si, grâce au passeport sanitaire européen mis en place dans le contexte de la COVID-19, le trafic intra-européen s’est rapproché bien plus rapidement des niveaux qu’il affichait avant la pandémie, le trafic aérien intérieur et le trafic long-courrier n’en sont pas au même stade de reprise. Le trafic d’affaires devrait se redresser beaucoup plus lentement que le trafic de loisirs (4). Rien ne permet de garantir que ce dernier se rétablira durablement: une partie de la croissance qu’il enregistre peut être imputée au désir de vacances qui a été réprimé durant deux années de COVID-19. Les principaux transporteurs en réseau européens n’ont pas encore réintroduit leur grand avion long-courrier Airbus 380 dans leurs flottes respectives, précisément parce que les compagnies aériennes sont confrontées à des coûts de carburant élevés et parce qu’elles ne s’attendent pas à une augmentation significative et constante de la demande en matière de trafic. Les données fournies par les parties prenantes indiquent que les mouvements de trafic devraient augmenter pour atteindre 90 % des niveaux de 2019, mais que la demande du côté des voyageurs ne devrait s’établir qu’à 78 % de ces niveaux. Si les taux d’occupation des avions diminuent, on peut s’attendre à ce que les compagnies aériennes combinent, par exemple, plusieurs vols par jour afin de préserver leur rentabilité (5). La demande sera affectée par la hausse des taux d’inflation et par les risques croissants de récession dans plusieurs pays. Les prévisions ne devraient donc pas se fonder sur les seules régions où la reprise est la plus solide, mais tenir compte également des sous-marchés qui sont particulièrement touchés. |
|
2.4. |
Ces éléments amènent le CESE à penser que la reprise du marché de l’aviation pourrait être plus laborieuse que ne le suppose la Commission. Les différents segments du marché ne se rétablissent pas tous au même rythme: 6 % par rapport aux niveaux de 2019 pour le fret, — 9 % pour les compagnies aériennes à bas coûts, et 21 % pour les transporteurs en réseau. Ce facteur a d’autant plus d’importance que les seuils portent sur des séries entières de créneaux horaires, ce qui signifie que ce sont ces séries de créneaux (telles que les vols en période de pointe) qui doivent être supérieures au seuil de 80 %. Avant la pandémie, le taux d’utilisation des créneaux horaires s’établissait à 95 %, le taux le plus faible étant de 80 %. Si Eurocontrol prévoit un taux moyen d’utilisation de 90 %, il faut en déduire que ces séries de créneaux n’atteindront pas (en moyenne) 80 %. Il est dès lors tout à fait prématuré de rétablir les seuils de 80-20. Il semble plus judicieux d’opter pour un taux de 70-30 jusqu’à ce que des données plus solides viennent confirmer que le marché connaît une reprise durable. Il convient également de noter que les problèmes auxquels sont confrontés les aéroports européens démontrent clairement que les effets de la pandémie de COVID-19 n’ont pas encore été résorbés. Les grandes plateformes aéroportuaires de l’UE, telles que Francfort, et celles extérieures à l’Union, telles que Londres Heathrow, ont plafonné les vols à destination et en provenance de ces aéroports, entraînant des annulations massives de vols destinées à alléger la pression pesant sur les activités des compagnies aériennes dans ces aéroports. Ces tensions trouvent leur origine dans diverses variables, telles que les pénuries de main-d’œuvre. Ces éléments démontrent qu’il n’est pas encore possible à ce stade d’atteindre les seuils antérieurs à la pandémie pour ce qui est du taux d’utilisation des créneaux horaires (6). |
|
2.5. |
Un taux de 70-30 serait conforme aux seuils et à la logique adoptés par le gouvernement britannique (7). Bien qu’il ait fait l’objet de vives critiques de la part du secteur aérien, le CESE estime qu’il permettrait de trouver un juste équilibre entre le retour à la situation antérieure et la nécessité de reconnaître qu’un certain degré de protection (même réduite) des créneaux horaires reste nécessaire compte tenu des graves défis auxquels le secteur est actuellement confronté. Un tel taux alignerait en outre le seuil fixé par le règlement de l’UE relatif aux créneaux horaires sur celui défini par les pays voisins et rétablirait des conditions de concurrence plus équitables entre les plateformes de transporteurs de l’UE et l’aéroport de Londres Heathrow, la plus grande plateforme internationale d’Europe. |
|
2.6. |
En outre, la Commission propose qu’au cours de la période comprise entre le 29 octobre 2022 et le 26 mars 2024, elle puisse adapter à tout moment et de manière indépendante, par acte délégué, le taux d’utilisation des créneaux horaires dans une fourchette comprise entre 0 % et 70 %, à la condition que les données d’Eurocontrol montrent que le trafic aérien hebdomadaire sur quatre semaines consécutives tombe en dessous de 80 % par rapport aux semaines correspondantes de 2019 et que la réduction du trafic soit susceptible de persister. Elle propose également que si les autorités publiques introduisent des restrictions visant à faire face à une situation épidémiologique, à des troubles politiques ou à des catastrophes naturelles, et pour autant que celles-ci aient un effet préjudiciable sur le trafic aérien, les compagnies aériennes puissent faire valoir une non-utilisation justifiée des créneaux horaires. |
|
2.7. |
Le CESE soutient la Commission dans ses démarches visant à s’assurer qu’elle puisse recourir aux actes délégués de manière souple et transparente dans des circonstances exceptionnelles clairement définies afin d’adapter le calcul des taux d’utilisation des créneaux horaires et, partant, d’ajuster les seuils pour la protection desdits créneaux. Cela étant, la nouvelle proposition ne permet pas d’atteindre cet objectif, et ce à plusieurs égards. |
|
2.7.1. |
Contrairement à la Commission, le CESE estime que les compagnies aériennes devraient pouvoir bénéficier des exceptions de non-utilisation justifiée des créneaux horaires en cas de recommandations publiques déconseillant les voyages. Même si les avertissements aux voyageurs n’ont pas d’effet juridique immédiat, ils ont à n’en pas douter une incidence sur la demande en matière de transport aérien, laquelle devrait être dûment prise en considération. |
|
2.7.2. |
Le CESE estime par ailleurs que l’obligation de surveiller les courants de trafic aérien hebdomadaires pendant quatre semaines consécutives avant que toute mesure corrective ne puisse être prise constitue une charge excessive et pourrait retarder inutilement les mesures de réglementation. Établir une phase de surveillance de quatre semaines en l’absence de toute justification s’apparente à une décision arbitraire. Il est nettement plus important de garantir la transparence du processus décisionnel. |
|
2.7.3. |
Le CESE recommande que la règle en matière de non-utilisation justifiée des créneaux horaires s’applique à l’aéroport de départ comme à celui d’arrivée: les deux sont intrinsèquement liés et forment un binôme lorsqu’il s’agit de rétablir le portefeuille de créneaux horaires antérieur sur des liaisons données. En l’état actuel des choses, la Commission ne fait pas de ce principe une exigence obligatoire. |
|
2.7.4. |
La Commission n’a pas suffisamment étayé la raison pour laquelle le calcul du taux d’utilisation des créneaux devrait être modifié: alors que l’article 10, paragraphe 4, du règlement sur les créneaux horaires dispose que les créneaux protégés doivent être comptabilisés comme des créneaux utilisés, elle propose aujourd’hui de les ignorer. La Commission part du principe, sans fournir d’élément corroborant, que les règles normales en matière de créneaux horaires pourront être rétablies seize semaines après la réouverture de l’espace aérien ukrainien. Cela semble excessivement optimiste à la lumière des hostilités en cours, du degré de destruction des infrastructures et des incertitudes qui pèsent quant à la teneur et à la solidité d’un accord entre les deux parties. Le chiffre de seize semaines semble avoir été fixé arbitrairement et ne devrait pas constituer la base d’une décision réglementaire devant marquer un «retour à la normale». |
|
2.8. |
Le CESE a toujours plaidé pour que la Commission s’efforce d’aligner, dans toute la mesure du possible, le règlement relatif aux créneaux horaires sur les pratiques et politiques internationales. Toutes les parties prenantes concernées participent aux consultations sur la manière d’adapter les réglementations relatives aux créneaux horaires aux crises auxquelles le marché est confronté. |
|
2.9. |
Le CESE se félicite des améliorations proposées par la Commission concernant la manière dont les coordonnateurs de créneaux coopèrent. La transparence accrue du processus permet d’éviter toute confusion inutile entre les différents acteurs du marché. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1).
(2) Publication faisant état de l’intention de la compagnie aérienne allemande Lufthansa de réduire une nouvelle fois ses capacités dès lors que la crise se poursuit: https://www.airliners.de/lufthansa-streicht-winterflugplan/65956
(3) JO C 123 du 9.4.2021, p. 37, paragraphe 1.5.
(4) https://www.airliners.de/prognose-globaler-geschaeftsreiseverkehr-erholt-deutlich/65958
(5) Publication des chiffres relatifs aux passagers et des prévisions applicables à l’aéroport de Munich indiquant que le retour aux volumes de trafic d’avant la pandémie prendra plus de temps qu’escompté initialement: https://www.airliners.de/wachsendes-passagieraufkommen-bayerns-flughaefen-weit-entfernt-corona-niveau/65950
(6) Si la Commission fait état de la pénurie de main-d’œuvre frappant les principaux aéroports dans l’exposé des motifs, elle considère qu’il s’agit là d’un phénomène à court terme. Ce point de vue est discutable dès lors que cette pénurie touche de nombreux secteurs économiques, et pas uniquement l’aviation. Rien n’indique que ce problème sera résolu à court terme dans le secteur de l’aviation.
(7) Le 24 janvier 2022, le gouvernement britannique a ajusté le taux d’utilisation des créneaux horaires à 70-30 à compter du 27 mars 2022, afin de se rapprocher des règles ordinaires tout en protégeant le secteur contre les incertitudes futures, comme l’a déclaré le secrétaire d’État britannique aux transports, Grant Shapps.
|
21.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 486/198 |
Avis du Comité économique et social européen sur les incidences géopolitiques de la transition énergétique
[JOIN(2022) 23 final]
(2022/C 486/27)
|
Rapporteur: |
Tomasz Andrzej WRÓBLEWSKI (PL-I) |
|
Corapporteur: |
Ioannis VARDAKASTANIS (EL-III) |
|
Consultation |
28.6.2022 |
|
Base juridique |
Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
|
Décision de l’assemblée plénière |
21.9.2022 |
|
Base juridique |
Article 52, paragraphe 2, du règlement intérieur |
|
|
Saisine du Comité |
|
Compétence |
Section «Relations extérieures» |
|
Adoption en section |
14.9.2022 |
|
Adoption en session plénière |
21.9.2022 |
|
Session plénière no |
572 |
|
Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
229/1/6 |
1. Conclusions et recommandations
|
1.1. |
2022 entrera dans l’Histoire comme une année marquée par de profonds changements géopolitiques et énergétiques dans le monde. Le CESE salue les efforts déployés par la Commission européenne et les différents États membres, qui ont accéléré le processus visant à affranchir l’Union de sa dépendance vis-à-vis de la Russie pour son approvisionnement énergétique. Le CESE estime que, compte tenu de la dynamique de la guerre en Ukraine, il est néanmoins nécessaire d’accélérer ce processus en imposant un embargo strict, ce qui implique de rechercher sans attendre d’autres sources d’énergie propres. |
|
1.2. |
L’avis tient compte de la saisine relative à la communication JOIN(2022) 23 final intitulée «Stratégie énergétique extérieure de l’UE dans un monde en mutation», publiée conjointement par la direction générale de l’énergie de la Commission européenne et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le 18 mai 2022. |
|
1.3. |
Le CESE se félicite que l’Europe demeure à la pointe de la transition énergétique, mais souligne que les changements au sein de l’Union ne suffisent pas à compenser les effets des émissions mondiales et qu’il est dans notre intérêt, tant au regard du changement climatique que de l’expansion économique pour garantir un développement mondial durable, de prendre des mesures au niveau international. |
|
1.4. |
Le CESE accueille favorablement un certain nombre d’initiatives de l’Union qui renforcent sa résilience interne, telles que REPowerEU, le partenariat pour une transition énergétique juste, la stratégie «Global Gateway» et le programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux, qui contribuent à la stabilité politique. |
|
1.5. |
Dans le même temps, il attire l’attention sur le fait que les tensions politiques actuelles nécessiteraient une coopération encore plus active avec certains pays capables d’approvisionner l’Europe en gaz et en pétrole. Citons notamment les États-Unis et, à des degrés divers, des pays d’Amérique du Sud et d’Afrique dont les exportations de combustibles fossiles devraient être complétées par des transferts de connaissances et des technologies renouvelables susceptibles d’accélérer leur transition climatique. |
|
1.6. |
Le CESE se félicite de l’initiative visant à relier la Moldavie et l’Ukraine au réseau énergétique européen mais préconise également un réexamen périodique de la situation géopolitique résultant des changements dynamiques de la structure énergétique dans des pays tels que l’Arménie, la Géorgie et le Kazakhstan. |
|
1.7. |
Le CESE attire l’attention sur la nécessité d’établir des relations spéciales avec les pays qui sont les principaux fournisseurs de métaux lourds et de matières premières nécessaires à la production de technologies énergétiques propres et qui peuvent être menacés. Dans cette optique, l’Europe doit développer une diplomatie énergétique en tant que tout nouveau domaine de ses relations internationales. |
|
1.8. |
Compte tenu de l’expérience récente liée à la dépendance excessive de l’Europe à l’égard des matières premières provenant de sources incertaines, le CESE demande instamment à l’UE d’être aussi souple que possible dans ses plans ambitieux de transition énergétique, en se laissant le temps d’analyser les incidences géopolitiques de certaines décisions et de les ajuster si elles provoquent des tensions indésirables et inattendues au niveau mondial. |
2. Introduction
|
2.1. |
Depuis de nombreuses années, dans le monde entier, les questions liées à la transition énergétique figurent au premier rang des priorités politiques. Grâce au pacte vert pour l’Europe, l’Union européenne est pionnière en matière de transition énergétique; elle s’appuie sur ses valeurs que sont la durabilité, la solidarité et la coopération internationale. Toutefois, alors que l’Union n’est responsable que d’environ 8 % des émissions mondiales (et que cette part diminue), sa politique intérieure en la matière n’est pas suffisante, aussi ambitieuse soit-elle. |
|
2.2. |
Comme indiqué dans les conclusions de la conférence sur la géopolitique du pacte vert pour l’Europe (1), le multilatéralisme est indispensable pour lutter contre les menaces climatiques communes et transfrontières; ce sont les relations multilatérales, et non les frictions géopolitiques, qui nous permettront de surmonter la crise planétaire. Les constats qui précèdent ont également été pris en compte dans l’avis sur la «Nouvelle stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique» (2), dans lequel le CESE a approuvé la nécessité d’«intensifier l’action internationale en faveur de la résilience face au changement climatique», selon les termes de la Commission, partageant l’affirmation de cette dernière selon laquelle «[n]os ambitions dans le domaine de l’adaptation au changement climatique doivent être à la hauteur de notre rôle de chef de file mondial en matière d’atténuation du changement climatique». |
|
2.3. |
Le changement climatique et les mesures prises dans ce contexte provoquent des changements profonds en matière de géopolitique et d’industrie, dus à la forte expansion des énergies renouvelables, qui ont une forte incidence sur les relations internationales. Le CESE a de ce fait décidé qu’il s’impose de mettre l’accent sur les effets géopolitiques afin d’élaborer un avis qui soit à la fois général et exhaustif sur la lutte contre le changement climatique. |
|
2.4. |
S’il existe un consensus scientifique concernant la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la politique climatique ne saurait ignorer l’essor des liens positifs et négatifs entre les défis économiques, sociaux et environnementaux y relatifs. |
|
2.5. |
Le fonctionnement et les paramètres du marché de l’énergie sont directement liés à la situation politique dans chaque région. Le constat qui précède est conforté par le fait que l’approvisionnement en combustibles fossiles est caractérisé par une forte dépendance à l’égard de quelques pays producteurs. |
|
2.6. |
Comme le montre l’avis du CESE consacré à « La dimension extérieure de la politique énergétique européenne » (3), la prédominance de certaines sources d’importation, qui ne respectent pas les mêmes règles de marché et principes politiques que l’Union, a inscrit la question de la sécurité énergétique parmi les principales priorités européennes. À cette époque, les conséquences de l’agression militaire menée contre la Géorgie en 2008 ont été évoquées, mais le contexte reste particulièrement pertinent compte tenu de la situation actuelle en Ukraine, qui a un impact très significatif sur l’analyse des questions liées à la sécurité énergétique et à la géopolitique. |
|
2.7. |
À moyen terme, le paysage énergétique mondial sera radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. La transition énergétique aura une incidence fondamentale sur la géopolitique et sera à la fois source de menaces et d’opportunités. La nature de cette incidence dépendra de nombreux facteurs. À titre d’exemple, la décarbonation peut entraîner une dépendance accrue à l’égard des importations de gaz, ce qui risque de rendre les relations entre l’Union et la Russie encore plus complexes. |
|
2.8. |
Au fur et à mesure que le système énergétique évoluera, il en ira de même pour la politique énergétique. Dans le monde de l’énergie propre, un nouvel ensemble de gagnants et de perdants émergera. D’aucuns considèrent qu’il s’agit d’une course à l’espace énergétique propre. Les pays ou régions qui maîtrisent des technologies propres, exportent de l’énergie verte ou importent moins de combustibles fossiles auront tout à gagner du nouveau système, tandis que ceux ou celles qui dépendent de l’exportation de combustibles fossiles pourraient voir leur puissance s’affaiblir. |
3. Observations générales
|
3.1. |
Si la transformation énergétique consiste à prendre des actions et des mesures systémiques visant à réduire les rejets de composés du carbone dans l’atmosphère qui accélèrent les processus de changement climatique, il convient de rechercher et de mettre en œuvre, outre la transformation énergétique, des solutions optimales dans le domaine de l’agriculture durable et de la gestion forestière, de la bioséquestration, de l’élevage ou de l’utilisation du bétail ainsi que des possibilités qu’offre le développement des technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone. |
|
3.2. |
Compte tenu du niveau des émissions de gaz à effet de serre générées par les pays de l’Union par rapport aux autres économies mondiales, pour atteindre les résultats requis, il est primordial de déployer des efforts pour associer d’autres pays à la coalition visant à lutter contre le changement climatique. L’UE doit accorder une attention particulière à la coopération internationale sous ses différentes formes, y compris les partenariats en matière d’investissement, de commerce et d’innovation, dans le but de renforcer les mesures d’adaptation à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement. |
|
3.3. |
Les activités commerciales menées par les États membres de l’Union laissent une empreinte carbone significative dans le reste du monde. Il incombe à l’UE d’aborder cette dimension extérieure de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, notamment en promouvant la transition dans la coopération au développement bilatérale et régionale et en s’attaquant aux retombées négatives dans le cadre de ses politiques commerciales. |
|
3.4. |
La géopolitique est essentielle pour garantir le succès du pacte vert pour l’Europe, étant donné que la transition écologique aura de toute évidence de profondes répercussions sur les relations internationales. La divergence des priorités entre les pays développés et les pays en développement constituera un défi de taille, puisque le pacte vert pour l’Europe affectera certains pays de manière disproportionnée. Pour relever ces défis, les pays développés devraient tout mettre en œuvre pour remédier aux conséquences que subiront les citoyens des pays à faible revenu afin de montrer que le pacte vert pour l’Europe ne les laissera pas pour compte. |
|
3.5. |
Un exemple d’activités axées sur la participation de partenaires mondiaux est le partenariat pour une transition énergétique juste qui a été lancé lors du sommet des dirigeants mondiaux de la COP 26 par les gouvernements d’Afrique du Sud, de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni, des États-Unis et l’Union européenne. Cette initiative vise à aider l’Afrique du Sud à décarboner son économie, à abandonner le charbon et à s’orienter vers une économie à faibles émissions et résiliente au changement climatique, fondée sur des énergies et des technologies propres et vertes. |
|
3.6. |
Un autre exemple est la nouvelle stratégie européenne «Global Gateway», axée sur l’intensification de liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports et sur le renforcement des systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Global Gateway vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’euros d’investissements entre 2021 et 2027 pour soutenir une reprise mondiale durable, en tenant compte des besoins de nos partenaires et des intérêts de l’UE. |
|
3.7. |
Dans le contexte géopolitique, on peut citer comme autre exemple particulièrement important le programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux, qui vise à favoriser une transition écologique complète vers une économie circulaire, sobre en carbone et durable dans cette région. Ce programme peut notamment libérer le potentiel de l’économie circulaire en créant davantage d’emplois et en ouvrant des perspectives de croissance nouvelle. Un financement adéquat de l’UE, des gouvernements nationaux et du secteur privé sera essentiel pour soutenir cette transition écologique. Selon l’avis du CESE intitulé «L’énergie, facteur de développement et d’approfondissement de l’adhésion des Balkans occidentaux» (4), l’énergie doit être un facteur de développement et d’interconnexion de la région, et les citoyens des Balkans occidentaux doivent avoir une idée claire des avantages économiques et environnementaux de l’adhésion à l’Union. |
|
3.8. |
Comme indiqué dans les conclusions de la conférence sur la géopolitique du pacte vert pour l’Europe mentionnée précédemment, la transition énergétique s’accompagnera d’une volatilité considérable des prix de l’énergie. Le constat qui précède constitue un défi géopolitique que l’Union et ses partenaires mondiaux devraient contribuer à circonscrire, en réduisant les risques liés à la promotion et à l’essor de la consommation d’énergie propre, en évitant d’exacerber les inégalités existantes. |
|
3.9. |
Ces éléments ont déjà été exprimés dans l’avis du CESE sur «La nouvelle stratégie de l’UE pour l’adaptation au changement climatique» (5), dans lequel le Comité invitait la Commission à s’efforcer de mieux aligner les politiques d’ajustement climatique sur la justice climatique dans le cadre des futurs travaux sur les politiques d’adaptation. Le Comité a reconnu que le changement climatique peut avoir un impact social, économique, de santé publique et d’autres incidences négatives sur les communautés, et a préconisé de s’attaquer aux inégalités existantes au moyen de stratégies d’atténuation et d’adaptation à long terme, de sorte que personne ne soit laissé de côté. Le CESE a demandé instamment à la Commission de préciser comment elle supprimera les obstacles à l’accès aux financements pour les pays, les communautés et les secteurs les plus vulnérables à l’échelle mondiale, ainsi que la manière dont elle inclura des propositions pour l’intégration de la dimension de genre et la lutte contre les inégalités aux niveaux régional et local. |
|
3.10. |
La politique extérieure de l’Union en matière de lutte contre le changement climatique devrait s’appuyer non seulement sur ses pays membres pour fournir des arguments «extérieurs» et soutenir la mise en œuvre d’une stratégie exigeante de transformation climatique, mais aussi sur le savoir-faire de pays tiers, par exemple, en collaboration avec le Natural resources conservation service (NRCS) américain (service de conservation des ressources naturelles) et avec d’autres organisations similaires. Il convient de rappeler qu’il est tout aussi important de veiller à l’échange interne de bonnes pratiques et au développement d’une approche systémique des défis liés à la transformation, dans le cadre d’initiatives telles que la construction du marché commun de l’énergie. |
|
3.11. |
Le développement dynamique des sources d’énergie renouvelables nécessite une modernisation parallèle de l’infrastructure de transport et l’intégration du système énergétique, ainsi qu’un abandon du mode centralisé de production et de fourniture d’électricité. Il est nécessaire de promouvoir de manière cohérente les initiatives locales visant à répondre aux besoins énergétiques, conformément au principe de subsidiarité. Comme indiqué dans l’avis du CESE sur «Une stratégie de l’UE pour l’intégration du système énergétique» (6), la Commission devrait encourager les pays voisins de l’Union européenne, en particulier les pays du partenariat oriental, à suivre ce plan, non seulement pour parvenir à la neutralité climatique, mais aussi pour préserver la stabilité de la sécurité de l’approvisionnement et garantir aux consommateurs et aux entreprises des prix abordables, en l’incluant dans leur propre politique. À cet effet, il serait opportun d’examiner de manière plus approfondie l’utilité d’une taxe carbone aux frontières. |
|
3.12. |
Il n’est pas possible de mettre en œuvre de manière crédible et efficace la stratégie consistant à présenter la nécessité d’appliquer la politique climatique en dehors de l’Union si les défis sociaux qui accompagnent les processus de transformation ne sont pas correctement traités au sein de ses États membres. Comme le CESE l’a déjà fait observer dans son avis intitulé «Ne laisser personne de côté lors de la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030» (7), «ne laisser personne de côté signifie que tous les membres de la société, et en particulier les personnes les plus défavorisées, ont une réelle chance de saisir les possibilités qui s’offrent à eux et sont bien préparés pour faire face aux risques. Dans ce contexte, les groupes les plus vulnérables de la société ainsi que les régions et territoires les plus défavorisés doivent faire l’objet d’une attention particulière». |
|
3.13. |
Une prise en compte efficace et socialement acceptable des questions liées à la diversité des répercussions de la politique climatique dans ses différents pays membres donnerait à l’Union la crédibilité pour agir en tant que chef de file mondial en matière de durabilité. Dans le même temps, un engagement en faveur de la durabilité au niveau mondial concourt à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE dans d’autres domaines (tels que la lutte contre les causes de la migration, le commerce mondial équitable et la réduction de la dépendance à l’égard des pays riches en pétrole du point de vue de la politique étrangère). |
|
3.14. |
Comme indiqué dans l’avis cité précédemment, la Commission européenne a déjà adopté une approche consistant à internaliser davantage les effets externes, en reconnaissant par exemple que les énergies renouvelables sont défavorisées aussi longtemps que les coûts externes des ressources fossiles ne sont pas intégralement pris en compte dans le prix du marché ou en s’efforçant de prendre en compte les externalités négatives dans le secteur des transports. |
|
3.15. |
L’éducation et le transfert de connaissances revêtent une importance capitale tant au niveau de l’enseignement obligatoire pour tous que de la communication destinée au grand public, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes sociaux directement touchés par la transformation. Il est nécessaire de décrire clairement le choix de civilisation qui s’offre à nous pour défendre efficacement la thèse selon laquelle l’effort de transformation actuel consenti par une partie de la société évitera des coûts bien plus élevés qui, en cas d’inaction, seront à la charge de l’ensemble de la communauté internationale. |
|
3.16. |
La transformation énergétique et le développement de nouvelles technologies vertes contribuent au développement de connaissances et de compétences uniques et à la création d’emplois hautement qualifiés. Cette orientation de l’évolution des économies européennes constitue une occasion de développement inédite et permet aux États membres de l’Union de renforcer leur position de leader technologique dans le domaine de la transformation, entendu comme la réduction des émissions. L’adhésion d’un plus grand nombre de pays tiers à l’alliance pour contrer les effets négatifs du changement climatique permettra de créer des marchés pour les technologies dérivées des économies européennes. |
|
3.17. |
La suppression progressive des combustibles fossiles favorisera l’escalade de tensions entre les pays de l’UE, importateurs de ces matières premières, et les pays tiers fournisseurs. À cet égard, il convient tout particulièrement de tenir compte de la Russie en tant que fournisseur local de combustibles, pour qui les revenus provenant de la vente de ces matières premières constituent une part importante des recettes budgétaires. En outre, les pays du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord et les régions d’Afrique subsaharienne, dont les revenus dépendent fortement des exportations de combustibles fossiles, risquent de subir des répercussions politiques et sociales importantes qui pourraient déclencher des vagues de réfugiés et une migration vers l’Europe. Le changement du modèle de coopération peut certainement être considéré, d’un point de vue politique, comme une menace pour la position d’un pays dont l’économie et la gouvernance dépendent des recettes provenant de l’approvisionnement en combustibles fossiles. Les investissements et les solutions collaboratives dans la promotion de l’énergie verte pourraient être conçus comme une occasion de soutenir la transition de ces économies. |
|
3.18. |
L’expérience du conflit armé qui a éclaté en Europe au XXIe siècle suscite une réflexion sur l’utilisation responsable de l’énergie nucléaire et une révision des règles de taxinomie qui ne contribuent pas aux effets négatifs du changement climatique. |
|
3.19. |
L’éventuel embargo sur les importations de pétrole, de gaz et de charbon russes au titre des sanctions imposées à la Russie dans le contexte de l’agression contre l’Ukraine, ou un abandon des importations lié à la nécessité de suspendre les transferts financiers soutenant le régime de Poutine, contribueront à l’accélération des effets géopolitiques attendus de la suspension des importations de carburant en provenance de Russie. Dans le même temps, il pourrait être nécessaire de reconsidérer le rythme de l’abandon des carburants disponibles dans les pays de l’Union. |
|
3.20. |
L’intégration en vue de créer une union gazière des pays de l’UE semble justifiée. Une telle approche permettrait des processus d’achats groupés et contribuerait à l’instauration de conditions économiques favorables, tout en facilitant la coordination des décisions visant à suspendre l’importation de cette matière première en provenance de l’Est. Compte tenu de la dimension politique d’une telle décision, cela se traduirait par une politique étrangère cohérente des pays de l’Union. |
4. Défis et perspectives
|
4.1. |
La portée de la politique climatique de l’Union européenne variera en fonction de la région concernée et des activités menées dans le domaine de la politique extérieure pour atténuer les risques identifiés et améliorer les processus de transition. |
|
4.2. |
En ce qui concerne les Balkans occidentaux, de grands espoirs sont attendus dans le domaine des activités liées au marché de l’énergie en lien avec le processus d’adhésion à l’Union. Les constats qui précèdent peuvent jouer un rôle important et positif dans la définition des conditions géopolitiques dans cette région. En signant la déclaration de Sofia sur le programme en matière d’environnement, les gouvernements des pays des Balkans occidentaux se sont engagés à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 et à s’aligner pleinement sur le pacte vert pour l’Europe. Le programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux pourrait notamment libérer le potentiel de l’économie circulaire, en créant davantage de lieux de travail et en ouvrant de nouvelles perspectives de croissance. Un financement adéquat de l’UE, des gouvernements nationaux et du secteur privé sera essentiel pour soutenir cette transition écologique. |
|
4.3. |
En ce qui concerne l’Afrique, il convient avant tout de souligner que les politiques d’atténuation du changement climatique ne constituent pas une priorité pour les pays de ce continent. L’UE devrait dès lors collaborer avec l’Afrique, comme elle le fait avec d’autres pays en développement, afin de veiller à ce que toutes les initiatives soient acceptées au niveau local et cohérentes avec les priorités des pays partenaires, en appliquant une approche ascendante. Dans le cas contraire, les mesures prises au titre de la politique climatique pourraient se heurter à un manque de compréhension et à une opposition de la part des communautés locales confrontées à des problèmes fondamentaux. Comme indiqué dans l’avis du CESE intitulé «UE-Afrique: concrétiser un partenariat de développement équitable fondé sur la durabilité et des valeurs communes» (8), les défis auxquels font face les pays en développement en Afrique étant très complexes, il convient d’aborder ces questions dans le cadre d’une approche appropriée et multidimensionnelle. De plus, la demande énergétique du continent devrait doubler d’ici 2050, tandis que les taux de pauvreté demeureront probablement élevés. Une telle situation perpétuerait, voire aggraverait, les problèmes liés à la durabilité sur le plan environnemental et socio-économique. Néanmoins, des opportunités pourraient se présenter, les pays africains jouant un rôle de premier plan dans la technologie solaire photovoltaïque et la production à grande échelle de combustibles de synthèse. Des possibilités spécifiques de projets, d’activités commerciales et de politiques communes pourraient déboucher sur une nouvelle approche socio-écologique de l’économie de marché. |
|
4.4. |
En ce qui concerne le partenariat oriental, il est particulièrement important de coopérer étroitement avec des pays qui, comme l’Union européenne, dépendent fortement des combustibles fossiles et sont donc exposés à une forte volatilité des prix, en particulier compte tenu des hostilités actuelles en Ukraine. S’agissant de l’Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie, il s’impose de déployer des efforts pour aider ces pays à se libérer de leur dépendance à l’égard de l’approvisionnement en combustibles fossiles provenant de Russie et pour permettre l’intégration de leurs réseaux électriques dans le réseau européen. Les activités susmentionnées se reflètent dans la récente déclaration sur une intégration rapide dans le réseau électrique de l’Union, qui requiert un effort conjoint des organes de décision et des gestionnaires de réseaux de transport. |
Bruxelles, le 21 septembre 2022.
La présidente du Comité économique et social européen
Christa SCHWENG
(1) https://www.eesc.europa.eu/fr/agenda/our-events/events/la-geopolitique-du-pacte-vert
(2) JO C 374 du 16.9.2021, p. 84.
(3) JO C 264 du 20.7.2016, p. 28.
(4) JO C 32 du 28.1.2016, p. 8.
(5) JO C 374 du 16.9.2021, p. 84.
(6) JO C 123 du 9.4.2021, p. 22.